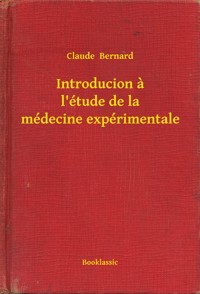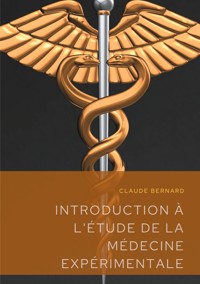Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Jacques Bouvard est un avocat névrosé qui ne cesse d’être tourmenté par la médiocrité du monde qui l’entoure et un mal intime qui le ronge. Au détour d’un chemin, sur les remparts de Laon, il rencontre le président Gregory Mangin qui hystérise la France depuis son élection. Un passage à l’acte va alors faire basculer le destin de Bouvard et celui de la France dans le chaos.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Juriste, auteur de nombreuses publications dans le domaine du droit,
Claude Bernard signe, avec
Quand bien même, une puissante réflexion mêlant tourments intimes et malaise démocratique français tout en livrant un saisissant portrait clinique du monde juridique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claude Bernard
Quand bien même
Roman
© Lys Bleu Éditions – Claude Bernard
ISBN : 979-10-377-4051-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le peuple a le droit d’aller choisir l’homme auquel il croit, partout, au fond d’un cachot comme au fond d’un palais, comme au fond de l’exil. Et toute barrière qui n’est pas la loi doit tomber devant l’appel souverain du peuple.
Victor Hugo
Prologue
De la vie de Jacques Bouvard, il y avait, semble-t-il, peu à dire. Elle aurait pu demeurer une vie simple, presque ordinaire, vécue au niveau des lectures qui nourrissaient son imaginaire frustré et solitaire et du poste de télévision à travers lequel, depuis l’enfance, le monde contemporain venait, chaque jour, vomir sa dose de médiocrité dans son salon. Ce n’est que par quelques hasards, dont on ne sait bien distinguer s’ils peuvent être qualifiés d’heureux ou de malheureux, qu’il crut entrevoir l’occasion de s’élever au-delà de sa condition – celle du commun des mortels – en voyant poindre, sur un sentier mal assuré, un de ceux qui font mouvoir le monde ou qui pensent le faire, en mimant la geste des grands hommes d’autrefois. Un acte simple, presque banal, devait alors faire de Bouvard, pour un temps, non le symbole de la haine, mais la haine elle-même ; et il s’éleva. C’est ce qui a semblé rendre cette vie digne d’être évoquée, bien que l’on puisse la juger tendancieuse à bien des égards.
Cette histoire se déroula dans un pays, la France, qui, pour l’essentiel, n’avait pas encore pris conscience de sa faillite morale et de l’ampleur du mal qui rongeait ses institutions. Elle narre un tournant de l’histoire de ce pays qui devait durablement modifier les rapports entre la morale et la politique ; l’équilibre entre la société civile et sa représentation. Il a semblé pertinent d’envisager tous ces changements à l’aune de l’un de ses acteurs principaux ; le lecteur en sera, en définitive, seul juge.
Première partie
Certains êtres éprouvent très tôt une effrayante impossibilité à vivre par eux-mêmes ; au fond, ils ne supportent pas de voir leur propre vie en face, et de la voir en entier, sans zones d’ombre, sans arrière-plans.
Michel Houellebecq
1
Sentir moins sa passion, c’était sentir plus son néant ; réduit, cet amour ne lui masquait plus le vide.
François Mauriac
Le soleil commençait à se coucher là-bas au loin. L’éclat de ses rayons mourants, qui perçaient les vitres de la vaste salle des conférences de la faculté de droit de Nanterre, donnait à l’atmosphère une touche de fin de partie. Debout, près de la table derrière laquelle il venait, trois heures durant, de soutenir sa thèse de doctorat, habillé d’un costume Bleu ciel Hugo Boss parfaitement ajusté, Jacques Bouvard faisait maintenant face au jury qui venait, à l’instant, de lui décerner le titre de Docteur en droit pour ses travaux de thèse portant sur La figure présidentielle sous la IIe république. Les cinq membres du jury le regardaient exprimer sa gratitude contenue, une certaine – quoique relative – satisfaction du travail accompli, et ses remerciements.
Pendant ces quelques secondes, il prenait soin, en s’adressant à ce cénacle en majesté, de ne pas regarder celui de ses membres qui, tout à droite, se tenait raide, les deux mains agrippées sur le dossier de la chaise rangée devant lui, comme ne sachant qu’en faire. Visiblement mal à l’aise, pas encore soulagé, l’œil à l’affût de la moindre contrariété, il écoutait d’une oreille distraite les propos sans aspérité de son doctorant : des propos certes débités sur un ton jovial mais qui ne se distinguaient en rien de la masse de lieux communs qu’il avait sans doute cent fois entendue dans la même situation. Rien de plus convenu qu’un thésard s’exprimant devant un jury de thèse. Bouvard se tourna alors vers lui ; dans l’assistance, on entendit une voix chuchoter « Là, il y a danger » ; Bouvard s’exécuta : « Et enfin merci à vous, Monsieur l’ancien Directeur ». Surpris malgré lui d’une telle apostrophe, son destinataire, le professeur Marcel Bruno, esquissa un rictus convenu et baissa la tête, ne voyant pas sa voisine qui se tournait vers lui, le regard interloqué, attendant une réaction devant un tel manquement à la bienséance universitaire.
Cela faisait cinq ans que ces deux-là avaient essayé, sans succès, de trouver un terrain d’entente. Lorsqu’il s’était engagé en thèse, Bouvard était promis à une brillante carrière universitaire, ou du moins le croyait-il ; il allait être un grand professeur de droit, un de ceux qui marquent les esprits de plusieurs générations d’étudiants. Enseigner, il avait ça dans le sang ; il faisait partie de ces quelques rares personnes qui avaient le truc de façon innée : il savait captiver son auditoire et pouvait l’entretenir de tout ce qui lui passait par la tête, ce dont il s’était rarement privé pendant ses séances de travaux dirigés. Il avait débuté dans l’équipe de l’inénarrable Maurice Antoine, le plus connu des professeurs de droit constitutionnel de l’époque ; le plus médiatique et le plus populaire aussi.
Dès ses premières séances, il avait découvert son talent propre pour donner vie à la plus austère théorie juridique comme pour restituer l’intérêt concret du plus technique des arrêts du Conseil d’État. Nanti d’une réputation d’excellence et d’un financement assuré par l’université, il avait facilement pu s’engager en thèse. Lors de leur premier entretien, Bruno, qui allait diriger sa thèse, lui avait dit sur un ton qui se voulait prophétique « Sur un tel sujet, je vous vois faire une thèse brève, mais puissante ». Une thèse « agrégative » comme il disait alors pour se donner un air encore plus important, celui du professeur qui sait d’emblée fixer les justes objectifs, ceux qui compteront, car lui connaît les codes à respecter pour « faire carrière ». Celui d’un pygmalion, car c’est ainsi qu’il avait voulu paraître à Bouvard. Pourtant, lors de cet entretien, de sujet précis il n’avait curieusement jamais été question ; comme si le travail de thèse consistait à poursuivre son sujet par-delà celui dûment enregistré à son commencement, à le parfaire sans cesse en remettant l’ouvrage sur le métier jusqu’au dépôt de la version finale ; une subtilité qui devait toujours échapper à un type comme Bouvard, peut-être encore un peu trop primitif, ce qui ne veut pas dire scolaire.
Et puis la prophétie censément auto-réalisatrice avait viré au cauchemar. Confiant dans ses capacités, sûr de son destin, Bouvard avait remis à plus tard la concrétisation de ce projet de thèse, se contentant de quelques lectures en guise de recherches, allant en bibliothèque uniquement pour y faire quelques photocopies, là où tous les bons usages enseignent qu’il faut d’abord y faire des rencontres pour constituer un réseau, lequel sera plus tard très utile pour le partage des places, des honneurs et du vide. Bouvard avait surtout joui de son nouveau statut d’enseignant, pour lequel il s’était découvert une passion : la séduction, celle des masses – certes modestes – de préférence. Il avait vu, sur lui, le regard des femmes changer. En fait de femmes, c’était plutôt à des filles qu’il s’intéressait et c’est ainsi, en se laissant gagner par des instincts régulièrement brimés depuis le lycée, qu’il avait connu, pour la première fois de sa vie, non seulement le plaisir de posséder physiquement quelques filles, mais aussi l’amour en rencontrant Mathilde à l’anniversaire d’un ami en Bretagne. Il découvrit la passion, totale et dévorante, de celui qui la sait partagée mais qui n’en est nullement satisfait. Celle qui ne comble jamais vraiment et qui frustre en permanence. Mathilde était plus jeune que lui, elle passait son Bac ; pendant les quelques mois où elle avait électrisé sa vie, il n’avait vécu que par elle. Il n’avait jamais ressenti pour un être humain – une de ces petites choses que, depuis l’enfance, il aimait souvent mépriser – un tel attachement brutal, animal, qui le faisait sortir de lui-même. On l’avait même vu en larmes dans une rame du métro aérien, une semaine où elle était loin de lui. Jamais personne ne l’avait accompagné si intimement, de façon si fusionnelle : à ce sagouin qui n’avait jamais appris l’amour – ni à le donner ni à le recevoir –, elle avait été la plus belle chose qui soit jamais arrivée. Avec elle – et malgré les ravages de la passion –, tout paraissait simple.
Une passion aussi intense, vécue sur le mode soumis de celui qui, d’abord, la subit, devait finalement le mener à découvrir la fragilité des émotions et lui révéler l’inconstance profonde de son être. Un soir où ils étaient en vacances à Bordeaux, une de ces soirées caniculaires de l’été 2006, il s’était couché près d’elle, éperdument amoureux comme au premier jour ; ils s’étaient endormis ensemble, baignés d’amour l’un pour l’autre ; il s’était réveillé près d’un corps semblable à mille autres. Sans crier gare, comme la vague qui se retire laissant le sable libre de sécher et de se décomposer de nouveau en une multitude de grains, l’amour en lui avait fondu, s’était retiré au petit matin. Inexpérimenté, il avait d’abord cru à une simple transition ; il avait simulé la continuité plutôt qu’assumer la solution. Mais dans les semaines qui suivirent, l’indifférence qui s’était faite jour en lui avait vite laissé la place au mépris pour ce corps étranger qui osait l’étreindre. Les tripes ne mentent jamais : bientôt, ses viscères lui traduiraient sa défiance contre Mathilde par d’horribles maux de ventre qui allaient durer plusieurs semaines. Il ne pouvait plus la supporter. Inévitable, la rupture avait cependant été longue à se dessiner pour celui que la situation rendait agressif, tout en préservant sa lâcheté. Elle avait été un déchirement ; il ne devait jamais se relever de la perte de cet amour-là : il sentait bien qu’elle signifiait moins la séparation d’avec une autre personne que la sécession d’une partie de lui-même, qui passait sur l’autre rive. C’est en vain qu’il avait voulu comprendre ce qui lui était arrivé : « Contentez-vous de savoir » lui enjoindrait plus tard le psychanalyste. Il se savait désormais habité par un autre qu’il appelait parfois son cancer, qui le rongeait périodiquement et qui ne le quitterait plus. S’était ainsi enclenché le déclin inexorable de son rapport aux femmes. Ces questionnements et leurs prolongements allaient devenir structurants dans la vie de Bouvard.
Avec l’aide d’un psychiatre, consulté le temps de faire le deuil de son amour pour Mathilde – un deuil long car l’amour lui revenait intellectuellement, avec un léger décalage temporel, sans qu’il puisse le ressentir, ce qui le poussait à retourner vers Mathilde sans réellement pouvoir reprendre leur relation ; alors ils couchaient ensemble – il avait pu se remettre à ses travaux de thèse, essayer de nouveau de croire en son destin ; il était trop tard. Et celui qui l’avait si chaleureusement invité à entreprendre une thèse sous sa direction n’allait plus cacher l’incompréhension suscitée en lui par ce jeune thésard au regard – déjà – éteint et incapable de se plier aux règles – le fameux « caractère-trop-indépendant-de-Bouvard ». Il avait fallu composer et c’est dans une atmosphère tendue, avec une communication limitée à l’essentiel et souvent aigre, que le travail avait pu se poursuivre. Mais, dépourvu de la confiance de celui qui avait semblé croire en lui, Bouvard avait aussi perdu ses certitudes depuis Mathilde. Bien plus, il avait perdu la foi en sa valeur et c’est privé de cette foi qu’il avait achevé à la hâte ses travaux de recherche, bâclant outrageusement ses écrits et imposant à Bruno le principe d’une soutenance alors que ce dernier avait essayé de l’en dissuader : « Pourquoi soutenir ? » lui avait-il demandé, un jour, assis à son bureau étroit du dernier étage de la faculté, ses grandes jambes mal installées sous le plateau du bureau, comme pour faire sentir à Bouvard l’incongruité de sa situation. Bouvard avait tenu, il s’était imposé, violant l’autorité incertaine de son directeur ; cela avait été sa petite victoire, la seule qu’il ait pu arracher dans son face-à-face de plusieurs années avec une autorité qu’il avait d’abord respectée, qui l’avait désarmé, qu’il avait fini par contester, sans jamais vraiment être en mesure de la déborder autrement que par le biais d’une soutenance au rabais pour un travail mineur.
Dans les minutes qui suivirent la soutenance, il repensait à tout ce chemin douloureux, perdu entre ses quelques amis présents, en particulier les fidèles Stéphane et Julie, eux qui avaient partagé sa galère et qui connaissaient mieux que personne les relations tendues qu’il avait entretenues avec Bruno, ses parents divorcés qui faisaient semblant de ne pas se voir, chacun à un bout de la pièce, et le champagne qui coulait à flots durant l’inutile pot de soutenance. Allait débuter pour lui une traversée du désert, cette période post soutenance où l’on tente soit son entrée dans la carrière universitaire via les concours – et d’abord l’insondable qualification aux fonctions de maître de conférences – soit de transformer l’essai d’une autre manière en revenant à des métiers plus classiques du droit – ceux où on est réputé le « pratiquer ». De tout ce qui prédisposait Bouvard à commencer une pénible traversée du désert, aucun élément n’était plus sensible que sa propre idéalisation de l’enseignement universitaire du droit et le caractère tragique qu’avait pris son sentiment d’échec à la satisfaire. Pour se consoler, il se récitait parfois Henri II après Saint-Quentin : « Ne s’étonner de rien et avoir bon cœur ».
2
Assuré que son avenir professionnel ne s’écrirait pas à l’Université – Bruno le lui avait suffisamment répété – Bouvard savait qu’il avait devant lui des temps difficiles. C’était l’automne, saison du lent pourrissement du paysage, certes masqué par le carrousel des couleurs ; pour lui, il n’y avait plus de cours à assurer, pas d’avenir précis à envisager, aucun rôle social déterminé à jouer. Les yeux des autres ne lui renvoyaient plus rien quant à ce qu’il était ; personne ne lui permettait plus de se rêver, de soutenir un rêve de soi, aussi misérable soit-il.
Un titre universitaire ne valait rien en dehors de l’université, en dehors de ceux qui en vivent en dévorant la vieille bête croulante, cette alma mater du pauvre qu’en France on laisse se tenir seule dans son coin en espérant simplement qu’elle ne s’effondrera pas sous le poids des étudiants en surnombre et du manque de moyen, ni même ne se rebellera : « Au reste après nous le déluge » devait plaisanter la Pompadour après Rosbach. Un titre universitaire ne rapportait pas d’argent, il ne payait pas le loyer ; il ne le paierait jamais. À peine offrait-il quelques prestiges symboliques comme celui de pouvoir publier quelques études censément érudites dans des revues à comité de lecture, et, s’agissant du droit, un laissez-passer bien pratique pour éviter l’examen du barreau et entrer directement à l’École des avocats.
Peu après son entrée en thèse, Bouvard s’était installé à Paris, dans un petit appartement de la rue de Verneuil au-dessus d’un restaurant indien. Dans ces deux pièces, il cachait tout son monde ; c’était la suite de sa chambre d’adolescent qui elle-même n’avait fait que prolonger sa chambre d’enfant. Il avait toujours vécu en considérant l’extérieur avec une certaine méfiance. Enfant pas encore scolarisé – il ne le fut qu’à l’âge de trois ans – il avait l’habitude de se cacher derrière les jambes de sa mère quand ils croisaient des visages inconnus à l’extérieur du domicile. Il n’avait jamais conçu que des rapports ambivalents à l’autorité, manifestant une sensibilité parfois pathologique aux conflits. À Paris, il vivait péniblement ; sorti de chez lui, il n’était pas à l’aise. Cette ville bouffie lui paraissait un monde sordide où les bruits n’avaient de cesse de se mêler : les transports publics se mélangeaient aux voitures, lesquelles se mélangeaient à la foule des passants qui, eux, n’arrêtaient jamais de passer. Et puis il y avait les soirées où on ne l’invitait pas ; où il ne souhaitait pas être invité. Il n’avait jamais pu, même dans les ressources offertes par l’habitude, trouver la tranquillité. Il aurait pu quitter cette ville s’il n’y avait eu les commodités de transport et surtout s’il ne bénéficiait pas d’un loyer étonnamment généreux. Il avait fait, presque malgré lui, une bonne affaire et ne pouvait se résoudre tout à fait à l’abandonner. Il pensait souvent que, si hostile qu’elle puisse lui paraître, cette ville que, paraît-il, le monde enviait, à la France, devait bien avoir un ressort secret qui finirait par l’enivrer, lui aussi. Les boutiquiers des bords de Seine, parfois, avaient apaisé son ressentiment. Il aimait aussi remonter la rue Soufflot et se balader dans ses librairies juridiques, y prendre connaissance des nouveautés ; parfois, il arrivait de Saint-Sulpice, le monument de Paris qui l’impressionnait le plus, ou de La Procure, où il achetait souvent des livres historiques : Bouvard raffolait des biographies. Pendant sa thèse, il s’était souvent rendu dans l’endroit le plus sinistre de Paris, la bibliothèque Cujas, toujours un peu bluffé que sa carte d’enseignant lui offre un accès total à ses sous-sols crasseux, mais remplis de vieux livres de droit. Là, il pouvait errer, seul, parmi toute cette diversité, des publications juridiques à ne plus savoir qu’en faire, et fantasmer sa carrière de professeur à venir, les ouvrages qu’il écrirait, le succès qui serait le sien au sein de l’institution.
Il avait vécu les neuf premières années de sa vie d’enfant à Laon avec ses parents. Fils unique, toute son enfance s’était déroulée dans le cadre rassurant de la petite résidence Montreuil, dans une ville peu fréquentée et où jamais rien ne se passait. Il avait mis plusieurs années avant de comprendre que les immeubles qui formaient la résidence n’étaient pas des hachelems comme il le pensait et que ce mot n’en était pas un. Cette découverte ne se fit pas sans une certaine honte de ses origines qui jamais ne le quitta vraiment. Pourtant, dans cet univers rassurant, entre l’école et l’appartement familial, rien n’était jamais venu troubler le paisible écoulement des jours, des semaines et des mois qui séparaient ses différents anniversaires. C’est quand son père avait perdu son emploi dans une boulangerie de la ville haute qu’il avait fallu rallier la banlieue parisienne. En Seine-Saint-Denis, plus de résidence HLM mais une « cité » comme l’on disait. Il n’avait que huit ans mais il se souviendrait longtemps de l’effet de vide qu’avait causé en lui ce déménagement – mot honni – et la nécessité de réapprendre à vivre, de s’adapter à un nouveau monde bien différent. Il n’était pas au bout de ses peines.
Au début des années quatre-vingt-dix, il existait encore une nette différence en matière d’immigration entre la province française, même dans ses quartiers dits populaires, et la banlieue parisienne. Quand une famille à la peau noire était venue s’installer dans la résidence Montreuil, elle était vite devenue une attraction publique. Bouvard se souvenait de la première fois où il avait vu l’un des garçons qui jouait au foot sur les pelouses : « on » venait le voir, l’approcher, voir comment « c’était en vrai » – et même d’abord que « c’était vrai » : on pouvait être noir de peau. Il se souvenait aussi d’Aziz, le petit algérien qui était arrivé dans sa classe de CP en cours d’année et qui ne savait pas lire – on l’avait finalement fait redoubler. Désormais, en la matière, il avait dû s’habituer à un complet renversement du panorama ; il s’y était fait même s’il n’avait pas vraiment saisi la subtilité géographique des origines de tous ceux qui l’entouraient, dans la cité ou à l’école. À peine inscrit en CE2, les enseignants avaient choisi de lui faire « sauter une classe » afin qu’il ne pâtisse pas de l’avance acquise sur le programme dans son école d’origine. Il était convenu de considérer, on le lui avait expliqué ainsi, que les « étrangers » (c’est le mot que tous employaient, certains avec une pointe de gêne à peine perceptible) généraient un ralentissement général dans la poursuite des programmes à l’école publique car ils avaient du retard dans l’apprentissage de la lecture et plus de mal à assimiler les notions de base. C’est donc nanti de cette avance plus ou moins artificielle et de ces riches explications qu’il avait franchi, plus ou moins heureusement, les différentes étapes qui devaient le mener à l’université. Rien toutefois n’était advenu sans souffrance dans l’éclosion progressive du jeune Bouvard qui allait percer sous le petit Jacques.
Lorsqu’il s’était agi de choisir sa voie, en l’absence de référence familiale ou de souhait clair, il s’en était remis à quelques représentations de la justice aperçues dans les films américains pour décider de faire son droit. C’est sans exceller particulièrement mais avec un intérêt croissant pour la chose qu’il avait appris à maîtriser l’essentiel des notions juridiques, à faire sien le mode de raisonnement propre aux juristes, celui qui, trop souvent, les enferme dans quelques pyramides étroites faites pour des esprits simples et obsessionnels, qui aiment à se penser raffinés. Il avait ainsi validé les semestres – car il avait connu l’enseignement supérieur après la « semestrialisation », absurde réforme administrative – les uns après les autres, migrant de sa fac de banlieue vers la Sorbonne puis de celle-ci – que, normalement, on ne quitte pas, mais où le « caractère-trop-indépendant-de-Bouvard » l’avait fait remarquer dans un sens qui ne l’avait pas avantagé aux yeux de certains – vers la faculté de droit de Nanterre, celle-là même où il était finalement entré en thèse et avait commencé à enseigner ; celle qui devait rester « sa » fac. Les revenus générés par l’allocation de recherche lui avaient permis de quitter le cocon familial de la banlieue, désormais limité à son père depuis le divorce de ses parents, lui qui s’apprêtait à repartir vivre à Laon une fois en retraite. C’est à cette époque qu’il s’était installé rue de Verneuil, à deux pas de la rue de Lille. À force de renoncement, de lâcheté et, sans doute aussi, de paresse, Bouvard devint extérieurement le contraire de ce qui – il le sentait bien – constituait le fond de son âme – car Bouvard croyait à l’âme. Il paraissait aux autres effronté, brusque, décidé, vulgaire parfois – un trait appelé à se développer – alors qu’il n’avait jamais été, au plus profond de lui, que timide et effacé devant le poids écrasant de l’existence.
Dans les jours qui suivirent la soutenance, Bouvard était resté allongé sur son lit, réfléchissant à ce qui allait désormais, pour un temps au moins, primer : la nécessité de trouver des revenus, donc de s’inventer une vie professionnelle. Il avait toujours espéré échapper à ces rituels-là ; l’Université avait semblé lui offrir le meilleur rempart qui soit en lui permettant de multiplier les années d’études et en lui assurant, par la grâce d’un statut de doctorant qui ne lui imposait que d’animer quelques séances de travaux dirigés et de sembler travailler sur sa thèse, des revenus réguliers que jamais il n’avait eu l’ambition de voir croître. Bouvard détestait l’argent. Seules comptaient pour lui la liberté et la tranquillité, sans qu’il ait développé une claire appréhension des contingences réelles qu’imposait une vie dite « normale ». Quand la réalité de sa situation lui était apparue en fin de thèse, quand il avait compris que le seul doctorat qu’il pourrait se voir octroyer serait purement platonique, il avait commencé à déprimer et à s’enfoncer dans ses noires pensées. L’introspection, dans ce qu’elle a de plus vrai, a cela de terrible que celui qui la mène – et s’en félicite par surcroît – ne peut s’empêcher, instruisant à charge plus qu’à décharge, de comprendre que la complexité du monde n’est que la résultante de la complexité des êtres et que celui qui le saisit ne peut que se maudire d’en être un, voir toutes ses pensées parmi les plus positives se colorer de noir, et finalement se charger des malheurs du monde en se vautrant dans un narcissisme douillet. Tendanciellement, c’est ainsi que tournait l’humeur de Bouvard.
Sa rupture amoureuse avec Mathilde – une rupture avec l’amour, de celles qui révélaient un clivage interne – et l’incompréhension de lui-même qui en était résultée avaient mis fin, sinon à son éducation, du moins à ses illusions sentimentales. Il allait connaître la forclusion émotionnelle. Après cela, toutes les motions émotives ne lui apparaîtraient plus que comme coupées en deux et donc sans vie : il ne les vivrait qu’intellectuellement sans pouvoir les ressentir. Un peu comme la lumière qui perce le fond d’un verre obscur à travers lequel on essaie de voir le monde n’en laisse deviner que quelques contours grossiers, il pouvait penser l’émotion à gros traits, mais pas la vivre. À cette singulière atrophie intérieure, qui ne cesserait de le tourmenter et de brouiller ses relations aux autres, s’ajoutait désormais la perte de toute confiance en son destin, le seul moteur qui, jusque-là, n’avait jamais failli. Il avait tendance à ne plus distinguer d’autres rôles pour lui en société que celui d’un éternel raté, même s’il arrivait encore, subrepticement, que le regard des autres lui renvoie un mauvais brouillon de réussite au visage. Il s’imaginait rejeté, marginalisé, incapable de travailler – ah ce sentiment de lourdeur physique, de pesanteur infinie, cette raideur dans la nuque quand il s’agissait simplement de s’asseoir et de se concentrer pour écrire ce que, pourtant, il avait parfaitement imaginé, envisagé, découpé mille fois dans son esprit, souvent sans effort, en promenade ou sous sa douche. Il se voyait parfois finir sur le quai d’un métro à cinq heures trente du matin pour y tendre un vilain bol et y recevoir la mauvaise soupe, comme il l’avait vu dans un film ; cette image le poursuivait jusque dans ses rêves. Pourtant, il savait qu’il n’en arriverait pas à une telle extrémité – « au pire, se promettait-il, je serai mort avant ». Mais cette pensée le hantait et n’en finissait pas d’obscurcir tout le reste. Il vivait sous le règne d’une injonction intérieure à regarder en face sa médiocrité, laquelle n’avait même pas la délicatesse d’être honnête.
Dans cette période de doute, le temps qui s’écoulait lui semblait étonnamment court et éperdument long : le sentiment de solitude est si intense face à soi qu’on pense parfois qu’il est sans fin possible, que cela ne cessera pas, qu’à vie – soit si peu ou tant selon l’humeur – on est condamné à se voir diminué, ensablé dans ses propres méditations sans issue. Chaque seconde paraît une éternité à celui qui se vit comme un damné. À l’inverse, dans son regard sur la marche de la vie extérieure, on voit le temps passer trop vite. Dans ces moments-là, le monde paraissait à Bouvard se mouvoir sans lui, comme si on l’avait abandonné au bord d’un grand chemin et qu’il voyait passer les autres à toute allure sur quelques machines diaboliques ; ces autres qui grandissaient, construisaient, progressaient. Un jour qu’il surveillait un partiel à l’Université, en fin de thèse, coincé pour trois heures de temps dans un bâtiment d’une grande laideur, enfermé dans une grande salle où la lumière naturelle ne pénétrait jamais, si ce n’est, à l’occasion, lointainement lorsque s’ouvraient les entrées placées aux quatre extrémités, obligé de supporter ses pensées tout en feignant d’être attentif aux centaines d’étudiants présents qu’on le chargeait de surveiller, ce qu’il était bien incapable de faire, il avait ressenti amèrement cette réalité lorsque, promenant son regard sur tous ces visages, il en reconnut progressivement trois. Il s’agissait de trois jeunes femmes, toutes assez jolies pour avoir, jadis, attiré son attention. C’était cinq ans plus tôt, à son entrée en thèse, autant dire une éternité. Le temps avait passé, elles avaient évolué, franchissant les années universitaires comme d’autres escaladent une colline, sans attendre, sacrifiant la prudence à l’énergie. Et Bouvard en était là, à surveiller bêtement, à faire le tour de l’amphithéâtre sans trop savoir quoi faire de ses bras, quelle pose adopter, comme cinq ans plus tôt, engoncé dans son immobilité maladroite. Il en avait ressenti une douleur sourde, celle de celui qui se sent pris dans d’horribles sables mouvants qui n’en finissent pas de l’emporter vers son propre néant.
3
Dix jours s’étaient écoulés depuis la soutenance de sa thèse. Dix jours passés au fond de son lit où une mauvaise grippe – signe tangible du relâchement de son corps tout entier après cinq années troubles mêlant l’oisiveté, l’effort et l’effroi – l’avait retenu. Il avait beaucoup dormi. Il avait beaucoup lu. Il avait beaucoup pensé. Il avait perdu tous ses repères et ne devait pas les retrouver avant longtemps. Il s’était progressivement résolu à s’inscrire à l’École des avocats. Il avait pourtant juré le contraire quelques mois auparavant à son ancien complice des premières années de fac, Jean-Louis Ferrot, lui-même avocat, qui l’avait incité, un jour qu’ils prenaient un verre pendant les fêtes de fin d’année, à passer par le barreau pour acquérir de l’expérience. À tort ou à raison, Bouvard méprisait les avocats ; dans leur office, il ne voyait qu’argent, petits arrangements et commerce – il n’était pas loin de la vérité. Cela gênait en lui l’amoureux du Droit autant que le catholique contrarié sur les questions pécuniaires. Guidé, peut-être, par un curieux destin qui le voyait emprunter à rebours des chemins contradictoires, convaincu plus sûrement par le sésame que lui offrait son doctorat pour entrer à l’École, il avait décidé d’emprunter la fameuse « passerelle ». Il allait devoir faire des stages, chercher à s’insérer, se vendre comme tout un chacun ; cette perspective le pétrifiait. Plus d’une fois, en y songeant, il se recroquevillait, le soir venu, sur son canapé, incapable de renoncer, incapable d’avancer. Il somatisait son angoisse de ridicule.
L’occasion de tester son rôle social à venir allait se présenter à lui : invité par d’anciens étudiants à une soirée organisée chez l’un d’entre eux, qui vivait dans un appartement cossu du XVe arrondissement, il s’était décidé à s’y rendre, quoi qu’il se fît désirer au point de ne donner confirmation de sa présence que le jour même. Au milieu de ses anciens étudiants qui s’amusaient à leurs manières, il caressa du doigt tout le changement qui s’opérait, ce passage vers un autre lui-même qu’il ne pouvait pas encore rêver – se rêverait-il encore un jour ? Pour la première fois, il avait profité de cette soirée pour essayer d’assumer et de revendiquer publiquement le fait d’entreprendre de devenir avocat. Cette décision, il ne pouvait l’afficher que comme mûrement réfléchie et déterminée. Il affecta donc d’avoir la maîtrise de son destin, dans une période où il se savait fragile, sans revenu autre que le chômage – réalité pesante, impossible à assumer : qui était prêt à l’imaginer, lui le virtuose de l’enseignement à la puissante logorrhée verbale, obligé de se rendre aux entretiens absurdes et à demi silencieux que l’on subit dans un Pôle emploi ? – et menacé comme jamais d’être le jouet de circonstances malheureuses. Avocat devint donc, pour une soirée, sa vocation. Vocation tardive. Vocation de circonstance. Vocation peu conforme à l’idée qu’il se faisait de ce que cette profession représentait. Pas vraiment conforme non plus à la haute idée qu’il se faisait encore de son destin, celle qui vibrait toujours, malgré tout, au fond de lui. Rejeté par l’université – du moins est-ce ainsi qu’il se voyait – vivant une vocation insincère, qu’il était bien décidé à trahir dès que l’occasion se présenterait, cette soirée lui permettait de vivre encore sur les braises de son passé d’enseignant. Aux yeux des étudiants réunis ce soir-là, il demeurait une référence, un mystère qu’il fallait pouvoir percer.
Sur la longue terrasse, Bouvard admirait la tour Eiffel et ses lumières chaudes, comme pour se donner une contenance. L’automne l’avait toujours déprimé. Jamais plus que cet automne-là, synonyme de fin de thèse et de transition vers un possible néant. S’éloignant d’un groupe qui discutait de choses qui ne l’intéressaient pas – c’est le propre d’une telle soirée et c’est aussi le propre de Bouvard en soirée que de ne pas savoir trouver sa place – il rencontra, seul à l’autre bout de la terrasse, Alain, un étudiant qui en profita pour venir lui parler alors que, jusque-là, il était resté discret. Il avait été son étudiant le plus brillant et devait le rester. Bouvard se souviendrait longtemps de le lui avoir dit, en pleine séance de travaux dirigés et devant toute l’assistance, à l’occasion d’une remise de copie. Il avait salué sa qualité d’écriture, la fluidité du raisonnement, la citation exacte des références pertinentes pour résoudre le cas posé. Il s’en souvenait comme d’un exemple accompli de correction, de copie parfaite, l’idéal recherché mais jamais trouvé, pas même dans ses propres corrigés. Cela l’avait marqué. Il ne savait pas encore que ce moment avait davantage encore laissé son empreinte chez Alain ; quoi qu’il aurait pu le deviner. Jeune homme réservé mais entouré d’amis, il symbolisait sûrement aux yeux de ses camarades l’archétype de l’étudiant brillant, bosseur mais avec d’évidentes facilités, promis à l’avenir lumineux qu’il saurait se donner. Prenant Bouvard à part, il lui indiqua sa joie de le voir dans un tel cadre : « J’ai du mal à réaliser que vous êtes là. Il y a quelques semaines vous étiez mon chargé de TD, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand Thomas m’a dit que vous alliez venir, je n’y ai pas cru, et vous êtes là devant moi ». Il qualifiait cette situation de « bizarre », sans cacher une excitation, palpable à travers le rythme saccadé de son débit de parole. Il en profita pour se confier à Bouvard, comme à une personne dont on est en droit d’attendre, sinon un conseil avisé, du moins une écoute bienveillante. Il était plein d’ambition et de questionnements quant à son avenir professionnel. Allait-il devenir avocat comme sa mère, bien que celle-ci lui eût laissé entrevoir les difficultés de la profession ? Bouvard sut lui transmettre un message essentiel, quoique banal, auquel il croyait, bien qu’il ne l’eût pas encore totalement éprouvé dans les faits : la vie réservait des surprises, l’importance des rencontres était déterminante et une vie professionnelle ne pouvait plus s’envisager que sur un mode ouvert et pluriel. Il ajouta que l’avocat de vocation allait, pour partie, disparaître et emporter avec lui un savoir-faire autant qu’une éthique, balayés par le marché qui standardise toujours plus les profils et les prestations, les hommes et leur production, la culture et sa floraison. Comme Bouvard devait souvent le répéter depuis l’adolescence « rien n’est impossible, tout est affaire de circonstances ». Cette discussion décousue, qui venait s’ajouter à l’année qu’ils avaient passée ensemble comme étudiant et enseignant, prolongeait un respect réciproque en le colorant d’un aspect plus intime. Bouvard ne devait pas l’oublier. C’est d’ailleurs ce qu’il choisit de retenir de cette soirée comme si cet entretien avait, à lui seul, justifié sa présence.
Dans les semaines qui suivirent, Bouvard avait aussi profité de contacts établis avec une de ses anciennes étudiantes pour se donner la preuve qu’il vivait encore. Forclos émotionnellement, il n’avait en rien renoncé à son attirance pour les jeunes filles et au plaisir « physique et sans issue » chanté naguère sur les radios de France : privé d’un véritable désirde l’autre, il s’adonnait à la jouissancepar l’autre. Louise avait vingt ans, jeune et singulièrement effrontée, elle était d’une beauté froide et charnelle ; pourtant, il ne l’avait pas particulièrement remarquée. Ni ses courtes jupes, ni ses longs cheveux blonds pleins de lumière, ni ses grands sourires ne lui avaient permis de percer le dessein de cette jolie nymphette. Bouvard était un cas en matière de sexualité, c’était entendu. La plupart du temps, il ne cherchait jamais à devancer le désir de l’autre : il préférait cueillir les fruits mûrs en les croquant à pleines dents. Pourtant, quand Louise avait commencé à lui envoyer des messages, d’abord sans apprêt durant l’été où il achevait son travail de thèse, il avait déjà en tête de la posséder. À cela une raison très simple qu’il n’osait s’avouer totalement : un autre que lui, qu’il admirait, avait relevé sa beauté devant lui. Le jour du partiel de fin d’année, alors qu’il était assis au grand bureau qui dominait l’amphithéâtre si laid de Nanterre à côté de Maurice Antoine, ce dernier lui avait demandé d’un air goguenard « Jacques, cette jolie étudiante aux cheveux longs là-bas, elle est à vous ? » Après avoir confirmé que Louise suivait ses séances, Bouvard eut la surprise de voir Antoine lui exposer à quel point la beauté de cette étudiante l’avait frappé en cours, un jour où elle avait défait son chignon pour ajuster sa coiffure, laissant apparaître sa volumineuse chevelure bouclée pleine de lumière. « Claudia Chou-fleur », avait-il énoncé dans un rire, pour illustrer son trouble avec cet humour jovial et contagieux qui le caractérisait. Et de conclure, toujours rieur : « Heureusement qu’on a une éthique ».
Ce n’est pas vraiment l’éthique qui avait intéressé Bouvard, mais bien le spectacle du désir d’un homme de soixante ans, exprimé sans détour, pour une étudiante qui, à lui jeune enseignant un peu arrogant, paraissait accessible. Il est des choses curieuses dans la vie des hommes, comme ce transfert malsain qui veut que, d’un homme qu’on admire, on puisse aller jusqu’à emprunter les fantasmes pour les faire siens et les réaliser, de façon à partager – secrètement et donc sur un mode mineur – quelque chose avec lui. Peut-être Bouvard avait-il compris cet aparté comme une invitation, ou peut-être s’était-il laissé porter par les messages grisants que Louise avait fini par lui envoyer. C’est armé de cet imaginaire-là – celui d’un autre – qu’il avait conversé avec elle, puis l’avait finalement invitée à prendre un café quelques semaines après sa soutenance.
C’était près du jardin du Luxembourg qu’ils s’étaient retrouvés et les choses n’avaient pas traîné : dans sa voiture mal garée près de l’Odéon, elle lui avait témoigné toute son affection. Il en avait été pour une note de teinturier pour son costume – celui de la soutenance, opportunément remis ce soir-là. Pendant quelques semaines, jusqu’à son entrée à l’École du barreau, ses rapports avec Louise lui avaient rendu une part d’estime de lui en réactivant un instinct qui le dépassait, celui de posséder physiquement celles qui lui plaisaient, même quand, comme avec Louise, c’était finalement au nom d’une procuration imaginaire. Il pouvait posséder mais il ne pouvait plus aimer. Il couchait quelques nuits avec ses partenaires avant que l’angoisse ne lui étreigne de nouveau les tripes ; il fallait en changer. La même angoisse qu’avec Mathilde, toujours, tout le temps, à lui tordre le ventre, à lui donner envie de vomir sans pouvoir le faire. C’était « le symptôme » comme devait le qualifier, plus tard, le psychanalyste. Au début, on lutte, on pense que l’on peut guérir, s’imposer à la chose, que c’est une affaire de temps ; puis on finit par se rendre à l’évidence et il faut s’adapter à la réalité ; ou plutôt à l’impalpable réel. Bouvard était bouffé par le symptôme comme d’autres se laissent pousser un ulcère. Il pensait encore qu’un jour il pourrait, par la grâce d’une rencontre, s’exorciser ; le soir parfois, dans son lit, la lumière éteinte, il priait maladroitement Dieu en ce sens, ne sachant bien quelles paroles employer pour cela, s’en remettant à quelques vieux souvenirs de catéchisme pour marmonner de bien baroques patenôtres. En attendant, il prit congé de Louise quand elle partit en voyage de Noël à la Réunion. Tout juste consentit-il à un contact puéril dans les toilettes de l’aéroport. Il la laisserait croire que c’est elle qui avait pris congé de lui quelques semaines plus tard. Quelle importance désormais ?
C’est vers cette époque que, pour la première fois, comme il devait s’en souvenir plus tard, Bouvard entendit vraiment parler de Mangin. Lorsqu’il fit ses débuts en politique, Gregory Mangin n’était pas, à proprement parler, un homme du sérail. Polytechnicien et énarque, inspecteur des finances, il avait démissionné de ses fonctions pour vivre une « expérience intérieure » dans un monastère du centre de la France, expérience dont on savait, à vrai dire, peu de choses, mais qui devait beaucoup impressionner ses interlocuteurs. Puis il devint avocat dans un grand cabinet d’affaires parisien, poste où il put se faire un début de fortune personnelle, et épousa Martine Cons, la fille d’un grand industriel de l’armement, de sept ans son aînée, dont les dîners demeuraient parmi les plus courus du Tout-Paris. Ce parcours atypique et ce réseau en dot l’avaient fait remarquer du monde politique ; avec l’entregent de sa femme, il avait pu être nommé conseiller technique à Matignon. S’acquittant de sa tâche avec talent, il séduisit le président de la République par sa fraîcheur et son intelligence pétillante et fut rapidement promu secrétaire général adjoint de l’Élysée, un poste exposé où ce charmeur au physique avantageux avait pu avoir ses premiers contacts suivis avec la presse politique parisienne. C’est « Madame Cons », comme on continuait de l’appeler, qui faisait office d’attachée de presse plus qu’efficace pour vendre les bienfaits et le brio des conseils prodigués par son mari au président de la République. Ce n’est que lors de son entrée au gouvernement comme ministre de l’Industrie, à l’occasion d’un remaniement dont Bouvard n’avait pas perdu une miette, allongé dans son lit, un dimanche soir, avec Louise, dont il caressait les fesses, qu’il remarqua cet homme qui n’avait jamais exercé de mandat, jamais animé de réunion électorale et qui, pourtant, semblait ne respirer que par la politique, sans jamais avoir été affilié à un parti. Bouvard fut séduit par ce qu’il perçut d’abord comme un homme politique vertébré susceptible, dans les années à venir, de réveiller le pays. Il remarqua aussi la beauté profonde de son visage et l’humanité qui paraissait en émaner.