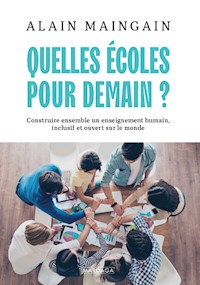
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
La révision du système scolaire actuel est un défi complexe mais nécessaire.
L’école est l’affaire de tous, et l’engagement des citoyens est primordial afin de définir les finalités et les modalités du système scolaire. Une transformation de ce dernier est aujourd’hui indispensable, mais elle doit prendre en compte les aspirations et les propositions des acteurs de terrain (enseignants, éducateurs, directeurs etc.), les plus à même d’identifier et de dépasser les difficultés et les défis qui se posent. Cet ouvrage s’appuie sur l’expérience professionnelle de l’auteur, qui a passé plus de quarante ans au cœur de ce système. De l’enseignement secondaire aux cabinets des ministres de l’Education, son parcours lui a permis non seulement d’observer la réalité du terrain, mais également de prendre du recul et d’appréhender dans leur globalité les réalités plurielles du monde scolaire. Il nous livre ainsi un témoignage authentique et des analyses objectives. Ce texte polyphonique, qui mêle anecdotes et réflexions personnelles, positions politiques, références à des chercheurs…, s’articule autour de trois grands axes. Après une présentation des thématiques majeures des débats contemporains concernant les politiques d’éducation et d’enseignement, l’auteur pointe les forces et les faiblesses du système actuel, afin d’identifier les actions transformatrices nécessaires. Il s’intéresse enfin aux pistes et dispositifs déjà mis en place, ainsi qu’aux choix politiques qu’il conseille pour faire émerger l’école de demain.
Fort d'une solide expérience de terrain, l'auteur nous livre dans cet essai son témoignage et ses positions ainsi qu'une analyse objective et globale, tout en explorant les différentes voies possibles pour l'enseignement de demain.
EXTRAIT
La majorité des acteurs du système scolaire belge francophone gardent, quant à eux, la conviction qu’un redoublement permet à l’élève de « repartir sur de bonnes bases ». Même si cette doctrine se vérifie dans un certain nombre de cas, particulièrement – de ce que j’ai pu observer – lorsque l’élève bénéficie d’un soutien parental, il y a lieu de se demander si le redoublement constitue une réponse pédagogique adéquate, profonde et durable, aux difficultés rencontrées par les apprenants. Les recherches et publications de Marcel Crahay, qui a beaucoup travaillé cette thématique, ont montré que les élèves qui, en dépit de leurs lacunes ou difficultés, n’ont pas été arrêtés dans leur parcours scolaire rejoignent davantage, à moyen et à long termes, le niveau de leurs condisciples et le niveau requis, que les élèves qui ont redoublé une année. Ces derniers, après une embellie souvent très brève, renouent souvent avec l’échec, ce qui démontre, à tout le moins, que le redoublement présente des limites. Ainsi, dans bien des conseils de classe, au cours du deuxième trimestre de l’année scolaire recommencée, on relève un certain essoufflement des doubleurs. En outre, le redoublement peut affecter de manière durable et profonde la confiance de l’élève dans ses propres capacités. Et cela aussi, les acteurs de terrain l’observent.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Maingain, né en 1953, a été successivement enseignant, chercheur-formateur, directeur d’un établissement d’enseignement secondaire, conseiller et chef de cabinet adjoint auprès des ministres de l’Éducation au cours de la législature 2009-2014. Ses quarante années de pratiques et de responsabilités diverses lui ont permis d’observer la réalité du terrain, mais également de prendre du recul et d’appréhender dans leur globalité les différentes facettes du monde scolaire, afin de nous livrer aujourd’hui un témoignage authentique et des analyses objectives.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quelles écoles pour demain ?
Alain Maingain
Quelles écoles pour demain ?
Construire ensemble un enseignement humain, inclusif et ouvert sur le monde
À celles et ceux qui m’ont mis aux mondes :
Parents, maitres, collègues, élèves…
Adresse au lecteur
L’école1est l’affaire de tous. Elle ne concerne pas uniquement les professionnels de l’enseignement et de l’éducation. Elle ne relève pas seulement des conceptions des autorités publiques. C’est un certain consensus sociétal qui a fait l’école d’aujourd’hui, avec ses forces et ses limites, et c’est un nouveau consensus sociétal, en cours d’élaboration, qui construira l’école de demain. La conscience et l’engagement des citoyens disposent de réels leviers quand il s’agit de définir les finalités et les modalités du système scolaire :associations de parents, conseils de participation dans les écoles, groupes de pression, réseaux sociaux et réseaux médiatiques, mouvements militants, programmes politiques, élections, forums, conférences de consensus, etc.
Le présent essai, nourri d’une expérience professionnelle de plus de quarante ans passés au cœur de ce système, s’adresse à tout citoyen qui s’intéresse au devenir de l’école et se pose des questions sur ses difficultés, ses défis, ses transformations, ses bifurcations possibles, ses utopies. Ma carrière s’étant entièrement déroulée dans l’enseignement secondaire de transition, ce n’est donc ni omission ni négligence de ma part sicet ouvragene s’attarde guère sur l’enseignement fondamental (maternel et primaire), sur l’enseignement spécialisé ou sur l’enseignement qualifiant. Ma fin de carrière s’est, quant à elle, déroulée dans les cabinets des ministres de l’Éducation. Si un tel poste peut paraitre plus éloigné des réalités quotidiennes, il permet néanmoins de se décentrer et d’appréhender les réalités plurielles du monde scolaire. Mon souci est de livrer ici un témoignage authentique qui, s’il ne peut embrasser tous les aspects de l’école, fournira je l’espère suffisamment de grain à moudre au moulin de tous ceux que l’école intéresse.
La diversité de mes expériences et de mes rencontres professionnelles m’a incité à composer un texte polyphonique, tisséde situationsvécues, de témoignages, de réflexions personnelles, de positions politiques, de références à des auteurs ou à des chercheurs relevant de différents domaines :philosophie, sociologie, psychologie, psychopédagogie, didactique, etc. Ce côté bigarré du témoignage proposé reflète le parcours intellectuel d’un praticien confronté à des questions, à des doutes, à des défis et porté par de multiples sources d’inspiration au gré des formations, des rencontres, des lectures. Je ne me présente donc pas comme un expert en sciences de l’éducation et je n’ai pas cherché à rédiger un ouvrage académique conforme aux règles de la littérature scientifique.
L’ouvrage est composé d’un prologue et de trois grandes parties.
•Réminiscences relate brièvement un vécu personnel, une expérience professionnelle, un parcours culturel. Ce prologue me permet d’exprimer d’où je viens, d’esquisser le parcours mené, de préciser les influences subies, d’élucider les valeurs au nom desquelles je m’exprime.
•Débats, la première partie, vise une mise à plat de quelques thématiques parmi les plus saillantes dans les débats contemporains autour des politiques d’éducation et d’enseignement. Il s’agit de confronter des représentations collectives ou individuelles au vécu de l’école et de s’interroger sur la commande sociétale à son égard : quelle école veut-on faire, pour quels types d’humains et quels contrats sociaux ?
•Défis, la deuxième partie, envisage les conditions d’une école démocratique, émancipant chaque personne et contribuant au destin collectif. Elle ausculte ce que certains n’hésitent pas à appeler les « maux » ou les « fléaux » de l’école : discriminations persistantes et parcours brisés… Il s’agit de pointer les faiblesses, mais aussi d’identifier les forces du système scolaire en vue d’actions transformatrices.
•Orientations, la troisième partie, s’intéresse aux énergies qui animent au quotidien l’école d’aujourd’hui et aux dispositifs qui permettent de faire émerger l’école de demain. Il s’agit de reconnaitre des pistes patiemment ouvertes dans les champs éducatif, pédagogique et organisationnel par des acteurs et des partenaires du système scolaire, et d’identifier, le cas échéant, des choix politiques à (p)oser.
Certaines thématiques, quoiqu’importantes à mes yeux, n’ont pu être développées dans le cadre limité de cet essai, en particulier lorsqu’il s’agit de chantiers en cours pour lesquels le recul nécessaire fait défaut. Je pense entre autres à la consolidation de la formation initiale des personnels, à la mise en œuvre concrète d’un tronc commun allongé dans le cadre de nouvelles grilles-horaires, et au pilotage du système éducatif qui ont fait l’objet de décisions politiques récentes en Fédération Wallonie-Bruxelles2. Par ailleurs, des problématiques qui me préoccupent d’autant plus qu’elles constituent des fléaux pour notre système scolaire et des drames pour les personnes concernées ne sont guère développées ici dès lors qu’elles sont longuement traitées dans différents ouvrages de sociologie scolaire avec une grande valeur scientifique :les mécanismes de relégation, lesprocessusde démotivations, de décrochages et d’abandons précoces, les violences et les différentes formes de harcèlement, etc.
En tant que citoyen, j’assume pleinement le caractère politique du présent essai, au sens où il propose des analyses, indique des orientations, identifie des décisions à prendre. Les analyses menées se veulent objectives ;les orientations proposées sont éclairées par la littérature scientifiqueet l’expérience de terrain ;les décisions suggérées relèvent d’une vision humaniste de l’éducation et visent une organisation inclusive du système scolaire.
Pour enchanter l’humain et cultiver le bien commun, éduquer et enseigner ne sont pas des actes distincts, mais entrelacés. Les deux facettes d’un même métier :éducateur-enseignant/enseignant-éducateur. Je ne sais si le métier d’enseignant-éducateur relève d’une vocation. Certainement pas d’un talent inné. On n’éduque ni n’enseigne uniquement selon ses intuitions. C’est une profession qui s’apprend, comme d’autres. Mais je suis convaincu que la plupart l’exercent au nom de hautes valeurs, en associant exigence et bienveillance.
Une« transition scolaire »est aujourd’hui nécessaire, pour aller à la rencontre des générations qui viennent et recoudre le tissu social déchiré par les crises financière, économique, sociale, écologique, culturelle. La transformation de l’école ne peut connaitre des coups de frein ou d’arrêt, car nombre d’acteurs, en de multiples lieux, se sentent bien malgré eux dépassés par les situations vécues. Je conçois cette« transition scolaire »comme un refus de l’enlisement, comme un mouvement de dépassement, pour aller au-delà des difficultés ressassées et des défis recensés. Il ne s’agit pas d’opposer de façon binaire un« ancien monde »et un« nouveau monde », selon une formule à la mode dans le champ politique, mais de jeter des passerelles entre les époques.
C’est en partant de l’école telle qu’elle se fait au quotidien en ses lieux multiples (les écoles), en prenant en compte les aspirations et les propositions des acteurs de terrain, en construisant un nouveau pacte sociétal pour l’école qu’une telle transition est réalisable. Parmi une multitude depropos récents, j’épingle celui-ci tenu par une institutrice de troisième annéematernelle :« Cela fait 30 ans que j’enseigne. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ma façon de travailler ne convenait plus aux enfants de notre époque. Certains entraient dans l’apprentissage, d’autres pas »3. Dès le jardin des premiers apprentis-sages, le statuquo n’est plus possible, si l’on ne veut pas perdre le lien entre les générations !
1. Chaque fois qu’il est question du système scolaire pris dans sa globalité, j’utiliserai l’expression « l’école » au singulier, quoique la réalité de ce système soit faite d’une pluralité d’établissements et d’une diversité de situations qui en font la complexité et la richesse. Ce singulier ne désigne donc pas une abstraction transcendante, mais une constellation d’expériences.
2. Selon la Constitution belge, l’institution compétente en matière d’enseignement en Belgique francophone est la « Communauté française ». Toutefois, la classe politique, pour souligner la communauté d’intérêts entre Région wallonne et Région bruxelloise, y a substitué le terme de « Fédération Wallonie-Bruxelles » qui est devenu d’usage courant.
3. « Les inégalités scolaires se (dé)jouent dès la maternelle », dans Le Soir, 18 février 2019.
PARTIE 1 : DÉBATS
Ils sont nombreux ceux qui se penchent et se font entendre sur la place et le fonctionnement de l’école : parents, grands-parents, étudiants, personnels de l’enseignement, journalistes, sociologues, psychopédagogues, chercheurs en éducation, philosophes, économistes, entrepreneurs, mandataires publics, experts internationaux, etc. Il suffit de parcourir les revues de presse pour y découvrir quasi quotidiennement des articles consacrés au monde scolaire. Sans parler du foisonnement de commentaires sur les réseaux sociaux.
Avis, diagnostics, recommandations, programmes politiques divergent selon les lieux d’où l’on parle et les enjeux que l’on privilégie. Rien de plus clivant que le « cas » de l’école dont tous disputent. La binarité sous-tend bien des discours. Aux extrêmes du spectre des opinions publiques, certains prônent des recettes traditionnelles (le retour à…) pour maintenir en équilibre un système qui aurait fait ses preuves, d’autres brandissent d’indispensables ruptures (l’audace de…) pour abandonner un système qui serait devenu obsolescent.
Cette première partie s’intéresse à quelques-uns des débats les plus récurrents ou les plus prégnants dans les expressions publiques, à défaut de pouvoir tous les ausculter :
• Était-ce vraiment mieux avant ?
• Y a-t-il une crise de l’autorité ou une nouvelle façon de l’exercer ?
• Quelles références communes proposer ?
• L’école a-t-elle renoncé à la transmission intergénérationnelle ?
• Comment concilier excellence et émancipation ?
• L’école peut-elle proposer un « pacte d’Humanités » sur la base d’un consensus sociétal ?
Focus donc sur quelques controverses en cours, avec le souci d’en sortir avec des choix clairs pour le meilleur ad-venir collectif.
« Il meurt lentement
Celui qui devient esclave de l’habitude
Refaisant tous les jours les mêmes chemins,
Celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à changer la couleur
De ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnu. »
Pablo Neruda
CHAPITRE 1 La complainte du bon vieux temps
• Mauvaise note ?
• L’orthographe malmenée ?
• La culture générale en déliquescence ?
• L’histoire méconnue ?
• Vraiment mieux avant ?
Où que j’aille, je n’y échappe pas… Soirées entre amis, réceptions de mariage, cocktails officiels, salons de coiffure, salles d’attente, tables d’hôtes :toujours les mêmes couplets et les mêmes rengaines. Dès que mon identité professionnelle est connue, je reçois mon lot de commentaires affligeants sur la médiocrité de l’enseignement, sur le défaut d’éducation et l’abandon de la culture, sur l’incapacité du système scolaire à s’adapter aux réalités économiques… et, bien entendu, sur les avantages dont bénéficieraient les enseignants,« ces nantis ». Le discours décliniste, si l’on n’y prend garde,pourrait pourrir les idéaux et les enthousiasmes les mieux chevillés.
Ce discours se nourrit généralement, pour en prendre argument, des considérations déploratoires sur l’état supposé calamiteux du système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles à la lumière des résultats des élèves aux évaluations communes ou internationales22. Certains parlent même du« tableau noir de l’école »23. En se voulant acérée, la métaphore n’en est pas moins sinistrement abusive.
1. Mauvaise note ?
J’ai toujours été ulcéré par l’utilisation brute des études PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis)24. Des commentateurs de tous poils brandissent des moyennes sans contextualisation ni décryptage. Des analyses fines, sous la plume des chercheurs qui prennent le temps de désagréger les résultats, ne manquent pas.Les scores moyens de la Fédération Wallonie-Bruxelless’expliquent notamment par une très grande dispersion des résultats des élèves et des différences beaucoup plus fortes que la moyenne– pour les pays comparés –entre les résultats des élèves des niveaux socioéconomiques élevés et ceux des élèves des niveaux socioéconomiques plus faibles. Pourtant, les avis péremptoires et les conclusions hâtives persistent. De même, la corrélation entre les performances des systèmes éducatifs et leurs contextes sociétaux est éloquente, mais le grand public n’en a guère cure.
Un regard pour le moins distancié s’impose à l’égard de ces enquêtes, qui ne sont pas étrangères aux préoccupations politiques et économiques de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE) et développent un climat concurrentiel entre les systèmes scolaires comparés. C’est particulièrement sensible quand on examine les commentaires médiatisés. Via PISA, l’OCDE s’instaure en agence de notation des systèmes scolaires. Selon l’excellente formule du philosophe Pascal Chabot,« Le village global est devenu une vaste arène de comparaison ». Il précise encore avec pertinence :« Rien n’y échappe parce que le comparatisme est le mode d’intervention de l’outil numérique qui s’est partout immiscé »25.
Dans les sociétés ultra-libérales26, la notation fait désormais la valeur selon des normes, des règles et des procédures en cours sur les marchés financiers et dans les entreprises capitalistiques. Cette vision quantifiée du travail fourni, des prestations assurées, des performances atteintes ou encore du rendement obtenu appliquée au secteur non marchand, en particulier au monde de l’éducation, constitue un changement de paradigme dont on n’a pas fini de mesurer les conséquences. Il ne s’agit plus de donner de la valeur à un processus éducatif long et complexe visant l’avènement d’une personne, mais de noter à un moment donné des niveaux de performance par rapport à des compétences standardisées.
Mon propos ne consiste pas à rejeter les évaluations internationales, mais à en faire un usage modéré, avec les analyses requises si l’on ne veut pas tomber dans des dérives technocratiques ou se convertir à une culture du résultat quantifiable.
Il faudrait au moins s’entendre sur les finalités de l’école et leur hiérarchisation, avant d’en mesurer l’efficacité. Instruire, éduquer, socialiser, personnaliser, orienter, professionnaliser, développer la créativité, préparer à la compétitivité ou à la flexibilité, assurer le bien-être, etc. Les points de vue divergent et, partant de là, la validité d’outils de mesure standardisés, censés mesurer l’efficacité/l’efficience de tel système éducatif, est profondément discutable. Toutes les missions de l’école ne sont pas mesurables et évaluables à l’aune de questionnaires numérisés et d’items quantifiables.
Bien des discours tenus sur l’école sont empreints de stéréotypes (sur le métier d’enseignant-éducateur ou sur les bonnes écoles), d’idées préconçues (sur l’efficacité pédagogique du redoublement ou de la dictée), ou encore d’accents nostalgiques (quant au niveau qui baisse ou à l’incivilité de la jeunesse). Comme bien des acteurs et partenaires de l’école, je suis passablement agacé par des approximations largement répandues dans l’opinion publique, voire chez les enseignants eux-mêmes, et il me parait nécessaire de prendre le temps de les discuter, voire de les déconstruire. Comment regarder l’avenir avec confiance et réaliser, au jour le jour, une école pour demain, ce que nous devons à nos enfants et à nos adolescents, si l’esprit s’englue dans un immobilisme frileux ?Pour ma part, je ne cultive ni la morosité scolaire, ni le déclinisme culturel. Mais je dois bien admettre que ce n’est pas toujours une position partagée par mes interlocuteurs. Parmi d’autres symptômes débattus dans l’opinion publique, je voudrais en examiner trois :« le déclin de l’orthographe »,« la perte de culture générale »,« l’oubli de l’histoire ».
2. L’orthographe malmenée ?
L’orthographe est un code parmi d’autres. Je disais souvent à mes élèves qu’en le respectant, le scripteur facilite la réception du message par son lecteur. Respecter l’orthographe, mais aussi la syntaxe, cela relève d’un principe de coopération. Lorsque je formule un message, je fais tout pour queles destinataires le comprennent aisément. C’est une règle pragmatique et une marque de respect. Or, l’on assiste aujourd’hui à l’estompement des normes. Code de courtoisie, code de la route, code fiscal…, pour ne prendre que quelques exemples au hasard, connaissent bien des entorseset des infractions. Pourquoi en serait-il autrement du code orthographique ?Par ailleurs, le rapport au texte est sensiblement modifié. Autrefois, le texte était véhiculé sous forme manuscrite ou imprimée, selon des conventions stabilisées. Aujourd’hui, la production et la réception de textes se fait par de multiples canaux – sms, courriel, tweet, facebook, whatsapp… – ayant chacun leurs normes pragmatiques et permettant des écarts souvent ludiques. Dans les réseaux sociaux, les codes sont devenus flottants. En dépit de ces évolutions, il faut relever le fait que le niveau en orthographe ne baisse pas et reste stable depuis vingt ans selon les résultats de tests pratiqués à l’entrée des études supérieures.
L’orthographe française est parfois inutilement compliquée :la complexité des règles d’accord du participe passé que des linguistes belges voudraient simplifier, en s’appuyant sur des arguments d’ordre sémantique, en constitue un bel exemple. Il y a des érudits qui semblent adorer les exceptions, les bizarreries et les excentricités de la langue française27. Leur excitation n’est guère partagée par celles et ceux qui essayent quotidiennement d’enseigner une langue commune, en incluant les publics fragiles. En tant que professeur de français, j’étais rebuté par les jongleries grammaticales que proposaient certains manuels à longueur d’exercices monotones pour couvrir cette matière absconse, s’attardant en particulier sur les exceptions aux règles communes. J’ai toujours considéré qu’il valait mieux consacrer du temps à donner aux élèves des outils pour qu’ils puissent produire et décoder des textes, à l’écrit et à l’oral. Je partage largement le point de vue de Dan Van Raemdonck, professeur de linguistique à l’ULB :« On doit se demander pourquoi on fait de la grammaire à l’école :pour vénérer les totems d’une culture ou émanciper les gens en leur donnant des outils pour se comprendre et s’exprimer ? »28.
La complexité orthographique peut rendre l’accès de notre langue difficile. Cette complexité a été délibérément recherchée dans le passé, singulièrement auxviie siècle, pour en faire une langue de cour et d’érudition. Aujourd’hui, concurrencé par l’anglais commelingua franca, le français gagnerait à se montrer plus accessible à ceux qui souhaitent l’adopter ou se voient contraints de le faire par la force de leur situation. La langue, en tant que bien commun, évolue avec l’usage, n’en déplaise à ceux qui la conçoivent comme un marqueur social. Pour ma part, je suis farouchement adepte des réformes proposées par les linguistes visant la simplification orthographique et la suppression des incohérences. Il est regrettable que le bon usage des rectifications orthographiques, recommandées par leConseil Supérieur français de la langue française en 1990, rencontre encoredes résistances. Il est aberrant que l’enseignement de l’orthographe oscille entre orthographe traditionnelle et orthographe rectifiée d’un professeur à l’autre, même si l’Académie française accepte les deux orthographes comme correctes. Une langue évolue avec, par et pour ses usagers.
3. La culture générale en déliquescence ?
La perte de la culture générale ou de la culture tout court est un étonnant poncif des discours déclinistes. Cette incrimination me laisse pour le moins sceptique. Un de mes anciens élèves, devenu professeur en faculté de médecine, me disait avec une sincère désolation que ses étudiants n’avaientplus de culture générale. Mais de quelle culture générale s’agit-il ?Incontestablement, ses étudiants ne disposent pas de« sa »culture générale, celle qui lui permet à lui, avec son histoire et ses affinités, de se situer tant bien que mal dans la multitude des phénomènes du monde. Sans le blesser, j’aimerais lui dire qu’il ne dispose pas, quant à lui, de la culture générale de mes maitres, un ensemble de références parmi lesquelles ma propre génération a opéré des choix arbitraires selon des critères liés à sa situation historique. Par ailleurs, ses étudiants, par les voyages et les échanges, ont accès à des cultures étrangères auxquelles ma génération ne s’est guère frottée.
La culture dite« générale »consiste, me semble-t-il, en un certainnombre de points d’ancrageset d’échanges pour bien faire l’humain et pour(se) questionner adéquatement. Elle est une production permanente. Elle permet de modeler des cadres généraux de pensée, pour rendre intelligible le rapport à soi, à l’autre, au(x) monde(s) et pour jouer son rôle d’humain. Grand mode d’emploi de la vie, la culture se régénère régulièrement. Elle résulte d’un mouvement trialectique29 :transmission-appropriation-reformulation. Pas sûr, dès lors, que l’on assiste à une déperdition ou à une absence de culture générale. Plutôt à des ajustements et à des déplacements des références communes et des symboles collectifs. Cela n’exclut nullement la rencontre, à partir de questions partagées, avec des« grandes œuvres »ou avec des« œuvres classiques ».
Mon propos est sous-tendu par un constat empirique :auxxie siècle, l’école de tous et pour tous n’est plus ni dépositaire, ni reproductrice d’une culture« légitime », celle des groupes sociaux dominants, qui s’imposerait par essence à tous les publics scolarisés, alors que les objets d’une telle culture résultent de choix arbitraires, comme l’ont montré les travaux de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron au cours des années 60 et 70 dusiècle passé. En dehors de milieux conservateurs, la culture des« héritiers », selon l’expression de ces deux auteurs, ne présente plus guère un avantage déterminant :peut-être un critère de distinction pour cercles clos, mais guère une clé de lecture-interprétation de mondes interconnectés.
En se recroquevillant sur elle-même sous une forme encyclopédique, la culture transmise par l’école risquerait de devenir anachronique. Je ne partage pas le point de vue de ceux qui estiment qu’il incombe à l’école de déployer ses programmes à l’abri de la vie réelle, en proposant une culture« éternelle »qui transcenderait les modes du moment, les questions d’actualité et les contingences du vécu. Ce qui importe, ce n’est pas de capitaliser du« patrimoine culturel »dans un esprit de thésaurisation, mais de s’inscrire, harmonieusement et utilement, dans un réseau de relations, de communications et d’échanges humains, dans les contextes de la vie en cours. Et plus encore de susciter une curiosité vivace, pour que chaque apprenant poursuive, de manière autonome, un maillage culturel tout au long de son parcours de vie. À rebours, on risque de transmettre ce que Philippe Meirieu qualifie de« savoirs morts »ou encore de morceaux de patrimoine« fossilisés »30.
Pour faire société dans un espace-temps particulier (l’Europe, la Communauté française de Belgique, la Région bruxelloise ou un village du Luxembourg belge… auxxie siècle), il faut partager des valeurs, des récits, des codes, des modes, des rituels, des objets, des références, des croyances… résultant d’un tissage collectif et inclusif au sein d’un groupe donné. Il y adonc, quelle que soit la dimension du groupe concerné, un équilibre à préserver sans cesse entre l’universalisable et le particulier. À défaut, on tombe dans l’insécurité culturelle et dans la crispation identitaire, qui résultent du frottement des modes de vie juxtaposés et menacent le pacte social. National-populismes et ethno-communautarismes en attestent. La culture commune est une invention perpétuelle au cœur des rencontres et des interactions humaines, autour de questionnements, de projections, de réalisations, mais aussi de défis, de menaces, de crises… qui nécessitent de tisser un ordre symbolique, constitué de représentations et de productions matérielles et immatérielles, pour rassembler et harmoniser les membres d’un groupe organisé par un contrat social. Tous les lieux d’éducation-instruction, de l’école maternelle aux études supérieures, de la famille aux mouvements associatifs, des livres aux réseaux sociaux… contribuent à cette co-construction toujours inachevée. Dans ce sens, l’école est un lieu de production d’une culture vivante et ouverte.
Un indispensable ajustement des contenus de notre enseignement, en fonction de nouveaux domaines d’apprentissage issus des évolutions sociétales, économiques, technologiques et numériques, offre une opportunité d’interroger sans tabous les modalités de l’enseignement des langues anciennes. L’évolution des publics scolaires, y compris dans les établissements les plus traditionnalistes, impose ce questionnement. En Belgique francophone, dans le cadre de l’instauration progressive, à partir de la rentrée scolaire 2020, d’un tronc commun renforcé et allongé jusque 15 ans31, le gouvernement et le parlement ont opté pour une initiation au latin, pour tous les élèves, en renforcement de l’apprentissage du français, durant les trois années de l’enseignement secondaire inférieur32. Cette mesure résulte vraisemblablement d’un compromis avec un certain dogmatisme :pour les puristes, un tronc commun doit proposer le même programme de cours à tous, au nom d’un principe d’équité et d’inclusion. Alors, pour faire place au latin, comme le souhaitent certains publics, il s’imposera à tous, sous une forme qui reste encore flouedans les commentaires du texte décrétal :« une initiation aux racines étymologiques et culturelles de la langue française ». Je demande à voir ce qui se fera effectivement d’une école à l’autre, à la faveur de la liberté pédagogique et organisationnelle des pouvoirs organisateurs. Pour les enfants issus des classes populaires ou de cultures non européennes, l’apprentissage du latin avec une orientation linguistique risque de constituer plus souvent un obstacle qu’un adjuvant. L’objectif de« l’intégration »ne justifie pas la latinisation à tout prix. L’émergence d’une culture commune pour faire société repose sur la fluidité des échanges culturels et non sur l’imposition d’un héritage particulier. À la lumière des effets induits, on en arrivera peut-être, dans un délai plus ou moins long, à laisser le choix à l’élève et à ses parents entre le latin ou des activités d’expression écrite/orale en français ou des activités de structuration de la langue familiale. Pendant prèsde trente ans, j’ai enseigné la langue latine avec conviction. Sans renier l’importance de cet engagement passé, j’accepte lucidement aujourd’hui que d’autres apprentissages s’avèrent prioritaires pour relever d’autres défis avec d’autres jeunes.
Pour conclure provisoirement sur la question des contenus culturels au sens large, je m’en tiens à une intuition qui a guidé mon enseignement :la culture est d’abord fille d’un temps et d’un lieu particuliers, une manifestation du processus d’humanisation long, lent et inachevé. Je livre unedernière réflexion. Ceux qui invoquent« la »culture générale évoquent plusrarement la place de la culture sociologique, économique, scientifique, technologique, informatique, écologique… N’y a-t-il de culture que philosophique (ou religieuse pour certains), littéraire, historique, artistique ?Préjugé des humanités d’antan !
4. L’histoire méconnue ?
En rapport avec le thème de la culture dite « générale », un autre sujetbrûlant sur la place publique est celui de l’enseignement de l’histoire, censéinstiller à tous les écoliers une« mémoire commune », faisant référence à des évènements, à des réalisations humaines, à des personnalités, à deslieux et monuments, à des traits civilisationnels… constitutifs d’unesociété donnée, que nul futur citoyen de cette dernière ne devrait ignorer, pense-t-on.« Ils confondent Charlemagne et Charles-Quint… De mon temps, on connaissait ses dates (sic) et on maitrisait la ligne du temps… Hitler, ils connaissent à peine… La shoah, on ne peut pas leur en parler… ». Ces quelques réactions épidermiques, glanées au fil de conversations impromptues,révèlent en fait que nos enfants et adolescents ne baignent pas (ou plus) dans un paysage culturel imprégné du passé. Comme les adultes, ils participent à une culture basée sur l’intensification du présent, un trait typique des sociétés consuméristes depuis les années 60 du siècle dernier. Alors que nos sociétés s’agitent dans le présentisme, il est quelque peu paradoxal de reprocher à l’école de ne pas entretenir suffisamment la mémoire (ce qui reste à démontrer !).
Par ailleurs, si on ouvre le débat de l’enseignement de l’histoire, il y a matière à interroger le caractère européocentré du cours d’histoire tel que ma génération l’a connu. Et que dire des oublis et des amnésies, comme le silence sur le génocide arménien jusqu’à une époque récente ?
Les humeurs du moment et l’écume de l’actualité ne doivent pas occulter des questions fondamentales pour la didactique de l’histoire :récit national ou histoire globale des civilisations ;histoire des grands hommes(rois, conquérants, génies) ou histoire des masses (dominés, oubliés, déportés) ;histoire des évènements ou histoire des tendances longues ;mémorisation de faits datés ou construction de représentations conceptuelles





























