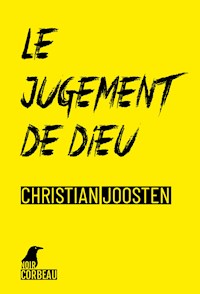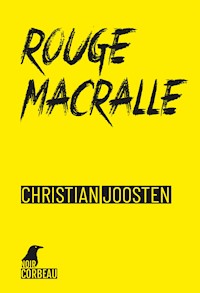
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Aux premières heures de la nuit, faites disparaître un convoyeur. Aux premières lueurs de l’aube, faites revenir un ancien flic. Ajoutez alors un soupçon de truand, un entrefilet de journaliste et une pincée de violence. Laissez reposer quelques jours, le temps que les éléments décantent. Placez alors les rancœurs de côté pour ne garder que les bons morceaux. Mélangez fort jusqu’à obtenir une réaction en chaîne. Dans le chaudron de Stavelot où frémit le Laetare, toujours la macralle ensorcelle.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Archiviste, photographe amateur et passionné de football américain,
Christian Joosten entraîne Guillaume Lavallée, flic trouble au passé hanté par ses fantômes, dans une troisième aventure au cœur de Stavelot.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Descriptif
La collection de romans policiers Noir Corbeau bénéficie du regard averti de François Périlleux, Commissaire Divisionnaire (e. r.), ancien chef de la Crime à la Police Judiciaire Fédérale de Liège.
« Tout homme dans ma situation a forcément des ennemis. En vérité, j’aurais plus vite fait de compter mes amis ! »
S.A. Steeman – L’infaillible Silas Lord
« Cela n’a aucun sens que d’expliquer ce qui est correct aux gens qui ne le sont pas »
Manifeste de la Fraction armée rouge – 5 juin 1970
Prologue Samedi 13 mars vers 3 heures du matin, entre Lausdell et la frontière allemande
— Pierre, je crois que c’est eux ! dit-il doucement en bousculant du coude son collègue assoupi dans la camionnette de service. Là ! ajoute-t-il comme une évidence, en pointant de son index ce qui semble être sur un chemin, au loin, un véhicule en mouvement.
Pierre Moinet a le début de quarantaine fatiguée. Agent de la DNF – Département Nature et Forêts, il adore ses week-ends de garde à surveiller la nuit, parce que c’est calme et surtout bien payé. Ça lui permet de récupérer un peu les heures de sommeil perdues depuis l’arrivée de la petite dernière. Quand sa femme lui a annoncé sa grossesse, l’année passée, il ne savait pas s’il devait en rire ou en pleurer. Quatre, bon sang ! C’est pas ça, il les aime…, mais quatre quand même ! Heureusement que son fils est là, le troisième… Sinon, que des filles. Sa cuisine, son salon et l’étage des chambres étaient recouverts de licornes, de princesses et d’arc-en-ciel. Alors, quand « son gars », comme il l’appelle, cherche à jouer au ballon dans le jardin, c’est pour lui un moment de calme dans ce monde qu’il trouve tellement mièvre. Mais bon, Sylvia, sa femme, gère ça comme une cheffe… Et puis Raymond, son collègue avec qui il effectue les gardes, comme celle de ce soir, est un taiseux, un vieux de la vieille qui décompte les semaines avant sa mise à la retraite.
S’il le réveille, c’est parce qu’il a un doute. Depuis leur emplacement de surveillance, sous les feuillus bordant une parcelle déboisée l’année dernière, il a un aperçu de plusieurs routes. Raymond n’aime pas les braconniers. Dès lors, cette voiture qui roule sans phares sur un des larges chemins à travers leur secteur, ça pourrait être eux. Ils ont tiré la semaine dernière un daim, mais probablement incapables de le traîner jusqu’à la route, ils l’avaient découpé à même les fourrés et emporté la viande. Un truc de dégueulasses. Faut pas aimer les bêtes pour faire un truc comme ça. Depuis, il veut se les faire. Quand on vieillit, on commence à avoir des manies, des obsessions. De toute façon, là, c’est suspect ; fallait qu’il réveille Pierre. « On va couper par les crêtes et leur tomber dessus au carrefour du gros chêne. On y sera plus vite qu’eux. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. On va rouler discret », dit-il en mettant le contact.
En quelques secondes, les roues de la Land Rover s’accrochent aux cailloux du chemin et la jeep zigzague vers les hauteurs du vallon en une accélération rapide. Pierre évacue en lui ses derniers rêves, bâille et se voit ballotter sur son siège, ce qui l’empêche de prendre un peu de café. Il regarde sa montre, agrippe son carnet dans la poche intérieure et note l’heure pour le rapport de mission. Quelques minutes à deviner parfois le chemin, se dire qu’on est passé un peu vite à tel ou tel endroit. À l’approche du croisement du gros chêne, Raymond fait ralentir le véhicule. Sauf s’ils sont déjà passés, cela ne devrait pas tarder ; mais Raymond, il a envie de savoir, alors il se gare comme il peut et sort. Portière ouverte, il pense d’abord à remettre sa casquette, lisser sa chemise et enfiler sa veste qui arbore les logos de son institution. Faire ça dans les règles. Pierre, lui, profite de l’arrêt pour enfin se servir une tasse. Le froid extérieur de mars contraste fort avec la chaleur de l’habitacle. Il voit son collègue se diriger vers le chemin, fier et droit représentant de l’ordre, raide à scruter la route d’où le véhicule suspect doit déboucher. Il le voit vérifier son équipement, fermer sa veste.
Raymond regarde rapidement vers le ciel, devine un mouvement, et au loin, le ronronnement sourd d’un moteur en approche. Il fait deux ou trois pas sur le côté pour veiller à son effet de surprise, constate que son collègue s’habille lui aussi le long de la voiture. Il lui fait des signes, tant pour attirer son attention que pour mimer la manière de les appréhender, mais Pierre sait ce qu’il a à faire, tend l’oreille et comprend que les autres arrivent.
Quand la voiture est à environ 150-200 mètres d’eux, Raymond secoue sa lampe de poche en la pointant vers sa paume pour une dernière vérification avant de la braquer, allumée, vers le véhicule suspect. Il crie, comme il en a l’habitude, son identité et son service, même s’il sait que cela ne sert en général pas à grand-chose. À quelques mètres de lui, Pierre accélère le pas, enclenche, lui aussi, sa lampe et se positionne sur le chemin, comme on le fait habituellement en intervention. Mais là, le véhicule n’envisage pas de freiner, ni même de les éviter. Alors, Raymond sort son arme, hurle la sommation pendant que Pierre dégaine la sienne. Le conducteur éblouit de ses grands feux la scène pour aveugler les agents de la DNF, des détonations claquent dans la nuit. Raymond tire, comme on le lui a appris, la main serrée autour de la crosse, plusieurs fois. Un pare-brise explose. Pierre a plongé sur le côté et vise, en se relevant, les pneus à l’arrière de la voiture. L’échange est bref, la voiture criblée d’impacts passe entre eux, file d’abord et dévie un peu ensuite sur la droite pour aller heurter un tronc couché là après abattage par les forestiers. Éclats de lumière des phares, de bruits et de cris étouffés. Sous le choc, Raymond tremble un peu alors que Pierre, pas plus fier, se dirige vers la bagnole. La portière conducteur s’ouvre et une ombre tire vers les gardes de la DNF en s’extrayant du siège. Pierre saute sur le bord du chemin, cherchant un abri derrière un rocher, regarde où est son collègue qui, couché à même le sol, vise et tire encore une fois. Pierre pense à sa femme, ses enfants, oublie l’instant présent. Il a chaud, il a froid, il tremble et est en sueur.
« Il s’enfuit », hurle Raymond en se relevant, avant de crier vers son collègue un « là, là », désignant un flanc de vallon noir d’encre. Pierre braque sa lampe, cherche un reflet, une direction, mais le faisceau ne réfléchit que troncs, arbustes et ce vide entre les arbres. « On est en train de le perdre », fait-il remarquer. Raymond, lui, arrive près de la voiture et devine sur le siège à côté du conducteur, une masse de cheveux couchés sur le tableau de bord. « Putain », se dit-il en hésitant à pénétrer dans le véhicule. Il tend le bras et, du bout des doigts, touche le corps qui, dans sa masse inerte, glisse vers lui. Elle, c’est une femme, semble morte. Pour s’en assurer, il cherche avidement une pulsation au niveau du cou mais ne perçoit rien. Raymond se dit alors qu’il a sans doute buté quelqu’un, que ce n’est pas ce qu’il voulait, que c’est une femme, et cette vision, il va la garder en lui pour le reste de sa vie. Hébété, il recule et lâche son arme sur la route alors que son collègue arrive à son niveau. Pierre lui touche l’épaule, comprend son état en voyant cette fille penchée, les yeux grand ouverts sur le vide. Il contacte la centrale, rameute ce qu’il peut, tente de surmonter la panique naissante. Derrière lui, Raymond pleure ; les nerfs.
Pierre s’approche alors d’elle, obnubilé par l’idée de lui fermer les yeux. La radio s’affole et des messages criés se suivent. Pierre découvre, grâce aux reflets de sa lampe de poche posée à même le siège, tout un tas de pièces de monnaie, de billets, et un portefeuille, dispersés par le choc. Instinctivement, il s’en empare, fait glisser entre ses doigts des cartes de visite et une photo d’un homme en uniforme, il trouve enfin les documents d’identités ; sa main cherche alors la radio en suivant le cordon de l’émetteur et, se redressant, dans la pénombre des phares, indique au central : « L’homme qu’on recherche s’appelle Guillaume Lavallée… C’est apparemment un flic. Il est armé et dangereux. »
La nuit du jeudi 4 mars 2010
Les phares illuminent tant le ruban de macadam que les abords, remblais et bornes réfléchissantes. Des arbres tendent vers le ciel d’étoiles des bras faméliques d’où émergent les feuilles annuelles, projetant leurs ombres tels des échos, de tronc en tronc. Rarement, il diminue l’intensité de ses phares en prévision de l’arrivée d’un autre véhicule en sens contraire. Il laisse même ses feux les plus grands lors du passage d’un village où les poteaux d’éclairage marquent pourtant de leur aura lumineuse la géographie du lieu. Il y a comme un sentiment d’isolement tant les rencontres sont rares, seul dans le confort de sa berline. La radio qu’il écoute a fini par abandonner les débats et dernières nouvelles pour se plonger dans les rediffusions d’albums, d’archives sonores ou ces longues introspections psychologiques qu’une voix enrouée hypnotise sur les ondes. Cet entre-deux qui crée le flou entre aujourd’hui et demain, ce moment de flottement, intemporel.
Il se sait presque arrivé, encore quelques kilomètres, une trentaine tout au plus.
Dans l’espace noir, il accélère sur une longue ligne droite, attentif parfois à ce qu’il perçoit dans son rétroviseur ou comme ici, au loin devant, par le mouvement alternatif de clignoteurs, sur le bas-côté de la route. Il diminue sa vitesse. Il déborde doucement sur le milieu du chemin et remarque les gestes de secours d’une jeune femme. La petite japonaise qu’elle conduit est en rade. Il freine, il sait pourtant qu’il ne peut pas s’arrêter. La jeune conductrice s’approche des vitres teintées toujours remontées, armée de son plus beau sourire, et dit merci ; enfin, c’est ce qu’il s’imagine au mouvement des lèvres. Il coupe la radio. L’espace d’un instant, il pense à un autre visage, un autre corps. Il remarque la crevaison avant gauche, le cric déposé à même le sol, entre la route conquise sur la nature et les premières plantes. Il est à cadence d’homme, vérifie si la balise d’alerte ne s’est pas encore déclenchée. Il continue, plus lentement encore sous le regard étonné et suppliant de la jeune fille qui ne comprend pas la raison de son hésitation. Des cheveux noirs, un visage avenant, une pointe trop criarde de rouge sur les lèvres. Elle passe la main sur sa manche, elle doit avoir froid. Prenant son téléphone portable, il pianote un message à la centrale, indique une « pause 5 minutes sur bord de route » et enclenche dans la foulée son clignotant. L’auto s’immobile, la balise déclenche l’alarme lumineuse sur le tableau de bord.
La fille garde ses distances, rougie par les feux d’arrêt de la voiture. Elle est hésitante, lui aussi. Un regard circulaire pour inspecter les alentours avec l’espoir de voir les prémices d’une venue d’un véhicule, d’avoir ainsi un motif de repartir, quoique. Il souffle, se dit qu’il n’en a pas pour longtemps et décroche sa ceinture. Sonnerie d’une portière ouverte pour des phares toujours allumés. Le vent frais qui courbe les herbes hautes des prés entre dans l’habitacle et mord sa chair. Il change de visage et sourit. Elle hésite. Un bonsoir, un merci et une explication d’une crevaison alors qu’elle n’est pas près de rentrer chez elle. Son boulot « l’a amenée tard et elle est crevée » ; grimace d’un jeu de mots facile. En plus, son téléphone est à plat. Elle se passe une main dans les cheveux pour les lisser vers l’arrière, découvrant un petit tatouage à la base du cou. Lui n’écoute qu’à moitié, referme bien la portière derrière lui, fait bonne figure, regarde le pneu et se propose de l’aider. Son propos est sans ambages, sans doute un peu cru. Il plante le décor et espère un remerciement. Effarée, elle recule de deux pas, regarde à gauche et à droite, espère l’arrivée d’un autre véhicule. Elle tend l’oreille et fait semblant de ne pas avoir compris. Il rigole pour ne pas l’effrayer, lève les paumes vers elle en indiquant qu’elle n’est pas obligée d’accepter ses avances, qu’elle peut rester ici encore un certain temps. Elle hésite. Il la juge en se disant qu’elle est vraiment mignonne. Son regard se pose sur lui et, l’étonnement des mots passé, elle essaie un sourire et laisse entrevoir, contrainte, une potentielle récompense. Il se dit qu’elle est seule, qu’elle est fragile et il aime ça.
Il s’intéresse enfin au pneu à réparer, se penche, plie les genoux, inspecte rapidement, et puis commence en attaquant les boulons d’une poigne ferme. Elle se propose d’aller chercher le pneu de rechange. Il fait signe que oui en pensant déjà à après. Il la voit revenir encombrée, un peu gauche avec ses mains sales et la roue de secours. Un déclic, le temps indistinct d’une nuit qui s’arrête.
Il sent le choc du coup de pied dans son dos, s’écroule à moitié sur la route froide, sa tempe heurtant le cric alors qu’il cherche à se retourner, à faire face. Devant lui, une ombre se détache au clair de lune, quelqu’un de casqué, qu’il n’a pas vu avant, qui le braque avec une arme. L’intrus relève légèrement la visière pour que l’autre entende sa réplique, sa promesse faite à un ami. L’homme couché se souvient d’avoir laissé de quoi se défendre dans les compartiments à côté du siège conducteur. Il panique, son regard ne trompe pas. La fille, elle, se tient en retrait et regarde si la route est toujours laissée à la nuit. « Fais vite », dit-elle alors que sa voix trahit une nervosité, « bute-le, ce sale porc ».
L’homme couché se sent condamné, encore quelques secondes, une trentaine tout au plus.
Alors, désespéré, il propose en bafouillant de tout donner, son argent, la voiture. Une larme naît dans ses yeux, initiée tant par le froid du vent que par ce sentiment d’un destin inéluctable. L’autre le laisse à ses gestes erratiques. L’homme au sol remarque son sourire. « Fais vite, redit-elle, inutile de prendre des risques. » Il pleure, sait maintenant que s’approche sa fin, savait qu’il ne devait pas s’arrêter. Il regrette. Son verbiage reprend celui des origines, mêlant l’arabe appris par sa famille, un français de rue, l’ensemble noyé dans des bulles de salive. Prière ou excuse, pardon ou regrets. Face à lui, l’autre cale son pied sur le torse, se plie un peu pour qu’il l’entende. « T’as le bonjour de Khaled, enfoiré ! » Une détonation, un éclair dans la nuit, le son qui se répercute probablement sur les valons voisins.
Même pas une seconde d’hommage, une organisation répétée. Lui tapote le pantalon à la recherche des clés de la voiture, les agrippe et ouvre la berline, son coffre. Dedans, une valise noire avec un code et, sans la moindre hésitation, il retire l’objet pour le remplacer par le corps inanimé. Quelques bavures de sang glissent le long de la carrosserie et sont essuyées d’un revers de poignet. Elle, pendant ce temps, replace la roue de secours dans son logement, empoigne une bombe aérosol pour regonfler le pneu problématique. Pas un mot, des gestes précis. Lui s’installe au volant, les pieds toujours sur la route, cherche rapidement la manette qui ouvre le capot avant et, la minute suivante, arrache des fils circulant autour du bloc moteur. À l’intérieur de la voiture, la balise lumineuse qui égrenait les secondes et donnait alternativement un intérieur rougi ou noir bascule définitivement pour ce dernier. L’homme casqué remet en route la voiture aux vitres teintées, s’avance lentement, phares éteints, reprend son chemin pour quelques centaines de mètres avant d’emprunter un large sentier de terre au milieu d’arbres. Une route cabossée qui mène à une pièce d’eau, un lac. Il s’arrête, sort et vérifie si, comme tout à l’heure, l’endroit est bien désert. Il regarde autour de lui par sécurité, se penche à nouveau vers l’intérieur de la berline et débranche le frein à main. Quelques pas pour se mettre en position. Appuyé sur l’arrière de la voiture, il vérifie l’axe des roues, s’assure de la déclivité du terrain, donne finalement l’impulsion nécessaire à la bagnole pour qu’elle glisse, s’enfonce lentement dans un grand bouillon de bulles, vers son envasement. Il hésite à rester pour s’assurer que tout se passe comme prévu, se replace au pied d’un arbre. Sur la route, plus haut, il entend un véhicule passer, en pleine accélération et il se dit que c’est elle, qu’elle en a fini avec tout cela. Sa nervosité s’échappe à chaque respiration, son pouls reprend un rythme plus familier. Le plafond de la berline glisse enfin sous le niveau de l’eau, les dernières bulles regagnent la surface. Il se rapproche une dernière fois pour s’assurer que, dans le reflet de la lune, rien ne laisse penser qu’une voiture gît là. Il écoute les marais, surprend la conversation des grenouilles et laisse à celles-ci la nuit.
Retour à la route, retour sur les lieux. Rien ne reste si ce n’est cette tache brunâtre dont il sait que c’est du sang. Se repérer rapidement et retrouver sa moto. Un coup de starter, la poignée des gaz. Sortir du repli feuillu où elle se cachait et lui aussi, dérouler la route.
L’esprit se sent sale et contaminé, encore quelques minutes, une trentaine tout au plus, et il pourra se laver de ses actions passées.
Vendredi 5 mars 2010, tôt le matin
C’est un grand carré de béton avec, en ses angles, de larges tourelles où siègent antennes et caméras. Telles des forteresses imprenables, des miradors aux vitres teintées laissent imaginer de quelconques gardiens s’assurer de bien séparer les deux mondes ; celui du dedans et le vrai, par-delà les murs. Et puis, il y a ces fils de fer barbelés où seuls les oiseaux curieux viennent se poser, ces filets anti-intrusions qui relient les bâtiments entre eux. De hautes murailles pour cacher l’intérieur, pour rassurer le monde du dehors et rappeler à ceux qui, le temps passé, sortent avec l’espoir d’un nouveau chapitre de leur vie ou plus simplement d’un entracte dans leur descente au quotidien, qu’ils seront toujours ici chez eux.
Une herbe rase, chahutée par les secousses d’un vent déjà chaud d’un matinal printemps. Un soleil hésitant perce par endroits le rideau blanc des nuages et offre aux arbres à l’entour, bien à distance de la forteresse, des reflets brillants. Enfin, il y a la rosée qui glisse en fines gouttelettes le long des nervures, de haut en bas, de la cime aux branches basses, finissant par s’oublier, se perdre, s’évaporer dans un souffle de vent. Il fait encore frais et l’aube laisse place à l’agitation. Au loin, les bruits de la nationale étouffés par les reliefs des collines et les murs de protection sonore ; là-haut un avion marque sa présence en laissant dans son sillage une traînée de nuages pour qu’on le suive.
Il s’est assis dans un premier temps sur son capot avant, profitant de la chaleur transmise par le moteur. Présent depuis la disparition de la nuit, il se dégourdit maintenant les jambes. La route a été longue jusqu’ici, mais il lui devait bien ça. C’était la moindre des choses.
On entend des sonneries, une alarme probablement, comme celles qui réglementent les cours d’école, à heures fixes : l’heure de la récré, celles du retour en classe, à l’atelier, celles des visites. Des cris s’élèvent de l’enceinte, indistincts, de joies ou de révoltes étouffées. Le soleil peine à illuminer la cour, les murs intérieurs. La lumière glisse de la toiture vers les étages supérieurs, atteint les premiers encadrements, les barreaux. Il faudra encore un bon moment pour qu’enfin, il s’insinue dans l’espace clos, qu’il calme dans ces premières heures les détenus, avant d’en chauffer l’esprit de certains, abrutis par un temps qui ne s’écoule pas.
C’est un carré de macadam délimité à la latte, cerclé de bordures usées et effritées faites d’un béton grossier, séparé en de multiples rectangles égaux ou presque, par grappes, où siègent quelques voitures laissées là par une famille venue pour ne pas l’abandonner en ces murs. Plus tôt, deux ou trois fourgonnettes vertes aux gyrophares bleus se sont présentées devant la lourde porte de métal. Un bruit de moteur ronronnant, l’ouverture enfin et l’accès à un sas où s’entasseront les jugés du jour, en route pour une quelconque salle d’audience. Ils seront tous encagés pour le voyage et sujets de la loi de l’hermine pour la journée. L’homme sur le parking sait que certains pleureront ce soir au retour ; il en a tellement vu. Alors, il ne jette qu’un œil vers les reflets des gyrophares et préfère se concentrer sur le ciel.
Des corbeaux croassent à la verticale de son véhicule. Il s’est rassis sur le capot avec, à ses côtés, un sac en papier d’où il sort un croissant encore tiède. Il est venu tôt, pour ne pas le rater, pour ne pas le faire attendre, s’est arrêté en chemin pour prendre un déjeuner. Devant le présentoir, il s’est posé la question s’il en mangerait ou pas, puis s’est laissé tenter par les viennoiseries. Il s’est demandé s’il se souviendrait de lui, car il n’est jamais venu le voir en prison ; seule sa sœur lui rendait visite, et au début, son avocat. Une fois la peine prononcée et la sentence en cours, il n’est réapparu que pour plaider sans succès une libération conditionnelle. Trente années, pas une de moins.
Il réajuste ses lunettes et lisse d’une main un peu graisseuse ses cheveux vers l’arrière, cachant de fait une calvitie naissante. S’en rendant compte, il jure un peu de sa maladresse, en rigole aussi, car la première impression est souvent celle dont on se souvient, se frotte les paumes, les fait rosir par la chaleur diffusée. Il se résigne à descendre de son capot pour aller à la recherche d’une serviette ou d’un mouchoir dans le vide-poche. Sa voiture, c’est une vieille américaine, une Buick, d’où son surnom à l’époque, qui l’a d’ailleurs suivi jusqu’à maintenant. Elle est bleu ciel, chromée, l’intérieur en cuir beige, usé aux coutures, mais reste, avec le temps, toujours en bon état. Il y tient. Cette voiture, c’est une histoire de famille.
Penché vers la boîte à gants en quête de son mouchoir, il entend le grincement d’une porte au loin, accélère ses gestes ; un pressentiment, une nervosité le gagne. Dans son empressement, en voulant se relever trop vite, sa tête heurte l’encadrement métallique de la vitre latérale. Il grimace du choc, s’en veut. Le mouchoir est tellement torturé entre ses doigts qu’il finit par se déchirer. Il s’éclaircit la voix, réajuste ses lunettes du pouce et du majeur de sa main droite, il plisse les yeux comme pour faire une mise au point afin de s’assurer de l’origine du bruit. Il cherche la confirmation de ce que son cerveau a imaginé ; le retour à la liberté de son ami. Saisir ses premiers moments, le saluer au plus vite pour qu’il ne se sente pas trop perdu. Il cherche, le voit, lève sa main d’une manière un peu maladroite, comme pour s’excuser ou ne pas déranger et, dans un déhanchement du corps, referme la lourde portière de sa voiture.
L’autre est là, un bras le long du corps où pend une petite valise. Il a maigri même si l’ombre dans laquelle il se trouve encore ne permet pas de le voir correctement. Il cherche aussi, les yeux vagues vers ce que lui offre le paysage. Enfin se croisent leurs regards, se devinent dans un premier temps avant de se retrouver. Il a effectivement maigri, grisonné aussi. Ils s’avancent l’un vers l’autre d’un pas assuré, sans courir, puis finissent par se faire face. Quelques secondes de silence où les yeux se fixent, un sourire naît, et puis c’est l’accolade, longue, une respiration forte qui se perd sur l’épaule de l’autre, des paupières closes qu’écrasent les débuts de larmes. Ils s’écartent tout en gardant le contact des mains. Saisir l’instant pour comprendre qu’il est bien réel.
— Chiale pas, Buick ! C’est que moi.
— T’es toujours aussi con, Patrick, malgré les années.
— T’as pas trop changé. T’as toujours la même gueule d’ange…
— … et c’est toi qui dis ça ! Je te rappelle qu’à l’époque, c’est toi qui enchaînais les conquêtes dans ma bagnole, au grand déplaisir de ta sœur et de ta famille.
— Au fait, elle est là ? Avec toi ?
Buick nie de la tête, glisse sur le côté pour prendre la valise qu’un mouvement avait fait tomber au sol.
— Saskia nous attend à Stavelot, à la librairie. Elle te prépare ta chambre.
Une légère poussée d’une main amicale le fait se diriger vers la voiture. Patrick, lui, a le regard usé quand les rayons du soleil daignent enfin le couvrir.
— Tu l’as toujours conservée… C’est toujours celle de tes parents ?
L’autre approuve et sourit, signe d’une certaine fierté, indique en quelques mots hachés qu’à la mort de ceux-ci, il a gardé le véhicule, l’a restauré.
— Cette bagnole, c’est un peu l’histoire de la famille, conclut-il.
Patrick sourit, se dit : « Rien n’a changé », toujours la même histoire entendue des dizaines de fois qui résonne aujourd’hui comme si la parenthèse venait de se refermer. La vie reprend son cours.
Buick laisse Patrick admirer l’intérieur de l’antiquité pendant qu’il place la valise dans le coffre. Une main glisse sur le tableau de bord à la recherche d’un souvenir. Un claquement de portière, un second dans la foulée et tous deux sont à nouveau assis comme de très nombreuses fois auparavant… Il y a plus de vingt ans. Le silence, le tintement de la clé avec le décapsuleur auquel elle est accrochée. Un mouvement de rotation, un contact, une musique de blues s’invite dans la conversation en concurrence avec le ralenti du moteur.
— Merci, André ! C’est sympa d’être venu me reprendre, lâche l’un.
Un geste pour contrer le frein à main un peu dur et le pied qui enfonce doucement l’accélérateur. Un regard pour sortir du parking, un autre vers son passager.
— De rien ! C’est avec plaisir. Y a à bouffer dans le sachet en papier. Je me suis dit que fallait que tu te refasses au plus tôt avec la nourriture du monde extérieur. Et puis, c’est toujours Buick. André, c’est pour les étrangers.
Un échange de sourires et la voiture, un peu poussive, s’aventure sur la route, prend de la vitesse, s’échappe de l’enceinte et des tourelles, file vers les bois, là-bas au loin, chez eux.
Avant l’aube du vendredi 5 mars