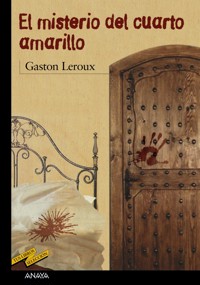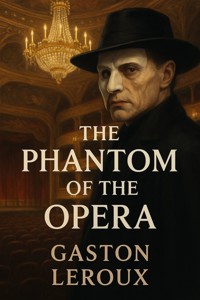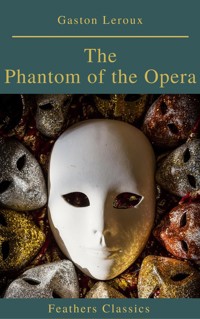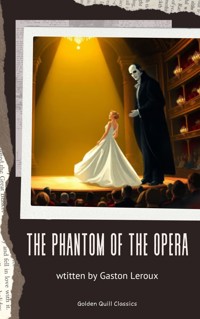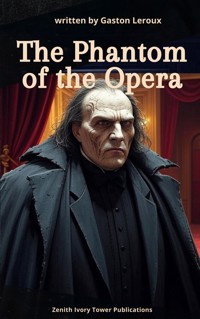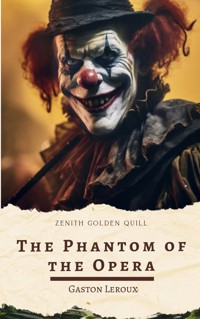Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
"Rouletabille chez le Tsar est un roman captivant écrit par Gaston Leroux, l'auteur renommé du célèbre personnage de Rouletabille. Plongez dans une aventure palpitante qui vous transporte dans la Russie impériale du Tsar Nicolas II.
L'histoire débute lorsque Rouletabille, jeune journaliste intrépide et brillant détective, est envoyé en mission secrète à Saint-Pétersbourg. Accompagné de son fidèle ami Sainclair, il se retrouve plongé au cœur d'une conspiration politique qui menace la stabilité du pays.
Entre complots, trahisons et mystères, Rouletabille devra user de toute son intelligence et de son sens de la déduction pour démêler les fils de cette intrigue complexe. Au fil des pages, le lecteur est entraîné dans un tourbillon d'événements haletants, où chaque rebondissement révèle de nouveaux indices.
Leroux nous offre une plongée fascinante dans la Russie du début du XXe siècle, avec ses palais somptueux, ses rues animées et ses personnages hauts en couleur. L'auteur nous dépeint avec talent l'atmosphère de l'époque, mêlant habilement réalité historique et fiction.
Rouletabille chez le Tsar est un roman captivant qui ravira les amateurs de mystère et d'aventure. Avec son héros charismatique et son intrigue palpitante, ce livre est un véritable page-turner qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière ligne. Plongez dans l'univers captivant de Gaston Leroux et laissez-vous emporter par cette incroyable épopée au cœur de la Russie impériale.
Extrait : ""– Barinia, le jeune étranger est arrivé. – Où l'as-tu mis ? – Oh ! il est resté dans la loge. – Je t'avais dit de le conduire dans le petit salon de Natacha : tu ne m'as donc pas compris, Ermolaï ? – Excusez-moi, barinia, mais le jeune étranger, lorsque j'ai voulu le fouiller, m'a envoyé un solide coup de pied dans le ventre."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335008692
©Ligaran 2015
– Barinia, le jeune étranger est arrivé.
– Où l’as-tu mis ?
– Oh ! il est resté dans la loge.
– Je t’avais dit de le conduire dans le petit salon de Natacha : tu ne m’as donc pas compris, Ermolaï ?
– Excusez-moi, barinia, mais le jeune étranger, lorsque j’ai voulu le fouiller, m’a envoyé un solide coup de pied dans le ventre.
– Lui as-tu dit que tout le monde était fouillé avant d’entrer dans la propriété, que c’était l’ordre, et que ma mère elle-même s’y soumettait ?
– Je lui ai dit tout cela, barinia, et je lui ai parlé de la mère de Madame.
– Qu’est-ce qu’il t’a répondu ?
– Qu’il n’était pas la mère de Madame. Il était comme enragé.
– Eh bien, fais-le entrer sans le fouiller.
– Le pristaff ne sera pas content.
– Je commande.
Ermolaï s’inclina et descendit dans le jardin. La barinia quitta la véranda où elle venait d’avoir cette conversation avec le vieil intendant du Général Trébassof, son mari, et rentra dans la salle à manger de sa datcha des îles où le joyeux Conseiller d’Empire Ivan Pétrovitch racontait aux convives amusés sa dernière farce de chez Cubat. Il y avait là bruyante compagnie et le moins gai n’était pas le Général qui allongeait sur un fauteuil une jambe dont il n’avait pas encore la libre disposition depuis l’avant-dernier attentat si fatal à son vieux cocher et à ses deux chevaux pie. La bonne farce du toujours aimable Ivan Pétrovitch (un remuant petit vieillard au crâne nu comme un œuf) datait de la veille. Après s’être comme il disait « récuré la bouche » (car ces messieurs n’ignorent rien de notre belle langue française qu’ils parlent comme la leur, et dont ils usent volontiers entre eux pour n’être point compris des domestiques), après s’être récuré la bouche d’un grand verre de « mousseux, pétillant vin de France », il s’esclaffait :
– On a bien ri, Féodor Féodorovitch : on avait fait chanter les chœurs, à la barque, et puis, les bohémiennes parties avec leur musique, on était descendu sur la rive pour se dégourdir les jambes et se nettoyer le visage dans le frais petit jour, quand une sotnia de cosaques de la garde vint à passer. Je connaissais l’officier qui la commandait et je l’invitai à venir trinquer à la santé de l’Empereur chez Cubat. Cet officier est un homme, Féodor Féodorovitch, qui connaît bien les marques depuis sa plus tendre enfance et qui peut se vanter de n’avoir jamais avalé un verre de vin de Crimée. Au seul nom de champagne, il crie : « Vive l’Empereur ! » Un vrai patriote. Il a accepté. Et nous voilà partis, gais comme des enfants au cœur léger qui se rappellent des histoires de l’école. Toute la sotnia suivait, puis toute la bande des soupeurs qui jouaient du mirliton et les isvotchiks par-derrière, à la file : une vraie sainte procession ! Devant Cubat, j’ai honte de laisser les compagnons officiers de mon ami à la porte. Je les invite. Ils acceptent naturellement.
Mais les sous-officiers avaient soif. Je connais la discipline. Tu sais, Féodor Féodorovitch, que j’ai toujours été pour la discipline. Ce n’est pas parce qu’on est gai, un matin de printemps, qu’il faut oublier la discipline. J’ai fait boire les officiers en cabinet particulier et les sous-officiers dans la grande salle du restaurant. Quant aux soldats, qui avaient soif, eux aussi, je les ai fait boire dans la cour. Ainsi, ma parole, il n’y avait pas de fâcheux mélange. Mais voilà que les chevaux hennissaient.
C’étaient de braves chevaux, Féodor Féodorovitch, qui, eux aussi, voulaient boire à la santé de l’Empereur. J’étais bien embarrassé à cause de la discipline. La salle, la cour, tout était plein ! Et je ne pouvais faire monter les chevaux en cabinet particulier ! Tout de même, je leur fis porter du champagne dans des seaux et c’est alors qu’a eu lieu ce fâcheux mélange que je tenais tant à éviter ; un grand mélange de bottes et de sabots de cheval qui était bien la chose la plus gaie que j’aie jamais vue de ma vie. Mais les chevaux étaient bien les plus joyeux et dansaient comme si on leur avait mis une torche sous le ventre et tous, ma parole, étaient prêts à casser la figure de leurs cavaliers, pour peu que les hommes ne fussent pas du même avis qu’eux sur la route à suivre. À la fenêtre du cabinet particulier, nous mourions de plaisir de voir une pareille salade de bottes et de sabots dansants. Mais les cavaliers ont ramené tous leurs chevaux à la caserne, avec de la patience, parce que les cavaliers de l’Empereur sont les premiers cavaliers du monde, Féodor Féodorovitch ! Et nous avons bien ri ! À votre santé, Matrena Pétrovna.
Ces dernières gracieuses paroles s’adressaient à la Générale Trébassof elle-même, qui haussait les épaules aux propos insolites du gai Conseiller d’Empire. Elle n’intervint dans la conversation que pour calmer le Général qui voulait faire coller toute la sotnia au cachot, hommes et chevaux. Et, pendant que les convives riaient de l’aventure, elle dit à son mari, de sa voix décidée de maîtresse femme :
– Féodor, tu ne vas pas attacher d’importance à ce que raconte notre vieux fou d’Ivan. C’est l’homme le plus imaginatif de la capitale, accompagné de champagne.
– Ivan !… tu n’as pas fait servir aux chevaux du champagne dans les seaux ! Vieux vantard, protesta, jaloux, Athanase Georgevitch, l’avocat bien connu pour son solide coup de fourchette, et qui prétendait posséder les meilleures histoires à boire et qui regrettait de n’avoir pas inventé celle-là.
– Ma parole ! et de première marque ! J’avais gagné quatre mille roubles au cercle des marchands. Je suis sorti de cette petite fête avec cinquante kopecks.
Mais, à l’oreille de Matrena Pétrovna s’est penché Ermolaï, le fidèle intendant de campagne qui ne quitte jamais, même à la ville, son habit nankin beurre frais, sa ceinture de cuir noir et ses larges pantalons bleus et ses bottes brillantes comme des glaces (comme il sied à un intendant de campagne qui est reçu chez son maître, à la ville). La Générale se lève, après un léger coup de tête amical à sa belle-fille, Natacha, qui la suit des yeux jusqu’à la porte, indifférente en apparence aux propos tendres de l’officier d’ordonnance de son père, le soldat poète Boris Mourazoff, qui a fait de si beaux vers sur la mort des étudiants de Moscou, après les avoir fusillés, par discipline, sur leurs barricades.
Ermolaï a conduit sa maîtresse dans le grand salon et là il lui montre une porte qu’il a laissée entrouverte et qui donne sur le petit salon précédant la chambre de Natacha…
– Il est là ! fait Ermolaï à voix basse.
Ermolaï, au besoin, aurait pu se taire, car la Générale eût été renseignée sur la présence d’un étranger dans le petit salon par l’attitude d’un individu au paletot marron, bordé de faux astrakan comme on voit à tous les paletots de la police russe (ce qui fait reconnaître les agents secrets à première vue). L’homme de la police était à quatre pattes dans le grand salon et regardait ce qui se passait dans le petit salon par l’étroit espace de lumière qui se présentait entre la porte entrouverte et le mur, près des gonds. De cette manière ou d’une autre, tout personnage qui voulait approcher du Général Trébassof était ainsi mis en observation, sans qu’il s’en doutât, après avoir été fouillé, tout d’abord, dans la loge (mesure qui ne datait que du dernier attentat).
La Générale frappa sur l’épaule de l’homme à genoux, avec cette main héroïque qui avait sauvé la vie de son mari et qui portait encore des traces de l’affreuse explosion (dernier attentat, où Matrena Pétrovna avait saisi à pleine main la boîte infernale destinée à faire sauter le Général).
L’individu se releva et, à pas feutrés, s’éloigna, gagna la véranda où il s’allongea sur un canapé, simulant immédiatement un pesant sommeil, mais surveillant en réalité les abords du jardin.
Et ce fut Matrena Pétrovna qui prit sa place à la fente de la porte et qui observa ce qui se passait dans le petit salon. Du reste, ceci n’était point exceptionnel. C’était elle qui avait le dernier coup d’œil sur tout et sur tous. Elle rôdait, à toute heure du jour et de la nuit, autour du Général, comme une chienne de garde, prête à mordre, à se jeter au-devant du danger, à recevoir les coups, à mourir pour son maître. Cela avait commencé à Moscou après la terrible répression, les massacres de révolutionnaires sous les murs de Presnia, quand les nihilistes survivants avaient laissé derrière eux une affiche condamnant à mort le Général Trébassof victorieux. Matréna Pétrovna ne vivait que pour le Général. Elle avait déclaré qu’elle ne lui survivrait point. Elle avait deux fois raison de le garder. – mais elle n’avait plus confiance…
Il s’était passé chez elle des choses qui avaient dérouté sa garde, son flair, son amour… elle n’avait parlé de ces choses-là qu’au grand maître de la police, Koupriane, qui en avait parlé à l’Empereur…
Et voilà que l’Empereur lui envoyait, comme suprême ressource, ce jeune étranger… Joseph Rouletabille, reporter…
– mais c’était un gamin ! Elle considérait, sans comprendre, cette bonne jeune tête ronde, aux yeux clairs et – dès le premier abord – extraordinairement naïfs, des yeux d’enfant (il est vrai que, dans le moment, le regard de Rouletabille ne semble point d’une profondeur de pensée surhumaine car, laissé en face de la table des zakouski dressée dans le petit salon, le jeune homme paraît uniquement occupé à dévorer, à la cuiller, ce qui reste de caviar dans les pots). Matrena remarquait la fraîcheur rose des joues, l’absence de duvet au menton, pas un poil de barbe… la chevelure rebelle avec des volutes sur le front… ah ! le front… le front, par exemple, était curieux. Oui, c’était, ma foi, un curieux front, avec des bosses qui roulaient au-dessus de l’arcade sourcilière, profonde, pendant que la bouche s’occupait… s’occupait… on eût dit que Rouletabille n’avait pas mangé depuis huit jours.
Maintenant, il faisait disparaître une magnifique tranche de sterlet de la Volga, tout en contemplant avec sympathie une salade de concombres à la crème, quand Matrena Pétrovna parut.
Il voulut s’excuser tout de suite et parla la bouche pleine :
– Je vous demande pardon, Madame, mais le Tsar a oublié de m’inviter à déjeuner.
La Générale sourit et lui donna une solide poignée de main en le priant de s’asseoir :
– Vous avez vu Sa Majesté ?
– J’en sors, Madame. C’est à la Générale Trébassof que j’ai l’honneur de parler ?
– Elle-même. Et c’est à Monsieur ?
– Joseph Rouletabille lui-même, Madame, je n’ajoute pas : pour vous servir, car je n’en sais rien encore. C’est ce que je disais, tout à l’heure, à Sa Majesté : vos histoires de nihilistes, moi, ça ne me regarde pas, n’est-ce pas ?…
– Alors ? interrogea la Générale, assez amusée du ton que prenait la conversation et de l’air un peu ahuri de Rouletabille.
– Alors, voilà ! moi, j’suis reporter, s’pas ? C’est ce que j’ai d’abord dit à mon directeur à Paris… j’ai pas à prendre parti dans des affaires de révolution qui ne regardent pas ma patrie. À quoi mon directeur m’a répondu : « il ne s’agit pas de prendre parti. Il s’agit d’aller en Russie faire une enquête sur la situation des partis. Vous commencerez par interviewer l’Empereur. » Je lui ai dit : « comme ça, ça va ! » et j’ai pris le train.
– Et vous avez interviewé l’Empereur ?
– Oui, ça n’a pas été difficile. Je comptais arriver directement à Pétersbourg, expliqua-t-il ; mais, après Gatchina, le train s’arrêta et le grand Maréchal de la Cour vint à moi et me pria de le suivre. C’était rien flatteur ! Vingt minutes plus tard, j’étais à Tsarskoïe-Selo, devant Sa Majesté…
Elle m’attendait ; j’ai bien compris tout de suite que c’était évidemment pour une affaire qui n’était pas ordinaire…
– Et que vous a-t-elle dit, Sa Majesté ?
– C’est un bien brave homme de Majesté. Il m’a rassuré tout de suite quand je lui eus fait part de mes scrupules. Il m’a dit qu’il ne s’agissait pas de faire de la politique, mais de sauver son plus fidèle serviteur, qui était sur le point d’être victime du plus étrange drame de famille qui se pût concevoir…
La Générale s’était levée, toute pâle.
– Ah ! fit-elle, simplement…
Et Rouletabille, à qui rien n’échappait, vit sa main trembler sur le dossier de sa chaise.
Il continua, n’ayant point l’air de prendre garde à l’émotion de la Générale :
– Sa Majesté a ajouté textuellement : « c’est moi qui vous le demande, moi et la Générale Trébassof. Allez, Monsieur, elle vous attend !… »
Alors, Rouletabille se tut, attendant que la Générale parlât à son tour. Elle s’y décida, après une courte réflexion.
– Vous avez vu Koupriane ? demanda-t-elle.
– Le grand maître de la police ? Oui… le grand Maréchal m’avait réaccompagné à la gare de Tsarskoïe-Selo ; le grand maître de la police m’attendait à celle de Pétersbourg. On n’est pas mieux reçu !
– Monsieur Rouletabille, fit Matrena qui s’efforçait visiblement de reconquérir tout son sang-froid, je ne suis pas de l’avis de Koupriane et… je ne suis pas (ici elle baissa la voix qui tremblait) de l’avis de Sa Majesté !… j’aime mieux vous avertir tout de suite… pour que vous n’ayez pas à regretter d’intervenir dans une affaire où il y a… des risques… des risques terribles à courir… non ! il n’y a pas ici de drame de famille… la famille ici est toute petite, toute petite… le Général, sa fille, Natacha, qu’il a eue d’un premier mariage, et moi… il ne peut pas y avoir de drame de famille entre nous trois… il y a tout simplement mon mari, Monsieur, qui a fait son devoir de soldat en défendant le trône de Sa Majesté… mon mari que l’on veut m’assassiner… il n’y a pas autre chose… pas autre chose, mon cher petit hôte…
Et, pour cacher sa détresse, elle se prit à découper une belle tranche de veau aux carottes dans sa gelée.
– Vous n’avez pas mangé, vous avez faim, c’est abominable, mon cher petit Monsieur… voyez-vous, vous allez dîner avec nous et puis… vous nous direz adieu… oui… vous me laisserez toute seule… j’essaierai de le sauver toute seule… bien sûr… j’essaierai…
Et une larme coula dans le veau aux carottes.
Rouletabille, qui sentait que l’émotion de cette brave femme le gagnait, se raidissait pour n’en laisser rien paraître…
– Je pourrais tout de même bien vous aider un peu, fit-il… M. Koupriane m’a dit qu’il y avait un véritable mystère… c’est mon métier à moi de démêler les mystères…
– Je sais ce que pense Koupriane, dit-elle, en secouant la tête. Mais, si je devais penser un jour, moi, ce que pense Koupriane, j’aimerais mieux être morte !
Et la bonne Matrena Pétrovna leva vers Rouletabille ses beaux grands yeux tout brillants des larmes qu’elle retenait… et elle ajouta tout de suite :
– Mais mangez donc, mon cher petit hôte, mangez donc !… mon cher enfant, il faudra oublier tout ce que vous a dit Koupriane… quand vous serez retourné dans la belle France…
– Je vous le promets, Madame…
– C’est l’Empereur qui vous a fait faire ce grand voyage… moi, je ne voulais pas… il a donc bien confiance en vous ? demanda-t-elle naïvement, en le fixant avec une grande attention à travers ses larmes.
– Madame, je vais vous dire. J’ai quelques bonnes affaires à mon actif, sur lesquelles on lui a fait des rapports, et puis on lui permet de lire quelquefois les journaux, à votre Empereur. Il avait entendu parler surtout (car on en a parlé dans le monde entier, Madame) du mystère de la chambre jaune et du parfum de la dame en noir –
Ici, Rouletabille regarda en-dessous la Générale et conçut une grande mortification de ce que celle-ci exprimât, à ne s’y point tromper, sur sa bonne franche physionomie, l’ignorance absolue où elle était de ce mystère jaune et de ce parfum noir.
– Mon petit ami, dit-elle, d’une voix de plus en plus voilée, vous m’excuserez, mais il y a longtemps que je n’ai plus d’yeux pour lire…
Et les larmes, maintenant, le long du visage, coulaient… coulaient…
Rouletabille n’y tint plus. Il se rappela, d’un coup, tout ce que cette héroïque femme avait souffert dans ce combat atroce de chaque jour contre la mort qui rôde. Il prit en frémissant ses petites mains grasses aux doigts trop chargés de bagues :
– Madame ! ne pleurez plus ! On veut vous tuer votre mari. Eh bien, nous serons au moins deux à le défendre, je vous le jure !…
– Même contre les nihilistes ?
– Eh ! Madame, contre tout le monde !… j’ai mangé tout votre caviar : je suis votre hôte !… je suis votre ami !…
Disant cela, il était tout vibrant, tout sincère et si drôle que la Générale ne put s’empêcher de sourire au milieu de ses larmes. Elle le fit se rasseoir tout près d’elle.
– Le grand maître de la police m’a beaucoup parlé de vous. Et c’est venu tout d’un coup, par hasard, après le dernier attentat et une chose mystérieuse que je vous dirai. Il s’est écrié : « Ah ! il nous faudrait un Rouletabille pour débrouiller cela !… » le lendemain, il revenait ici. Il était allé à la Cour. Là-bas, on s’était, paraît-il, beaucoup occupé de vous. L’Empereur désirait vous connaître… voilà comment les choses se sont faites par l’entremise de l’Ambassade, à Paris…
– Oui, oui… et naturellement, tout le monde l’a su… c’est gai !… les nihilistes m’ont averti aussitôt que je n’arriverais pas en Russie vivant. C’est, du reste, ce qui m’a décidé à y venir. Je suis d’un naturel très contrariant.
– Et comment s’est passé le voyage ?
– Mais, pas mal… merci !… j’ai déniché tout de suite, dans le train, le jeune slave qui était chargé de ma mort et je me suis entendu avec lui… c’est un charmant garçon : ça s’est très bien arrangé.
Rouletabille mangeait maintenant des plats étranges auxquels il lui eût été difficile de donner un nom. Matrena Pétrovna lui posa sa grasse petite main sur le bras :
– Vous parlez sérieusement ?
– Très sérieusement.
– Un petit verre de vodka ?
– Jamais d’alcool.
La Générale vida le petit verre d’un trait :
– Et comment l’avez-vous découvert ? Comment avez-vous su ?
– D’abord, il avait des lunettes. Tous les nihilistes ont des lunettes en voyage. Et puis, j’ai eu un bon truc. Une minute avant le départ de Paris j’ai fait monter un de mes amis dans le couloir du sleeping, un reporter qui fait tout ce que je veux, sans demander d’explications jamais, le père La Candeur. Je lui ai dit : « père La Candeur, tu vas crier, tout à coup, très fort : "Tiens ! voilà Rouletabille !" La Candeur cria donc : "Tiens, voilà Rouletabille !" Et aussitôt tous ceux qui étaient dans le couloir se retournèrent et tous ceux qui étaient déjà dans les compartiments en sortirent, excepté l’homme aux lunettes. J’étais fixé.
La Générale regarda Rouletabille, qui était maintenant rouge comme une crête de coq et assez embarrassé de sa fatuité.
– Ça mérite peut-être des gifles, ce que je dis là, Madame ; mais, du moment que l’Empereur de toutes les Russies avait le désir de me connaître, je ne pouvais pas admettre qu’un quelconque monsieur à lunettes n’eût point la curiosité de voir comment j’avais le nez fait. Ça n’était pas naturel. Aussitôt le train en marche, je suis allé m’asseoir auprès de ce monsieur et je lui ai fait part de ces réflexions. J’étais tombé juste. Le voyageur enleva ses lunettes et, me fixant bien dans les yeux, m’avoua qu’il était heureux d’avoir avec moi une petite conversation avant qu’il ne me fût rien arrivé de fâcheux. Une demi-heure plus tard, l’entente cordiale était signée. Je lui avais fait comprendre que j’allais là-bas pour faire mon métier de reporter et qu’il serait toujours temps de se fâcher si je n’étais pas sage. À la frontière allemande, il me laissa continuer ma route et retourna tranquillement à sa nitroglycérine.
– Vous voilà « visé », vous aussi, mon pauvre enfant !…
– Oh ! ils ne nous ont pas encore !…
Matrena Pétrovna toussa. Ce « nous » venait de lui chavirer le cœur. Avec quelle tranquillité cet enfant, qu’elle ne connaissait pas une heure auparavant, se proposait de partager les dangers d’une situation qui excitait généralement la pitié, mais dont les plus braves s’écartaient avec autant de prudence que d’effroi.
– Ah ! mon petit ami… un peu de ce magnifique bœuf fumé de Hambourg ? Vous m’en direz des nouvelles, arrosé d’anisette…
Mais le jeune homme faisait déjà mousser dans son verre le blond pivô frais :
– Là, fit-il. Maintenant, Madame, je vous écoute. Racontez-moi d’abord le premier attentat.
– Maintenant, dit Matrena, nous allons aller dîner…
Rouletabille ouvrait les yeux.
– Mais, Madame, qu’est-ce que je viens donc de faire !
La Générale sourit. Tous ces étrangers étaient les mêmes. Parce qu’ils avaient mangé quelques hors-d’œuvre, quelques zakouski, ils s’imaginaient que l’hôte allait les laisser tranquilles. Ils ne savaient pas manger.
– Nous allons passer dans la salle. Le Général vous attend. On est à table.
– À ce qu’il paraît que je suis censé le connaître ?
– Oui, vous vous êtes déjà rencontrés à Paris. C’est tout naturel que, de passage à Pétersbourg, vous lui fassiez donc une visite. Vous le connaissez même très bien, assez pour qu’il vous offre la bonne hospitalité complète. Ah ! écoutez ! Ma belle-fille aussi !… oui, Natacha croit que son père vous connaît, ajouta-t-elle, en rougissant.
Elle poussa la porte du grand salon, qu’il fallait traverser pour aller à la salle à manger.
De l’endroit où il se trouvait, Rouletabille pouvait apercevoir tous les coins du grand salon, la véranda, le jardin et la loge d’entrée, près de la grille. Dans la véranda, l’homme au paletot marron bordé de faux astrakan semblait continuer son somme sur le canapé ; dans un des coins du salon, un autre individu, silencieux et immobile comme une statue, mais habillé également d’un paletot marron et de faux astrakan, debout, les mains derrière le dos, semblait frappé de paralysie au spectacle d’une aquarelle toute flamboyante d’un coucher de soleil qui allumait comme une torche la flèche d’or des saints-Pierre-et-Paul.
Enfin, dans le jardin et devant la loge, trois autres pardessus marron erraient comme des âmes en peine autour des pelouses ou devant la porte d’entrée. Rouletabille retint d’un geste la Générale, rentra dans le petit salon et referma la porte.
– Police ? demanda-t-il.
Matrena Pétrovna fit un signe de tête avec un mouvement de l’index qui fermait sa petite bouche naïve, comme on a coutume de faire, avec le doigt et la bouche, pour recommander le silence. Rouletabille sourit.
– Combien sont-ils ?
– Dix, relevés toutes les six heures.
– Cela vous fait quarante inconnus chez vous, par jour.
– Pas inconnus, reprit-elle… police !…
– Et malgré cela, vous avez eu le coup du bouquet dans la chambre du Général ?
– Non !… ils n’étaient que trois, alors… c’est depuis le coup du bouquet qu’ils sont dix.
– N’importe… c’est depuis ces dix-là que vous avez eu…
– Quoi ? demanda-t-elle, anxieuse…
– Vous savez bien… le plancher –
– Taisez-vous ! ordonna-t-elle encore.
Et elle alla jeter un coup d’œil à la porte, considérant avec attention le policier-statue devant son coucher de soleil… elle dit :
– Personne ne sait… pas même mon mari…
– C’est ce que m’a dit M. Koupriane… Alors, c’est lui qui vous a octroyé ces dix agents-là…
– Certainement !
– Eh bien, vous allez commencer par me mettre toute cette police à la porte…
Matrena Pétrovna lui prit la main, effarée.
– Vous n’y pensez donc pas ?
– Si ! il faut savoir d’où vient le coup ! Vous avez ici quatre sortes de gens : la police, les domestiques, les amis, la famille. Éloignons d’abord la police. Qu’elle n’ait pas le droit de franchir votre seuil. Elle n’a pas su vous garantir. Vous n’avez rien à regretter. Et si, elle absente, aucun nouveau fait redoutable ne se produit, nous pourrons laisser à M. Koupriane le soin de continuer l’enquête, sans se déranger, chez lui…
– Mais vous ne connaissez pas l’admirable police de Koupriane. Ces braves gens ont fait preuve d’un dévouement…
– Madame, si j’étais en face d’un nihiliste, la première chose que je me demanderais serait celle-ci : est-il de la police ? La première chose que je me demande en face d’un agent de votre police : n’est-il point nihiliste ?…
– Mais ils ne voudront point partir !…
– L’un d’eux parle-t-il français ?
– Oui, leur chef, celui qui est debout, là, dans le salon.
– Appelez-le, je vous prie.
La Générale s’avança dans le salon et fit un signe.
L’homme parut. Rouletabille lui tendit un papier que l’autre lut.
– Vous allez rassembler vos hommes et quitter la villa, ordonna Rouletabille. Vous vous rendrez à la police. Vous direz à M. Koupriane que ceci a été commandé par moi et que j’exige que tout le service de police de la villa soit suspendu… jusqu’à nouvel ordre.
L’homme s’inclina, parut ne pas comprendre, regarda la Générale et dit au jeune homme :
– À vos ordres !…
Il sortit.
– Attendez-moi une seconde ici, pria la Générale qui ne savait quelle contenance tenir, et dont l’inquiétude faisait réellement peine à voir.
Et elle disparut derrière l’homme au faux astrakan.
Quelques instants après, elle revenait. Elle paraissait encore plus agitée.
– Je vous demande pardon, murmura-t-elle, mais je ne pouvais les laisser partir ainsi. Ils en avaient, du reste, une très grosse peine. Ils m’ont demandé s’ils avaient démérité, s’ils avaient manqué à leur service. Je les ai calmés avec le natchaï.
– Oui, et dites-moi toute la vérité, Madame. Vous leur avez demandé de ne point trop s’éloigner, de rester aux alentours de la villa, de la surveiller d’aussi près que possible.
– C’est vrai, avoua la Générale, en rougissant. Mais ils sont partis quand même. Ils doivent vous obéir. Quel est donc ce papier que vous avez montré ?…
Rouletabille sortit à nouveau son billet tout couvert de cachets, de signes, de lettres cabalistiques, auquel il ne comprenait goutte. La Générale traduisit, tout haut : « Ordre à tous les agents en surveillance à la villa Trébassof d’obéir absolument au porteur. Signé : Koupriane. »
– Possible ! murmura Matrena Pétrovna, mais jamais Koupriane ne vous eût donné ce papier s’il avait pu imaginer que vous vous en serviriez pour chasser ses agents.
– Évidemment ! je ne lui ai point demandé son avis, Madame, veuillez le croire… mais je le verrai demain et il me comprendra…
– En attendant, qui va le veiller ? s’écria-t-elle.
Rouletabille lui prit encore les mains. Il la voyait souffrir, en proie à une angoisse presque maladive. Il avait pitié d’elle. Il eût voulu lui donner confiance, tout de suite.
– Nous ! dit-il.
Elle vit ces bons yeux si clairs, si profonds, si intelligents, cette bonne petite tête solide, ce front de volonté, toute cette jeunesse ardente qui se donnait à elle, pour la rassurer.
Rouletabille attendait ce qu’elle allait dire.
Elle ne dit rien. Elle l’embrassa de tout son cœur.
Dans la salle à manger, c’est le tour de Thadée Tchichnikof, de raconter des histoires de chasse.
Ah ! c’est tout à fait le plus gros marchand de bois de l’antique Lituanie, qui possède des forêts immenses et un grand amour pour Féodor Féodorovitch, avec lequel il a joué tout enfant, et qu’il a sauvé de l’ours, qui se préparait à enlever le crâne de ce cher petit camarade comme on enlève un chapeau de dessus une tête, tout simplement. En ce temps-là, le père de Féodor était gouverneur de Courlande, s’il vous plaît, par la grâce de Dieu et du petit père. Thadée, qui avait treize ans tout juste, avait tué l’ours d’un bon coup d’épieu, et il était temps. Une grande amitié était née entre les familles à cause de ce coup d’épieu et, bien que Thadée ne fût ni noble, ni soldat, Féodor le considérait comme son frère et l’aimait comme tel. Maintenant, Thadée est tout à fait le plus gros marchand de bois des provinces occidentales, avec ses forêts à lui, et sa haute stature, et son visage gras, huileux, et son cou de taureau, et sa panse rebondie. Il a tout quitté – toutes ses affaires, toute sa famille – lors du dernier attentat, pour venir serrer dans ses bras son vieux cher Féodor. Ainsi a-t-il fait à chaque attentat, sans en oublier un seul. C’est un ami fidèle. Mais il est désolé qu’on ne sache plus chasser l’ours comme au temps de sa jeunesse. D’abord, est-ce qu’il y a encore des ours en Courlande, et des arbres ? Est-ce qu’il y a encore des arbres – ce qu’on appelle des arbres ? Car il les a connus, lui, les vieux illustres arbres contemporains des grands-ducs de Lituanie, arbres géants qui projetaient leur ombre au loin, jusque sur les créneaux des villes. Où sont-ils ?…
Thadée s’amuse, bien sûr, car c’est lui qui les a coupés, bien tranquillement, pour en faire de la fumée de locomotive. C’est le progrès. Ah ! la chasse perd son caractère national, évidemment, avec les petits arbres qui n’ont pas le loisir de pousser… et c’est à peine si, dans ces jeunes forêts, on a le temps de tuer une paire de bécasses, en « tiaga », c’est-à-dire à l’affût. Or, à cet endroit de la divagation de Thadée, il y eut une grande complication de paroles parmi les convives, à cause qu’il y a la tiaga du matin et la tiaga du soir, et ces messieurs ne pouvaient s’entendre sur la préférence qu’il faut accorder à l’une ou à l’autre.
Le champagne coulait à flots quand Rouletabille, poussé par Matrena Pétrovna, fit son entrée. Le Général, dont les regards, depuis quelques instants, retournaient assidûment à la porte, s’écria, comme il s’y était préparé :
– Ah ! mon cher Rouletabille !… je vous attendais !… on m’avait dit que vous alliez venir à Pétersbourg !
Rouletabille alla lui serrer la main, comme à un ami que l’on retrouve, après une longue absence.
Et le reporter fut présenté comme un vrai jeune ami de Paris avec qui on s’est bien amusé, lors du dernier voyage à la ville lumière. Tous demandèrent des nouvelles de Paris comme d’une chère connaissance.
– Comment va Maxim ? s’inquiéta l’excellent Athanase Georgevitch.
Thadée était allé une fois à Paris et en était revenu avec un souvenir enthousiaste pour les françaises. Il dit, voulant être tout de suite aimable, et appuyant sur chaque mot, et prononçant à la mode tudesque, car il était des provinces occidentales :
– Vos gogottes !… monsieur… Ah ! vos gogottes !… on tirait tes femmes tu monte !
Matrena Pétrovna voulut le faire taire, mais l’autre faisait valoir son excuse et son droit d’apprécier le beau sexe en dehors de chez lui. Il avait une femme bouffie, sentimentale, pleurnicheuse et toujours fourrée chez le pope.
Il fallut que Rouletabille dît ce qu’il pensait de la Russie, mais il n’avait pas encore ouvert la bouche qu’on la lui fermait :
– Permettez !… permettez !… faisait Athanase Georgevitch. Vous autres, de la jeune génération, vous ne pouvez vous rendre compte… il faut avoir vécu longtemps, dans tous les pays, pour apprécier celui-ci à sa juste valeur… la Russie, mon jeune Monsieur, est encore pour vous lettre close…
– Évidemment ! soupirait Rouletabille…
– Eh bien, à votre santé !… ce que je puis vous dire, pour le moment, sans trahir le secret de personne, c’est que c’est une bonne cliente pour ce qui est du champagne, eh ! eh ! continuait l’avocat avec un gros rire. Mais le plus fort buveur que j’aie rencontré était né sur les rives de la Seine, ma parole ! Tu l’as connu, Féodor Féodorovitch ?
C’est ce pauvre Charles Dufour qui est mort, il y a deux ans, à la fête des officiers de la garde. Il avait parié, en fin de banquet, qu’il boirait un verre plein de champagne à la santé de chacun des convives. Ils étaient soixante, en le comptant. Il commença de faire le tour de la table, et l’affaire alla merveilleusement jusqu’au cinquante-huitième verre compris. Mais au cinquante-neuvième, il y eut un grand malheur : le champagne vint à manquer. Ce pauvre, ce charmant, cet excellent Charles, saisit alors le verre de vin doré qui se trouvait dans la coupe du cinquante-neuvième, souhaita longue vie à cet excellent cinquante-neuvième, lui vida son verre, d’un coup, prit le temps de murmurer : « Tokay 1807 ! » et tomba raide mort. Ah ! celui-là aussi connaissait bien les marques, ma parole ! Et il le prouva jusqu’à son dernier soupir. Paix à sa mémoire ! On s’est demandé de quoi il était mort. Pour moi, il est mort du fâcheux mélange, sans aucun doute. Il faut de la discipline en tout et pas de fâcheux mélanges. Un verre de champagne de plus et il trinquerait ce soir avec nous ! À votre bonne santé, Matrena Pétrovna ! Du champagne, Féodor Féodorovitch ! Vive la France, Monsieur !…
Natacha, mon enfant, tu devrais nous chanter quelque chose. Boris t’accompagnerait sur la guzla. Et ton père serait content.
Tous les regards se tournèrent vers Natacha qui s’était levée.
Rouletabille fut frappé de la beauté sereine de la jeune fille. Oui, ce fut tout d’abord la parfaite sérénité de ce visage qui l’étonna, le calme suprême, l’harmonie tranquille de ces nobles traits. Natacha pouvait avoir vingt ans. De lourds cheveux bruns encadraient son front de marbre et venaient s’enrouler aux oreilles qu’ils cachaient.
Son profil était très pur ; sa bouche n’était point petite et découvrait, sous des lèvres un peu fortes et sanglantes, des dents de jeune louve. Elle était d’une taille moyenne. En marchant, elle avait la majesté aimable et frêle des vierges qui ne parviennent point à courber les fleurs sous leurs pas, chez les primitifs. Mais toute sa vraie grâce semblait s’être réfugiée dans ses yeux qui étaient d’un bleu sombre et profond. L’impression que l’on recevait en voyant Natacha était fort complexe. Et l’on n’eût pu dire en vérité si le calme dont elle se plaisait à parer le moindre geste de sa beauté était le résultat d’un effort de sa volonté ou de la plus réelle insouciance.
Elle s’en fut décrocher la guzla et la tendit à Boris qui en tira tout de suite quelques sons plaintifs.
– Que voulez-vous que je vous chante ? demanda-t-elle, en s’appuyant au dossier du fauteuil où était étendu son père, et en portant à ses lèvres la main du Général qu’elle baisa filialement.
– Invente ! dit le Général. Invente en français, à cause de notre hôte…
– Oui, pria Boris, improvisez comme l’autre soir…
Et déjà il faisait entendre sur son instrument une lente mélopée.
Natacha chanta en regardant son père : « Quand le moment sera venu de nous séparer, à la fin du jour, que l’ange du sommeil te couvre de ses ailes azurées… que tes yeux se reposent de tant de pleurs, et que le calme rentre dans ton cœur oppressé… que chaque moment de nos entretiens, ô père chéri ! Laisse vibrer dans ton âme une douce et magique harmonie… et quand ta pensée aura fui vers d’autres mondes, que mon image s’incline sur tes paupières endormies… » Natacha avait une voix d’une grande douceur et son charme était pénétrant. Les paroles qu’elle modulait devaient avoir une signification précise pour l’assistance, car celle-ci manifestait une forte émotion et il y avait des larmes dans les yeux de tout le monde, excepté dans ceux de Michel Korsakof, le second officier d’ordonnance, qui parut à Rouletabille un homme au cœur solide et peu accessible aux doux sentiments :
– Féodor Féodorovitch, dit ce Michel, quand la voix de la jeune fille eut éteint son dernier soupir dans le gémissement de la guzla. Féodor Féodorovitch est un homme, un glorieux soldat qui peut dormir en paix, car il a bien travaillé pour la patrie et pour le Tsar !…
– Oui ! oui ! bien travaillé !… bien travaillé !…
Glorieux soldat ! répétèrent Athanase Georgevitch et Ivan Pétrovitch… il peut dormir en paix !…
– Natacha a chanté comme un ange, émit la voix timide de Boris, le premier officier d’ordonnance.
– Comme un ange, Boris Nikolaïvitch !… mais pourquoi parle-t-elle de cœur oppressé ? Je ne vois pas le Général Trébassof avec un cœur oppressé, moi !… ajouta avec force Michel Korsakof en vidant son verre.
– Nous non plus !… nous non plus ! firent les autres…
– Une jeune fille peut tout de même souhaiter une bonne nuit à son père ! déclara avec un certain bon sens Matrena Pétrovna. Natacha nous a tous émus, n’est-ce pas, Féodor Féodorovitch ?
– Eh ! j’ai pleuré ! avoua le Général. Mais buvons un bon coup de champagne pour nous remettre. Nous allons passer pour des poules mouillées auprès de mon jeune ami.
– Ne croyez pas cela ! dit Rouletabille. Mademoiselle m’a profondément touché, moi aussi. C’est une artiste, une grande artiste. Et un grand poète, ajouta-t-il.
– Il est de Paris ! il s’y connaît ! firent les autres.
Et l’on but.
Alors, ils parlèrent musique avec une grande connaissance des choses de l’opéra. Tantôt l’un, tantôt l’autre se mettait au piano et rappelait quelque motif que les convives accompagnaient d’abord à mi-voix et puis en donnant du son, de toute force. Et puis l’on buvait encore avec un parfait fracas de paroles et de gaieté. Ivan Pétrovitch et Athanase Georgevitch se levèrent pour embrasser le Général sur la bouche. Rouletabille avait devant lui de grands enfants, qui s’amusaient avec une innocence incroyable et qui buvaient d’une façon plus incroyable encore. Matrena Pétrovna fumait sans s’arrêter des cigarettes de tabac blond, se levait à chaque instant, allait faire un petit tour inquiet dans les salles et, après avoir interrogé les domestiques, considérait longuement Rouletabille qui ne bougeait pas, lui, attentif aux paroles et aux gestes de chacun.
Enfin, en soupirant, elle s’asseyait auprès de Féodor en lui demandant des nouvelles de sa jambe.
Michel et Natacha, dans un coin, étaient en grande conversation, et Boris regardait de leur côté avec impatience, tout en grattant sa guzla. Mais ce qui frappait par-dessus tout le jeune esprit de Rouletabille, c’était assurément l’aspect peu farouche du Général. Il ne s’était pas représenté le terrible Trébassof avec cette bonne mine paternelle sympathique. Des journaux de Paris avaient donné de lui des portraits redoutables, plus ou moins authentiques, mais où l’art du photographe ou du graveur avait soigneusement souligné les rudes traits d’un boïard peu accessible à la pitié. Ces images, du reste, étaient en parfait accord avec l’idée que l’on était en droit de se faire de l’exécuteur des hautes œuvres du gouvernement du Tsar, à Moscou, de l’homme qui, pendant huit jours – la « semaine rouge » –, avait fait tant de cadavres d’étudiants et d’ouvriers, que les salles des facultés et les usines avaient vainement, depuis, ouvert leurs portes… Il eût fallu ressusciter les morts pour peupler ces déserts ! Jours terribles de bataille où, de part et d’autre, on ne connaissait que le massacre et l’incendie, où Matrena Pétrovna et sa belle-fille Natacha (on avait raconté cela encore dans les journaux), étaient tombées à genoux devant le Général pour obtenir la grâce des derniers révolutionnaires réfugiés dans le quartier de Presnia – grâce qui, du reste, leur avait été refusée –.
– La guerre, c’est la guerre, leur avait répondu le Général avec une logique irréfutable. Comment voulez-vous que je fasse grâce à des gens qui ne se rendent pas ?
Il fallait, en effet, accorder cette justice à ces jeunes gens des barricades, qu’ils ne s’étaient pas rendus, et cette autre justice à Trébassof, qu’il les avait proprement fusillés.
– Si j’avais écouté mon intérêt, avait expliqué le Général à un journaliste de Paris, j’aurais été, avec ces messieurs, doux comme un mouton, et, à l’heure actuelle, je ne serais pas condamné à mort. Après tout, je ne sais pas ce que l’on me reproche : j’ai servi mon maître comme un brave et loyal sujet, sans plus, et après la bataille, j’ai laissé à d’autres le soin d’aller traquer les enfants derrière les jupes de leurs mères. On parle de la répression de Moscou : parlez-nous donc, Monsieur le Parisien, de la Commune. Voilà une besogne que je n’aurais point faite, de massacrer dans des cours un peuple d’hommes, de femmes et d’enfants qui ne résiste plus. Je suis un rude et fidèle soldat de Sa Majesté, mais je ne suis pas un monstre et j’ai le sentiment de la famille, mon cher Monsieur. Dites-le à vos lecteurs, si ça peut leur faire plaisir, et ne me demandez plus rien, car j’aurais l’air de regretter d’être condamné à mort… et la mort, je m’en f…
Oui, ce qui stupéfiait Rouletabille, c’était cette bonne figure de condamné à mort, qui paraissait si tranquillement apprécier la vie. Quand le Général n’encourageait pas la gaieté de ses amis, il s’entretenait avec sa femme et sa fille, qui l’adoraient et qui ne cessaient de lui baiser les mains, et il paraissait parfaitement heureux. Avec son énorme moustache grisonnante, son teint haut en couleur, ses petits yeux rieurs et perçants, il paraissait le type accompli du papa gâteau.
Le reporter examinait ces types si différents et faisait ses observations en simulant une faim insatiable qui lui servit, du reste, à s’établir définitivement dans l’estime des hôtes de la datcha des îles. Mais, en réalité, il donnait tout à dévorer à un énorme chien bouledogue qui, sous la table, lui faisait mille amitiés. Comme Trébassof avait prié ses amis de laisser son petit ami apaiser en paix sa boulimie, on ne s’occupait plus de lui. Enfin, la musique avait fini par distraire l’attention de tous et, à un certain moment, Matrena Pétrovna fut bien effrayée, en tournant la tête vers la place du jeune homme, de ne plus voir de Rouletabille. Où était-il passé ?… Elle sortit, s’en fut dans la véranda, n’osa pas appeler, revint dans le grand salon, et trouva le reporter dans le moment qu’il sortait du petit salon.
– Où étiez-vous ? demanda Matrena.
– Ce petit salon est tout à fait charmant et décoré avec un art exquis, complimenta Rouletabille. On dirait un boudoir.
– Il sert, en effet, de boudoir à ma belle-fille dont la chambre donne directement sur ce petit salon ; vous voyez la porte ici… c’est tout à fait exceptionnellement qu’on y a dressé la table des zakouski ; mais la véranda, depuis quelque temps, était devenue la pièce de la police.
– Votre chien, Madame, est de bonne garde ? demanda Rouletabille, en caressant la bête qui l’avait suivi.
– Khor est fidèle et nous a toujours bien gardés, les autres années.
– Il se repose donc, maintenant ?
– Vous l’avez dit, mon petit ami. C’est Koupriane qui le fait enfermer dans la loge pour qu’il n’aboie plus la nuit. Koupriane craignait certainement, si on le laissait en liberté, qu’il ne dévorât quelqu’un de ses policiers, ce qui pouvait fort bien arriver la nuit dans le jardin. Je voulus alors qu’il couchât dans la maison, ou devant la porte de son maître, ou même au pied du lit, mais Koupriane m’a répliqué : « Non, non, pas de chien !… Ne comptez pas sur le chien !… Il n’y a rien de plus dangereux que de compter sur le chien ! » alors, on a enfermé Khor, la nuit, mais je n’ai pas compris Koupriane…
– M. Koupriane avait raison, fit le reporter. Les chiens ne sont bons que contre les étrangers.
– Oh ! soupira la bonne dame, en détournant les yeux, Koupriane connaît bien son métier, il pense à tout… Venez, ajouta-t-elle rapidement, comme si elle eût voulu masquer son embarras… et ne sortez plus comme cela sans me prévenir… on vous réclame dans la salle…
– J’exige tout de suite que vous me parliez de cet attentat…
– Dans la salle, dans la salle !… c’est plus fort que moi, fit-elle, en baissant la voix, je ne puis pas laisser seul le Général sur le parquet !
Elle poussa Rouletabille dans la salle, où ces messieurs se racontaient d’étranges histoires de kouliganes qui les faisaient rire à grand bruit.
Natacha conversait toujours avec Michel Korsakof ; Boris, qui ne les quittait pas des yeux, était d’une pâleur de cire au-dessus de sa guzla, qu’il raclait de temps à autre, inconsciemment. Matrena fit asseoir Rouletabille sur un coin du canapé, près d’elle, et, comptant sur ses doigts comme une excellente ménagère qui ne laisse rien perdre dans ses calculs domestiques :
– Il y a eu trois attentats, dit-elle… deux, d’abord, à Moscou. Le premier est arrivé bien simplement. Le Général savait qu’il était condamné à mort. On lui avait apporté, au palais, dans l’après-midi, les affiches révolutionnaires qui apprenaient la nouvelle à la population de la ville et des campagnes. Aussitôt, Féodor, qui s’apprêtait à sortir, renvoya son escorte. Et il commanda qu’on lui attelât le traîneau. Je lui demandai en tremblant quel était son dessein ; il me répondit qu’il allait se faire traîner bien tranquillement dans tous les quartiers de la ville pour montrer aux Moscovites qu’on n’intimide pas facilement un gouverneur nommé, selon la loi, par le petit père, et qui a la conscience d’avoir fait tout son devoir. On approchait de quatre heures. On touchait à la fin de la journée d’hiver, qui avait été claire, transparente et très froide. Je m’enveloppai dans mes fourrures et montai dans le traîneau, à côté du Général, qui me dit : « c’est très bien, Matrena, cela fera un très bon effet sur ces imbéciles. » Et nous voilà partis. D’abord, nous descendons le long de la Naberjnaïa. Le traîneau filait comme le vent.
Le Général donna un grand coup de poing dans le dos du koudchar, en lui criant : « Tout doucement, imbécile, on va croire que nous avons peur !… » et c’est presque au pas que, remontant derrière l’église de la protection et de l’intercession, nous arrivâmes sur la place rouge. Jusque-là, les rares passants nous avaient regardés et, après nous avoir reconnus, s’étaient empressés de s’enfuir. Sur la place rouge, il n’y avait personne qu’un groupe de femmes devant la vierge d’Ibérie.
Ces femmes, aussitôt qu’elles nous eurent aperçus et qu’elles eurent reconnu l’équipage du gouverneur, se dispersèrent comme une bande de corneilles, en jetant des cris d’effroi. Féodor riait si fort que son rire, sous la voûte de la vierge, semblait faire trembler les pierres. J’en étais moi-même toute réconfortée, mon petit Monsieur. Notre promenade continuait sans incidents remarquables. La ville était presque déserte. On était encore trop sous le coup de la bataille des rues. Féodor disait : « Ah ! ils font le vide devant moi ; ils ne savent pourtant pas combien je les aime. » Et, tout le long de la promenade, il me dit encore des choses charmantes et délicates.
Enfin, nous parlions doucement sous les fourrures, dans le traîneau, quand on passa de la place Koudrinsky dans la rue Koudrinsky, exactement. Il était quatre heures juste et une légère buée commençait à courir au ras de la neige glacée ; on n’apercevait plus les maisons que comme des grandes boîtes d’ombre, à droite et à gauche. On glissait sur la neige comme glisse un bateau sur le fleuve en temps de brouillard calme. Et, tout à coup, nous entendîmes des cris perçants et nous vîmes des ombres de soldats qui s’agitaient devant nous, avec des gestes grandis par le brouillard ; leurs fouets courts paraissaient énormes et s’abattaient comme des bûches sur d’autres ombres. Le Général fit arrêter le traîneau et descendit pour voir de quoi il s’agissait. Je descendis avec lui. C’étaient des soldats du fameux régiment Semenowsky, qui emmenaient deux prisonniers, un jeune homme et un enfant. Le petit recevait des coups sur la nuque. Et il se roulait par terre et poussait des cris déchirants. Il pouvait bien avoir neuf ans, au plus.
L’autre, le jeune homme, se tenait tout droit et marchait sans répondre, même par une plainte, aux coups de lanière qui venaient le fouetter. J’étais outrée. Je ne laissai point le temps à mon mari d’ouvrir la bouche et je dis au sous-officier qui commandait le détachement : « Tu n’as pas honte de battre ainsi un enfant et un chrétien qui ne peuvent se défendre ! » Le Général me donna raison. Alors, le sous-officier nous apprit que le petit enfant venait de tuer un Lieutenant dans la rue, en déchargeant un revolver qu’il nous montra, qui était le plus gros que j’aie jamais vu, et qui devait, pour cet enfant, être lourd à soulever comme un petit canon. C’était incroyable.
– Et l’autre, demanda le Général, qu’est-ce qu’il a fait ?
– C’est un étudiant dangereux, répondit le sous-officier, qui est venu se constituer lui-même prisonnier, parce qu’il l’avait promis à la propriétaire de la maison qu’il habite, pour lui éviter qu’on ne démolisse sa maison à coups de canon.
– Mais c’est très bien, cela ! Pourquoi le battez-vous ?
– Parce qu’on nous a dit que c’est un étudiant dangereux.
– Ça n’est pas une raison, répondit sagement Féodor. Il sera fusillé s’il l’a mérité, et le petit enfant aussi, mais je vous défends de les battre. On vous a donné des fouets, non pas pour battre des prisonniers isolés, mais pour fouetter la foule qui n’obéit pas aux ordres du gouverneur. Dans ce cas-là, on vous crie : « Chargez ! » Et vous savez ce que vous avez à faire. Vous m’avez compris ? Termina Féodor d’une voix rude. Je suis le Général Trébassof, votre gouverneur.
Ce que venait de dire là, Féodor, était tout à fait humain ; eh bien, il en fut bien mal récompensé, bien mal, en vérité. Et l’étudiant était vraiment dangereux, car il n’eût pas plutôt entendu mon mari dire : « Je suis le Général Trébassof, votre gouverneur », qu’il s’écria : « Ah ! c’est toi, Trébassof », et qu’il sortit un revolver d’on ne sait où, et le déchargea entièrement sur le Général, presque à bout portant. Mais le Général ne fut pas atteint, heureusement, ni moi non plus, qui étais à son côté et qui m’étais jetée sur le bras de l’étudiant pour le désarmer, et qui fus roulée aux pieds des soldats dans la bataille qu’ils livraient autour de l’étudiant, pendant que le revolver se déchargeait toujours. Il y eut, du coup, trois soldats tués. Vous comprenez que les autres étaient furieux. Ils me relevèrent avec des excuses et, tout de suite, se mirent à donner des coups de bottes et de cannes dans les reins de l’étudiant qui avait, lui aussi, roulé par terre, et le sous-officier lui cingla la figure d’un coup de fouet qui aurait pu lui cueillir les deux yeux.
C’est là-dessus que Féodor donna un grand coup de poing sur la tête du sous-officier, en lui disant : « Tu n’as donc pas entendu ce que je t’ai dit ? » Le soldat, assommé, tomba, et Féodor le coucha lui-même dans le traîneau avec les morts. Puis il se mit en tête des soldats et ramena le détachement à la caserne. Moi, je formais l’arrière-garde. Une heure après, nous revenions au palais. Il faisait tout à fait nuit et, presque sur le seuil du palais, nous avons été passés par les armes d’une petite troupe de révolutionnaires qui défilaient à toute allure dans deux traîneaux, qui disparurent dans la nuit et qu’on n’a pas pu rattraper. J’avais une balle dans ma toque. Le Général n’avait rien encore, mais nos fourrures étaient perdues à cause de tout le sang des soldats morts qu’on avait oublié d’éponger dans le traîneau.
Voilà le premier attentat qui ne signifie pas grand-chose, affirma Matrena, car nous étions encore en pleine guerre… Ce n’est que quelques jours plus tard qu’on est entré dans l’assassinat…
À ce moment, Ermolaï entrait avec quatre bouteilles de champagne sous les bras, et Thadée tapait sur le piano comme un sourd.
– Allez, vite… Madame… le second attentat ?… fit Rouletabille, qui prenait des notes hâtives sur sa manchette, tout en ne cessant de regarder les convives et d’écouter Matrena des deux oreilles…
– Le second a eu lieu encore à Moscou. Nous avions fait un joyeux dîner, car nous pensions bien que les beaux jours allaient revenir et que les bons citoyens auraient la paix de vivre, et Boris avait gratté de la guzla en chantant des chansons d’Orel pour me faire plaisir, car c’est un brave garçon sympathique. Natacha était passée on ne sait où.
Le traîneau nous attendait devant la porte. Nous montons dedans. Presque aussitôt, un fracas épouvantable, et nous sommes jetés dans la neige, le Général et moi. Il ne restait plus trace du traîneau, ni du cocher ; les deux chevaux étaient éventrés, deux magnifiques chevaux pie, mon cher petit Monsieur, auxquels le Général tenait beaucoup. Quant à Féodor, il avait des blessures profondes à la jambe droite ; le mollet était presque en bouillie. Moi, l’épaule un peu arrachée, presque rien. La bombe avait dû être déposée sous le siège du malheureux cocher, dont on ne retrouva que le chapeau, au milieu d’une mare de sang. À la suite de cet attentat, le Général resta deux mois au lit.
C’est le deuxième mois que l’on arrêta deux dvornicks que j’avais surpris, une nuit, sur le palier du premier étage où ils n’avaient que faire, et je jurai bien, à la suite de cela, de faire venir pour nous servir, nos vieux domestiques d’Orel. Il fut établi que les dvornicks en question avaient des accointances avec des révolutionnaires ; alors, on les a pendus. L’Empereur avait nommé un gouverneur provisoire et, le Général se trouvant beaucoup mieux, il fut décidé que nous quitterions la Russie momentanément, et que la convalescence s’achèverait dans le Midi de la France. Nous prîmes le train pour Pétersbourg, mais le voyage occasionna une forte fièvre à mon mari, et la blessure du mollet se rouvrit. Les médecins ordonnèrent un repos absolu et nous vînmes nous installer dans cette datcha des îles. Depuis notre arrivée, il ne s’est guère passé de jour où le Général n’ait reçu quelque lettre anonyme, lui assurant que rien ne pourra le soustraire à la vengeance des révolutionnaires.
Il est brave et n’a fait qu’en sourire ; mais moi, je savais bien que tant que nous serions en Russie, nous n’aurions pas une seconde de sécurité. Aussi, je veillais sur lui à toute minute, et ne le laissais approcher que de ses amis intimes et de sa famille. J’avais fait venir ma vieille Gniagnia qui m’a élevée, Ermolaï, et les dvornicks d’Orel. C’est sur ces entrefaites que, il y a deux mois, le troisième attentat survint. C’est certainement, de tous, celui qui m’a le plus épouvantée, car il commençait de déceler un mystère qui n’est pas encore, hélas ! éclairci…
– Mais Athanase Georgevitch devait en avoir raconté une « bien bonne » car tous s’esclaffaient.
Féodor Féodorovitch s’amusait tellement qu’il en avait les larmes aux yeux. Rouletabille se disait, pendant que Matrena parlait :
– Je n’ai jamais vu des gens aussi gais, et cependant, ils n’ignorent point qu’ils courent parfaitement le risque de sauter tous, à l’instant même !…
Le Général, qui n’avait cessé d’observer Rouletabille, lequel observait tout le monde, lui dit :
– Eh ! eh ! Monsieur le journaliste, vous nous trouvez gais ?
– Je vous trouve braves, dit Rouletabille, en baissant la voix.
– Pourquoi donc ? fit en souriant Féodor Féodorovitch.
– Je vous demande pardon de songer à des choses que vous semblez avoir tout à fait oubliées…
Et il lui montra la jambe victime de l’avant-dernier attentat.
– C’est la guerre ! c’est la guerre ! fit l’autre… une jambe par-ci, un bras par-là !… Mais, vous voyez bien… on s’en tire tout de même… ils finiront bien par se lasser et me ficher la paix… à votre santé, mon ami…
– À votre santé, Général.
– Vous comprenez, continua Féodor Féodorovitch, il ne faut pas vous extasier : c’est notre métier à nous de défendre l’Empire au péril de notre vie. Et nous trouvons ça tout naturel. Seulement, il ne faut pas non plus crier à l’ogre. Des ogres, j’en ai connu dans l’autre camp, et qui parlaient d’amour tout le temps, qui ont été plus féroces que vous ne pourriez l’imaginer. Tenez ! ce qu’ils ont fait de mon pauvre ami, le chef de la sûreté Boïchlikof, est-ce recommandable, en vérité ? En voilà encore un qui était brave. Le soir, sa besogne finie, il quittait les bureaux de la préfecture et venait retrouver sa femme et ses enfants dans un appartement de la ruelle des loups. Croyez-vous que cet appartement n’était même pas gardé ! Pas un soldat ! Pas un gardavoï ! Les autres ont eu beau jeu. Un soir, une vingtaine de révolutionnaires, après avoir chassé les dvornicks terrorisés, montèrent chez lui. Il soupait en famille. On frappe à la porte. Il va ouvrir. Il voit de quoi il retourne. Il veut parler. On ne lui en laisse pas le temps. Devant sa femme et ses enfants, fous d’épouvante et qui se jetaient aux genoux des révolutionnaires, on lui lit sa sentence de mort ! En voilà une fin de dîner !…
En entendant ces mots, Rouletabille pâlit et ses yeux se dirigent vers la porte comme s’il redoutait de voir celle-ci s’ouvrir, livrant passage aux farouches nihilistes dont l’un, un papier à la main, se dispose à lire la sentence de mort à Féodor Féodorovitch. L’estomac de Rouletabille n’est pas encore fait à la digestion de pareilles histoires. Le jeune homme est bien près de regretter d’avoir pris cette terrible responsabilité d’éloigner, momentanément, la police… après ce que lui a confié Koupriane de ce qui se passait dans cette maison, il n’a pas hésité à risquer ce coup plein d’audace… mais tout de même, tout de même, ces histoires de nihilistes qui apparaissent à la fin d’un repas, la sentence de mort à la main…
Cela le retourne… lui chavire le cœur… ah ! c’est un coup d’audace ! C’est un coup d’audace d’avoir chassé la police !…
– Alors, demande-t-il, surmontant son émoi, et reprenant comme toujours confiance en lui-même… alors… qu’est-ce qu’ils ont fait, après cette lecture ?
– Le chef de la sûreté savait qu’il n’avait aucune grâce à attendre. Il n’en demanda pas. Les révolutionnaires ordonnèrent à Boïchlikof de dire adieu à sa famille. Il releva sa femme, ses enfants, les embrassa, leur conseilla le courage et dit aux autres qu’il était prêt. On le fit descendre dans la rue. On le colla contre le mur. Une salve retentit. La femme et les enfants étaient à la fenêtre qui regardaient. Ils descendirent chercher le corps du malheureux troué de vingt-cinq balles.
– C’est exactement le nombre de blessures que l’on avait relevées sur le corps du petit Jacques Zlovikszky, fit entendre la voix calme de Natacha.
– Oh ! toi, tu leur trouves toujours des excuses… bougonna le Général… le pauvre Boïchlikof a fait son devoir comme j’ai fait le mien !…
– Toi, papa, tu as agi comme un soldat ! Voilà ce que les révolutionnaires ne devraient pas oublier !… Mais ne crains rien pour nous, père, car s’ils te tuent, nous mourrons tous avec toi !…
– Et gaiement encore !… déclara Athanase Georgevitch. Ils peuvent venir ce soir. On est en forme !…
Sur quoi Athanase remplit les verres.
– Cependant, permettez-moi de dire, émit timidement le marchand de bois Thadée Tchichnikof, permettez-moi de dire que ce Boïchlikof a été bien imprudent.
– Dame, oui ! gravement imprudent, approuva Rouletabille. Quand on a fait mettre vingt-cinq bonnes balles dans le corps d’un enfant, on doit précieusement se garder chez soi si on veut souper en paix…
Ce disant, il toussa, car il se trouvait passablement du toupet, après ce qu’il avait fait de la garde du Général, d’émettre de pareilles conclusions…
– Ah ! s’écria avec vigueur Athanase Georgevitch, de sa plus belle voix du tribunal… ah !… ce n’était point de l’imprudence ! C’était du mépris de la mort ! Oui, c’est le mépris de la mort qui l’a tué. Comme le mépris de la mort nous conserve tous, en ce moment, en parfaite santé… à la vôtre, Mesdames, Messieurs !… connaissez-vous quelque chose de plus beau, de plus grand au monde que le mépris de la mort ? Regardez Féodor Féodorovitch et répondez-moi ! Superbe, ma parole ! superbe !… à la vôtre !… Les révolutionnaires, qui ne sont pas tous de la police, seront de mon avis en ce qui concerne nos héros. Ils peuvent maudire les tchinownicks qui exécutent les ordres terribles venus d’en haut ; mais ceux qui ne sont pas de la police (il y en a, je crois, quelques-uns), ceux-là reconnaîtront que des hommes comme le chef de la sûreté, notre défunt ami, sont braves.