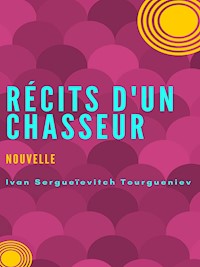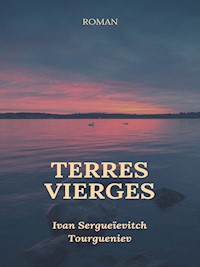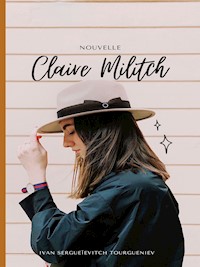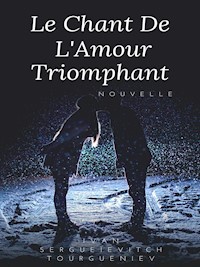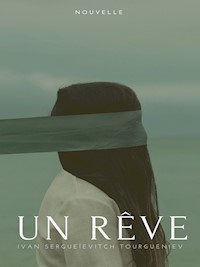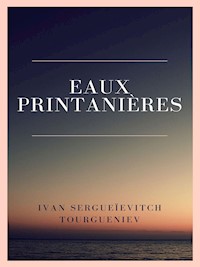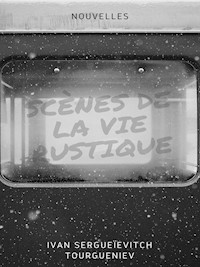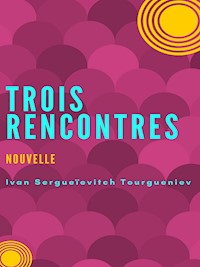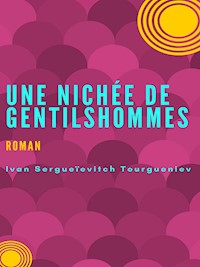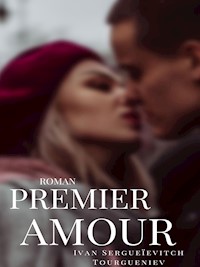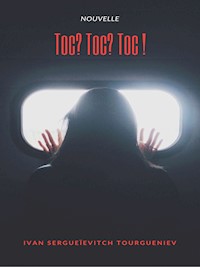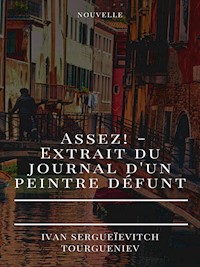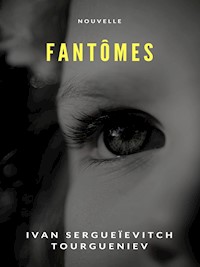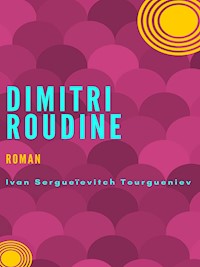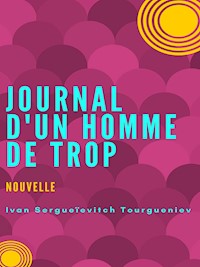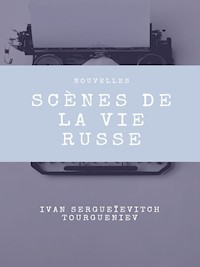
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce recueil de nouvelles, parues séparément dans les revues littéraires de l'époque, n'a jamais été édité sous cette forme en russe. Il résulte d'une compilation faite par Hachette, le grand éditeur de l'époque, qui lui a donné son titre destiné à allécher le lecteur français, friand d'exotisme. Trois thèmes, présents dans toute l'oeuvre de Tourgueniev, donnent une certaine unité au recueil. La dénonciation du servage, pour l'abolition duquel Tourgueniev lutta et fut emprisonné. La vanité de la recherche du bonheur, but impossible à atteindre. Enfin la mort et son mystère, qui hante l'auteur jusqu'à sa dernière oeuvre, Claire Militch, au bord de l'hallucination. La mort, violente le plus souvent, parfois accidentelle mais en même temps providentielle, conclut toutes ces nouvelles. Les amours sont toutes malheureuses, les couples mal assortis, les vies sont subies dans la résignation. Tous les récits ont pour cadre la bonne société russe de province, gens relativement fortunés, en général éduqués, donc parlant le français et l'allemand, b a ba de la culture à l'époque. Les petites gens, paysans, domestiques, sont totalement soumis à la volonté de leur maître qui les marie à son gré, sans tenir compte de leur aspirations. C'est donc une vie russe bien spécifique que nous présente l'auteur. On ne doit pas oublier l'amour profond de Tourgueniev pour la profusion de la nature russe, qu'il ne manque jamais de nous décrire en détail, et dont il donne parfaitement le sentiment de son immensité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Scènes de la vie russe
Scènes de la vie russeLES DEUX AMISJACQUES PASSINKOFMOUMOUFAUSTLE FERRAILLEURLES TROIS PORTRAITS SCÈNES DE MŒURS RUSSES AU XVIIIe SIÈCLEPage de copyrightScènes de la vie russe
Ivan Sergueïevitch Tourgueniev
LES DEUX AMIS
Au printemps de l’année 184…, un jeune homme de vingt-six ans, nommé Boris Andréitch Viasovnine, venait de quitter ses fonctions officielles pour se vouer à l’administration des domaines que son père lui avait légués dans une des provinces de la Russie centrale. Des motifs particuliers l’obligeaient, disait-il, à prendre cette décision, et ces motifs n’étaient point d’une nature agréable. Le fait est que, d’année en année, il voyait ses dettes s’accroître et ses revenus diminuer. Il ne pouvait plus rester au service, vivre dans la capitale, comme il avait vécu jusque-là, et, bien qu’il renonçât à regret à sa carrière de fonctionnaire, la raison lui prescrivait de rentrer dans son village pour mettre ordre à ses affaires.
À son arrivée, il trouva sa propriété fort négligée, sa métairie en désordre, sa maison dégradée. Il commença par prendre un autre staroste, diminua les gages de ses gens, fit nettoyer un petit appartement dans lequel il s’établit, et clouer quelques planches au toit ouvert à la pluie.
Là se bornèrent d’abord ses travaux d’installation ; avant d’en faire d’autres, il avait besoin d’examiner attentivement ses ressources et l’état de ses domaines.
Cette première tâche accomplie, il s’appliqua à l’administration de son patrimoine, mais lentement, comme un homme qui cherche pour se distraire à prolonger le travail qu’il a entrepris. Ce séjour rustique l’ennuyait de telle sorte que très souvent il ne savait comment employer toutes les heures de la journée qui lui semblaient si longues. Il y avait autour de lui quelques propriétaires qu’il ne voyait pas, non point qu’il dédaignât de les fréquenter, mais parce qu’il n’avait pas eu occasion de faire connaissance avec eux. En automne, enfin, le hasard le mit en rapport avec un de ses plus proches voisins, Pierre Vasilitch Kroupitzine, qui avait servi dans un régiment de cavalerie et s’était retiré de l’armée avec le grade de lieutenant.
Entre les paysans de Boris Andréitch et ceux du lieutenant Pierre Vasilitch, il existait depuis longtemps des difficultés pour le partage de deux bandes de prairie de quelques ares d’étendue. Plus d’une fois ce terrain en litige avait occasionné, entre les deux communautés, des actes d’hostilité. Les meules de foin avaient été subrepticement enlevées et transportées en une autre place. L’animosité s’accroissait de part et d’autre, et ce fâcheux état de choses menaçait de devenir encore plus grave. Par bonheur, Pierre Vasilitch, qui avait entendu parler de la droiture d’esprit et du caractère pacifique de Boris, résolut de lui abandonner à lui-même la solution de cette question. Cette démarche de sa part eut le meilleur résultat. D’abord, la décision de Boris mit fin à toute collision, puis, par suite de cet arrangement, les deux voisins entrèrent en bonnes relations l’un avec l’autre, se firent de fréquentes visites, et enfin en vinrent à vivre en frères presque constamment.
Entre eux pourtant, dans leur extérieur comme dans la nature de leur esprit, il y avait peu d’analogie. Boris, qui n’était pas riche, mais dont les parents autrefois étaient riches, avait été élevé à l’université et avait reçu une excellente éducation. Il parlait plusieurs langues ; il aimait l’étude et les livres ; en un mot, il possédait les qualités d’un homme distingué. Pierre Vasilitch, au contraire, balbutiait à peine quelques mots de français, ne prenait un livre entre ses mains que lorsqu’il y était en quelque sorte forcé, et ne pouvait être classé que dans la catégorie des gens illettrés.
Par leur extérieur, les deux nouveaux amis ne différaient pas moins l’un de l’autre. Avec sa taille mince, élancée, sa chevelure blonde, Boris ressemblait à un Anglais. Il avait des habitudes de propreté extrême, surtout pour ses mains, s’habillait avec soin, et avait conservé dans son village, comme dans la capitale, la coquetterie de la cravate.
Pierre Vasilitch était petit, un peu courbé. Son teint était basané, ses cheveux noirs. En été comme en hiver, il portait un paletot-sac en drap bronzé, avec de grandes poches entrebâillées sur les côtés.
« J’aime cette couleur de bronze, disait-il, parce qu’elle n’est pas salissante. »
La couleur en effet n’était pas salissante, mais le drap qu’elle décorait était bel et bien taché.
Boris Andréitch avait des goûts gastronomiques élégants, recherchés. Pierre mangeait, sans y regarder de si près, tout ce qui se présentait, pourvu qu’il y eût de quoi satisfaire son appétit. Si on lui servait des choux avec du gruau, il commençait par savourer les choux, puis attaquait résolument le gruau. Si on lui offrait une liquide soupe allemande, il acceptait cette soupe avec le même plaisir, et entassait le gruau sur son assiette.
Le kwas était sa boisson favorite et, pour ainsi dire, sa boisson nourricière. Quant aux vins de France, particulièrement les vins rouges, il ne pouvait les souffrir, et déclarait qu’il les trouvait trop aigres.
En un mot, les deux voisins étaient fort différents l’un de l’autre. Il n’y avait entre eux qu’une ressemblance, c’est qu’ils étaient tous deux également honnêtes et bons garçons. Pierre était né avec cette qualité, et Boris l’avait acquise. Nous devons dire, en outre, que ni l’un ni l’autre n’avaient aucune passion dominante, aucun penchant, ni aucun lien particulier. Ajoutons enfin, pour terminer ces deux portraits, que Pierre était de sept ou huit ans plus âgé que Boris.
Dans leur retraite champêtre, l’existence des deux voisins s’écoulait d’une façon uniforme. Le matin, vers les neuf heures, Boris ayant fait sa toilette, et revêtu une belle robe de chambre qui laissait à découvert une chemise blanche comme la neige, s’asseyait près de la fenêtre avec un livre et une tasse de thé. La porte s’ouvrait, et Pierre Vasilitch entrait dans son négligé habituel. Son village n’était qu’à une demi-verste de celui de son ami, et très souvent il n’y retournait pas. Il couchait dans la maison de Boris.
« Bonjour ! disaient-ils tous deux en même temps. Comment avez-vous passé la nuit ? »
Alors Théodore, un petit domestique de quinze ans, s’avançait avec sa casaque, ses cheveux ébouriffés, apportait à Pierre la robe de chambre qu’il s’était fait faire en étoffe rustique. Pierre commençait par faire entendre un cri de satisfaction, puis se paraît de ce vêtement, ensuite se servait une tasse de thé et préparait sa pipe. Puis l’entretien s’engageait, un entretien peu animé et coupé par de longs intervalles et de longs repos. Les deux amis parlaient des incidents de la veille, de la pluie et du beau temps, des travaux de la campagne, du prix des récoltes, quelquefois de leurs voisins et de leurs voisines.
Au commencement de ses relations avec Boris, souvent Pierre s’était cru obligé, par politesse, de le questionner sur le mouvement et la vie des grandes villes ; sur divers points scientifiques ou industriels, parfois même sur des questions assez élevées. Les réponses de Boris l’étonnaient et l’intéressaient. Bientôt pourtant il se sentit fatigué de cette investigation ; peu à peu il y renonça, et Boris n’éprouvait pas un grand désir de l’y ramener. De loin en loin, il arrivait encore que tout à coup Pierre s’avisait de formuler quelque difficile question comme celle-ci :
« Boris, dites-moi donc ce que c’est que le télégraphe électrique ? »
Boris lui expliquait le plus clairement possible cette merveilleuse invention, après quoi Pierre, qui ne l’avait pas compris, disait :
« C’est étonnant ! »
Puis il se taisait, et de longtemps il ne se hasardait à aborder un autre problème scientifique.
Que si l’on veut savoir quelle était la plupart du temps la causerie des deux amis, en voici un échantillon.
Pierre ayant retenu dans son palais la fumée de sa pipe, et la lançant en bouffées impétueuses par ses narines, disait à Boris :
« Qui est cette jeune fille que j’ai vue tout à l’heure à votre porte ? »
Boris aspirait une bouffée de son cigare, humait une cuillerée de thé froid, et répondait :
« Quelle jeune fille ? »
Pierre se penchait sur le bord de la fenêtre, regardait dans la cour le chien qui mordillait les jambes nues d’un petit garçon, puis ajoutait :
« Une jeune fille blonde qui n’est, ma foi, pas laide.
– Ah ! reprenait Boris après un moment de silence. C’est ma nouvelle blanchisseuse.
– D’où vient-elle ?
– De Moscou, où elle a fait son apprentissage. »
Après cette réponse, nouveau silence.
« Combien avez-vous donc de blanchisseuses ? demandait de nouveau Pierre en regardant attentivement les grains de tabac qui s’allumaient et pétillaient sous la cendre au fond de sa pipe.
– J’en ai trois, répondait Boris.
– Trois ! Moi, je n’en ai qu’une ; elle n’a presque rien à faire. Vous savez quelle est sa besogne.
– Hum ? » murmurait Boris.
Et l’entretien s’arrêtait là.
Le temps s’écoulait ainsi jusqu’au moment du déjeuner. Pierre avait un goût particulier pour ce repas, et disait qu’il fallait absolument le faire à midi. À cette heure-là il s’asseyait à table d’un air si heureux, et avec un si bon appétit, que son aspect seul eût suffi pour réjouir l’humeur gastronomique d’un Allemand.
Boris Andréitch avait des besoins très modérés. Il se contentait d’une côtelette, d’un morceau de poulet ou de deux œufs à la coque. Seulement il assaisonnait ses repas d’ingrédients anglais disposés dans d’élégants flacons qu’il payait fort cher. Bien qu’il ne pût user de cet appareil britannique sans une sorte de répugnance, il ne croyait pas pouvoir s’en passer.
Entre le déjeuner et le dîner, les deux voisins sortaient, si le temps était beau, pour visiter la ferme ou pour se promener, ou pour assister au dressage des jeunes chevaux. Quelquefois Pierre conduisait son ami jusque dans son village et le faisait entrer dans sa maison.
Cette maison, vieille et petite, ressemblait plus à la cabane d’un valet qu’à une habitation de maître. Sur le toit de chaume où nichaient diverses familles d’oiseaux, s’élevait une mousse verte. Des deux corps de logis construits en bois, jadis étroitement unis l’un à l’autre, l’un penchait en arrière, l’autre s’inclinait de côté et menaçait de s’écrouler. Triste à voir au dehors, cette maison ne présentait pas un aspect plus agréable au dedans. Mais Pierre, avec sa tranquillité et sa modestie de caractère, s’inquiétait peu de ce que les riches appellent les agréments de la vie, et se réjouissait de posséder une maisonnette où il pût s’abriter dans les mauvais temps. Son ménage était fait par une femme d’une quarantaine d’années, nommée Marthe, très dévouée et très probe, mais très maladroite, cassant la vaisselle, déchirant le linge, et ne pouvant réussir à préparer un mets dans une condition convenable. Pierre lui avait infligé le surnom de Caligula.
Malgré son peu de fortune, le bon Pierre était très hospitalier ; il aimait à donner à dîner, et s’efforçait surtout de bien traiter son ami Boris. Mais, par l’inhabileté de Marthe, qui, dans l’ardeur de son zèle, courait impétueusement de côté et d’autre, au risque de se rompre le cou, le repas du pauvre Pierre se composait ordinairement d’un morceau d’esturgeon desséché et d’un verre d’eau-de-vie, très bonne, disait-il en riant, contre l’estomac. Le plus souvent, après la promenade, Boris ramenait son ami dans sa demeure plus confortable. Pierre apportait au dîner le même appétit qu’au repas du matin, puis il se retirait à l’écart pour faire une sieste de quelques heures ; pendant ce temps, Boris lisait les journaux étrangers.
Le soir, les deux amis se rejoignaient encore dans une même salle. Quelquefois ils jouaient aux cartes. Quelquefois ils continuaient leur nonchalante causerie. Quelquefois Pierre détachait de la muraille une guitare et chantait d’une voix de ténor assez agréable. Il avait pour la musique un goût beaucoup plus décidé que Boris, qui ne pouvait prononcer le nom de Beethoven sans un transport d’admiration, et qui venait de commander un piano à Moscou.
Dès qu’il se sentait enclin à la tristesse ou à la mélancolie, il chantait en nasillant légèrement une des chansons de son régiment. Il accentuait surtout certaines strophes telles que celle-ci :
« Ce n’est pas un Français, c’est un conscrit qui nous fait la cuisine. Ce n’est pas pour nous que l’illustre Rode doit jouer, ni pour nous que Cantalini chante. Eh ! trompette, nous sonnes-tu l’aubade ? le maréchal des logis nous présente son rapport. »
Parfois Boris essayait de l’accompagner, mais sa voix n’était ni très juste ni très harmonieuse.
À dix heures, les deux amis se disaient bonsoir et se quittaient, pour recommencer le lendemain la même existence.
Un jour qu’ils étaient assis l’un en face de l’autre, selon leur habitude, Pierre, regardant fixement Boris, lui dit tout à coup d’un ton expressif :
« Il y a une chose qui m’étonne, Boris.
– Quoi donc ?
– C’est de vous voir, vous si jeune encore, et avec vos qualités d’esprit, vous astreindre à rester dans un village.
– Mais vous savez bien, répondit Boris surpris de cette remarque, vous savez bien que les circonstances m’obligent à ce genre de vie.
– Quelles circonstances ? Votre fortune n’est-elle pas assez considérable pour vous assurer partout une honnête existence ? Vous devriez entrer au service. »
Et, après un moment de silence, il ajouta : « Vous devriez entrer dans les uhlans.
– Pourquoi dans les uhlans ?
– Il me semble que c’est là ce qui vous conviendrait le mieux.
– Vous, pourtant, vous avez servi dans les hussards.
– Oui ! s’écria Pierre avec enthousiasme. Et quel beau régiment ! Dans le monde entier, il n’en existe pas un pareil ; un régiment merveilleux ; colonel, officiers…, tout était parfait… Mais vous, avec votre blonde figure, votre taille mince, vous seriez mieux dans les uhlans.
– Permettez, Pierre. Vous oubliez qu’en vertu des règlements militaires, je ne pourrais entrer dans l’armée qu’en qualité de cadet. Je suis bien vieux pour commencer une telle carrière, et je ne sais pas même si à mon âge on voudrait m’y admettre.
– C’est vrai, répliqua Pierre à voix basse. Eh bien ! alors, reprit-il en levant subitement la tête, il faut vous marier.
– Quelles singulières idées vous avez aujourd’hui !
– Pourquoi donc singulières ? Quelle raison avez-vous de vivre comme vous vivez et de perdre votre temps ? Quel intérêt peut-il y avoir pour vous à ne pas vous marier ?
– Il ne s’agit pas d’intérêt.
– Non, reprit Pierre avec une animation extraordinaire, non, je ne comprends pas pourquoi, de nos jours, les hommes ont un tel éloignement pour le mariage… Ah ! vous me regardez… Mais moi j’ai voulu me marier, et l’on n’a pas voulu de moi. Vous qui êtes dans des conditions meilleures, vous devez prendre un parti. Quelle vie que celle du célibataire ! Voyez un peu, en vérité, les jeunes gens sont étonnants. »
Après cette longue tirade, Pierre secoua sur le dos d’une chaise la cendre de sa pipe, et souffla fortement dans le tuyau pour la nettoyer.
« Qui vous dit, mon ami, repartit Boris, que je ne songe pas à me marier ? »
En ce moment, Pierre puisait du tabac au fond de sa blague en velours ornée de paillettes, et d’ordinaire il accompagnait très gravement cette opération. Les paroles de Boris lui firent faire un mouvement de surprise.
« Oui, continua Boris, trouvez-moi une femme qui me convienne, et je l’épouse.
– En vérité ?
– En vérité !
– Non. Vous plaisantez ?
– Je vous assure que je ne plaisante pas. »
Pierre alluma sa pipe ; puis, se tournant vers Boris :
« Eh bien ! c’est convenu, dit-il, je vous trouverai une femme.
– À merveille ! Mais, maintenant, dites-moi, pourquoi voulez-vous me marier ?
– Parce que, tel que je vous connais, je ne vous crois pas capable de régler vous-même cette affaire.
– Il m’a semblé, au contraire, repris Boris en souriant, que je m’entendais assez bien à ces sortes de choses.
– Vous ne me comprenez pas, » répliqua Pierre, et il changea d’entretien.
Deux jours après, il arriva chez son ami, non plus avec son paletot-sac, mais avec un frac bleu, à longue taille ornée de petits boutons et chargée de deux manches bouffantes. Ses moustaches étaient cirées, ses cheveux relevés en deux énormes boucles sur le front et imprégnés de pommade. Un col en velours, enjolivé d’un nœud en soie, lui serrait étroitement le cou et maintenait sa tête dans une imposante roideur.
« Que signifie cette toilette ? demanda Boris.
– Ce qu’elle signifie, répliqua Pierre en s’asseyant sur une chaise, non plus avec son abandon habituel, mais avec gravité ; elle signifie qu’il faut faire atteler votre voiture. Nous partons.
– Et où donc allons-nous ?
– Voir une jeune femme.
– Quelle jeune femme ?
– Avez-vous donc déjà oublié ce dont nous sommes convenus avant-hier ?
– Mais, mon cher Pierre, répondit Boris, non sans quelque embarras, c’était une plaisanterie.
– Une plaisanterie ! Vous m’avez juré que vous parliez sérieusement, et vous devez tenir parole. J’ai déjà fait mes préparatifs.
– Comment ? Que voulez-vous dire ?
– Ne vous inquiétez pas. J’ai seulement fait prévenir une de nos voisines que j’irais lui rendre aujourd’hui une visite avec vous.
– Quelle voisine ?
– Patience ! vous la connaîtrez. Habillez-vous et faites atteler.
– Mais voyez donc quel temps, reprit Boris tout troublé de cette subite décision.
– C’est le temps de la saison.
– Et allons-nous loin ?
– Non ; à une quinzaine de verstes de distance.
– Sans même déjeuner ? demanda Boris.
– Le déjeuner ne nous occasionnera pas un long retard. Mais, tenez, allez vous habiller ; pendant ce temps, je préparerai une petite collation : un verre d’eau-de-vie. Cela ne sera pas long. Nous ferons un meilleur repas chez la jeune veuve.
– Ah ! c’est donc une veuve ?
– Oui, vous verrez. »
Boris entra dans son cabinet de toilette. Pierre apprêta le déjeuner et fit harnacher les chevaux.
L’élégant Boris resta longtemps enfermé dans sa chambre. Pierre, impatienté, buvait, en fronçant le sourcil, un second verre d’eau-de-vie, lorsque enfin il le vit apparaître vêtu comme un vrai citadin de bon goût. Il portait un pardessus dont la couleur noire se détachait sur un pantalon d’une nuance claire, une cravate noire, un gilet noir, des gants gris glacés ; à l’une des boutonnières de son gilet était suspendu une petite chaîne en or qui retombait dans une poche de côté, et de son habit et de son linge frais s’exhalait un doux arôme.
Pierre, en l’observant, ne fit que proférer une légère exclamation et prit son chapeau.
Boris but un demi-verre d’eau-de-vie et se dirigea avec gon ami vers sa voiture.
« C’est uniquement par condescendance pour vous, lui dit-il, que j’entreprends cette course.
– Admettons que ce soit pour moi, répondit Pierre sur lequel l’élégante toilette de son voisin exerçait un visible ascendant ; mais peut-être me remercierez-vous de vous avoir fait faire ce petit voyage. »
Il indiqua au cocher la route qu’il devait suivre et monta dans la calèche.
Après un moment de silence pendant lequel les deux amis se tenaient immobiles l’un à côté de l’autre :
« Nous allons, dit Pierre, chez Mme Sophie Cirilovna Zad-nieprovskaïa. Vous connaissez sans doute déjà ce nom ?
– Il me semble l’avoir entendu prononcer. Et c’est elle avec qui vous voulez me marier ?
– Pourquoi pas ? C’est une femme d’esprit, qui a de la fortune et de bonnes façons, des façons de grande ville. Au reste vous en jugerez. Cette démarche ne vous impose aucun engagement.
– Sans aucun doute. Et quel âge a-t-elle ?
– Vingt-cinq ou vingt-six ans, et fraîche comme une pomme. »
La distance à parcourir pour arriver à la demeure de Sophie Cirilovna était beaucoup plus longue que le bon Pierre ne l’avait dit. Boris, se sentant saisi par le froid, plongea son visage dans son manteau de fourrure. Pierre ne s’inquiétait guère en général du froid, et moins encore quand il avait ses habits de grande cérémonie qui l’étreignaient au point de le faire transpirer.
L’habitation de Sophie était une petite maison blanche assez jolie, avec une cour et un jardin, semblable aux maisons de campagne qui décorent les environs de Moscou, mais qu’on ne rencontre que rarement dans les provinces.
En descendant de voiture, les deux amis trouvèrent sur le seuil de la porte un domestique vêtu d’un pantalon gris et d’une redingote ornée de boutons armoriés ; dans l’antichambre, un autre domestique assis sur un banc et habillé de la même façon. Pierre le pria de l’annoncer à sa maîtresse, ainsi que son ami. Le domestique répondit qu’elle les attendait, et leur ouvrit la porte de la salle à manger, où un serin sautillait dans sa cage, puis celle du salon, décoré de meubles à la mode, façonnés en Russie, très agréables en apparence, et en réalité très incommodes.
Deux minutes après, le frôlement d’une robe de soie se fit entendre dans une chambre voisine, puis la maîtresse de la maison entra d’un pas léger. Pierre s’avança à sa rencontre et lui présenta Boris.
« Je suis charmé de vous voir, dit-elle en observant Boris d’un regard rapide. Il y a longtemps que je désirais vous connaître, et je remercie Pierre Vasilitch d’avoir bien voulu me procurer cette satisfaction. Je vous en prie, asseyez-vous. »
Elle-même s’assit sur un petit canapé en aplatissant d’un coup de main les plis de sa robe verte garnie de volants blancs, penchant la tête sur le dossier du canapé, tandis qu’elle avançait sur le parquet deux petits pieds chaussés de deux jolies bottines.
Pendant qu’elle échangeait elle-même l’entretien, Boris, assis dans un fauteuil en face d’elle, la regardait attentivement. Elle avait la taille svelte, élancée, le teint brun, la figure assez belle, de grands yeux brillants un peu relevés aux coins de l’orbite comme ceux des Chinoises. L’expression de son regard et de sa physionomie présentait un tel mélange de hardiesse et de timidité qu’on ne pouvait y saisir un caractère déterminé. Tantôt elle clignait ses yeux, tantôt elle les ouvrait dans toute leur étendue, et en même temps sur ses lèvres errait un sourire affecté d’indifférence. Ses mouvements étaient dégagés et parfois un peu vifs. Somme toute, son extérieur plaisait assez à Boris. Seulement il remarquait à regret qu’elle était coiffée étourdiment, qu’elle avait la raie de travers.
De plus, elle parlait, selon lui, un trop correct langage, car il avait à cet égard le même sentiment que Pouchkine, qui a dit : « Je n’aime point les lèvres roses sans sourire, ni la langue russe sans quelque faute grammaticale. » En un mot, Sophie Cirilovna était de ces femmes qu’un amant nomme des femmes séduisantes ; un mari, des êtres agaçants et un vieux garçon des enfants espiègles.
Elle parlait à ses deux hôtes de l’ennui qu’on, éprouve à vivre dans un village. « Il n’y a pas ici, disait-elle en appuyant avec afféterie sur l’accentuation de certaines syllabes, il n’y a pas ici une âme avec qui l’on puisse converser. Je ne sais comment on se résigne à se retirer dans un tel gîte, et ceux-là seuls, ajouta-t-elle avec une petite moue d’enfant, ceux que nous aimerions à voir, s’éloignent et nous abandonnent dans notre triste solitude. »
Boris s’inclina et balbutia quelques mots d’excuse. Pierre le regarda d’un regard qui semblait dire : En voilà une qui a le don de la parole.
Vous fumez ? demanda Sophie en se tournant vers Boris.
– Oui… mais…
– N’ayez pas peur. Je fume aussi. »
À ces mots elle se leva, prit sur la table une boîte en argent, en tira des cigarettes qu’elle offrit à ses visiteurs, sonna, demanda du feu, et un domestique qui avait la poitrine couverte d’un large gilet rouge apporta une bougie.
« Vous ne croiriez pas, reprit-elle en inclinant gracieusement la tête en lançant en l’air une légère bouffée de fumée, qu’il y a ici des gens qui n’admettent pas qu’une femme puisse savourer un pauvre petit cigare. Oui, tout ce qui échappe au vulgaire niveau, tout ce qui ne reste point asservi à la coutume banale est si sévèrement jugé.
– Les femmes de notre district, dit Pierre Vasilitch, sont surtout très sévères sur cet article.
– Oui. Elles sont méchantes et inflexibles ; mais je ne les fréquente pas, et leurs calomnies ne pénètrent point dans mon solitaire refuge.
– Et vous ne vous ennuyez pas de cette retraite ? demanda Boris.
– Non. Je lis beaucoup, et lorsque je suis fatiguée de lire, je rêve, je m’amuse à faire des conjectures sur l’avenir.
– Eh quoi ! vous consultez les cartes ! s’écria Pierre étonné.
– Je suis assez vieille pour me livrer à ce passe-temps.
– À votre âge ! Quelle idée ! » murmura Pierre.
Sophie Cirilovna le regarda en clignotant, puis, se retournant vers Boris : « Parlons d’autre chose, dit-elle ; je suis sûre, monsieur Boris, que vous vous intéressez à la littérature russe ?
– Moi… sans doute, répondit avec quelque embarras Boris, qui lisait peu de livres russes, surtout peu de livres nouveaux, et s’en tenait à Pouchkine.
– Expliquez-moi d’où vient la défaveur qui s’attache à présent aux œuvres de Marlinski ? Elle me semble très injuste, n’êtes-vous pas de mon avis ?
– Marlinski est certainement un écrivain de mérite, répliqua Boris.
– C’est un poète, un poète dont l’imagination nous emporte dans les régions idéales, et maintenant on ne s’applique qu’à peindre les réalités de la vie vulgaire. Mais, je vous le demande, qu’y a-t-il donc de si attrayant dans le mouvement de l’existence journalière, dans le monde, sur cette terre ?
– Je ne puis m’associer à votre pensée, répondit Boris en la regardant. Je trouve ici même un grand attrait. »
Sophie sourit d’un air confus. Pierre releva la tête, sembla vouloir prononcer quelques mots, puis se remit à fumer en silence.
L’entretien se prolongea à peu près sur le même ton, courant rapidement d’un sujet à l’autre, sans se fixer sur aucune question, sans prendre aucun caractère décisif. On en vint à parler du mariage, de ses avantages, de ses inconvénients, et de la destinée des femmes en général. Sophie prit le parti d’attaquer le mariage, et peu à peu s’anima, s’emporta, bien que ses deux auditeurs n’essayassent pas de la contredire. Ce n’était pas sans raison qu’elle vantait les œuvres de Marlinski ; elle les avait étudiées et en avait profité. Les grands mots d’art, de poésie diapraient constamment son langage.
« Qu’y a-t-il, s’écria-t-elle à la fin de sa pompeuse dissertation, qu’y a-t-il de plus précieux pour la femme que la liberté de pensée, de sentiment, d’action ?
– Permettez, répliqua Pierre, dont la physionomie avait pris depuis quelques instants une expression marquée de mécontentement. Pourquoi la femme réclamerait-elle cette liberté ? qu’en ferait-elle ?
– Comment ? selon vous elle doit être l’attribut exclusif de l’homme.
– L’homme non plus n’en a pas besoin.
– Pas besoin ?
– Non. À quoi lui sert cette liberté tant vantée ? À s’ennuyer ou à faire des folies.
– Ainsi, repartit Sophie avec un sourire ironique, vous vous ennuyez : car, tel que je vous connais, je ne suppose pas que vous commettiez des folies.
– Je suis également soumis à ces deux effets de la liberté, répondit tranquillement Pierre.
– Très bien, je ne puis me plaindre de votre ennui. Je lui dois peut-être le plaisir de vous voir aujourd’hui. »
Très satisfaite de cette pointe épigrammatique, Sophie se pencha vers Boris et lui dit à voix basse : « Votre ami se complaît dans le paradoxe.
– Je ne m’en étais pas encore aperçu, repartit Boris.
– En quoi donc me complais-je ? demanda Pierre.
– À soutenir des paradoxes. »
Pierre regarda fixement Sophie, puis murmura entre ses dents : « Et moi je sais ce qui vous plairait… »
En ce moment le domestique en gilet rouge vint annoncer que le dîner était servi.
« Messieurs, dit Sophie, voulez-vous bien passer dans la salle à manger ? »
Le dîner ne plut ni à l’un ni à l’autre des convives. Pierre Vasilitch se leva de table sans avoir pu apaiser sa faim, et Boris Andréitch, avec ses goûts délicats en matière de gastronomie, ne fut pas plus satisfait de ce repas, bien que les mets fussent servis sous des cloches et que les assiettes fussent chaudes. Le vin aussi était mauvais, en dépit des étiquettes argentées et dorées qui décoraient chaque bouteille.
Sophie Cirilovna ne cessait de parler, tout en jetant de temps à autre un regard impérieux sur ses domestiques. Elle vidait à de fréquents intervalles son verre d’une façon assez leste, en remarquant que les Anglaises buvaient très bien du vin, et que, dans ce district sévère, on trouvait que, de la part d’une femme, c’était une inconvenance.
Après le dîner, elle ramena ses hôtes au salon, et leur demanda ce qu’ils préféraient, du thé ou du café. Boris accepta une tasse de thé, et, après en avoir : pris une cuillerée, regretta de n’avoir pas demandé du café. Mais le café n’était pas meilleur. Pierre, qui en avait demandé, le laissa pour prendre du thé, et renonça également à boire cette autre potion.
Sophie Cirilovna s’assit, alluma une cigarette, et se montra très empressée de reprendre son vif entretien. Ses yeux pétillaient et ses joues étaient échauffées. Mais ses deux visiteurs ne la secondaient pas dans ses dispositions à l’éloquence. Ils semblaient plus occupés de leurs cigares que de ses belles phrases, et, à en juger par leurs regards constamment dirigés du côté de la porte, il y avait lieu de supposer qu’ils songeaient à s’en aller. Boris cependant se serait peut-être décidé à rester jusqu’au soir. Déjà il venait de s’engager dans un galant débat avec Sophie, qui, d’une voix coquette, lui demandait s’il n’était pas surpris qu’elle vécût ainsi seule dans la retraite. Mais Pierre voulait partir, et il sortit pour donner l’ordre au cocher d’atteler les chevaux.
Quand la voiture fut prête, Sophie essaya encore de retenir ses deux hôtes, et leur reprocha gracieusement la brièveté de leur visite. Boris s’inclina, et, par son attitude irrésolue, par l’expression de son sourire, semblait lui dire que ce n’était pas à lui que devaient s’adresser ses reproches. Mais Pierre déclara résolument qu’il était temps de partir pour pouvoir profiter du clair de lune. En même temps, il s’avançait vers la porte de l’antichambre. Sophie offrit sa main aux deux amis, pour leur donner le shakehand, à la façon anglaise. Boris seul accepta cette courtoisie, et serra assez vivement les doigts de la jeune femme. De nouveau elle cligna les yeux, de nouveau elle sourit et lui fit promettre de revenir prochainement. Pierre était déjà dans l’antichambre, enveloppé dans son manteau.
Il s’assit en silence dans la voiture, et lorsqu’il fut à quelques centaines de pas de la maison de Sophie :
« Non, non, murmura-t-il, cela ne va pas.
– Que voulez-vous dire ? demanda Boris.
– Cela ne vous convient pas, répéta-t-il avec une expression de dédain.
– Si vous voulez parler de Sophie Cirilovna, je ne puis être de votre avis. C’est une femme, il est vrai, un peu prétentieuse, mais agréable.
– C’est possible dans un certain sens. Mais songez au but que je m’étais proposé en vous conduisant près d’elle. »
Boris ne répondit pas.
« Non, reprit Pierre. Cela ne va pas. Il lui plait de nous déclarer qu’elle est épicurienne. Et moi, s’il me manque deux dents au côté droit, je n’ai pas besoin de le dire. On le voit assez. Eu outre, je vous le demande, est-ce là une femme de ménage ? Je sors de chez elle sans avoir pu satisfaire mon appétit. Ah ! qu’elle soit spirituelle, instruite, de bon ton, je le veux bien ; mais, avant tout, donnez-moi une bonne ménagère, que diable ! Je vous le répète, cela ne vous convient pas. Est-ce que ce domestique, avec son gilet rouge, et ces plats recouverts de cloches en fer-blanc, vous ont étonné ?
– Il n’était pas nécessaire que je fusse étonné.
– Je sais ce qu’il vous faut. Je le sais à présent.
– Je vous assure que j’ai été très content de connaître Sophie Cirilovna.
– J’en suis charmé. Mais elle ne vous convient pas. »
En arrivant à la maison de Boris, Pierre lui dit :
« Nous n’en avons pas fini. Je ne vous rends pas votre parole.
– Je suis à votre disposition, répondit Boris.
– Très bien. »
Une semaine entière s’écoula à peu près comme les autres, si ce n’est que Pierre disparaissait quelquefois pendant une grande partie de la journée. Un matin, il se présenta de nouveau chez son ami, dans ses vêtements d’apparat, et invita Boris à venir faire avec lui une autre visite.
« Où me conduisez-vous aujourd’hui ? demanda Boris, qui avait attendu cette seconde invitation avec une certaine impatience, et qui se hâta de faire atteler son traîneau ; car l’hiver était venu, et les voitures étaient remisées pour plusieurs mois.
– Je veux vous présenter dans une très honorable maison, à Tikodouïef. Le maître de cette maison est un excellent homme qui s’est retiré du service avec le grade de colonel. Sa femme est une personne fort recommandable, et il y a là deux jeunes filles fort gracieuses, qui ont reçu une éducation de premier ordre et qui en outre ont de la fortune. Je ne sais laquelle des deux vous plaira le plus. L’une est vive et animée, l’autre un peu trop timide. Mais toutes deux sont de vrais modèles. Vous verrez.
– Et comment s’appelle le père ?
– Calimon Ivanitch.
– Calimon ! Quel singulier nom. Et la mère ?
– Pélagie Ivanovna. L’une de ses filles s’appelle aussi Pélagie ; l’autre Émérance.
– Émérance ! Calimon. Jamais je n’ai entendu prononcer de noms semblables. Émérance, Calimovna ! Quel assemblage !
– Je l’avoue. Mais cette jeune fille est remplie de je ne sais quelle flamme de vertu.
– Comme vous devenez poétique, mon cher Pierre. Et cette belle Émérance est-ce celle qui est si timide ?
– Non. C’est sa sœur. »
L’habitation de Calimon ne ressemblait guère à la coquette villa de la jeune veuve. C’était un vaste et lourd bâtiment, avec des fenêtres étroites et des vitres ternes. Devant la façade s’élevaient deux grands bouleaux, et de l’autre côté, de vieux tilleuls dont la cime surpassait, le toit de la maison, dont les noirs rameaux s’étendaient au loin. En été, ces arbres gigantesques devaient par leur feuillage décorer cette retraite. En hiver ils l’assombrissaient. Enfin toute cette maison avait une apparence de tristesse et de vétusté qui ne pouvait produire une impression agréable.
Les deux visiteurs se firent annoncer et furent introduits dans le salon. Le maître et la maîtresse du logis s’avancèrent à leur rencontre ; mais pendant quelques instants ils ne purent exprimer que par des signes et des gestes de politesse ce qu’ils voulaient dire, et les deux amis ne pouvaient pas mieux se faire comprendre, car, à leur approche, quatre barbets s’étaient levés et faisaient par leurs aboiements un vacarme effroyable. En les frappant avec des mouchoirs, en les menaçant du pied et de la main, on parvint, non sans peine, à les apaiser, et une servante entraîna dans une chambre voisine le plus obstiné, qui la mordit au doigt.
Dès que le calme fut rétabli, Pierre présenta son ami à M. et à Mme Calimon, qui lui dirent à la fois combien ils se réjouissaient de le voir. Puis M. Calimon présenta Boris à ses filles. Il y avait encore là deux femmes d’un certain âge, très modestement vêtues, qui se tenaient à l’écart, et auxquelles personne ne semblait faire attention.
Calimon Ivanitch était un homme de cinquante ans, à la taille élevée, aux cheveux gris. Sa physionomie, un peu vulgaire, avait une expression de bonté, d’apathie et d’indifférence. Sa femme, maigre, petite, portant sur la tête un lourd échafaudage de coiffure, semblait être au contraire dans une agitation perpétuelle. Sa figure avait depuis longtemps perdu la fraîcheur de la jeunesse. Ses deux filles formaient entre elles un singulier contraste. Pélagie avait le teint brun, les cheveux noirs, et un air de réserve, de timidité extraordinaires. Elle se tenait, comme un enfant craintif, derrière ses parents ; tandis que sa sœur s’avançait d’un pas léger, avec ses cheveux blonds, ses joues purpurines, sa bouche en cœur, son nez légèrement retroussé et ses yeux étincelants. À la voir, il était aisé de deviner qu’elle jouait habituellement un grand rôle dans le salon paternel, et qu’elle n’en était point embarrassée. Elle portait, ainsi que sa sœur, une robe blanche avec une profusion de rubans bleus qui se soulevaient et flottaient au moindre mouvement. La couleur de ces rubans s’harmonisait très bien avec l’ensemble de sa physionomie, et s’accordait mal avec celle de Pélagie. Mais il eût été difficile de dire quel genre de toilette pouvait convenir à Pélagie, quoique pourtant elle ne fût pas laide.
On s’assit. Les maîtres de la maison adressèrent à leurs hôtes quelques banales questions de politesse, avec cet air affecté et contraint que l’on remarque ordinairement entre des gens qui se voient pour la première fois. Les deux amis leur répondirent sur le même ton. L’entretien était froid et difficile. Calimon, qui n’avait pas l’esprit très inventif, ayant demandé pour la seconde fois à Boris s’il était depuis longtemps dans le pays, sa femme lui fit remarquer sa distraction avec l’accent mielleux qu’elle avait coutume d’employer devant des étrangers. Le colonel, confus, tira de sa poche son mouchoir et se moucha si bruyamment que les chiens se mirent de nouveau à aboyer, et qu’il fallut de nouveau courir près d’eux pour les apaiser.
Émérance parvint enfin à rendre à ses parents le service qu’elle leur rendait habituellement en de telles circonstances. Elle s’assit près de Boris, elle anima l’entretien par des questions insignifiantes, il est vrai, mais vives et gracieuses. Bientôt la conversation devint de part et d’autre plus libre. Chacun s’y associa, à l’exception de Pélagie, qui restait immobile, les yeux fixés sur le plancher, tandis que l’alerte Émérance souriait, gesticulait, causait, puis, de temps à autre, s’arrêtait et semblait se dire : Voyez, comme je suis aimable et bien élevée ; voyez, comme je sais plaire à tout le monde. Il semblait même que son zézaiement ne provenait que de l’excès de sa bonté. Elle riait en donnant des inflexions prolongées et doucereuses à son rire, quoique Boris ne dit rien qui pût lui mériter une telle grâce ; elle sourit encore plus quand elle le vit s’égayer et s’enhardir à quelques vives répliques.
Pierre sourit aussi, et comme on en était venu à parler des beaux-arts, tout à coup il s’écria que son ami aimait beaucoup la musique.
« Et moi aussi, dit Émérance, je suis passionnée pour la musique.
– Non seulement, reprit Pierre, vous avez cet excellent goût, mais vous êtes une musicienne accomplie.
– En vérité ! dit Boris.
– Oui, ajouta Pierre. Émérance et Pélagie Calimovna jouent du piano avec un rare talent, surtout Émérance. »
En entendant prononcer son nom, Pélagie frissonna. Émérance baissa modestement les yeux.
« Ah ! mesdemoiselles, s’écria Boris, est-ce que j’oserais vous prier ? est-ce que vous voudriez être assez bonnes ?
– Mais, vraiment ! murmura Émérance, je ne sais si je puis… » Et jetant un regard de côté à Pierre : « Je vous en veux, » dit-elle d’un ton de voix qui démentait son reproche.
Pierre, qui n’était pas homme à se laisser si aisément déconcerter, se tourna vers Mme Calimon.
« Je vous en prie, dit-il, ordonnez donc à mesdemoiselles vos filles de jouer et de chanter quelque chose.
– Je ne sais si elles sont en voix aujourd’hui, répondit la mère ; mais elles peuvent essayer.
– Oui, oui, ajouta le colonel, il faut qu’elles essayent.
– Mais, maman, je vous assure que je ne puis.
– Émérance, quand je le veux, » répliqua Mme Calimon en français. Elle avait l’habitude de donner ses ordres à ses filles en français, quand il y avait des étrangers chez elle, lors même que ces étrangers comprenaient cette langue ; et ce qu’il y avait de plus singulier, c’est qu’elle-même ne la parlait que très difficilement et la prononçait fort mal.
Émérance se leva.
« Que faut-il chanter ? demanda-t-elle d’un ton soumis.
– Votre duo, qui est charmant. Mes filles, ajouta-t-elle en s’adressant à Boris, ont chacune une voix différente. Émérance a une voix de soprano.
– De soprano, répliqua Boris.
– Oui, de soprano, et Pélagie une voix de contralto.
– De contralto ? C’est délicieux.
– Il ne m’est pas possible de chanter aujourd’hui, balbutia Pélagie ; je suis trop enrouée. »
Sa voix, en effet, ressemblait plus en ce moment à la basse qu’au contralto.
« Eh bien ! Émérance, chantez cet air italien ; vous savez, celui que vous aimez, et Pélagie vous accompagnera.
– Cet air avec des roulades, des petites machines entortillées ; très bien », ajouta le colonel.
Les deux sœurs s’avancèrent vers le piano ; Pélagie leva le couvercle de l’instrument, ouvrit son cahier de musique et s’assit. Émérance se plaça debout, près d’elle, dans une attitude plastique, sous le regard attentif de Boris. De temps à autre, pour se donner une nouvelle pose, elle portait son mouchoir à ses lèvres. Enfin, elle chanta, comme chantent la plupart de nos jeunes filles, d’une voix glapissante qui, parfois, résonnait comme un gémissement. Elle prononçait si mal les paroles qu’il n’était pas possible de les comprendre ; à certaines accentuations, on reconnaissait seulement que c’était de l’italien. À la fin de ce morceau, elle se lança dans des roulades qui enchantèrent tellement le colonel qu’il se leva tout transporté sur sa chaise ; mais elle précipita le morceau et elle avait fini de chanter quand sa sœur continuait encore l’accompagnement. Cette petite méprise n’empêcha pas Boris de lui adresser de très vifs compliments ; et Pierre, après s’être écrié à diverses reprises : « À merveille ! à merveille ! » lui dit : « À présent, ne pourriez-vous pas nous faire, entendre un air russe, la romance du Rossignol, ou celle de la Fiancée, ou une chanson de bohémienne ? Toutes vos compositions étrangères peuvent être très jolies, mais, pour nous, elles ne valent pas notre bonne musique nationale.
– Je suis de votre avis ! s’écria le colonel.
– Chantez la romance de la Fiancée, dit à voix basse, mais d’un ton ferme, et toujours en mauvais français, Mme Calimon à sa fille.
– Non, dit le colonel ; j’aimerais mieux la chanson des Bohémiennes ou celle du Soldat. »
Émérance obéit. Son père, qui connaissait depuis longtemps ces airs par cœur, chantait avec elle, et Pierre était dans le ravissement.
« Voilà, disait-il, ce qui charme nos oreilles, voilà de vraies mélodies. Ah ! mademoiselle, vous avez raison d’aimer la musique. Vous êtes une artiste de premier ordre.
– Vous en dites trop, murmura Émérance en quittant le piano.
– À présent, reprit sa mère, chantez la romance de la Fiancée. »
Émérance se hâta de nouveau d’obéir.
« Maintenant, ajouta l’insatiable Mme Calimon, jouez votre sonate à quatre mains… Mais non, mieux vaut peut-être la remettre à une autre fois. Vous êtes peut-être fatiguée, et je crains d’ennuyer M. Boris.
– Comment donc, madame ? » s’écria Boris.
Mais Émérance déclara qu’elle était fatiguée, et le courtois visiteur s’approcha d’elle pour lui renouveler ses compliments.
« Ah ! monsieur Boris, lui dit-elle, vous avez entendu bien d’autres virtuoses ! Qu’est-ce que mon chant, comparé au leur ? Cependant Bomerius, à son passage ici, m’a affirmé… Vous connaissez sans doute Bomerius ?
– Non. Qui est-il ?
– Un élève du Conservatoire de Paris, un musicien éminent, un violon admirable. Il m’a dit que si ma voix était cultivée, si je pouvais avoir des leçons d’un bon maître, j’arriverais tout simplement à produire un effet merveilleux, et il m’a baisé les doigts l’un après l’autre… Mais ici, comment prendre des leçons ? »
Et Émérance soupira.
« Cependant avec vos dispositions naturelles… repartit Boris, avec votre talent… » Mais il ne put achever cette phrase qui l’embarrassait.
– Émérance, dit Mme Calimon, demandez, pourquoi… que…, le dîner.
– Oui, maman, » répondit la jeune fille, en sautillant du côté de la porte.
Elle ne sautillait ainsi que lorsqu’il y avait des étrangers au salon.
Boris s’approcha de Pélagie, qui ne put voir ce mouvement sans une sorte d’effroi.
« Vous avez, lui dit-il, accompagné votre sœur avec une rare habileté. »
Pélagie rougit jusqu’au blanc des yeux et ne répondit pas.
« Je regrette de n’avoir pas entendu votre duo. À quel opéra appartient-il ? »
Pélagie tournait de côté et d’autre un regard inquiet, et ne pouvait prononcer un mot.
« Quelle est la musique que vous préférez, reprit-il après un moment d’attente, celle d’Italie ou celle d’Allemagne ? »
Pélagie restait muette.
« Mais répondez donc, lui cria sa mère.
– J’aime tous les genres de musique, balbutia enfin la pauvre créature.
– Comment, tous ? cela me semble difficile. Par exemple, Beethoven est un compositeur de génie, mais il ne peut être apprécié par tous les amateurs.
– Non, murmura Pélagie.
– L’art est infini dans sa variété.
– Oui. »
Boris n’essaya pas de continuer ce pénible entretien.
« Non, se dit-il, il n’y a pas moyen de la faire parler. C’est l’image vivante de la peur. »
À la fin de cette journée, quand la pauvre Pélagie fut rentrée dans sa chambre, elle raconta à sa camériste ce qu’elle avait souffert, comment on l’avait obligée à faire de la musique devant un inconnu, comment elle n’avait su que répondre aux questions qu’il lui adressait, et toutes ses anxiétés quand il arrivait des étrangers, et les reproches que lui faisait sa mère.
À table, Boris fut placé entre M. Calimon et Émérance. Le dîner, préparé et servi tout entier à la façon russe, parut beaucoup plus agréable à Pierre que le repas raffiné de la jeune veuve. Pélagie, qui se trouvait assise à côté de lui, parvint peu à peu à surmonter sa timidité et finit par causer assez aisément avec lui, tandis que la coquette Émérance s’efforçait tellement de captiver l’attention de son voisin qu’il en était fatigué. Elle avait surtout une façon de tourner la tête qui lui déplaisait, et ce qui lui déplaisait encore plus, c’était de la voir toujours occupée d’elle-même, parlant sans cesse de sa propre personne, et racontant avec une assurance imperturbable les plus petits incidents de sa vie. Mais, en homme bien élevé, il maîtrisait ses impressions désagréables, et les dissimulait si bien que Pierre, qui l’observait attentivement, ne pouvait les deviner.
Après le dîner, le colonel devint très taciturne, ou, pour mieux dire, il était assoupi. Car, à ce moment de la journée, il avait l’habitude de faire la sieste. Il essaya pourtant de retenir ses hôtes, qui annonçaient leur intention de se retirer.
« Pourquoi donc, leur disait-il, nous quitter si vite ? Ne voulez-vous pas faire une petite partie de cartes ? » Mais au fond du cœur il se réjouit de les voir prendre leurs chapeaux.
Sa femme, au contraire, fit tous ses efforts pour les garder plus longtemps, et, dans cette tentative, elle était vivement secondée par Émérance, qui employait toutes sortes d’arguments pour les décider à retarder leur départ. Pélagie s’adjoignit aussi à elle, et, de sa voix craintive, balbutia : « Mais, messieurs… »
Pierre ne disait ni oui ni non, et s’en rapportait à la volonté de son ami. C’était la contre-partie de ce qui était arrivé chez Sophie Cirilovna. Boris déclara qu’il était absolument obligé de retourner chez lui, et s’éloigna en promettant de revenir bientôt. Émérance fixa sur lui un dernier regard.
Le colonel suivit ses deux hôtes jusque dans l’antichambre, resta là tandis que leur domestique les enveloppait dans leurs écharpes et leurs manteaux, et leur donnait des bottes fourrées, puis rentra dans son cabinet et s’endormit. Pendant ce temps, Pélagie, pour échapper aux réprimandes de sa mère, se sauva dans sa chambre, et les deux femmes qui avaient assisté comme deux muets comparses à cet événement de la journée félicitèrent Émérance sur sa nouvelle conquête.
Les deux amis voyageaient en silence. Boris, riant en dedans de lui-même, la tête plongée dans les replis de son collet de genette, attendait que Pierre prît la parole.
Celui-ci enfin s’y décida.
« Cette fois encore, dit-il, cela ne va pas ? »
Mais il prononçait ces mots d’un ton dubitatif, en cherchant à voir la figure de Boris pour fixer son indécision, et, ne pouvant y parvenir, il répéta sa première interrogation :
« Cela ne va pas ?
– Non assurément, répondit Boris en riant.
– Je m’en doutais. Mais pourquoi donc cela ne vous convient-il pas ? Que manque-t-il à cette jeune fille ?
– Il ne lui manque rien ; au contraire, elle n’a que trop d’agréments.
– Eh quoi ! c’est là votre objection ?
– Oui.
– En vérité, je ne vous comprends pas. Est-ce qu’elle n’est pas très bien élevée ? est-ce que son caractère, sa façon d’être…
– Mais c’est moi, Pierre, qui ne comprends pas qu’avec votre droiture de jugement vous puissiez vous abuser sur la nature de cette belle Émérance. Vous n’avez donc point remarqué cette fatigante amabilité, cette constante adoration d’elle-même, cette complaisance dans le sentiment de ses qualités, cette sorte de condescendance d’un être angélique qui daigne abaisser, du haut de ses splendeurs, ses regards sur de simples mortels ? Que vous dirai-je encore ? Elle m’inspire un tel éloignement que, si j’étais forcé d’épouser une des sœurs, j’aimerais mieux cent fois épouser l’autre ; au moins, celle-là sait se taire.
– Vous avez peut-être raison, » répliqua Pierre d’un ton soumis.
Les remarques de son ami l’embarrassaient.
« Non, se disait-il pour la première fois depuis qu’il connaissait Boris, je ne suis pas à sa hauteur ; il est trop fort pour moi.
– En avant ! en avant ! » cria Boris à son cocher.
Le cocher fouetta ses chevaux.
« Eh bien ! mon cher Pierre, reprit Boris en riant lorsqu’il descendit de son traîneau, cela ne va pas ; qu’en pensez-vous ? »
Pierre ne répondit pas et se retira dans sa chambre.
Le lendemain, Émérance écrivait une longue lettre à une de ses amies, et lui disait : « Hier, nous avons eu la visite d’un nouveau voisin, M. Boris Viasovnine. C’est un homme de bonnes manières, très agréable, qui a reçu une éducation distinguée ; et, je te l’avouerai tout bas, il me semble que j’ai fait sur lui une vive impression. Mais ne t’inquiète pas, mon amie, mon cœur est immuable, et Valentin n’a rien à craindre. »
Ce Valentin était professeur au gymnase de la ville voisine ; dans cette résidence, il s’abandonnait à toutes sortes de folies, et au village il se livrait près d’Émérance à un amour platonique sans espoir.
Après leur infructueuse visite, les deux amis avaient repris leur existence habituelle.
Quelques jours se passèrent. Boris s’attendait à être promptement invité à une autre excursion ; mais Pierre semblait avoir renoncé à ses projets. Pour l’y ramener, Boris se mit à parler de la jeune veuve et de la famille Calimon. Il disait qu’on ne pouvait bien juger les choses en un premier aperçu, qu’il faudrait revoir, et il faisait d’autres insinuations que le cruel Pierre s’obstinait à ne pas vouloir comprendre. À la fin, Boris, impatienté de cette froide réserve, lui dit un matin :
« Eh quoi ! mon ami, est-ce à moi à présent à vous rappeler vos promesses ?
– Quelles promesses ?
– Ne vous souvenez-vous plus que vous voulez me marier ? J’attends.
– Vous avez des prétentions trop difficiles à satisfaire, le goût trop délicat. Il n’y a pas dans ce district une femme qui puisse vous convenir.
– Ah ! ce n’est pas bien à vous, Pierre, de renoncer si vite à votre entreprise. Nous n’avons fait encore que deux essais infructueux ; est-ce une raison pour désespérer ? D’ailleurs, la veuve ne m’a point déplu. Si vous m’abandonnez, je retourne près d’elle.
– Allez à la grâce de Dieu !
– Pierre, je vous assure très sérieusement que je désire me marier. Faites-moi donc connaître une autre femme.
– Je n’en connais pas dans tout ce canton.
– C’est impossible ; vous ne pouvez me faire croire qu’il n’existe pas une agréable personne à plusieurs lieues à la ronde.
– Je vous dis la vérité.
– Voyons, réfléchissez, cherchez un peu dans votre esprit. »
Pierre mordait le bout d’ambre de sa pipe. Après un long silence, il reprit :
« Je pourrais bien vous indiquer encore Viéra Barçoukova. Une très brave fille ! Mais elle ne vous convient pas.
– Et pourquoi ?
– Parce qu’elle est trop simple.
– Tant mieux !
– Et son père est si bizarre !
– Qu’importe ? Allons, Pierre Vasilitch, allons, mon bon ami, faites-moi connaître Mlle… Comment l’appelez-vous ?
– Viéra Barçoukova. »
Boris insista tellement que Pierre finit par lui promettre de le conduire dans la maison de la jeune fille.
Le surlendemain, ils étaient en route. Étienne Barçoukof était en effet, comme Pierre l’avait dit, un homme de la nature la plus bizarre. Après avoir achevé d’une façon brillante son éducation dans l’un des établissements de la couronne, il était entré dans la marine et y avait acquis promptement une notable distinction ; puis, un beau jour, il avait tout à coup quitté le service pour se retirer dans son domaine, pour se marier ; puis, ayant perdu sa femme, il était devenu si sauvage qu’il ne faisait plus aucune visite et ne sortait pas même de sa demeure. Chaque jour, enveloppé dans sa touloupe, les pieds dans des babouches, les mains dans ses poches, il se promenait de long en large dans sa chambre, en fredonnant ou en sifflant, et à tout ce qu’on lui disait il ne répondait que par un sourire et une exclamation : Braou ! braou ! ce qui, pour lui, signifiait : bravo ! bravo !
Ses voisins aimaient à venir le voir, car, avec toute son étrangeté, il était très bon et très hospitalier. Si un ami, à sa table, lui disait :
« Savez-vous, Étienne, qu’au dernier marché de la ville le seigle s’est vendu trente roubles ?
– Braou ! braou ! répondait Étienne, qui venait de livrer le sien à moitié prix.
– Avez-vous appris, disait un autre, que Paul Temitch a perdu 20 000 roubles au jeu ?
– Braou ! braou ! répliquait Étienne avec le même calme.
– On affirme, disait un troisième, qu’une épizootie a éclaté dans le village voisin.
– Braou ! braou !
– Mademoiselle Hélène s’est enfuie avec l’intendant.
– Braou ! braou ! »
Et toujours le même cri. Soit qu’on vint lui annoncer que ses chevaux boitaient, qu’un juif arrivait au village avec une cargaison de marchandises, qu’un de ses meubles était brisé, que son groom avait perdu ses souliers, il répétait avec la même indifférence : Braou ! braou ! Cependant, sa maison n’était point en désordre ; il ne faisait point de dettes, et ses paysans vivaient dans l’aisance.
Nous devons dire en outre que l’extérieur d’Étienne Barçoukof était agréable. Il avait la figure ronde, de grands yeux vifs, un nez bien fait et des lèvres roses qui avaient conservé la fraîcheur de la jeunesse, une fraîcheur rehaussée encore par la teinte argentée de ses cheveux. Un léger sourire errait habituellement sur ses lèvres et se répandait même sur ses joues. Mais il ne riait jamais, ou il lui arrivait d’être saisi d’une sorte de rire convulsif qui le rendait malade. S’il était obligé de prononcer quelques autres mots que son exclamation accoutumée, il ne le faisait qu’à la dernière extrémité, et en abrégeant toujours autant que possible ses paroles.