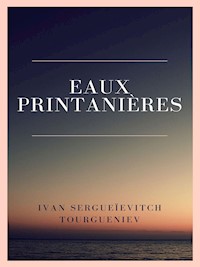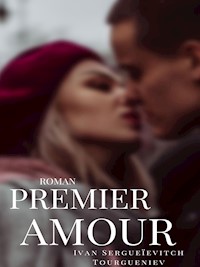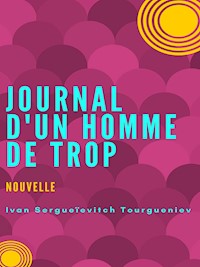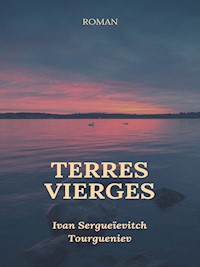
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
1868, St Pétersbourg, un groupe de jeunes gens, petit cercle politique, attendent le propriétaire des lieux, Néjdanof. Celui-ci est engagé, à la suite d'une annonce sur le journal, pour être le précepteur du fils du conseiller privé, Sipiaguine. Nous pénétrons dans la vie de ce dernier personnage et de Néjdanof, et ainsi les arcanes politiques de la Russie d'alors. Tout le récit est parsemé de portraits colorés, dans un style très fluide à la lecture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Terres vierges
Terres viergesIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIPage de copyrightTerres vierges
Ivan Sergueïevitch Tourgueniev
I
Au printemps de 1868, vers une heure de l’après-midi, un jeune homme d’environ vingt-sept ans, négligemment et même pauvrement vêtu, montait par l’escalier de service d’une maison à cinq étages située dans la rue des Officiers, à Pétersbourg. Traînant avec bruit des galoches éculées et balançant gauchement sa lourde et lente personne, il atteignit enfin la dernière marche de l’escalier, s’arrêta devant une porte délabrée qui était restée entr’ouverte, puis, sans tirer le cordon, mais en toussant avec fracas pour annoncer sa présence, il pénétra dans une antichambre étroite et mal éclairée.
« Néjdanof est-il là ? cria-t-il d’une grosse voix de basse.
– Non, c’est moi, entrez ! répondit de la pièce voisine une voix de femme, assez rude aussi.
– Machourina ? demanda le nouveau venu.
– Oui… Et vous, Ostrodoumof ?
– Pimène Ostrodoumof, » répondit-il.
Aussitôt, il se débarrassa de ses galoches, pendit à un clou son manteau râpé, et entra dans la chambre d’où partait la voix de femme.
C’était une pièce malpropre, au plafond bas, aux murs badigeonnés d’une couleur vert sale, qu’éclairaient à peine deux petites fenêtres poussiéreuses. Elle avait pour tout mobilier un lit de fer dans un coin, une table au milieu, quelques chaises, et une étagère surchargée de livres.
Près de la table était assise, fumant une cigarette, une femme de trente ans environ, nu-tête, vêtue d’une robe de laine noire.
En voyant entrer Ostrodoumof, elle lui tendit silencieusement sa large main rouge. Celui-ci répondit non moins silencieusement à son étreinte, se laissa tomber sur une chaise, et tira de sa poche une moitié de cigare.
Machourina lui donna du feu, il alluma son cigare, et tous deux, sans échanger une parole, ni même un regard, se mirent à lancer des tourbillons de fumée bleuâtre dans l’air épais de la chambre, déjà saturé de tabac.
Les deux fumeurs ne se ressemblaient point par les traits du visage ; mais entre ces deux figures ingrates, aux lèvres épaisses, aux grosses dents, au nez mal taillé (Ostrodoumof, en outre, était grêlé), il y avait quelque chose de commun, une expression de loyauté et d’énergie laborieuse.
« Est-ce que vous avez vu Néjdanof ? demanda enfin Ostrodoumof.
– Oui ; il va venir. Il est allé porter des livres à la bibliothèque.
– Qu’est-ce qu’il a à courir comme ça depuis quelque temps ? dit Ostrodoumof en se détournant pour cracher. Il n’y a plus moyen de mettre la main sur lui. »
Machourina prit un second papiros, et l’allumant consciencieusement :
« Il s’ennuie, répondit-elle.
– Il s’ennuie ! répéta Ostrodoumof d’un ton de reproche. Quel enfantillage ! On dirait que nous n’avons rien à faire ! Nous nous demandons comment nous abattrons toute cette besogne, et lui, il s’ennuie !
– Y a-t-il une lettre de Moscou ? demanda Machourina au bout d’un moment.
– Oui ; depuis avant-hier.
– Vous l’avez lue ? »
Ostrodoumof fit un simple signe de tête affirmatif.
« Et que dit-elle ?
– Il faudra bientôt partir. »
Machourina retira le papiros de sa bouche.
« Pourquoi donc ? On m’avait dit que tout allait bien là-bas.
– Ça va son train. Mais il y a un monsieur qui n’est pas sûr… Vous comprenez… il faut le déplacer, ou bien il faudra peut-être le supprimer tout à fait. Et puis il y a encore différentes choses. Vous aussi, vous êtes convoquée.
– Dans la lettre ?
– Oui, dans la lettre. »
Machourina secoua sa lourde chevelure, qui, négligemment tordue et rattachée en arrière, lui retombait sur le front et les sourcils.
« Très bien, dit-elle ; puisque c’est l’ordre, il n’y a pas à discuter.
– Naturellement. Mais sans argent, pas moyen ; et où le trouver, l’argent ? »
Machourina réfléchit.
« Néjdanof doit s’en procurer, dit-elle à demi-voix, comme se parlant à elle-même.
– C’est justement pour cela que je suis venu, fit observer Ostrodoumof.
– Vous avez la lettre sur vous ? lui demanda tout à coup Machourina.
– Oui. Voulez-vous la lire ?
– Donnez… Au fait, non ; nous la lirons ensemble… plus tard.
– Je vous ai dit la vérité, grommela Ostrodoumof ; n’en doutez pas.
– Eh ! je sais bien ! »
Ils se turent de nouveau, et de nouveau les minces filets de fumée que laissaient échapper leurs lèvres silencieuses montèrent en se tordant légèrement au-dessus de leurs têtes chevelues.
Un bruit de pas retentit dans l’antichambre.
« Le voilà ! » murmura Machourina.
La porte s’entre-bâilla, et une tête se glissa par l’ouverture ; mais ce n’était pas celle de Néjdanof.
C’était une figure ronde, aux cheveux noirs et rudes, au front large et sillonné de rides ; ses petits yeux bruns se mouvaient rapidement sous d’épais sourcils ; elle avait un nez en bec de canard, retroussé vers le ciel, et une petite bouche rose drôlement fendue.
Cette tête regarda autour d’elle, salua, sourit – en montrant deux rangées de toutes petites dents blanches, – et pénétra dans la chambre en même temps qu’un torse débile aux bras courts, aux jambes mi-bancales, mi-boiteuses.
Machourina et Ostrodoumof, en l’apercevant, eurent tous deux sur le visage la même expression d’indulgent dédain, à peu près comme s’ils se fussent dit intérieurement : « Ah ! ce n’est que lui. » Ils ne laissèrent échapper ni un mouvement, ni une parole.
Du reste, le nouveau venu, loin d’être choqué de cet accueil, eut l’air d’en éprouver quelque satisfaction.
« Qu’est-ce que ça veut dire ? s’écria-t-il d’une voix glapissante. – Un duo ? Pourquoi pas un trio ? Où est donc le premier ténor ?
– C’est de Néjdanof que vous voulez parler, monsieur Pakline ? lui dit Ostrodoumof d’un air très-sérieux.
– C’est justement de lui ; oui, monsieur Ostrodoumof.
– Il rentrera probablement bientôt, monsieur Pakline.
– Enchanté de l’apprendre, monsieur Ostrodoumof ! »
Le petit boiteux se tourna vers Machourina, qui, d’un air renfrogné, continuait à fumer sa cigarette.
« Comment vous portez-vous, très-aimable… très-aimable ?… Ah ! que c’est ennuyeux, je ne peux jamais me rappeler votre prénom ni votre nom patronymique[1] ! »
Machourina haussa les épaules.
« À quoi bon vous les rappeler ? Vous connaissez mon nom de famille. Que vous faut-il de plus ? Et pourquoi cette question : « Comment vous portez-vous ? » Ne voyez-vous pas vous-même que je ne suis pas morte ?
– Parfaitement, parfaitement juste ! s’écria Pakline en gonflant ses narines et en remuant ses sourcils inégaux. Si vous étiez morte, votre très-humble serviteur n’aurait pas l’avantage de vous voir ici et de causer avec vous. Considérez ma question comme un reste de mauvaise habitude surannée. C’est comme pour le prénom et le nom patronymique… Voyez-vous, ça me semble drôle de dire Machourina tout court ! Je sais bien que vos lettres ne sont jamais signées autrement que : Bonaparte… Pardon, Machourina, voulais-je dire ! Mais pourtant… quand on cause…
– Mais qui vous a prié de causer avec moi ? »
Pakline eut un petit rire nerveux, comme s’il avait avalé une gorgée de travers.
« Allons, allons, ma colombe, ne vous fâchez pas, donnez-moi votre main. Vous êtes très-bonne, je le sais bien, et moi non plus je ne suis pas méchant… Allons. »
Pakline tendait la main. Machourina le regarda d’un air sombre ; cependant elle lui tendit la sienne.
« Vous tenez beaucoup à connaître mon prénom ? dit-elle, sans que son visage s’éclaircît. Eh bien, je m’appelle Fiokla[2].
– Et moi, Pimène, ajouta la voix de basse d’Ostrodoumof.
– Ah ! C’est très-instructif, très-instructif ! mais alors, dites-moi donc, ô Fiokla, et vous, ô Pimène, dites-moi donc pourquoi vous me traitez toujours si peu amicalement, tandis que moi…
– Machourina trouve, et elle n’est pas seule de cet avis, interrompit Ostrodoumof, que l’on ne peut pas se fier à vous, parce que vous regardez toutes choses du côté risible. »
Pakline tourna vivement sur ses talons.
« Ah ! voilà, voilà, toujours la même erreur de la part des gens qui me jugent, très-honorable Pimène ! D’abord, je ne ris pas toujours ; et puis ça ne veut rien dire, et l’on peut se fier à moi ; la preuve en est, du reste, dans la confiance flatteuse qui m’a été plus d’une fois témoignée parmi les vôtres. Je suis un honnête homme, moi, très-honorable Pimène ! »
Ostrodoumof murmura quelque chose entre ses dents, et Pakline, secouant la tête, répéta, mais cette fois presque sans sourire :
« Non ; je ne ris pas toujours ! Je ne suis pas un homme gai ! regardez-moi un peu ! »
Ostrodoumof leva les yeux sur lui. En effet, lorsque Pakline ne riait pas et ne parlait pas, son visage prenait aussitôt une expression de tristesse mêlée de crainte : cette expression redevenait drôle et même maligne, dès qu’il ouvrait la bouche. Ostrodoumof cependant ne dit mot.
Pakline se retourna de nouveau vers Machourina.
« Et les études, comment vont-elles ? Faites-vous des progrès dans votre art éminemment philanthropique ? Ça doit être une rude affaire que d’aider un citoyen inexpérimenté à faire sa première apparition dans le monde, eh !
– Oh ! pas du tout, à moins que le petit citoyen ne soit beaucoup plus grand que vous ! » répondit Machourina en souriant d’un air satisfait.
Machourina venait de recevoir le diplôme de sage-femme. Dix-huit mois auparavant, elle avait abandonné sa famille. C’étaient de petits propriétaires nobles du midi de la Russie, et elle était arrivée à Pétersbourg avec six roubles dans sa poche ; entrée à l’école d’obstétrique, elle avait conquis par un travail acharné le grade qu’elle convoitait. Elle était fille et très-chaste… Chose peu étonnante ! s’écriera quelque sceptique en se rappelant ce que nous avons dit de son extérieur. Chose étonnante et rare ! nous permettrons-nous de dire à notre tour.
En entendant la réponse de Machourina, Pakline se remit à rire.
« Bien touché, ma chère ! s’écria-t-il. Ah ! vous êtes vive à la riposte ! Ça m’apprendra ! Aussi, pourquoi suis-je resté si petit ? Mais le maître de céans ne revient pas ; où diable s’est-il fourré ? »
C’est avec intention que Pakline changeait le sujet de l’entretien. Il n’avait jamais su se résigner à sa taille microscopique, à sa chétive personne. Ces défauts physiques lui étaient d’autant plus sensibles qu’il adorait les femmes. Pour leur plaire, que n’aurait-il pas donné ! Le sentiment de sa difformité le rongeait bien plus cruellement que l’humilité de sa naissance ou que la médiocrité de sa position.
Le père de Pakline, simple bourgeois devenu conseiller honoraire à force de roueries, était une espèce d’homme d’affaires que l’on consultait pour les procès, à qui l’on confiait la gestion d’un domaine, d’une maison. À ce métier, il avait amassé un petit pécule ; mais, s’étant mis à s’enivrer sur ses vieux jours, il n’avait rien laissé après lui. Le jeune Pakline se nommait Sila Samsonytch, c’est-à-dire Force, fils de Samson (ce qu’il jugeait être aussi une moquerie du sort) ; il fit son éducation dans une école de commerce où il apprit parfaitement l’allemand. Après avoir passé par diverses épreuves assez désagréables, il trouva enfin une place de quinze cents roubles dans un comptoir. Avec ces maigres ressources, il subvenait non-seulement à ses propres besoins, mais encore à ceux d’une tante malade et de sa sœur, qui était bossue.
À l’époque où se passe notre récit, il venait d’avoir vingt-sept ans. Il avait lié connaissance avec un grand nombre d’étudiants, jeunes gens auxquels il plaisait par la hardiesse quelque peu cynique de ses propos, par la gaieté et l’aplomb de sa parole, enfin par une érudition étroite, mais incontestable et dénuée de tout pédantisme.
Cela ne l’empêchait pas d’être parfois un peu malmené par eux. Un jour, par exemple, qu’il s’était mis en retard pour une réunion « politique », et qu’il présentait des excuses embarrassées, une voix dans un coin se mit à chanter : « Notre pauvre Pakline est un foudre de guerre, » et tout le monde éclata de rire. Pakline finit par rire comme les autres, quoique la colère le mordît au cœur. « Le gredin a mis le doigt sur la plaie, » se dit-il en lui-même.
Il avait fait connaissance avec Néjdanof dans une gargote grecque où il prenait ses repas, et où il émettait des opinions très-libres et très-accentuées. Il prétendait que la cause première de ses tendances démocratiques était précisément cette atroce cuisine grecque, qui lui irritait le foie.
« Oui… où diable s’est-il fourré, le maître de céans ? répéta Pakline. J’ai remarqué que, depuis quelque temps, il n’est pas dans son assiette. Serait-il amoureux ? »
Machourina fronça le sourcil.
« Il est allé à la bibliothèque, pour y chercher des livres. Quant à être amoureux, il a d’autres chiens à fouetter ; et d’ailleurs, de qui le serait-il ?
– De vous ! » faillit répondre Pakline…
Mais il se borna à dire :
« J’ai envie de le voir pour causer avec lui de choses graves.
– De quelles choses ? fit Ostrodoumof. De notre affaire ?
– Peut-être de la vôtre… Je veux dire de la nôtre à tous. »
Ostrodoumof poussa un : Hum ! Il éprouvait une certaine méfiance ; mais aussitôt il se dit : « Après tout, qui sait ? Cette anguille se glisse partout ! »
« Le voilà qui arrive enfin ! » dit tout à coup Machourina ; et dans ses petits yeux cernés, tournés vers la porte de l’antichambre, passa je ne sais quoi de chaud et de tendre, comme une petite tache lumineuse.
La porte s’ouvrit, et cette fois on vit entrer un jeune homme de vingt-trois ans, coiffé d’une casquette, un paquet de livres sous le bras ; c’était Néjdanof lui-même.
[1] En Russie, dans la conversation, il est rare que l'on nomme quelqu'un par son nom de famille ; on n'emploie guère non plus le prénom seul, qui serait trop intime ou trop familier. L'appellation généralement usitée, – qui a l'avantage d'être à la fois familière avec les inférieurs et respectueuse avec les supérieurs, – est analogue à l'antique formule grecque : Achille Péléïade ou fils de Pélée.
[2] En grec Thécla.
II
En apercevant les trois visiteurs, Néjdanof s’arrêta sur le seuil, les enveloppa d’un regard, jeta sa casquette, laissa tomber négligemment ses livres sur le plancher, et, sans dire une parole, alla s’asseoir sur le pied de son lit.
Son joli visage au teint blanc, que la couleur sombre de son abondante chevelure d’un brun roux faisait paraître plus blanc encore, exprimait le mécontentement et le dépit.
Machourina se détourna légèrement, en se mordant la lèvre. Ostrodoumof grommela :
« Enfin ! »
Pakline se rapprocha de Néjdanof.
« Qu’est-ce qui t’arrive, Alexis Dmitritch, Hamlet russe ? Quelqu’un t’a-t-il mis en colère ? ou bien es-tu tombé comme ça tout seul dans la mélancolie ?
– Laisse-moi la paix, Méphistophélès ! répondit Néjdanof avec impatience. Je n’ai pas le temps d’aiguiser avec toi des platitudes. »
Pakline se mit à rire.
« Tu ne t’exprimes pas correctement, mon cher : ce qui est aigu n’est pas plat ; ce qui est plat ne peut pas être aigu.
– C’est bon, c’est bon… tu as de l’esprit, nous le savons.
– Et toi, tu as les nerfs détraqués, répliqua lentement Pakline. Est-ce que, vraiment, il te serait arrivé quelque chose d’extraordinaire ?
– Il ne m’est rien arrivé d’extraordinaire ; il m’est arrivé qu’on ne peut plus mettre le nez dehors, dans cette ignoble ville, sans se heurter à quelque bassesse, à quelque sottise, à quelque absurde injustice, à quelque stupidité ! Il n’y a plus moyen de vivre ici.
– Voilà pourquoi tu as fait annoncer dans les journaux que tu cherches une place et que tu consentirais à quitter Pétersbourg ? grommela encore Ostrodoumof.
– Certainement, je partirai, et avec bonheur ! si seulement je trouvais quelqu’un d’assez bête pour me proposer une place !
– Avant tout, il faut remplir son devoir « ici ! » dit Machourina d’un ton significatif, mais sans cesser de détourner les yeux.
– C’est-à-dire ? » demanda Néjdanof, en faisant volte-face.
Machourina serra les lèvres.
« Ostrodoumof vous l’expliquera, » dit-elle enfin.
Néjdanof se tourna vers Ostrodoumof. Mais celui-ci toussa et dit seulement :
« Plus tard.
– Voyons, sérieusement, reprit Pakline, est-ce que tu aurais appris quelque chose… de désagréable ? »
Néjdanof bondit de son lit, comme poussé par un ressort.
« Eh ! quel désagrément te faut-il encore ? s’écria-t-il à tue-tête. La moitié de la Russie meurt de faim, la Gazette de Moscou triomphe, on introduit chez nous le classicisme, on interdit aux étudiants les caisses de secours ; – partout l’espionnage, l’oppression, la dénonciation, le mensonge et la fausseté ; – on ne peut plus faire un pas… Et tout cela ne lui suffit plus ! Il lui faut encore quelque désagrément nouveau ! Il me demande si je parle sérieusement !…
« Bassanof est arrêté, ajouta-t-il en baissant la voix ; on vient de me le dire à la bibliothèque. »
Ostrodoumof et Machourina levèrent la tête en même temps.
« Mon cher et bon Alexis, commença Pakline, tu es agité, cela se comprend… mais oublies-tu à quelle époque et dans quel pays nous vivons ? Chez nous, l’homme qui se noie doit encore fabriquer lui-même le brin de paille auquel il pourrait s’accrocher. Il s’agit bien de faire du sentiment ! Vois-tu, camarade, il faut savoir regarder le diable dans le blanc des yeux et ne pas s’exaspérer comme un enfant.
– Ah ! je t’en prie, assez ! interrompit Néjdanof avec angoisse, les traits contractés comme sous l’action d’une douleur physique. C’est une affaire entendue, toi, tu es un homme énergique, tu n’as peur de rien ni de personne…
– Peur de personne, moi ? murmura Pakline. Voyons ! voyons !
– Mais qui a pu dénoncer Bassanof ? Je n’y comprends rien.
– Un ami, ça va sans dire ! se hâta d’ajouter Pakline. Les amis sont de première force sur ce chapitre. C’est avec eux qu’il faut tenir l’oreille au guet. Moi, par exemple, j’avais un ami, un si bon garçon ! il s’inquiétait tant de moi, de ma réputation ! Un jour, il arrive chez moi : « Figurez-vous, me dit-il, quelle stupide calomnie on a répandue contre vous ; on prétend que vous avez empoisonné votre oncle, – que, dans une maison où l’on vous avait introduit, vous avez tourné le dos tout le temps à votre hôtesse et que vous êtes resté ainsi toute la soirée, pendant que la pauvre femme pleurait de honte. Quelle stupidité ! Faut-il être idiot pour inventer des bourdes pareilles ! » Eh bien ! imaginez-vous que l’année suivante, m’étant brouillé avec cet ami, je reçois de lui une lettre d’adieu dans laquelle il m’écrivait : « Vous qui avez tué votre oncle ! Vous qui n’avez pas eu honte d’insulter une respectable dame en lui tournant le dos ! etc., etc. » – Voilà ce que c’est que les amis ! »
Ostrodoumof échangea un regard avec Machourina.
« Alexis Dmitritch !… fit-il de sa voix de basse profonde, désirant évidemment mettre fin à cette dépense de paroles inutiles, – nous avons reçu de Moscou une lettre de la part de Vasili Nikolaïevitch. »
Néjdanof tressaillit légèrement et baissa les yeux.
« Qu’est-ce qu’il écrit ? demanda-t-il enfin.
– Elle et moi… Ostrodoumof indiqua sa voisine d’un mouvement de sourcils… nous devons partir.
– Comment ? Elle aussi est convoquée ?
– Elle aussi.
– Eh bien, pourquoi tardez-vous ?
– Naturellement… faute d’argent. »
Néjdanof se leva et s’approcha de la fenêtre.
« Combien vous faut-il ?
– Cinquante roubles… pas un kopek de moins. »
Néjdanof se tut un instant.
« Je ne les ai pas en moment-ci, murmura-t-il enfin en tambourinant avec les doigts sur la vitre ; mais… je peux les trouver. Je les trouverai. As-tu la lettre sur toi ?
– La lettre ? Elle… c’est-à-dire… naturellement !…
– Pourquoi vous cachez-vous de moi constamment ? s’écria Pakline. N’ai-je pas mérité votre confiance ? Et quand même je ne sympathiserais pas entièrement à… ce que vous projetez, – pensez-vous vraiment que je sois capable de vous trahir ou de divulguer votre secret ?
– Sans intention… peut-être ! gronda la voix d’Ostrodoumof.
– Ni sans intention, ni avec intention ! Voilà mademoiselle Machourina qui me regarde en souriant… et moi je vous dis…
– Je ne souris pas du tout ! dit Machourina avec colère.
– Et moi je vous dis, messieurs, continua Pakline, que vous n’avez pas le moindre flair ; que vous ne savez pas distinguer quels sont vos véritables amis ! Parce qu’on rit quelquefois, vous vous imaginez qu’on n’est pas sérieux…
– Certainement ! riposta Machourina du même ton.
– Tenez, par exemple, reprit Pakline avec une nouvelle force, sans répondre cette fois à l’interruptrice, vous avez besoin d’argent… Néjdanof, en ce moment, n’en a pas… Eh bien, je peux vous en donner. »
Néjdanof quitta brusquement la fenêtre.
« Non… non… à quoi bon ?… J’en trouverai… Je prendrai une avance sur ma pension. « Ils » me doivent quelque chose, je m’en souviens. Mais à propos, Ostrodoumof, montre-moi la lettre ! »
Ostrodoumof resta d’abord un moment immobile ; puis il regarda autour de lui ; puis il se leva, se courba jusqu’à terre, releva le bas de son pantalon, retira de la tige de sa botte un morceau de papier soigneusement plié, souffla sur ce papier – on ne sait pourquoi – et le remit enfin à Néjdanof.
Celui-ci, après l’avoir déplié et lu attentivement, le passa à Machourina, qui, s’étant levée de sa chaise, le lut à son tour et le rendit à Néjdanof, bien que Pakline avançât la main pour le prendre.
Néjdanof haussa les épaules, et tendit silencieusement la lettre à Pakline, qui, après l’avoir lue, serra les lèvres d’une façon significative et la replaça sur la table d’un air solennel, sans dire une parole.
Alors Ostrodoumof la prit, alluma une grosse allumette qui répandit dans la chambre une forte odeur de soufre, et, après avoir élevé le papier au-dessus de sa tête comme pour le montrer à tous les assistants, il le brûla à la flamme de l’allumette jusqu’à la dernière bribe, sans ménager ses doigts ; puis il jeta la cendre dans le feu.
Personne n’avait dit un mot, ni fait un mouvement pendant cette opération. Tous regardaient à terre ; Ostrodoumof avait l’air concentré et grave ; on lisait sur le visage de Néjdanof une expression presque méchante ; celui de Pakline indiquait une forte tension intérieure ; quant à Machourina, elle semblait assister à une cérémonie religieuse.
Deux minutes s’écoulèrent ainsi… Puis tous se sentirent un peu embarrassés. Ce fut Pakline qui, le premier, jugea à propos de rompre le silence :
« Eh bien ? dit-il, accepte-t-on, oui ou non, mon offrande sur l’autel de la patrie ? Puis-je apporter, sinon cinquante roubles, au moins vingt-cinq ou trente pour l’œuvre commune ? »
Néjdanof éclata tout d’un coup. La mauvaise humeur qui bouillait en lui, et que la solennelle crémation de la lettre n’avait pas apaisée, n’attendait qu’une occasion pour se faire jour.
« Je t’ai déjà dit que c’est inutile… entends-tu ? inutile ! Je ne permettrai pas… je ne prendrai pas cet argent. J’en trouverai, et tout de suite ! Je n’ai besoin du secours de personne.
– Allons, camarade, dit Pakline, je le vois : tu es un révolutionnaire, mais tu n’es pas un démocrate.
– Dis tout de suite que je suis un aristocrate !
– Eh ! certainement tu es un aristocrate… jusqu’à un certain point. »
Néjdanof eut un rire forcé.
« Tu fais allusion à ma naissance irrégulière. Tu prends une peine inutile, mon cher… Je n’ai pas besoin de toi pour m’en souvenir. »
Pakline frappa dans ses mains.
« Voyons, Alexis, quelle mouche te pique ? Comment peux-tu prendre ainsi mes paroles ? Je ne te reconnais pas aujourd’hui. – Néjdanof fit de la tête et des épaules un mouvement d’impatience. – L’arrestation de Bassanof t’a bouleversé… Mais aussi il se conduisait si imprudemment…
– Il disait tout haut ses opinions ! fit observer Machourina d’un air sombre. Ce n’est pas à nous de le blâmer.
– Fort bien ; mais il aurait pu songer aux autres qu’il compromet peut-être maintenant.
– Pourquoi pensez-vous cela de lui ? mugit à son tour Ostrodoumof. Bassanof est un caractère énergique ; il ne livrera personne ! Et quant à la prudence… voulez-vous que je vous dise ? Il n’est pas donné à tout le monde d’être prudent, monsieur Pakline ! »
Pakline, blessé, voulut répondre, mais Néjdanof lui coupa la parole.
« Messieurs, s’écria-t-il, croyez-moi, laissons en paix la politique pour quelque temps. »
Il y eut un silence. Ce fut de nouveau Pakline qui ranima la conversation.
« J’ai rencontré ce matin Skoropikhine, le grand critique esthétique de toutes les Russies. Quel personnage insupportable ! Toujours bouillonnant, écumant, pétillant ! On dirait une bouteille de mauvais kislistchi[1]… Le garçon qui l’a servie se hâte de la boucher avec son doigt en guise de bouchon ; un grain gonflé s’est arrêté dans le goulot ; tout cela crache et siffle, et quand l’écume est partie, il reste au fond de la bouteille quelques gouttes d’un affreux liquide, qui n’étanche pas la soif et qui, par-dessus le marché, donne la colique… Ce Skoropikhine est un individu pernicieux pour les jeunes gens. »
L’assimilation faite par Pakline, si parfaitement exacte qu’elle fût, n’amena le sourire sur aucun visage. Ostrodoumof seul fit remarquer que les jeunes gens capables de s’intéresser à « l’esthétique » ne valaient pas qu’on les plaignît, quand même le grand critique leur ferait perdre le bon sens.
« Ah ! mais pardon, permettez ! s’écria Pakline avec feu (il s’échauffait toujours davantage à mesure qu’on l’approuvait moins) ; la question, pour n’être pas politique, n’en a pas moins une grande importance ! À en croire Skoropikhine, toute ancienne production artistique est nulle, par cela seul qu’elle est ancienne… Mais, en ce cas, l’art n’est pas autre chose que la mode, et il ne vaut pas la peine qu’on en parle sérieusement ! S’il n’y a pas dans l’art quelque chose d’invariable, d’éternel, alors que le diable l’emporte ! Dans la science, dans les mathématiques, par exemple, regardez-vous Euler, Laplace, Gauss, comme de vieux chevaux de réforme ? Non : vous reconnaissez leur autorité. Mais pour vous autres, Raphaël et Mozart sont des crétins, et votre orgueil se révolte contre leur autorité, à eux ! Les lois de l’art sont plus difficiles à découvrir que celles de la science, je ne dis pas non, mais elles existent, et celui qui nie leur existence est un aveugle, volontaire ou involontaire, peu importe ! »
Pakline s’arrêta… Tous restaient muets comme s’ils se fussent mordu la langue, ou comme s’ils l’eussent pris en grande pitié. Seul Ostrodoumof grommela :
« Tout ça n’empêche pas que je n’aie aucun égard pour les jeunes gens qui se laissent abrutir par Skoropikhine.
– Qu’ils aillent au diable ! Je me sauve ! » se dit Pakline.
Il était venu chez Néjdanof pour lui faire part de ses idées au sujet de l’introduction en Russie d’exemplaires de l’Étoile polaire (la Cloche n’existait déjà plus à cette époque), mais la conversation ayant pris un tour si défavorable, il jugea plus prudent de ne pas soulever cette question.
Il prenait déjà son chapeau, quand tout à coup, sans qu’aucun bruit préalable eût averti nos jeunes gens, une voix se fit entendre dans l’antichambre :
« M. Néjdanof est-il chez lui ? »
C’était une voix de baryton très-agréable et étoffée, dont le timbre éveillait dans l’esprit des idées de suprême distinction, d’élégance parfaite, voire même de parfums exquis.
Les jeunes gens s’entre-regardèrent avec stupeur.
« Monsieur Néjdanof est-il chez lui ? répéta la voix.
– Oui, » répondit enfin Néjdanof.
Le porte s’ouvrit discrètement, d’un mouvement égal et souple, et sur le seuil apparut un homme d’environ quarante ans, grand de taille, bien fait, presque majestueux, qui, ôtant sans précipitation son chapeau admirablement lustré, découvrit une belle tête aux cheveux coupés ras. Vêtu d’un superbe paletot de drap anglais dont le collet, quoique avril touchât à sa fin, était garni d’une riche fourrure de castor, le visiteur frappa tout le monde, Néjdanof, Pakline, Machourina elle-même – mieux que cela, Ostrodoumof ! – par la noble assurance de son allure et l’aimable sérénité de son abord.
Involontairement tous se levèrent en le voyant paraître.
[1] Kislistchi, boisson fermentée et très-gazeuse, qui contient des raisins secs, du sucre, etc.
III
L’élégant visiteur s’avança vers Néjdanof et, avec un sourire plein de condescendance :
« J’ai déjà eu le plaisir de vous rencontrer, dit-il, et même de causer avec vous, monsieur Néjdanof, avant-hier, si vous voulez bien vous en souvenir, au théâtre. »
Le visiteur s’arrêta, attendant une réponse, Néjdanof fit un signe de tête et rougit.
« Oui !… et aujourd’hui je me présente chez vous en conséquence de l’annonce que vous avez fait insérer dans les journaux. J’aurais voulu causer avec vous à ce sujet, si toutefois cela ne gêne pas les personnes présentes… »
Il s’inclina vers Machourina et indiqua Ostrodoumof et Pakline d’un geste de sa main gantée de peau de Suède.
« … Et si je ne les dérange pas…
– Du tout… du tout… répondit Néjdanof, non sans quelque effort, mes amis permettront… Prenez la peine de vous asseoir. »
Le visiteur, de l’air le plus aimable, s’inclina, saisit par le dossier une chaise qu’il rapprocha de lui, mais il ne s’assit pas, – car tout le monde était debout dans la chambre, – et promena autour de lui ses yeux clairs et pénétrants, quoique à demi fermés.
« Au revoir, Alexis Dmitritch, dit tout à coup Machourina, je passerai tantôt.
– Moi aussi, ajouta Ostrodoumof, moi aussi… tantôt. »
Par une sorte de bravade, Machourina, passant à côté du visiteur, alla prendre la main de Néjdanof, la secoua énergiquement et sortit sans saluer personne.
Ostrodoumof sortit à sa suite, faisant résonner ses talons sur le plancher plus que cela n’était nécessaire ; il haussa même les épaules à deux reprises comme s’il eût voulu dire :
« Voilà pour toi, collet de castor ! »
Le visiteur les accompagna tous deux d’un regard poli, légèrement curieux, qu’il ramena ensuite sur Pakline, comme s’il se fût attendu à voir ce dernier suivre l’exemple des deux autres.
Mais Pakline, dont le visage, depuis l’arrivée de l’étranger, s’était éclairé d’une sorte de sourire contenu, se fit tout petit et se réfugia dans un coin. Ce que voyant, le visiteur s’assit. Néjdanof fit de même.
« Je me nomme Sipiaguine… Mon nom ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu ? » commença le visiteur, d’un air d’orgueilleuse modestie.
Mais avant tout, il faut raconter comment Néjdanof l’avait rencontré au théâtre.
On donnait une comédie d’Alexandre Ostrowski : Ne t’assieds pas dans le traîneau d’autrui. Néjdanof, dès le matin, était allé au bureau de location, où il y avait foule. Son intention était de prendre un simple billet de parterre ; mais, au moment où il s’approchait du guichet, un officier, placé derrière lui, tendit un billet de trois roubles par-dessus la tête de Néjdanof en criant au caissier :
« Monsieur aura sans doute besoin qu’on lui rende de la monnaie, – et moi, non ; – passez-moi donc, je vous prie, un fauteuil d’orchestre du second rang… Je suis un peu pressé.
– Pardon, monsieur, lui dit Néjdanof d’un ton sec, moi aussi je prends un fauteuil du second rang. »
Là-dessus, il jeta au caissier un billet de trois roubles, toute sa fortune ; et, le soir venu, il se trouva établi dans la région aristocratique du théâtre Alexandra.
Assez mal vêtu, sans gants, les bottes non cirées, il se sentait troublé, et en même temps furieux contre lui-même à cause de ce trouble. Son voisin de droite se trouvait être un général constellé de décorations ; son voisin de gauche était précisément cet élégant visiteur, le conseiller privé Sipiaguine, dont l’apparition, deux jours plus tard, devait si fort émouvoir Machourina et Ostrodoumof.
Le général jetait, par intervalles, un regard sur Néjdanof comme sur quelque chose d’inconvenant, d’inattendu et même de blessant ; quant à Sipiaguine, les regards obliques qu’il dirigeait sur lui n’étaient nullement hostiles.
Les gens qui entouraient Néjdanof n’étaient pas de simples individus ; c’étaient des personnages ; ils se connaissaient tous entre eux, et ils échangeaient de courtes phrases, des compliments, de simples exclamations qui passaient quelquefois, comme ce matin même devant la caisse, par-dessus la tête de Néjdanof ; et lui se tenait immobile, mal à l’aise dans son large et confortable fauteuil, se faisant à lui-même l’effet d’un paria. La mauvaise honte, l’amertume, toutes sortes de sentiments méchants lui gonflaient le cœur. Tout à coup, – ô miracle ! – pendant un entr’acte, son voisin de gauche, non pas le général constellé, mais l’autre, qui n’avait aucune marque de distinction sur la poitrine, lui adressa poliment la parole, avec un air de bienveillance où semblait percer une certaine envie de plaire. Il parlait de la pièce d’Ostrowski, il demandait à Néjdanof, « comme à un des représentants de la jeune génération », ce qu’il pensait de cet ouvrage.
Étonné, presque effrayé, Néjdanof ne répondit d’abord que par des monosyllabes, d’une voix saccadée… À vrai dire, le cœur lui battait très-fort. Puis il se sentit de nouveau furieux contre lui-même : pourquoi diable se troublait-il ainsi ? Son voisin n’était-il pas un homme comme les autres ?
Il se mit à énoncer ses idées sans hésitation, sans atténuation ; à la fin, il se laissa si bien entraîner et parla si haut que son voisin de droite en fut visiblement incommodé.
Néjdanof était un ardent admirateur d’Ostrowski ; mais, malgré tout le respect pour le talent déployé par l’auteur dans cette comédie, il ne pouvait y approuver une tendance évidente à rabaisser la civilisation, tendance que le type caricatural de Vikhoref[1] n’accusait que trop.
Son aimable voisin l’écoutait avec attention, avec complaisance ; et, à l’entr’acte suivant, il renoua conversation avec lui, non plus sur la comédie d’Ostrowski, mais en général sur des sujets tirés de la vie, de la science, et même de la politique. Il s’intéressait visiblement à son jeune et éloquent interlocuteur. Néjdanof non-seulement n’éprouvait plus de gêne, mais par moments, comme on dit, « il donnait de la vapeur. »
« Ah ! tu fais le curieux ! pensait-il. Eh bien, je vais t’en faire voir ! »
Quant au voisin de droite, ce qu’il éprouvait n’était plus de l’inquiétude, mais une indignation mêlée de soupçons.
À la fin du spectacle, Sipiaguine prit congé de Néjdanof de la façon la plus gracieuse ; toutefois il ne désira pas connaître son nom et lui-même ne se nomma pas.
Pendant qu’il attendait sa voiture devant le péristyle, il rencontra un de ses bons amis, le prince G…, aide de camp de l’empereur.
« Je t’ai vu de ma loge, lui dit le prince en souriant à travers ses moustaches parfumées. Sais-tu avec qui tu causais ?
– Non, je ne sais pas ; et toi ?
– Un garçon intelligent, n’est-ce pas ?
– Très-intelligent ! Qui est-il ? »
Le prince se pencha vers Sipiaguine, et lui dit à l’oreille :
« Mon frère, oui, mon frère ! un fils naturel de mon père… il s’appelle Néjdanof. Je te conterai ça… mon père ne l’attendait pas, c’est pourquoi il le nomma Néjdanof[2]. Cependant il s’occupa de lui… Il lui a fait un sort[3]… nous lui payons une pension. C’est un garçon de tête… grâce à mon père, il a reçu une bonne éducation. Seulement, c’est un toqué… un républicain… Nous ne le recevons pas… Il est impossible ! Mais voilà ma voiture ; au revoir. »
Le prince s’éloigna. Le lendemain, Sipiaguine, en lisant la Gazette de police, tomba sur l’annonce insérée par Néjdanof, et il se rendit chez lui.
« Je me nomme Sipiaguine, dit-il à Néjdanof en s’asseyant sur une chaise de paille vis-à-vis du jeune homme qu’il enveloppait d’un regard important et lucide. J’ai appris par les journaux que vous désirez accompagner une famille, et voici ce que je suis venu vous proposer. Je suis marié ; j’ai un fils âgé de neuf ans, un garçon très-bien doué, je n’hésite pas à le dire. Nous passerons à la campagne une partie de l’été et de l’automne, dans le gouvernement de S…, à cinq verstes du chef-lieu. Ne désireriez-vous pas nous accompagner pendant les vacances, pour enseigner à mon fils la langue russe et l’histoire, les deux sujets dont vous faites mention dans votre annonce ? J’ose croire que vous seriez content de moi, de ma famille et même de mon domaine. Un très-beau jardin, une jolie rivière, un bon air, une maison spacieuse… Consentez-vous ? En ce cas, il ne resterait plus qu’à me faire connaître vos conditions, quoique je suppose, ajouta-t-il avec un léger sourire, que, sur ce point, il ne peut pas s’élever entre nous la moindre difficulté. »
Pendant tout le temps que Sipiaguine parlait, Néjdanof était resté les yeux fixés sur lui ; il regardait ce front étroit, peu élevé, mais intelligent, ce nez romain aux lignes fines, ces yeux agréables, ces lèvres régulières d’où sortait un flot de courtoises paroles, ces longs favoris tombants à l’anglaise ; il regardait et ne savait que penser.
« Que signifie tout cela ? se demandait-il. Pourquoi cet homme a-t-il l’air de me faire des avances ? Cet aristocrate… et moi, comment se fait-il que nous soyons là ensemble ? Qu’est-ce qui l’a amené chez moi ? »
Il était si bien enfoncé dans ses réflexions, qu’il n’ouvrit pas la bouche, même alors que Sipiaguine, ayant terminé son petit discours, rentra dans le silence et attendit la réponse.
Sipiaguine jeta un coup d’œil vers le coin où s’était réfugié Pakline, qui le dévorait des yeux, pour le moins autant que Néjdanof. Peut-être était-ce la présence de ce tiers qui empêchait Néjdanof de parler ?
Sipiaguine leva les sourcils d’un air résigné, comme acceptant la bizarrerie d’une situation dans laquelle, d’ailleurs, il était venu se mettre volontairement ; puis, après avoir levé les sourcils, il éleva la voix et répéta la question.
Néjdanof tressaillit.
« Certainement, dit-il avec une certaine précipitation, je… consens… avec plaisir… quoique, je dois vous l’avouer… je ne puisse m’empêcher d’être un peu surpris… n’ayant auprès de vous aucune recommandation… et puis les opinions mêmes que j’ai énoncées avant-hier au théâtre auraient dû plutôt vous détourner…
– Vous vous trompez complètement sur ce point, cher monsieur Alexis… Alexis Dmitritch, je crois, n’est-ce pas ? dit Sipiaguine en souriant. Pour ma part, j’ose l’affirmer, je suis connu comme un homme aux convictions libérales, progressistes ; et vos idées, abstraction faite, – permettez-moi de vous le dire, – d’une certaine dose d’exagération qui est le propre de la jeunesse, vos idées ne sont nullement en contradiction avec les miennes ; – j’ajouterai même qu’elles me plaisent par leur ardeur juvénile. »
Sipiaguine parlait sans la plus légère hésitation ; ses périodes arrondies et moelleuses coulaient, selon l’expression russe, « comme du miel sur de l’huile. »
« Ma femme partage ma manière de voir, continua-t-il ; peut-être même ses opinions se rapprochent-elles plus des vôtres que des miennes ; c’est tout simple, elle est plus jeune que moi. Lorsque, le lendemain de notre entrevue, j’ai lu dans les journaux votre nom, que, par parenthèse, j’avais appris au théâtre, et que vous avez publié, contre l’usage ordinaire, en même temps que votre adresse, – ce fait m’a frappé. J’ai vu là-dedans, – dans cette coïncidence, – une sorte de… pardonnez ce qu’il y a de superstitieux dans mon expression… une sorte d’arrêt de la destinée. – Vous me parlez de recommandations. Votre extérieur, votre personnalité éveillent ma sympathie ; cela me suffit. J’ai l’habitude de me fier à mon coup d’œil. Ainsi je puis espérer… Vous consentez ?
– Je consens, certainement… répondit Néjdanof, et je m’efforcerai de justifier votre confiance. Cependant permettez-moi de vous avertir, dès à présent, que je suis prêt à être le professeur de votre fils, mais non son gouverneur. Je n’ai pas les aptitudes d’un gouverneur, et puis, je ne veux pas me lier, je ne veux pas renoncer à ma liberté. »
Sipiaguine fit avec la main le geste de chasser une mouche.
« Soyez tranquille, mon très-cher monsieur Néjdanof… Vous n’êtes pas du bois dont on fait les gouverneurs ; et, du reste, ce n’est pas d’un gouverneur que j’ai besoin. Je cherche un professeur, et je l’ai trouvé. Et maintenant, les conditions ? Les conditions pécuniaires ? Le vil métal ? »
Néjdanof, embarrassé, hésitait.
« Écoutez, dit Sipiaguine se penchant en ayant de tout son corps, et touchant amicalement du bout du doigt le genou de Néjdanof : – entre gens comme il faut, deux mots suffisent. Je vous propose cent roubles par mois ; les frais de voyage, aller et retour, naturellement à ma charge. – Cela vous va-t-il ? »
Néjdanof rougit de nouveau.
« C’est beaucoup plus que je n’avais l’intention de vous demander… car… je…
– Très-bien ! parfait ! interrompit Sipiaguine. Je regarde l’affaire comme conclue, et vous comme étant de la maison. »
Il se leva de sa chaise avec un air tout joyeux et tout épanoui, comme si on lui eût fait un cadeau. Une sorte de familiarité aimable, presque badine, apparut soudain dans tous ses mouvements.
« Nous partons dans quelques jours, reprit-il d’un ton dégagé ; j’aime à voir arriver le printemps à la campagne, bien que la nature de mes occupations fasse de moi un homme prosaïque, rivé à la ville… Vous me permettrez donc de compter votre premier mois à partir d’aujourd’hui. Ma femme et mon fils sont déjà à Moscou. Elle est partie en avant. Nous les retrouverons à la campagne… dans le sein de la nature. Vous et moi, nous partirons ensemble… en garçons… Hé ! hé !… »
Sipiaguine eut un petit rire bref, partant du nez, très-coquet d’ailleurs.
« Et maintenant… »
Il tira de la poche de son paletot un petit portefeuille noir monté en argent, où il prit une carte de visite.
« Voici mon adresse de Pétersbourg. Venez me voir, voulez-vous, demain, vers midi ? Nous causerons encore un peu. Je vous développerai quelques idées que j’ai sur l’éducation… Et puis nous fixerons le jour de notre départ. »
Sipiaguine prit la main de Néjdanof.
« À propos, ajouta-t-il en baissant la voix d’un air confidentiel, si vous avez besoin d’une avance… je vous en prie, pas de cérémonies ! Un mois si vous voulez. »
Néjdanof ne savait positivement que répondre ; il regardait, toujours incertain, ce visage radieux et avenant qui lui était si étranger, et qui, pourtant, s’avançant là, tout près du sien, lui souriait avec tant de bienveillance.
« Vous n’en avez pas besoin ? hein ? chuchota Sipiaguine.
– Si vous permettez, je vous dirai cela demain, répondit Néjdanof.
– Parfait ! Donc, au revoir ! À demain ! »
Sipiaguine lâcha la main du jeune homme ; il se préparait à sortir…
« Permettez-moi une question, dit tout à coup Néjdanof. Vous me disiez tantôt que c’est au théâtre même que vous avez appris mon nom. Qui est-ce qui vous l’a dit ?
– Qui ? mais une de vos bonnes connaissances, un parent à vous, je crois, un prince… le prince G…
– L’aide de camp ?
– Oui, lui-même. »
Néjdanof rougit – plus fort que jamais – et ouvrit la bouche. Mais il la referma sans rien dire. Sipiaguine lui serra de nouveau la main, – silencieusement cette fois, – le salua, salua Pakline, remit son chapeau en arrivant au seuil, et sortit en emportant sur son visage un sourire satisfait ; on y lisait la conviction de l’impression profonde que sa visite ne pouvait manquer d’avoir faite.
[1] Dans la comédie d’Ostrowski, Vikhoref est un viveur ruiné qui se fait aimer de la fille d’un riche marchand de petite ville, et qui enlève la fille pour être plus sûr qu’on la lui donnera en mariage. Avec ou sans intention, l’éminent dramaturge russe a mis en présence l’élément patriarcal du passé et un produit vicieux de la civilisation.
[2] Néjdanof, mot à mot : « non attendu. »
[3] Les phrases en italique sont en français dans l’original.
IV
Sipiaguine avait à peine disparu que Pakline, bondissant de sa chaise et se précipitant vers Néjdanof, se mit à féliciter son camarade.
« Voilà ce qui s’appelle pêcher un gros esturgeon ! disait-il en riant et en trépignant sur place. – Sais-tu qui est Sipiaguine ? C’est un homme connu de tous, un chambellan, un pilier de la société, si j’ose m’exprimer ainsi, un futur ministre !
– Il m’est parfaitement inconnu, » dit Néjdanof d’un air maussade.
Pakline leva les mains d’un air désespéré.
« Voilà justement notre malheur, mon bon Alexis, c’est de ne connaître personne ! Nous voulons agir, nous voulons mettre le monde entier sens dessus dessous, et nous vivons à l’écart de ce même monde ; nous n’avons de relations qu’avec deux ou trois amis, nous piétinons sur place dans un tout petit cercle…
– Pardon, interrompit Néjdanof, ce n’est pas tout cela. C’est seulement avec nos ennemis que nous refusons de frayer ! Quant aux gens de notre acabit, quant au peuple, nous sommes en constante communication avec lui.
– Là, là, là, là !… interrompit à son tour Pakline. D’abord, pour ce qui est des ennemis, permets-moi de te rappeler les vers de Goethe :
Celui qui veut comprendre le poëte
Doit aller au pays de poésie[1],
et moi je dis :
Celui qui veut comprendre l’ennemi
Doit aller dans le pays ennemi.
« Vivre à l’écart de ses ennemis, ignorer leurs mœurs et leur vie, – absurdité ! – Ab… sur… di… té ! Oui ! oui ! Pour traquer un loup dans le bois, il faut avant tout connaître toutes ses retraites !… Ensuite, tu parlais tout à l’heure de te mettre en communication avec le peuple. Mon pauvre ami ! En 1862, les Polonais se sont « jetés dans les bois »… Et maintenant, c’est nous qui nous jetons dans les bois, c’est-à-dire dans le peuple, qui est pour nous plus sourd et plus sombre que la première forêt venue !
– Alors, selon toi, que faut-il faire ?
– Les Hindous se jettent sous les roues du char de Jaggernaut, continua Pakline d’un air sombre : il les écrase, et ils meurent dans la béatitude. Nous avons aussi notre Jaggernaut… Il nous écrasera, cela est très-certain, mais il ne nous donnera pas la moindre béatitude.
– Mais que faut-il donc faire, à ton avis ? répéta Néjdanof en criant presque. Écrire des romans « à tendance », peut-être ? »
Pakline écarta les bras et pencha la tête sur l’épaule :
« Des romans, tu pourrais en écrire, dans tous les cas, puisque tu as en toi la veine littéraire… Allons, ne te fâche pas, je me tais. Je sais que tu n’aimes pas qu’on fasse allusion à cela. Du reste, je suis d’accord avec toi : ce n’est pas un métier réjouissant que de fabriquer de pareilles machines « farcies », surtout avec les nouvelles tournures à la mode : – « Ah ! je vous aime ! bondit-elle… » « Cela m’est bien égal, se secoua-t-il. » C’est pourquoi, je te répète, pénètre dans toutes les classes, à commencer par la plus haute. Se reposer sur les Ostrodoumofs ne suffit pas. Les Ostrodoumofs sont d’honnêtes gens, de braves cœurs, mais bêtes, bêtes ! Regarde notre ami. Rien chez lui, pas même les semelles de ses bottes, n’est fait comme chez les gens intelligents. Tiens, par exemple, tout-à-l’heure, pourquoi est-il sorti d’ici ? Pour ne pas rester dans la même chambre, pour ne pas respirer le même air qu’un aristocrate !
– Je te prie de ne pas parler ainsi d’Ostrodoumof devant moi ! s’écria Néjdanof avec emportement. Il porte de grosses bottes, parce que les grosses bottes coûtent moins cher !
– Ce n’est pas cela que je voulais dire… commença Pakline.
– Il ne veut pas rester dans la même chambre qu’un aristocrate, – continua Néjdanof en haussant le ton ; – eh bien ! justement je le loue pour cela ! Et surtout, il sait se sacrifier, et si cela est nécessaire, il ira au-devant de la mort, ce que ni toi, ni moi, ne ferons jamais ! »
Pakline fit une piteuse grimace et montra ses petites jambes torses.
« Comment pourrais-je aller me battre, mon cher ami, dis-moi ?… Mais laissons tout cela… Je te répète que je suis heureux de ton rapprochement avec M. Sipiaguine, et que je vois même d’avance là-dedans un grand profit pour notre œuvre. Tu vas te trouver dans le grand monde ; tu verras ces lionnes, ces femmes au corps de velours sur des ressorts d’acier, comme disent les Lettres sur l’Espagne ; étudie-les, mon ami, étudie-les ! Si tu étais un épicurien, j’aurais peur pour toi… vrai ! Mais ce n’est pas pour cela, n’est-il pas vrai, que tu as cherché une place ?
– J’ai cherché une place pour ne pas crever de faim ! répliqua Néjdanof, « et pour me débarrasser de vous tous pendant quelque temps », ajouta-t-il mentalement.
– Naturellement, naturellement ! C’est pourquoi je te répète : observe, étudie !… Quel parfum il a laissé après lui pourtant, ce monsieur ! – Pakline leva le nez pour humer l’air. – C’est justement le parfum ambré dont rêvait la femme du maire dans le Revisor[2].
– Il a interrogé le prince G… sur mon compte, dit d’une voix sourde Néjdanof, qui était retourné devant la fenêtre ; probablement, à l’heure qu’il est, toute mon histoire lui est connue.
– Non pas probablement, mais certainement. Qu’est-ce que ça fait ? – Je parie que c’est précisément cela qui lui a suggéré l’idée de t’avoir pour professeur. Tu as beau dire, tu es un aristocrate par le sang, – Or donc tu es des leurs ! Mais voilà longtemps que je suis ici ; il est temps que je me rende à mon bureau, chez les vils exploiteurs ! – Au revoir, camarade. »
Pakline se dirigeait vers la porte, mais il s’arrêta et se retourna.
« Écoute, Alexis, dit-il d’une voix câline : tout à l’heure tu m’as refusé… je sais bien qu’à présent tu vas avoir de l’argent, mais permets-moi pourtant de faire une toute petite offrande pour l’œuvre commune. Je ne peux pas être utile autrement ; que je le sois au moins avec ma bourse. Tiens, regarde : je mets sur la table un billet de dix roubles. Est-il accepté ? »
Néjdanof ne bougeait pas…
« Qui ne dit rien consent. Merci ! » s’écria joyeusement Pakline, et il disparut.
Néjdanof resta seul… Il continuait à regarder à travers les vitres de sa fenêtre la cour étroite et sombre où les rayons du soleil ne pénétraient jamais, même pendant l’été ; et son visage était aussi sombre que cette cour.
Néjdanof était né, comme nous l’avons déjà appris, du prince G…, riche personnage, général aide de camp, et d’une gouvernante de sa fille, – jolie personne, ancienne élève d’un institut de demoiselles nobles, morte le jour même de ses couches. Il reçut son éducation première dans une pension, chez un Suisse, intelligent et sévère pédagogue, – puis, il entra à l’Université. Il désirait faire son droit ; mais le général, son père, qui détestait les nihilistes, le lança dans « l’esthétique », comme le disait Néjdanof avec une amère ironie, c’est-à-dire qu’il le fit entrer à la faculté historico-philologique. Le père de Néjdanof voyait son fils trois ou quatre fois, au plus, par an, mais il s’intéressait à son sort, et, avant de mourir, il lui laissa par testament, « en souvenir de Nastia » (sa mère), un capital de six mille roubles dont les intérêts lui étaient servis sous forme de pension par ses frères, les princes G…
Ce n’est pas sans raison que Pakline le traitait d’aristocrate ; tout en lui rappelait son origine : la petitesse de ses oreilles, de ses mains, de ses pieds, la finesse de ses traits, un peu trop menus peut-être, la délicatesse de sa peau, la beauté de sa chevelure, le léger grasseyement de sa voix sympathique et chaude. Il était terriblement nerveux, terriblement chatouilleux et impressionnable, capricieux même ; la situation fausse dans laquelle il se trouvait placé depuis l’enfance, avait fort contribué à le rendre susceptible ; mais une générosité innée l’empêchait de devenir soupçonneux et méfiant. – Cette situation fausse expliquait aussi les contradictions qui se trouvaient en lui. D’une propreté scrupuleuse, difficile jusqu’à se dégoûter d’un rien, il affectait la grossièreté et le cynisme en paroles ; idéaliste par nature, passionné et chaste, audacieux et timide tout à la fois, il se reprochait à lui-même, comme un vice honteux, cette timidité, cette chasteté, et regardait comme un devoir de tourner l’idéal en ridicule. Il avait le cœur tendre, et il s’écartait des hommes ; il était facile à irriter, mais ne gardait jamais de rancune. Il s’indignait contre son père qui l’avait lancé dans « l’esthétique » ; ouvertement, il ne s’occupait que de politique et de questions sociales, il prêchait – (avec une parfaite conviction) – les idées les plus avancées ; – mais, en secret, il adorait la poésie, l’art, la beauté dans toutes ses manifestations… il faisait même des vers…
Il cachait très-soigneusement le petit cahier dans lequel il les écrivait, et, parmi ses amis de Pétersbourg, Pakline seul, – grâce au flair qui lui était propre, – en soupçonnait l’existence. Rien ne pouvait si fort blesser Néjdanof qu’une allusion, même très-discrète, à ses tendances poétiques, qu’il considérait comme une impardonnable faiblesse. Son professeur suisse lui avait appris un assez bon nombre de faits ; il ne craignait pas le travail, il s’y livrait même avec plaisir, quoique un peu fiévreusement et sans beaucoup de suite. Ses camarades l’aimaient, attirés par la sincérité, la bonté et la pureté qu’ils trouvaient en lui. Mais le pauvre Néjdanof n’était pas né sous une heureuse étoile ; la vie ne lui était pas facile. Il sentait cela profondément, et, malgré l’attachement de ses amis, il se faisait l’effet d’être à jamais isolé…
Resté seul dans sa chambre, et toujours debout devant la fenêtre, Néjdanof songeait péniblement à son prochain voyage, au tour nouveau et inattendu que prenait sa vie… Il ne regrettait guère Pétersbourg, n’y laissant rien qui lui fût particulièrement cher ; d’ailleurs, ne reviendrait-il pas en automne ? Et pourtant il se sentait plein d’irrésolution, et une mélancolie involontaire l’envahissait.
« Singulier professeur que je fais ! pensait-il ; étrange pédagogue ! »
Il se reprochait presque d’avoir pris cet engagement, quoique, en réalité, un pareil reproche fût injuste. Néjdanof possédait une instruction suffisante, et, malgré les inégalités de son humeur, les enfants venaient à lui sans répugnance, et lui-même s’attachait à eux facilement.
La tristesse qui s’était emparée de lui venait de cette impression qu’éprouvent les mélancoliques, les rêveurs, quand il leur faut changer de place. Les caractères aventureux, les sanguins ignorent cette impression-là ; ils sont plutôt portés à se réjouir quand le cours ordinaire de leur vie est interrompu, quand l’occasion se présente pour eux de changer de milieu.
Néjdanof s’était enfoncé si profondément dans ses rêveries, que peu à peu, presque inconsciemment, il les traduisit en paroles ; les impressions qui flottaient en lui se cadençaient et rimaient entre elles.
« Au diable ! s’écria-t-il tout haut : je crois vraiment que je vais composer des vers ! »
Il se secoua et s’éloigna de la fenêtre ; apercevant le billet de dix roubles que Pakline avait laissé sur la table, il le mit dans sa poche, et commença à se promener de long en large.
« Il faudra que je prenne une avance, se disait-il en lui-même, puisque heureusement ce monsieur me l’a offerte. Cent roubles… et chez mes frères, chez Leurs Altesses ! cent autres roubles… Cinquante pour mes dettes, soixante à soixante-dix pour le voyage, et le reste à Ostrodoumof… ainsi que les dix roubles de Pakline. De plus, nous recevrons encore quelque chose de Merkoulof… »
Pendant qu’il faisait ces calculs, les rimes recommençaient à se croiser dans sa tête. Il s’arrêta, rêveur, et, regardant vaguement de côté, resta sur place. Puis ses mains, comme à tâtons, cherchèrent et ouvrirent le tiroir de la table, au fond duquel elles trouvèrent un petit cahier couvert d’écriture.
Il s’affaissa sur sa chaise devant la table, sans changer la direction de son regard, et là, murmurant des mots insaisissables, secouant de temps en temps sa chevelure, effaçant, raturant, il se mit à aligner des vers.
La porte de l’antichambre s’ouvrit à moitié et la tête de Machourina apparut. Néjdanof ne s’en aperçut pas et continua son travail. Machourina le regarda longtemps fixement, puis secouant la tête à droite et à gauche d’un air de compassion, elle fit un pas en arrière. Mais Néjdanof se redressa tout à coup :
« Ah ! c’est vous ! dit-il, non sans dépit, en fourrant son cahier au fond du tiroir.
– Ostrodoumof m’a envoyée chez vous, dit-elle lentement, pour savoir quand on pourra toucher l’argent. Si vous en recevez aujourd’hui, nous partirons ce soir. »
Néjdanof fronça les sourcils :
« Impossible pour aujourd’hui ; revenez demain.
– À quelle heure ?
– À deux heures.
– Bien. »
Machourina se tut un instant, et tout à coup, tendant la main à Néjdanof :
« Je vous ai dérangé, je crois, dit-elle ; pardonnez-moi. Et puis… je vais partir. Qui sait si nous nous reverrons ? Je voulais vous dire adieu. »
Néjdanof serra la main rouge et froide de Machourina.
« Vous avez vu le visiteur de tout à l’heure ? dit-il. Je me suis entendu avec lui. Je l’accompagne dans son bien, près de S… »
Un sourire passa sur le visage de Machourina.
« Près de S… ! En ce cas, nous nous reverrons peut-être. Il est possible qu’on nous envoie de ce côté-là. »
Machourina soupira.
« Ah ! Alexis Dmitritch…
– Quoi donc ? » demanda Néjdanof.
Machourina prit un air concentré.
« Rien. Adieu ! Rien. »
Elle lui serra la main encore une fois et s’éloigna.
« Personne, dans tout Pétersbourg, ne m’est aussi attaché que cette drôle de fille, pensa Néjdanof ; mais elle aurait bien pu ne pas me déranger ! Bah ! tout est pour le mieux. »
Le lendemain matin, Néjdanof se dirigea vers la demeure de Sipiaguine, et là, dans un superbe cabinet, plein de meubles d’un style sévère tout à fait d’accord avec la dignité de l’homme d’État libéral et du gentleman ; assis devant un vaste bureau sur lequel gisaient dispersés dans un savant désordre, côte à côte avec d’énormes couteaux d’ivoire qui n’avaient jamais rien coupé, des tas de papiers qui n’avaient jamais servi à rien ni à personne ; il écouta pendant une heure entière les discours sensés, bienveillants, onctueux comme un baume, que lui tenait son hôte, toucha enfin l’avance de cent roubles, et, dix jours après, le même Néjdanof, à demi couché sur le divan de velours d’un compartiment particulier de première classe, à côté du même gentleman homme d’État sage et libéral, roulait vers Moscou sur les rails disjoints et durs du chemin de fer Nicolas.
[1] Wer den Dichter will versteh’n
Muss im Dichter’s Lande geh’n…
[2] Revisor, c'est-à-dire l'Inspecteur en tournée, comédie de Nicolas Gogol.
V
Dans le salon d’une grande maison de briques à colonnade et fronton, bâtie vers 1825 par le père de Sipiaguine, – très-connu comme agronome et comme un « arracheur de dents »[1] – Mme Sipiaguine, une fort jolie femme par parenthèse, attendait d’heure en heure l’arrivée de son mari, annoncée par télégramme.
L’arrangement de ce salon portait l’empreinte d’un goût délicat et moderne : tout y était gracieux et engageant, tout, depuis l’aimable bariolage des tentures et des draperies de cretonne, jusqu’aux formes variées des bibelots en porcelaine, en bronze ou en métal, répandus sur les tables et sur les étagères ; tout cela se détachait doucement et se fondait harmonieusement dans les joyeux rayons d’un jour de mai, qui pénétraient en toute liberté à travers les hautes fenêtres grandes ouvertes. Pleine d’un parfum de muguet (des bouquets de cette délicieuse fleur printanière étaient dispersés çà et là), l’atmosphère du salon frémissait parfois, à peine remuée par une légère bouffée de vent qui avait frôlé en passant la verdure épanouie du jardin.
Charmant tableau ! Et la dame elle-même, Valentine Mikhaïlovna Sipiaguine, complétait ce tableau en lui donnant la pensée et la vie.
C’était une femme d’environ trente ans, à la taille élevée, aux cheveux châtain foncé ; son visage, d’un ton uniforme, mais frais, rappelait celui de la madone Sixtine, avec ses yeux veloutés et profonds – Elle avait les lèvres pâles et un peu épaisses, les épaules un peu hautes, les mains un peu grandes… Mais, en somme, celui qui l’aurait vue aller et venir dans son salon, aisée et légère, – tantôt penchant vers une fleur sa taille fine et un peu serrée, pour en respirer le parfum, – tantôt changeant de place quelque vase chinois, tantôt rajustant ses cheveux lustrés devant la glace en fermant à demi ses beaux yeux, – celui-là se serait certainement écrié, en lui-même sinon tout haut, qu’il n’avait jamais rencontré une créature plus ravissante !
Un joli petit garçon de sept ans, tout bouclé, vêtu à l’écossaise avec les jambes nues, fortement pommadé et frisé, entra en courant dans le salon, et s’arrêta court à l’aspect de Mme Sipiaguine.
« Qu’y a-t-il, Kolia[2] ? » lui dit-elle.
Sa voix était aussi moelleuse, aussi veloutée que ses yeux.
« C’est que… maman… fit le petit garçon avec embarras, ma tante m’a envoyé ici… et m’a dit de prendre des muguets… pour sa chambre… Elle n’en a pas… »
Mme Sipiaguine prit son fils par le menton et lui fit lever la tête :
« Dis à ta tante qu’elle envoie chercher des muguets chez le jardinier ; ces muguets-ci sont à moi… Je ne veux pas qu’on y touche. Dis-lui que je n’aime pas qu’on dérange ce que j’ai arrangé. Sauras-tu lui répéter mes paroles ?
– Je saurai… balbutia le petit garçon.
– Voyons, comment diras-tu ?
– Je dirai… je dirai… que tu ne veux pas. »
Mme Sipiaguine se mit à rire. – Et le rire aussi chez elle était moelleux.
« Je vois qu’on ne peut pas encore te donner des commissions. Mais, c’est égal, dis comme tu sauras. »
Le petit garçon baisa vivement la main chargée de bagues de sa mère et se précipita hors du salon.
Mme Sipiaguine le suivit des yeux, soupira, s’approcha d’une cage dorée sur le grillage de laquelle un perroquet vert grimpait en s’aidant prudemment du bec et des pattes, l’agaça un peu du bout du doigt, puis se laissa tomber sur un divan bas, et, prenant sur un guéridon sculpté le dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, se mit à le feuilleter, appuyée au dos du divan.
Une toux respectueuse lui fit lever la tête. Un superbe serviteur en habit de livrée, cravaté de blanc, était sur le seuil de la porte.
« Qu’y a-t-il, Agathon ? dit-elle de la même voix douce.
– Siméon Pétrovitch Kalloméïtsef. Ordonnez-vous de le recevoir ?
– Certainement, fais entrer. Et fais dire à Mlle Marianne qu’elle est priée de vouloir bien venir au salon. »