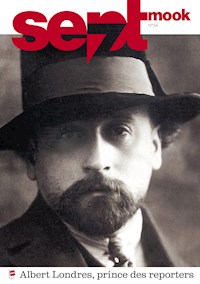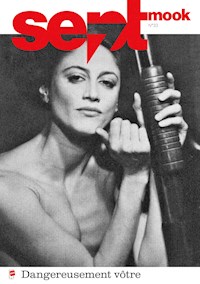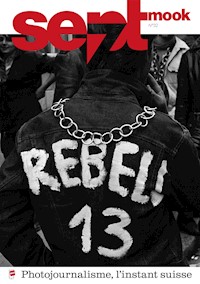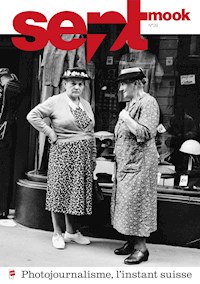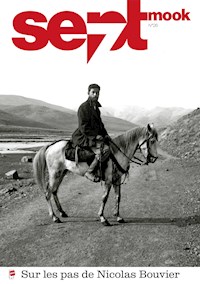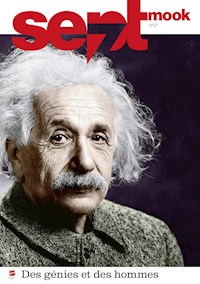I 3Automne 2021 Sept mook Notre manifesteSept, le meilleur du slow journalisme francophoneOsons être utiles. Notre mission n’est pasde vous distraire. Le journalisme utile quenous pratiquons ne veut cependant pas direjournalisme utilisé ou utilitaire. Nous sommesutiles parce que nous éclairons notre temps de manière intelligible et que nous vouspermettons de mieux le comprendre pour faire de vous des citoyens avisés.Osons l’excellence. Nous pratiquons unjournalisme de qualité. Un journalisme vrai quicoûte plus cher qu’une information prémâchéepar des agences de communication ou desgouvernements. Qui ne dépend pas que duseul journaliste. Nos équipes sont multiples:correcteurs, relecteurs, éditeurs, journalistes,photographes, graphistes, multimédiamaticiens,fact-checkers… Ensemble, nous travaillons pourvous livrer un produit artisanal digne d’uneappellation d’origine protégée. Voilà pourquoinous portons le plus grand soin à la forme de nos contenus.Osons innover. Nous améliorons sans cesse nos contenus et nos interfaces grâce à vosindications et remarques pour que votreexpérience utilisateur soit la plus confortable et la plus innovante possible. Au risque, parfois, de nous tromper... pour mieux rebondir.Osons l’intelligence. Nous ne détenons pas lavérité. Nous sommes les porteurs éphémères, lesintermédiaires d’une information qui doit vivre,se répandre, provoquer le débat et faire avancernos sociétés dans l’intelligence et la raison.Osons changer de rythme. Au diktat del’actualité et des réseaux sociaux, nous préféronsles informations négligées et occultées par lamajorité des médias. Nous prenons le temps defouiller, de creuser ailleurs pour vous rapporter etvous raconter des histoires inédites qui font sens.Avec pour seule ligne rédactionnelle, celle d’unregard original sur la marche de notre monde.Osons être longs. Aujourd’hui, nous pouvonschanger le monde en 280 caractères. Mais pour le raconter, pour le comprendre, il en fautbeaucoup plus. Nous donnons donc de l’espace à nos histoires, de l’ampleur, de la longueur et de la nuance, car le monde n’est pas tout blancou tout noir.Osons moins, mais mieux. Produire moins, maismieux. Telle est notre devise. Car l’information quipeut changer le cours du temps doit mijoter delongs mois. Ce temps lui donne de la profondeur,de l’envergure,
10 I Sept mook Automne 2021Patrick VallélianChère lectrice,Cher lecteur,Vingt ans ont passé depuis ce terrible mardi 11 septembre 2001.Ce matin-là, à New York, l’histoire de notre monde a basculé dansl’âge de la terreur. Dix ans après la chute du mur de Berlin et decelle de l’Union soviétique, une nouvelle pièce a fait son apparitionsur le grand échiquier de la politique internationale: l’islamisme.Depuis ces attentats les plus meurtriers jamais perpétrés surle sol américain, une boule de feu a embrasé nos rues, nos pays,nos esprits. Guerre sainte pour les uns, croisade contre le terrorismepour les autres, cette conflagration est sanglante et sans pitié.Quant à son bilan humain, il est d’ores et déjà très lourd et alimentequotidiennement le cycle infernal de l’injustice et de la violence(lire pages 110 à 155).Ce conflit désormais planétaire démontre également que nosdémocraties n’ont aucune peine à piétiner nos libertés fondamentales(lire pages 156 à 179) en emprisonnant des innocents sans raison (lire pages198 à 227), en tentant de cacher des informations compromettantes(lire pages 16 à 53) ou en faisant taire des femmes et des hommes quiauraient pu éviter la catastrophe annoncée (lire pages 72 à 87 et 88 à 109).«La première victime d’une guerre, c’est la vérité», a écrit il y abien longtemps Rudyard Kipling, l’auteur du Livre de la jungle qui étaitégalement grand reporter à l’occasion. Chez Sept, nous sommes trèsattachés à cette quête de la vérité même si nous la savons difficile,chronophage, parfois impossible et souvent périlleuse alors quel’information est devenue un champ de bataille où tous les coupssont permis. Elle est, pour nous, la base du vivre ensemble et d’undébat démocratique vivant et sain.Il nous a donc paru indispensable d’apporter notre pierre à laréflexion sur les attaques du 11 septembre et à leurs conséquencessur notre quotidien en leur consacrant un numéro collector quivous emmène des ruines fumantes de Ground Zero (lire pages 54 à 71)à l’Afghanistan du commandant Massoud (lire pages 228 à 245) enpassant par la prison de Guantanamo (lire pages 180 à 197) où les Etats-Unis ont voulu soigner leurs maux par le mal.Depuis notre fondation en 2014, nous observons notre époque.Nous allons là où nous estimons que l’intérêt public nous guide etnous en rapportons ce que nous voyons, entendons, ressentons. Sanshaine. Sans peur. Avec professionnalisme. Les prix de journalismeaccumulés depuis sept ans le prouvent.EditoImage de couverture: Marcy Borders, surnommée la Dust Lady (Dame de poussière), est décédée en août 2015, victime d’un cancer de l’estomac attribué aux
I 11Automne 2021 Sept mook Voilà comment nous luttons pour la vérité, contre les fake newsqui inondent chaque jour un peu plus notre planète et ses réseauxsociaux. Néanmoins, notre travail serait totalement inutile sansvotre soutien. Alors merci, encore et toujours. Notre média, quiédite, entre autres, le site sept.info, Sept mook et les Cahiers de Sept,
14 I Sept mook Automne 2021Par une tragique ironiedu sort, sans le vouloir, Al-Qaïda s’est débarrasséeen
Frère John et le jeune AliFlamboyant,
La dernière fois que j’ai dîné avec John PatrickO’Neill, il était mort depuis 10 ans. C’étaitle 28 mai 2011 à l’occasion de l’événementle plus important de la décennie depuis le 11 sep-tembre 2001: l’ultime soirée du restaurant Elaine’s,le plus couru de New York, avant sa fermeture défi-nitive. Woody Allen y avait sa table, la numéro 8.«Jackie O», c’était la 10. La 4 pour l’écrivain WilliamStyron. Mais celui qui avait droit à la meilleure table,c’était John O’Neill, la 3, la première en entrantà droite. Et gare à qui s’y asseyait sans l’autori-sation de la patronne Elaine Kaufman. Cette soi-rée aurait dû lui être dédiée. L’endroit était bourréà craquer. Que des potes de John. Des vedettesde télévision, de cinéma, des mafieux, des promo-teurs immobiliers trop gros pour être honnêtes.Ce grand gandin au physique avantageux de starhollywoodienne? C’est Mark Rossini, son frèrespirituel, un ange déchu du FBI comme lui. Etce quinqua un peu épais aux allures de flic new-yorkais? John Miller. Il a tellement fait d’allers etretours entre la police et la presse qu’il ne sait pluslui-même quand il est flic ou journaliste. Il est l’undes rares à avoir interviewé Oussama ben Laden enAfghanistan, et le seul à avoir rejoint la police new-yorkaise avant de devenir le responsable du FBI char-gé de la communication. Ce soir-là, chez Elaine’s,le nom de John O’Neill est sur toutes les lèvres. Il estquestion de ses cigares, un Bonbon avant le repas,un Belicoso après et un autre Bonbon pour aller aubout de la nuit, qu’il achetait exclusivement dansla petite boutique de Paul Garmirian dit «l’Armé-nien» en Virginie. Question de picole aussi, du Baro-lo bien sûr et du Chivaz relevé d’un trait de citron.Et des femmes. Croce e delizia (tourment et joie). Il nemanquait qu’une personne, un ancien du FBI d’ori-gine libanaise, LE protégé de John O’Neill. Mais AliSoufan a horreur des mondanités…En dépit de son air doux, limite premier declasse, d’éternel adolescent toujours propre surlui, Ali Soufan est fait du même alliage que JohnO’Neill. Longtemps, il a été la meilleure arme duFBI contre Al-Qaïda, toujours en première lignedans les endroits les plus chauds de la planète, duYémen à l’Afghanistan. John O’Neill était son mentor,un père. Il a grandi avec lui, grâce à lui. Les deuxhommes ont porté les premières estocades sérieusesaux réseaux de l’organisation dans le monde, bienavant le 11 septembre 2001. De tous les agents duBureau, ils étaient les mieux placés pour empêcherces attaques. Mais la CIA en a décidé autrement auterme d’une incroyable saga qui a fait l’objet d’unesérie télévisée diffusée début 2018, The looming tower.La distribution est d’enfer: qui mieux que Jeff Danielspour jouer John O’Neill, personnage incontournablede l’histoire du FBI, héros baroque, flamboyant, maisaussi touchant? Gamin, John O’Neill se rêvait déjà enagent du FBI. Et pas n’importe lequel, il voulait êtreLewis Erskine, le héros de la série télévisée voulue parJ. Edgar Hoover, The FBI. Son premier emploi: commisau bureau du FBI d’Atlantic City. Son job de guidetouristique au QG du Bureau lui a ensuite permisde payer ses études de criminologie. C’est donc toutnaturellement qu’il rejoint l’organisme d’enquête en1977 à 25 ans. Affecté au bureau de Baltimore, il estl’archétype de l’agent de base (brick agent) avec sonflingue (un 9 mm automatique attaché à la cheville),son badge et sa voiture. Nuit et jour, il arpente lesrues de la ville à la recherche de proies. Il portebeau: costume noir à double boutonnage sur unechemise blanche Brooks Brothers, cravate sombre.Même si ses collègues se gaussent de sa «garde-robede night-club», il ne faut pas se fier aux apparences.Ses mains délicates aux ongles toujours manucuréspeuvent se transformer en instrument de mort. Trèstôt, il affiche sa prédilection pour le monde de lanuit, les cigares, le whisky, les femmes et les potes.Surtout et avant tout, les potes. En 1991, à 39 ans,il est nommé numéro deux du bureau de Chicago,l’un des plus importants du pays. Son principal faitde gloire: Vapcon, une enquête sur les tueurs demédecins pratiquant des interruptions volontairesde grossesse. Il a fait des merveilles. Washingtona des projets pour lui, le poste de responsable dela section antiterroriste du FBI vient de se libérer.
Trade Center. Le nombre de victimes (six morts etun millier de blessés) aurait pu être beaucoup plusimportant. Quelques dizaines de kilos d’explosifsde plus et les deux tours s’effondraient. Depuis, sil’Amérique a oublié, le FBI, lui, recherche activementl’artificier d’origine baloutche qui a réussi à s’enfuirin extremis, Ramzi Yousef dont la tête est miseà prix. En acceptant de prendre la direction de la lutteantiterroriste du FBI, John O’Neill sait qu’il va trouverce dossier sur son bureau. Il sait aussi qu’Al-Qaïdan’a pas renoncé à détruire les deux tours jumellesdu World Trade Center et il se promet de tout fairepour empêcher l’attaque. Au même moment, à prèsde 8’000 kilomètres de là, à Islamabad au Pakistan,Ishtiaque Parker, un jeune Sud-Africain, se rend audomicile d’une employée de l’ambassade américainedont il a obtenu l’adresse par une connaissance.Dans un état de panique extrême, il réclame l’asilepolitique et dit avoir des informations qui peuventintéresser les Américains. Effrayée, l’employée quine comprend rien à ce qu’il raconte, téléphone auposte de sécurité de l’ambassade. Peu après, Parkertend à deux agents chargés de veiller à la sécuritédu personnel diplomatique (DSS) un exemplaire deNewsweek et, pointant une photo, leur affirme: «Lui,je le connais.» C’est Ramzi Yousef. Recroquevilléet dissimulé sous une couverture à l’arrière d’uneChevrolet Surban, Parker est conduit dans l’enceintede l’ambassade où il raconte tout ce qu’il sait sur leterroriste le plus recherché de la planète. Les agentspréviennent Washington et quelques heures plustard, le conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, Richard A. Clarke, appelle de sa ligne directele responsable de la lutte antiterroriste du FBI.A l’autre bout du fil, il entend une voix qui ne luiest pas familière.‒ Qui est à l’appareil? demande Richard Clarke.‒ Et vous, qui êtes-vous? aboie son interlocuteur.Je m’appelle John O’Neill!Le nouveau chef de la division antiterroristea conduit toute la nuit et n’a même pas pris le tempsde se changer.‒ Moi je travaille pour la Maison-Blanche. Je crois quenous avons une urgence. Ils ont peut-être retrouvéRamzi Yousef au Pakistan.C’est le premier contact entre ces deux hommesqui travailleront en étroite liaison pendant six ansjusqu’à la tragédie finale. L’antiterrorisme communiqueaux agents de la sécurité diplomatique à Islamabadune liste de questions à poser à Ishtiaque Parker. Enraison du montant élevé de la prime, des centainesde personnes ont déjà affirmé avoir vu Ramzi Yousefdans le monde entier. Les réponses du jeune Sud-Africain donnent satisfaction, elles ne peuventémaner que d’un proche de Yousef. Après lui avoirremis un téléphone portable, les agents du DSS lerenvoient chez lui avec pour instruction d’attendreque Ramzi Yousef se manifeste. Pendant ce temps,John O’Neill se démène. Il ne dort pratiquement pas. Ilenvoie fax sur fax, multiplie les appels téléphoniquesau Pentagone, au département d’Etat, à celui de laJustice et à ses homologues au Pakistan. L’affaireest loin d’être simple, l’enjeu colossal, O’Neillen est conscient. Après avoir obtenu toutes lesautorisations nécessaires à l’arrestation de RamziYousef et à son extradition vers les Etats-Unis, ilnégocie avec le Pentagone la mise à dispositiond’un avion militaire et charge le département d’Etatde lui procurer les autorisations de survol des paysconcernés; il mobilise un spécialiste des empreintesdigitales et bricole une équipe d’intervention avec deséléments disponibles sur place, n’ayant pas le tempsd’en faire venir une de l’étranger. Le représentantjuridique du FBI à Islamabad, le Legat, n’est pas unhomme d’action. En revanche, l’ambassade abritedes agents fédéraux de l’agence antidrogue (DEA)rompus à ce genre d’exercice. O’Neill se décarcasseafin qu’ils obtiennent du département d’Etat lesautorisations nécessaires pour opérer en territoirepakistanais. L’affaire remonte jusqu’au Premierministre pakistanais, Benazir Bhutto, qui donne sonfeu vert. Tandis que John O’Neill franchit les obstaclesbureaucratiques, les choses se précipitent au Pakistan.Ramzi Yousef a téléphoné à Ishtiaque Parker et luia donné rendez-vous le lendemain à l’aéroport pours’envoler avec lui vers Quetta, capitale de la provincedu Baloutchistan. Il faut agir vite.
accompagnés d’officiers pakistanais de la Directionpour le renseignement interservices (ISI), prennentdiscrètement position dans le hall de l’aéroport. Vers8 heures, le téléphone sonne chez Parker. C’est RamziYousef. Changement de programme, ils partironten bus. L’équipe d’intervention quitte en toute hâtel’aéroport pour la gare routière. Une demi-heure plustard, nouveau coup de fil de Yousef. Finalement,il demande à l’étudiant sud-africain de venir leretrouver dans sa chambre de la pension Su Casa,c’est pratique, c’est à deux pas de chez lui! Su Casaest un petit établissement ouvert par une ONG liéeà ben Laden, l’un des points de chute préférés desanciens combattants arabes de la guerre d’Afghanistanet des hommes d’Al-Qaïda de passage à Islamabad.Terrifié, Parker informe les Américains; ces dernierslui demandent de faire traîner les choses. Savoir safamille pratiquement à portée de tir de Yousef n’estpas fait pour rassurer le jeune homme qui se hâtelentement. Il redoute ce que le terroriste le plusrecherché de la planète va lui demander. Il passeune demi-heure chez Yousef, puis sort de la pension,seul. Pendant ce temps, les agents de l’ISI, des AK-47dissimulées sous leur salwar kameez, prennent positionsur les toits alentour, prêts à intervenir. Des voituresbanalisées de l’ambassade américaine arrivent à leurtour. Une fois dans la rue, Ishtiaque Parker passe samain dans ses cheveux. C’est le signal. «On y va», ditl’un des Américains dans le micro qui le relie à seshommes et à ceux de l’ISI chargés d’ouvrir le chemin.L’arme au poing, une dizaine d’agents de l’ISI fontirruption dans le hall de la pension. L’employé deréception est immobilisé tandis que le commando seprécipite au deuxième étage et fait voler en éclats laporte de la chambre 16. Ils se ruent sur Ramzi Yousef,le menottent mains dans le dos et le plaquent faceau mur. Yousef tente de se retourner, une forte giflele remet à sa place. Dans la pièce, les agents trouventdes armes, du coton imbibé d’une substance qui serévélera être de la nitroglycérine, des montres Casio,du fil électrique et des dizaines de jouets d’enfants,voitures et poupées, destinés à être transformésen autant de bombes. Yousef dit quelques mots enurdu, il ne comprend pas où est le problème, sespapiers sont en règle! Il n’a pas vu les Américainsse glisser discrètement dans la chambre. Les agentsde la DEA et de la DSS remarquent au pied du lit unexemplaire de Newsweek de juillet 1994 ouvert à lapage que l’hebdomadaire lui a consacrée. L’un d’entreeux sort un Polaroid tandis qu’un autre prépare sonkit d’empreintes digitales. «Quoi de neuf, Ramzi?»demande en anglais l’agent prêt à prendre la photo.Le jeune homme se retourne, le flash l’aveugle. Noussommes le 7 février 1995, il est 10 heures du matin etles Américains viennent enfin de gagner une batailleface à Al-Qaïda. John O’Neill peut enfin rentrer chezlui et prendre une douche.Fin du mois de mai 1996, un homme se présenteà l’Ambassade américaine d’Asmara en Erythrée. Ilprend des formulaires de demande de visa et faitsagement la queue devant un guichet en dépit d’unechaleur écrasante. Quand arrive son tour, tout entendant les papiers à l’agent consulaire, il murmurequ’il a des informations vitales pour la sécurité desEtats-Unis. Il s’appelle Jamal Ahmed al-Fadl, c’estl’un des membres fondateurs d’Al-Qaïda. Depuisle début de l’année, Jamal al-Fadl a tenté plusieursfois d’établir le contact avec les Américains. Sanssuccès. Il s’est fait éconduire de diverses ambassadesdu Moyen-Orient, les fonctionnaires américains nel’ayant pas cru. Cette fois-ci, la chance est de soncôté. L’agent consulaire le prend au sérieux et le meten contact avec l’officier de la CIA en charge de larégion. Saisissant immédiatement l’importance decet homme, il le confie à Alec Station, la brancheque l’Agence vient de créer pour traquer Oussamaben Laden. Là, il raconte son histoire: né à Rufa’a,au Soudan, Jamal Ahmed al-Fadl a tout juste vingtans quand il débarque en Amérique avec un visad’étudiant au début des années 1980. Il s’intègrefacilement dans la prospère communauté arabede Brooklyn, gagne sa vie en travaillant dans uneépicerie et fréquente avec assiduité la mosquéeAl-Farooq où il est accueilli à bras ouverts par desislamistes qui cherchent des volontaires pour serendre en Afghanistan. Il
émirs, Oussama ben Laden. En août 1988, il participeaux réunions de fondation d’Al-Qaïda, accompagneben Laden dans son exil soudanais et devient l’unde ses hommes de confiance. Dan Coleman et JackCloonan, les deux agents du FBI en poste à AlecStation, accompagnés de Patrick Fitzgerald, adjointdu procureur du district sud de New York chargédes dossiers de sécurité nationale, l’interrogent aumois de novembre 1996 dans une base militaire enAllemagne. Le trentenaire identifie sans hésitersur les photos que lui présente Dan Coleman lesterroristes impliqués dans les premiers attentatsislamistes contre les Etats-Unis, presque tous deproches collaborateurs de ben Laden, et leur révèlel’existence d’une organisation appelée Al-Qaïda.«C’était la première fois que nous entendions ce nom,m’explique Dan Coleman. Entre septembre 1996 etaoût 1998, il nous a décrit les camps d’entraînement,donné des noms, dessiné des organigrammes, parléde cellules dormantes aux Etats-Unis, décrit Al-Qaïdajusque dans ses moindres détails et fourni une grillede lecture, un code comme la pierre de Rosette quia permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes,pour comprendre l’organisation.» Al-Fadl n’estpas un djihadiste comme les autres. Nul agent dela CIA ou du FBI n’a jamais vu prier ce Soudanaisqui n’a rien d’un ascète. Jack Cloonan prend plaisirà le fréquenter: «C’était très amusant d’être avec lui,me dit l’agent du FBI. Il ne cessait de nous répéter:“Je ne sais pas pourquoi je vous parle. On m’a apprisà vous détester. Je ne comprends pas votre système.Vous me traitez avec justice. J’ai droit à un avocat.J’ai les mêmes droits que n’importe quel justiciableaméricain”» Les agents du FBI qui vivent avec lui jouenttous les rôles: ils sont ses parrains, ses conseillersfinanciers, voire matrimoniaux. Contrairement auxautres dirigeants d’Al-Qaïda, Jamal al-Fadl aime lesfemmes. Un peu trop. A peine arrivé outre-Atlantique,il flirte avec toutes celles qu’il croise, à commencerpar les agentes spéciales affectées à sa protection.Les fédéraux passent leur temps à l’empêcher decourser les femmes au bord de la piscine du moteldu New Jersey où il est censé se cacher. Passionnéde football, il supplie les agents du FBI de lui laisserentraîner une équipe de football… féminin! Pour lecalmer et canaliser son énergie, le Bureau lui achèteune table de ping-pong. «Il était comme un missileguidé par la chaleur, rigole Jack Cloonan. Il ne savaitpas nager alors on lui a procuré des “frites” de piscine.C’était un bonheur de le voir flotter, se donnant enspectacle comme s’il était le maître des lieux.» Unepile électrique alimentée par les dizaines de gaufresqu’il avale chaque jour. «On avait intérêt à laissers’échapper la vapeur de cette Cocotte-Minute, il fallaitlui faire sentir qu’il n’était pas prisonnier, poursuitl’agent. Ses sautes d’humeur nous préoccupaient.Parfois, il lui arrivait d’avoir des troubles du sommeilet, certaines nuits d’hiver, je le retrouvais en larmesà 3 heures du matin répétant entre deux sanglots:“Je suis un traître, j’ai raté ma vie”»Dans l’histoire du 11 septembre, il y a un avantet un après-Jamal al-Fadl. Désormais, les Américainssavent. Ils connaissent les secrets de leur ennemi,ses intentions. Tous les Américains? Non. Hormis lesagents d’Alec Station et John O’Neill, pas grand mondes’intéresse aux confessions du jeune transfuge. Lapoignée d’enquêteurs et d’officiers de renseignementqui travaillent sur Al-Qaïda savent en revanche qu’ilsfont face à une organisation qui n’a rien d’archaïqueet n’hésitera pas à se servir des armes et des outils lesplus modernes pour faire triompher sa conceptionrétrograde de l’islam. Michael Scheuer, le responsabled’Alec Station, comprend que ben Laden est uncurieux mélange entre un théologien du XIIesiècleet un PDG du XXIesiècle à la tête d’une organisation«multiethnique, multilingue et multinationale»absolument unique dans le monde islamique. Durantl’été 1996, la CIA et le FBI partagent encore desinformations sur Al-Qaïda. John O’Neill parle à MikeScheuer, son homologue au sein de l’Agence. O’Neillva même jusqu’à organiser une rencontre informelleentre agents du Bureau et officiers de l’Agence aucentre de formation de Quantico, en Virginie, le29 juin. Au menu, hot dogs et hamburgers. Tout lemonde est au polygone de tir où O’Neill a prévu
et en blessant plusieurs centaines d’autres. O’Neillmet le paquet et dépêche sur place le lendemain undétachement d’une centaine d’agents spéciaux qu’ilrejoint avec le directeur du FBI, Louis Freeh. Sur lascène de l’attentat, O’Neill prend conscience de laférocité de son ennemi, il n’a jamais vu ça. La bombeest plus puissante que celle qui a tué 168 personnesà Oklahoma City en avril 1995. De la base militaire,il ne reste plus qu’un cratère éclairé à giorno parde puissants projecteurs de chantier aux pieds desruines de deux tours. Observant ses hommes épuisésqui tamisent les gravats à la recherche de preuves,O’Neill éprouve une rage froide qui grandit au fur età mesure des rencontres auxquelles il assiste avec ledirecteur du FBI et les officiels saoudiens. Freeh sortà chaque fois ravi de ses discussions. A l’évidence,les autorités locales traînent les pieds de telle sortequ’elles donnent l’impression de faire avancer leschoses alors qu’il ne se passe rien. Louis Freeh estdupe, pas John O’Neill!‒ Ce fut un excellent voyage, se gausse Freeh tout ense frottant les mains dans le Gulfstream qui les ramèneà Washington. Je suis ravi de nos échanges avec lesSaoudiens, je pense qu’ils vont vraiment nous aider.C’en est trop pour John O’Neill qui explose:‒ Vous voulez rire. Ils ne nous ont rien donné etne nous donneront jamais rien. Ils sont complices.Les deux hommes ne s’adresseront plus la parole,quelque chose vient de se briser entre le directeurdu FBI et son responsable de l’antiterrorisme. Rienne sera plus jamais comme avant.Janvier 1997, John O’Neill n’en peut plus de Was-hington. Il n’est pas fait pour cette vie de bureau etdéteste la bureaucratie. Justement, un poste de res-ponsable à la sécurité nationale au bureau de NewYork, le navire amiral du FBI, se libère. Il le prend etne se prive pas de faire savoir qu’un nouveau shérifvient de débarquer en ville. En peu de temps, toutle monde le connaît et il connaît tout le monde, dumaire au garçon de café de chez Elaine’s, des starsde cinéma et de télévision aux journalistes. Il n’a quedes amis ou des obligés. Vous voulez un ticket pour leconcert déjà complet de Michael Jackson? Demandezà John. Une place pour le match des Yankees? Il vousla trouve. Son copain John Miller revient d’Afghanis-tan où il a interviewé ben Laden pour la chaîne detélévision ABC. La CIA n’est pas loin, puisqu’elle s’estdébrouillée pour mettre un mouchard dans la bat-terie du téléphone satellitaire que le fixeur des jour-nalistes a remis à ben Laden. De son côté, l’Agencenationale de la sécurité (National Security Agency,NSA), qui intercepte des signaux électroniques dansle monde entier, écoute depuis le mois de décembre1996 le numéro de téléphone Inmarsat d’Oussamaben Laden, le 00873-682505331. «C’était un cadeaude Dieu, m’explique Michael Scheuer, responsabled’Alec Station. Non seulement nous savions où ilse trouvait en Afghanistan, mais, grâce à ses com-munications téléphoniques, on pouvait se faire uneidée de l’implantation d’Al-Qaïda dans le mondeentier.» Mieux, ben Laden ne se doute de rien et neprotège pas ses conversations. Ses interlocuteursse servant d’un code élémentaire facile à casser, lesservices d’écoute de la NSA n’ont qu’à les traduire, etcréent ainsi une banque de données des appels. Maisle terroriste est malin, la CIA n’arrive pas à mettrela main dessus. Ni la CIA ni la NSA n’ont informéJohn O’Neill, lequel visionne les rushs de l’inter-view de ben Laden réalisée par son ami Miller. Bienqu’il n’y décèle rien de particulier, il a l’impressionque quelque chose cloche, que ben Laden s’est unenouvelle fois moqué de tout le monde. L’interviewest une déclaration de guerre contre les Etats-Unis.Citant en exemple Ramzi Yousef, le dirigeant d’Al-Qaïda, assis devant une carte de l’Afrique, annonceclairement qu’il planifie des attentats à la bombecontre les intérêts américains: «Les attaques serontterribles, plus rien ne sera comme avant pour lesEtats-Unis.» Une intuition que va venir confortercette anecdote que lui raconte Miller: MohammedAtef, le chef militaire d’Al-Qaïda, a ordonné à l’équiped’ABC de détruire les plans où figuraient deux jeunesguerriers aux visages masqués par
Le 25 juin 1996, des individus identifiés par les Etats-Unis comme membres du Hezbollah al-Hejaz (branche du Hezbollahlibanais opérant en Arabie saoudite) firent exploser un camion-citerne non loin du bâtiment où logeait du
la mise en accusation d’Oussama ben Laden. Toutela procédure doit rester secrète jusqu’à l’arrestationdu chef d’Al-Qaïda. Les chefs d’accusation, rédigésavec l’aide de John O’Neill, puis scellés, s’appuientsur les confessions de Jamal al-Fadl, la pierre deRosette d’Al-Qaïda, recueillies deux ans auparavantpar les hommes d’Alec Station, et portent sur deuxévénements précis: la destruction des hélicoptèresBlack Hawk à Mogadiscio en octobre 1993 et l’attentatcontre le centre d’entraînement de la Garde nationalesaoudienne à Riyad en novembre 1995 au coursduquel cinq militaires américains et deux Indiensont trouvé la mort. Durant ce même mois et lesuivant, les Services de renseignement recueillentdes informations auprès de plusieurs sources quis’accordent toutes pour dire que ben Laden s’apprêteà frapper les intérêts américains. Les informationsremontent jusqu’à Richard Clarke. Tout le mondes’attend à une attaque sur sol américain, à New Yorket à Washington. Certaines sources parlent aussi decibles à l’étranger. Le 12 juin 1998, le départementd’Etat émet un bulletin d’alerte: «Nous prenons lesmenaces très au sérieux, les Etats-Unis vont accroîtrela sécurité de leurs installations au Moyen-Orientet en Asie.» Bref, les Américains prennent leursprécautions partout, sauf là où il le faut. Le 7 août1998, deux voitures piégées détruisent les Ambassadesaméricaines de Nairobi au Kenya et de Dar es Salamen Tanzanie. Le bilan est très lourd: 247 morts etplus de 5’000 blessés. John O’Neill, qui avait créé unesection spéciale entièrement dédiée à ben Laden dèsson arrivée à New York, est hors de lui. Il inonde lequartier général du FBI de coups de fil.‒ C’est ben Laden, répète-t-il. Le bureau de New Yorks’occupe de tous les attentats d’Al-Qaïda, y comprisceux commis à l’étranger. Le bureau de New Yorkdoit suivre l’affaire.Mais le directeur du FBI, Louis Freeh, ne l’entendpas de cette oreille. Il confie l’enquête au bureau deWashington avec la bénédiction de Michael Scheuer,responsable d’Alec Station. Le divorce est consomméentre John O’Neill et Mike Scheuer, les frères enne-mis de l’antiterrorisme américain. «John O’Neill nes’entendait pas avec la CIA, me confie Dan Coleman,le premier agent du FBI détaché auprès d’Alec Sta-tion. On a essayé d’arrondir les angles, mais les chosess’étaient envenimées. C’était devenu personnel. Onn’a rien pu faire.» O’Neill, qui a plus d’un atout dansson jeu, à commencer par Richard Clarke, conseil-ler à la sécurité nationale du président Bill Clinton,se démène tant et si bien qu’il finit par arracherl’enquête sur les attaques contre les ambassades.A une condition, posée par Louis Freeh: John O’Neilln’ira pas en Afrique, il doit tout diriger depuis NewYork. La mort dans l’âme, il accepte et envoie surplace une équipe de 500 agents. Côté parquet, l’af-faire est suivie par Mary Jo White, un pitbull dont ondisait qu’elle pouvait inculper un sandwich. «L’en-quête sur les attentats à la bombe de nos ambas-sades en Afrique de l’Est était un modèle qui allaitservir à traquer Al-Qaïda à l’étranger», m’explique-t-elle. Les résultats de l’enquête désespèrent O’Neill,les attentats ayant été planifiés par des terroristesvivant aux Etats-Unis. Il peste aussi contre les loisqui limitent les capacités d’espionnage du Bureausur le territoire américain, car les attaques auraientpu être stoppées. Plutôt deux fois qu’une. En 1997,un responsable d’Al-Qaïda s’était présenté à l’Am-bassade américaine de Nairobi avec des révélationssur un projet d’attentat. Or l’officier de la CIA qui l’areçu ne l’a pas cru. Ce n’est qu’après les explosionsque l’Agence comprendra que l’homme de Nairobidisait vrai. Il y a plus décourageant encore pourO’Neill: le jour même des attentats, un responsabled’Al-Qaïda à Bakou a envoyé un fax à Londres dansune boutique de photocopies qui servait de boîteà lettres à l’organisation. Il s’agissait d’un commu-niqué de «l’Armée islamique pour la libération deslieux saints» qui revendiquait lesdits attentats. Orà l’heure où le fax a été envoyé (4 h 45 GMT), la doubleattaque n’avait pas encore eu lieu… Elle ne se pro-duira que trois heures plus tard. La NSA interceptaitpourtant toutes les communications de cette bou-tique de photocopies, sans pour autant les analyseren direct. Le communiqué sera donc lu trop tard, etla NSA se gardera bien d’en parler au FBI et à la CIA.John
«presque tous les groupes, s’ils le souhaitent, ont lacapacité aujourd’hui de frapper au cœur même dupays. Nous ne disposons pas des armes nécessairespour gagner la guerre qui est engagée.» Quelquesmois plus tard, à l’autre bout du pays, un incidentvient confirmer ses pires craintes. Le 14 décembre1999, un épais brouillard enveloppe la ville de PortAngeles dans l’Etat de Washington. Le dernier ferryen provenance de Victoria au Canada vient d’arriver.Dans la nuit, une trentaine de voitures débarquent.Les douaniers effectuent leur travail avec célérité.L’ultime véhicule est une Chrysler 300M bleu acier.Son chauffeur franchit sans encombre un premierpoint de contrôle avant d’être arrêté par l’inspectricedes douanes américaines Diana Dean qui commenceà l’interroger. Son histoire est bancale: pourquoi n’a-t-il pas pris une route directe depuis le sud de Van-couver pour rejoindre les Etats-Unis? Pourquoi avoireffectué un détour de plusieurs heures pour prendrele ferry de l’île Victoria? Espérait-il passer plus faci-lement qu’au poste frontalier principal de Blaine?Le conducteur est nerveux, ses mains tremblent. Endépit du froid humide, il transpire à grosses gouttes.‒ Sortez de la voiture et ouvrez le coffre arrière, luiintime finalement l’inspectrice.Le jeune homme ouvre la portière et pique unsprint. Les deux agents des douanes lancés à sestrousses le perdent un court instant puis le débusquentsous un véhicule. La course-poursuite reprend pours’achever quelques minutes plus tard par un plaquagedevant le restaurant chinois Wonderful House.Dans la voiture, les douaniers américains saisissentdix grands sacs de poudre blanchâtre et deux potsde liquide ressemblant à du miel emballés dansde la sciure de bois. Les gabelous pensent drogue.Il s’agit en fait de produits chimiques nécessairesà la fabrication de plusieurs bombes. Le conducteur,Ahmed Ressam, un petit délinquant d’originealgérienne, voyage sous une fausse identité.Il a réservé une chambre au Best Western Loyal Innde Seattle, près de la Space Needle. Tous les signauxd’alarme passent au rouge. Le pire cauchemar del’antiterrorisme américain semble sur le pointde se concrétiser: une série d’attaques de grandeenvergure au cours des festivités du réveillon quidoivent marquer le changement de millénaire.Rien que pour la ville de Seattle, 50’000 fêtardsont prévu de se retrouver au pied de la plate-formed’observation aux formes futuristes qui, du haut deses 182 mètres, est l’une des attractions touristiquesde la ville. D’autres porte-bombes accompagnaient-ilsRessam sur le ferry? Ont-ils passé la douane? Si oui,quelles sont leurs cibles? L’Algérien avait quant à luiprévu de faire sauter l’aéroport international de LosAngeles. D’autres attaques sont-elles en cours? Où?Le Centre d’information stratégique et d’opérationsdu FBI à Washington mobilise tous ses agents. Toutcomme la CIA, la NSA et la DIA (Defense IntelligenceAgency, Agence du renseignement de la défense). Lesdemandes d’écoutes et de filatures explosent. Lesdiplomates sondent leurs homologues au Canada,en Grande-Bretagne, en France et en Algérie. Uneenquête est lancée au niveau national. John O’Neillest chargé du versant new-yorkais. Mais il est frustré,il ne dispose pas de suffisamment d’informations.Chaque minute perdue le fait enrager.‒ Bougez-vous le cul, ordonne-t-il à ses hommes,comme si la vie de votre mère en dépendait!Ce n’est pas encore une certitude, mais son instinctd’agent du FBI lui souffle qu’une attaque majeurese prépare. Il ne va quand même pas rester les brascroisés. Quelques jours plus tard, il reçoit enfin desinformations sur les documents saisis dans la voiturede Ressam. Dans ses poches, les agents des douanesont trouvé un papier froissé avec trois numéros detéléphone griffonnés à côté d’un nom: Gani. L’indicatifdes numéros (718) fait faire un bond à John O’Neill;il correspond à quatre des cinq districts new-yorkais.Putain, ils sont là. Avant son arrestation, l’Algériena appelé plusieurs fois un habitant d’un immeublede l’avenue Newkirk à Brooklyn. O’Neill fait commes’il était tombé sur une cellule d’Al-Qaïda et mobilisedes dizaines d’agents. Leur mission: surveiller24 heures sur 24 le bâtiment en
à passer à l’action. Le Gani mentionné sur les papierssaisis est identifié; il s’agit d’Abdelghani Meskini,un autre Algérien qui vivait à Montréal après avoirpassé une année en Afghanistan, où il a reçu uneformation avancée dans l’utilisation d’explosifs. Cefameux 14 décembre 1999, Meskini est à Seattle oùil doit retrouver Ressam. Il repart en catastrophepour New York après avoir appris l’arrestation deson ami. Dans le même temps, O’Neill reçoit unrapport d’un de ses homologues jordaniens: il vientde démanteler une cellule d’Al-Qaïda qui prévoyaitde faire exploser une ambassade et plusieurs hôtelstouristiques remplis d’Américains en même tempsque d’autres attaques aux Etats-Unis.Les écoutes finissent par payer. Les réseauxapparaissent. Meskini a contacté plusieurs autrespersonnes à Brooklyn et dans le Queens. Les flics s’yprécipitent et tombent sur une agence de voyageset un chauffeur de taxi déjà soupçonné de contactsavec les réseaux islamistes. L’un des correspondantsde Meskini ne cadre pourtant pas: il s’agit d’unhomme d’affaires juif vivant sur Ocean Avenuedont le téléphone portable a été cloné... Deux joursaprès son retour à Seattle, Meskini le reçoit dansson appartement de Newkirk Avenue et lui donneles instructions suivantes: «Changez de beeper et detéléphone portable. Jetez-les, beaucoup de chosesse passent. Quittez l’endroit et abandonnez tout.»Meskini déchire un billet d’avion pour Seattle et desreçus bancaires qu’il jette dans une poubelle que lesfeds récupèrent. Chaque fois que Meskini sort de chezlui, il est suivi par des agents fédéraux et des détectivesdu NYPD. Les flics se servent même d’hélicoptèrespour les filatures. Trois jours à peine après le débutde l’enquête, O’Neill et ses hommes, alors qu’ils sonten train de se gaver de burgers-frites, reçoivent unmessage en provenance du Texas, à 2’500 kilomètresde là. Un agent employé d’une station-service a signaléà la police un groupe d’Arabes voyageant dans unecamionnette bleue bourrée de cartons. L’employéa tout de suite pensé terroriste, le FBI aussi. Des agentsfédéraux repèrent la camionnette alors qu’elle remontevers le nord. La filature commence, mais s’interromptnon loin de Washington DC quand un agent distraitperd de vue la camionnette. C’est l’alerte générale.Le lendemain, O’Neill et ses hommes suivent Meskinijusqu’à un restaurant halal sur Atlantic Avenue. Alorsqu’ils le photographient en train de lire le menu, ilsvoient arriver sur le parking la fameuse camionnettebleue qui a mobilisé tous les policiers de Washingtonà New York! Montée d’adrénaline. O’Neill appelledes renforts. Une heure plus tard, les deux occupantsde la fourgonnette sortent du restaurant, remontentdans leur véhicule et se dirigent vers le centre-ville.Les dizaines d’agents qui les suivent ne comprennentpas à quoi ils jouent: la camionnette sillonne lesrues de Brooklyn et de Manhattan, s’arrête parfoisprès de mosquées ou de librairies coraniques où l’undes occupants se rend pour en ressortir quelquesminutes plus tard.‒ Qu’est-ce qu’ils foutent? Les contacts sont vraimenttrop brefs. On dirait qu’ils cherchent quelque chose.Le véhicule repart et, le soir, après quelques arrêtspipi et repas, se gare pour que ses occupants puissentse reposer. Après deux jours de ce manège, alors quela camionnette passe non loin d’un restaurant fré-quenté par Meskini, O’Neill consulte ses hommes.‒ Putain, on fait quoi?‒ Si ça se trouve, on suit une camionnette bourréed’explosifs.‒ On aura l’air con quand ils auront tout fait sau-ter devant nous.O’Neill réfléchit. Il se retrouve dans la situationde son frère ennemi de la CIA Michael Scheuer à quiil a souvent reproché de prendre trop de risques avecles terroristes.‒ Bon, allez! On intervient, mais discrètement.La camionnette se gare, les deux hommes endescendent et se retrouvent encerclés d’une nuéed’agents engoncés dans leur gilet pare-balles leurhurlant de se coucher au sol les mains sur la tête.Une équipe de démineurs pénètre à l’arrière de lafourgonnette et inspecte les cartons. A