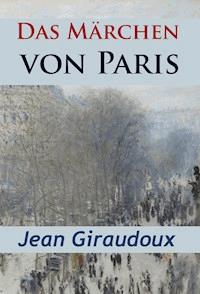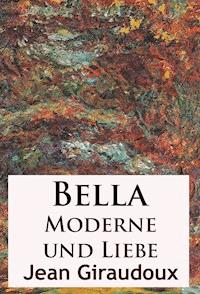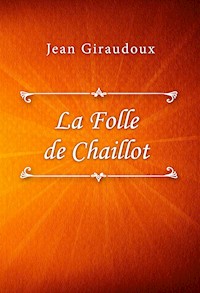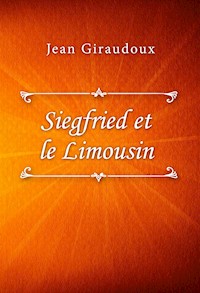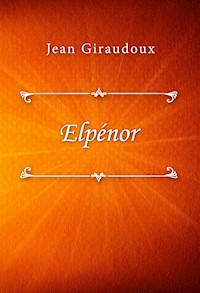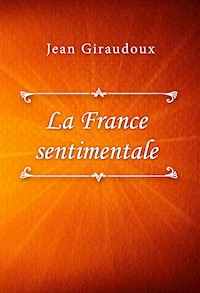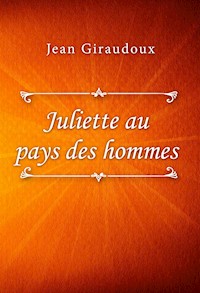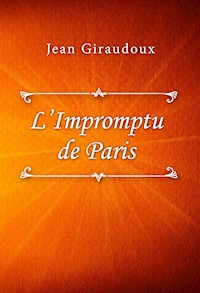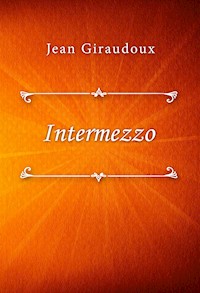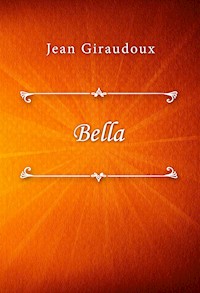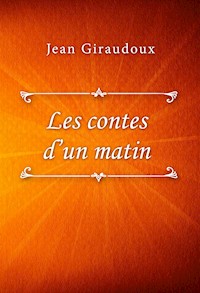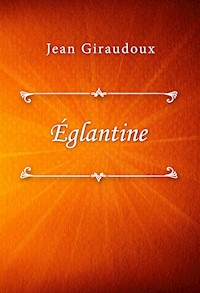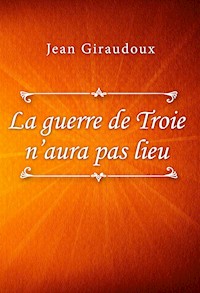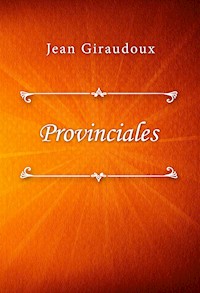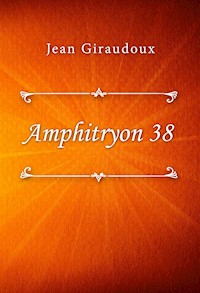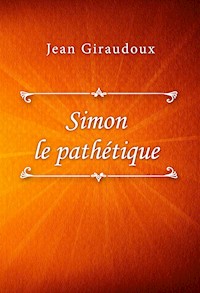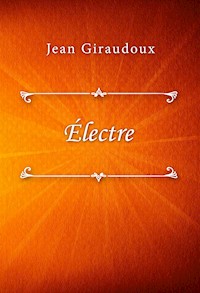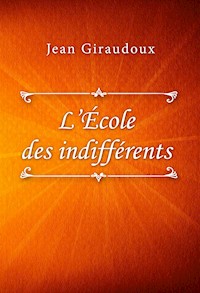0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SIN Libris Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un français peut-il être allemand ? Et un allemand, français ? Mais Siegfried von Kleist est bien Jacques Forestier et Forestier est bien Siegfried ! Recueilli amnésique après une bataille il est pris pour un soldat allemand et rééduqué comme tel. Mais si la couleur de son caleçon a changé qu’en est-il de l’homme ? L’écrivain devenu juriste se « plagie » tant qu’en janvier 1922, un ami de Forestier s’interroge et part à Berlin. Avec l’aide du baron Zelten, il reconnaît Forestier en Siegfried et fait tout pour lui faire retrouver la mémoire. Mais que reste-t-il de cette Allemagne qu’avait connue cet ami avant la guerre quand il était un jeune boursier ? La revanche est-elle devenue la seule motivation de ses ex-amis allemands ?
« Cette idée [d’une substitution] était si dramatique que, comme tous les grands drames, elle a été réalisée depuis par le sort. Je tiens en ce qui concerne ce sujet, à bien affirmer mon droit de priorité vis-à-vis de la Providence […] J’avais à parler de l’Allemagne, et le mégaphone lui-même n’est pas assez sonore dans ce cas ». Giraudoux cherche en effet, à démontrer à travers Siegfried, dans une période où beaucoup songent à la revanche, l’absence de raison déterminante aux haines et aux guerres entre la France et l’Allemagne, comme entre tout autre pays.
Ce roman au style imagé est plein de digressions, d’associations et de références, parfois ironique, improbable, surréaliste mais aussi profond. Couronné du prix Balzac, ce roman fit le succès de Jean Giraudoux. Adapté pour le théâtre, Siegfried, fut créé en 1928 avec Louis Jouvet. Aujourd’hui la pièce a supplanté le roman un peu tombé dans l’oubli.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jean Giraudoux
SIEGFRIED ET LE LIMOUSIN
Copyright
First published in 1922
Copyright © 2019 SIN Libris Digital
Chapitre 1
C’était en janvier 1922. Déjà les civils avaient achevé d’user tout ce qui leur avait été laissé par l’Intendance de leurs vêtements de la guerre, les militaires les derniers uniformes rouge et noir qui leur restaient d’avant 1914, et leur couleur dans la vie était désormais définitive. Mais les diplomates s’épuisaient encore à placer, alternativement dans un ciel ensoleillé et dans un ciel brumeux, à Cannes puis à Boulogne, à Gênes puis à La Haye, une clef de voûte pour l’Europe. Je lisais chaque jour les journaux allemands, dans l’espoir d’ailleurs toujours déçu d’y trouver un mot, un seul mot aimable ou juste à l’adresse d’un Français, fût-ce de Français internationaux comme Jeanne d’Arc et Cachin, ou d’une région de la France, fût-elle indivise entre la France et d’autres nations, comme le pays basque ou catalan, lorsqu’un matin je fus arrêté net dans ma lecture par un passage de la Frankfurter Zeitung… Le voici, dans la traduction que j’en pris aussitôt :
… Élisabeth de Bavière et l’empereur voulurent se baigner dans le Königsee et Adélaïde leur trouva des maillots, d’ailleurs mangés aux mites. Comme les souverains déshabillés arrivaient au lac, deux jeunes gens sortaient de l’eau, et c’était, en costume aussi délabré, leur fils Rudolf avec Dora Winzer l’actrice. Chacune des femmes observait l’autre par les trous du tricot comme par un trou de serrure. L’empereur et l’archiduc n’ayant que des caleçons, on voyait le cœur impérial battre deux fois plus vite que le cœur princier. Le couple jeune était ruisselant, avec des épaules gommées, dont le soleil, s’il y était une fois pris, ne pouvait plus se détacher, et des membres qui continuaient à s’allonger dans l’air comme dans l’eau du bain. Le couple âgé terne et tout sec, d’une sécheresse telle qu’elle en paraissait morale, et il se hâta d’entrer dans le lac comme dans une eau qui rajeunit…
J’avais de bonnes raisons pour être frappé par ces phrases : je les connaissais. Je les avais lues voilà dix ans, un jour qu’elles étaient nouvellement nées et françaises, dans un récit dont l’auteur était mon ami Forestier, disparu pendant la guerre. Mais ce qui m’étonnait, ce n’était pas de voir un journaliste démarquer un texte qu’il pouvait croire oublié. C’était que son article, si j’exceptais le plagiat, contînt ce que j’avais trouvé de plus impartial et de plus élevé, à beaucoup près, depuis qu’avait commencé ma revue de presse allemande. Pour prétendre, le 3 janvier 1922, que c’était dans la quinzaine après la visite de Gobineau que Nietzsche avait écrit pour la première fois le mot Surhomme, Wagner le mot Parsifal, et qu’Élisabeth de Bavière avait conçu son cirque, il fallait à un critique de Francfort une âme peu commune. La langue de l’auteur aussi me semblait originale, il y faisait un usage presque neuf pour l’Allemagne de la litote et de la paraphrase, et non moins originale la modestie avec laquelle il signait de trois initiales qui ne me permirent pas de bâtir sur elles un nom connu : S. V. K. Ces dernières constatations s’accordaient mal avec l’hypothèse d’un plagiat ou d’un vol, et, l’après-midi, je demandai à la Nationale cette revue où j’avais lu à sa naissance la nouvelle de Forestier… Je ne m’étais pas trompé : la description du bain était la même, avec quelque chose cependant de moins guindé et de plus radieux, bien que son premier auteur fût mort et le second vivant. Un père et un fils brouillés se retrouvaient à la baignade :
… Jean arriva en tricar avec Michèle. Depuis trente kilomètres, ils longeaient la Vienne avec la terreur qu’elle obliquât soudain trop à droite ou trop à gauche et qu’il ne fût pas possible de se baigner avant le déjeuner. Le tricar était encore chaud qu’ils se précipitèrent vers l’écluse et la vallée fut bientôt tapissée de cris sonores, mais qui ne s’élevaient pas, prononcés qu’ils étaient par deux bouches au ras du fleuve. Les baigneurs allaient sortir quand ils aperçurent près du bord le père de Jean et Olga Armandeau, se replongèrent dans l’eau jusqu’à leur visage qu’ils n’arrivèrent ainsi qu’à rendre plus distinct et plus reconnaissable ; puis se décidèrent, les deux femmes s’observant par les trous des maillots mangés aux mites comme par des trous de serrure, le couple âgé tout sec, d’une sécheresse telle qu’elle en paraissait morale, et bien que les yeux d’Olga Armandeau fussent soudain humides…
Le destin prenait de telles ruses depuis le début de l’année pour ne pas me laisser oublier un seul jour Forestier, donnant à mon frère une fiancée qui portait ce nom – absorbé le soir du mariage par le mien, son rôle de Mané Tecel Pharès terminé – me faisant découvrir dans mon bureau une liasse de lettres et de manuscrits que Forestier y avait placés le jour de son départ, m’apprenant par une carte postale de Séville que les plus beaux jardins d’Andalousie s’appellent Jardins Forestier, de ce Français qui les traça, que je vis dans ce nouvel épisode un de ses détours. Toutes les lignes que je jetais dans l’inconnu se relevaient avec ce nom. Je devins plus attentif… J’amorçai… Je relus le seul livre que mon ami eût publié…
Bien m’en prit, car, quinze jours plus tard, je constatai que dans les colonnes de la Frankfurter le plagiat continuait. S. V. K., dans le même article, démarquait trois phrases. Par hasard – était-ce un hasard ? – il était question dans ces trois phrases de rivière, de lac, d’eau enfin. Penseur original en trois éléments, dès qu’il touchait au quatrième, S. V. K. empruntait à Forestier :
– Aujourd’hui j’écris de mon lit, d’où je vois le lac… Tous les stylos sont cassés dans la villa… Je transporte plumée d’encre après plumée d’encre au-dessus de mon drap… Pas de tache encore…
– Le seul homme qui fût joyeux, mais vraiment joyeux, après l’amour et qui eût traversé la Manche à la nage.
– Je sais quelle sera ma mort… Une locomotive éclatera près de moi… Ou plutôt (oui, c’est bien cela) une vipère se prendra dans la roue de mon automobile, qui la projettera à ma tête. Elle me piquera… On m’étendra dans une prairie, le long d’une rivière, avec deux petits trous rouges à ma joue…
Dans S. V. K., plus romantique, comme il le devait à sa race, chaque roue lançait une vipère et il mourait avec huit trous rouges au visage au lieu de deux. Malgré cette sensible altération du texte, je fus cette fois froissé. On pillait le livre de Forestier comme on avait dû piller son portefeuille, la nuit où il était tombé entre les lignes, dans un no man’s land à cette époque grouillant encore de monde. J’écrivis pour S. V. K. une lettre ouverte que je portai au directeur de notre principale revue hebdomadaire. C’était un socialiste octogénaire qui avait comme quadragénaire publié les classiques grecs et latins, et conservé le ton pleurard qu’il avait comme unigénaire. Il n’avait pas connu Forestier… Il me calma…
– À quoi bon ? me dit-il. Ai-je réclamé contre Willamowitz Moellendorf ? Cependant il a fait sienne ma meilleure dénomination de Penthésilée : « Tigresse qui par-dessus sa peau porte encore une peau de tigre. » Il n’a pas même cité mon nom !
J’observai qu’il s’agissait, dans le cas Forestier, d’un pillage hebdomadaire et qui ne se justifiait pas, à la rigueur, comme pour Tigresse à manteau de tigre, par le prodigieux intérêt de l’expression.
– En effet, dit-il. Tigresse reste une trouvaille. Mais j’ai été victime de plagiats moins indispensables. Dans ma critique de la mise en scène du Banquet des sophistes où figurent Rhétorique, Musique, Gymnastique et autres cousines, j’appelle Instruction publique, qui se jette au cou de tous, Petite Grue pas chère. Avouez que Bapp n’était pas forcé de reprendre ce mot, comme il l’a fait dans les Leipziger Studien. Et quand L. Müller, non pas W. Müller, mais L. Müller en personne, avec son acolyte Lachmann, le vrai, le seul Lachmann, ravissent pour « relavamen » et « consolamen » l’épithète de « formes monstres » que j’ai donnée après Quicherat à ces mots barbares (repérés depuis, je dois l’avouer, dans Priscien et dans Saint Jérôme), croyez-vous sincèrement que lui, Lachmann, ne pouvait trouver mieux ?
Il me retint.
– Mais surtout, mon cher petit, quelle importance ont ces querelles ? Ou plutôt n’est-il pas avantageux que Forestier, dont la vie et l’œuvre fulgurantes (si vous me permettez de plagier à mon tour Baehrens dans son éloge de Firmicus Maternus) ont pénétré par embrasement tant de jeunes Français, s’insinue peu à peu dans l’appareil raisonnable d’un écrivain allemand, fut-ce par fragments aussi gros ? Votre S. V. K. a oublié de mettre des guillemets, mais y a-t-il des guillemets autour des parcelles du corps de votre ami, qui sont (c’est Brunn et Hirschfeld que je cite là), qui sont peut-être amalgamées déjà au corps d’un bel enfant ou d’un jeune tilleul ?… Laissez-moi vous apprendre, pour conclure, que le mot « Bloc », dont l’univers entier croit Clemenceau le père, fut imaginé par un de mes élèves et ami : Joseph Casanova, qui usa le premier de ce vocable dans le Réveil du Nord. Joseph Casanova figure actuellement à l’Office des Réparations, mais croyez que son mot Bloc est la dernière créance qu’il songe à réclamer…
Il y eut vers la fin du mois entre l’Allemagne et la France une période de plus grande tension, pendant laquelle barrages intellectuels et commerciaux se rétablirent. Les douaniers allemands déchaussaient les Français qui sortaient de la Hesse avec des souliers neufs, ou ne laissaient que leur oiseau à ceux qui avaient acheté des cages. Le malheureux surpris à Wissembourg avec des pièces d’or se voyait appliquer dans la minute la loi sur les faux monnayeurs. Les monceaux de livres d’art contenus à grand-peine par Leipzig durant la guerre, les biographies mises à jour des cubistes, les suppléments aux catalogues de l’art au Gabon, s’amoncelèrent aux gares frontières avec les denrées périssables. La demi-douzaine d’Allemands et de Français qui avaient repris – après combien de scrupules ! – leur correspondance d’avant-guerre durent à nouveau l’interrompre. Je ne reçus plus la Frankfurter. Je reçus la Chicago Tribune que je lisais sans curiosité, car Monsieur Mac Cormick ne s’avisait jamais de démarquer André Gide ; la Correspondancia de España, où l’éditeur non plus ne s’ingéniait guère à glisser des phrases de Marcel Proust ; et la Westminster Gazette, où Wells plagiait si rarement Francis Viélé-Griffin !… Le 31 janvier, septième anniversaire de sa mort, en l’absence de tombeau on cloua sur la maison que Forestier avait habitée, rue de Condé, une plaque en son honneur. Nous étions entassés dans cette rue devant une haute et antique façade, tous les gestes que fait un cortège devant une tombe contrariés ici par l’édifice. Nous devions lever la tête au lieu de la baisser, nous tenir sur un rang au lieu d’entourer le cercueil, cependant qu’aux différents étages les fenêtres s’ouvraient l’une après l’autre, de locataires désireux d’entendre cet Oceano Nox que clamait Madeleine Roch, fortement excitée par le voisinage de l’Odéon, et qui se penchaient ou se redressaient pour voir la plaque, toutes ces gargouilles humaines donnant d’ailleurs à notre chapelle son véritable mouvement. La fenêtre de Forestier s’ouvrit une des dernières, et il y apparut un enfant et un vieillard, personne avec qui le plus myope d’entre nous puisse se donner l’émotion de le confondre une seconde. Il y avait là, sans leur personnel, les dirigeants des journaux nationalistes et monarchistes, car Forestier appartenait l’après-midi à la Revue Critique, et, sans les directeurs, le petit personnel des journaux d’extrême gauche auxquels Forestier collaborait le soir pour gagner sa vie, Lanterne ou Progrès Civique. Un de ces typographes, se rappelant m’avoir vu avec lui, me remit un manuscrit que la guerre avait empêché de paraître et que personne n’avait réclamé. Forestier y décrivait la mort de Dumas, qui était à tous deux notre plus grand ami :
… Dumas avait trente-sept ans. Sur 5.313.000 tonnes d’acier produites en France, les usines de Dumas en donnaient 3.800.000. Tous les Français, réunis sur le plateau de la balance adverse, ne l’auraient pas fait pencher. Il était le Français le plus connu en Russie, le seul connu en Afghanistan. Dans le monde entier, on appelait un Dumas le bouton pour pression qu’il inventa à vingt-deux ans, pendant son agrégation des lettres, et un Dumas aussi le câble transafricain qu’il découvrit comme agrégé de droit, et un Dumas le modèle de maison ouvrière qu’il exposa comme diplômé des langues orientales, et acier Dumas l’acier du procédé qu’il conçut au cours de sa Présidence de la Conférence Molé. Après le mot Pasteur, le mot Dumas devenait l’épithète purifiante et consolante de l’univers. Libérés par lui de la pesanteur sociale, tous dans son entourage se sentaient devenir écrivains, musiciens ou poètes. Les jours où il y séjournait, des légions d’aquarellistes cernaient Rive-de-Gier ou Lens. Les femmes l’adoraient ; car toute pauvreté, tout accident, et par analogie toute laideur, tout eczéma entrevu par elles dans la rue se reliait dans leur pensée à Dumas par une sorte d’heureux pont, l’arc-en-ciel Dumas sans doute, qui les absolvait elles et leur luxe au regard de tant d’injustices. Un matin de juin, il fit arrêter son automobile au bord d’un ruisseau, plongea, et ne reparut plus. Pour sa mort pas de funérailles, de testament, de partage, car il n’avait pas voulu de la fortune, et il ne resta de lui que les vingt mains de bronze qu’on venait de fondre sur un moulage de sa main qu’avait pris Geneviève Prat. On chercha longtemps le corps dans le ruisseau, puis dans la Seine, mais il y avait un fort courant, il y eut ensuite une tempête, et il ne reste plus d’espoir de le retrouver qu’au milieu de la mer…
Quelques jours après, la tension internationale qui foudroyait les voyageurs aux gares frontières baissa de quelques volts. On rendit à l’oiseau impatient sa cage de Berlin, aux pieds nus des Français leurs souliers en carton-veau, et à moi ma Frankfurter. Je l’ouvris avec angoisse, mais je ne me doutais pas de ce que me réservait le début même du premier article :
– Müller, y disait S. V. K., avait trente-sept ans… Il était l’Européen le plus connu en Russie, le seul connu en Afghanistan…, Un matin de juin, il arrêta sa voiture près d’un ruisseau…
Je ne comprenais plus.
J’avais fait le vœu de résoudre l’énigme, quand la Providence se défit en ma faveur du meilleur agent de renseignements sur l’Allemagne. Je retrouvai Zelten.
Un jour, je fus convoqué par mon marchand de dessins, et, au lieu d’approcher, dès mon entrée en sa boutique, ce carton que l’on suspend, céleste avoine, aux naseaux des notaires ou des boursiers qui ont dételé une heure pour chasser les Pillement, il me poussa vers trois dessins posés à plat sur un tréteau, ainsi qu’on pousse un enfant, sur une montagne suisse, vers la table protégée de verre qui explique le paysage et indique les cimes. C’étaient trois dessins en effet qui expliquaient à peu près tout ce qui se trouve d’élevé et de lumineux aux environs de l’âme… Il n’est jamais hors de propos de décrire un dessin de Poussin – c’étaient trois Poussins. Le premier était minuscule, dix centimètres à peine sur quinze. Il représentait une ville dont l’aspect seul vous faisait venir à la bouche, comme la vue d’un fruit sa saveur, un beau nom féminin – avec ses douze portes, sa tour de Babel ruinée à partir du huitième cercle, sa tour de Pise achevée mais penchée, son Odéon, son fleuve peuplé de laveuses et de marins dont je voyais ainsi les trois enveloppes, corps, ombres et reflets. Sur les ponts passaient des caravanes. L’armée des cavaliers maîtresse des faubourgs fourbissait les chars dans la forêt d’ifs qui dominait la capitale ennemie dont on voyait tout juste les cathédrales et les piscines. Toute cette agitation, ce foisonnement de monuments et de peuples, on sentait qu’il était le masque d’une toute petite opération immortelle et méconnue qui s’accomplissait ce jour-là, mort d’un philosophe ou naissance d’une martyre… Dans l’immense ciel, un oiseau… Le second dessin avait ceci d’inestimable pour moi que le principal personnage me ressemblait… Jamais photographie n’avait mieux marqué ce qui restait de mon visage quand la marée du soleil à son plein l’avait recouvert… Il était daté de Rome et de mai 1648. Je me promenais au bord du Tibre. Tout l’éclat romain et du printemps 1648 était étale autour de quatre petits écueils à la sépia qui étaient mon nez, mes sourcils et ma bouche. Ce qui marquait de mon visage sur la neige, je le voyais marqué sur l’âme du Poussin… Dans le ciel volait le même oiseau, un peu rapproché cependant, et, tout au fond, sous un bosquet, dormaient deux personnages qui étaient ma fille et mon gendre nus, Narcisse je crois et Écho… Le troisième dessin était le même héros sur son lit de mort, était ma mort… Mais revenons à Zelten.
Quand j’eus demandé le prix de ces dessins et que je les eus ravis en échange de quelques billets, qui servaient non à les payer, mais à payer ceux que je devais déjà (car un amateur croirait un dessin déshonoré s’il l’achetait comme une marchandise au lieu de se libérer par un système de rançons, payant le Nicole emporté le mois précédent pour avoir le Hubert Robert et le Granet de l’an passé pour saisir le Piranèse), j’appris qu’ils avaient été apportés d’Allemagne par le petit comte von Zelten, qui les avait choisis à cause de cette ressemblance et avait demandé qu’on me prévînt. Il me faisait dire qu’il possédait un autre carton, si j’aimais toujours les Rembrandt, et qu’il serait tous les soirs vers six heures à la Rotonde, si j’aimais toujours les Boches… Il était cinq heures. Je me hâtai au rendez-vous avec l’aide d’une ligne d’autobus de nouvelle création, mais que Zelten justement aurait eu jadis grand avantage à connaître, car son parcours touche successivement, par hasard ou par bonté municipale, les quatre Monts-de-Piété épars dans Paris…
À l’angle du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse, à la terrasse d’un café au milieu de laquelle, parmi les tables, débouchait la sortie du métro, j’attendis donc Zelten. C’était un de ces beaux soirs de mars où le soleil n’est pas encore soutenu une heure de plus au-dessus de l’horizon par les députés ouvriers, et dès qu’il effleurait la ville, il s’étalait comme un œuf sur la gare et la Tour Eiffel. À cette intersection de la route d’Orléans et des routes de Dreux, à ce carrefour où les seuls passants ne devraient être que Tourangeaux, Beaucerons et coquassiers de Choisy, était installé tout ce que Paris compte de Japonais expressionnistes, de Suédois cubistes, d’Islandais graveurs, de Turcs médaillers, de Hongrois et de Péruviens à vocations complémentaires, chacun agrémenté d’une demi-épouse à maquillage individuel et dont aucune n’employait les mêmes couleurs pour les yeux ou les lèvres ; chacun dans l’accoutrement qui le faisait passer pour fou dans sa ville natale, mais qui représentait dans ce quartier, et pour la concierge elle-même, le minimum de l’extravagant. Des femmes seules se levaient parfois, c’est qu’elles allaient tirer la flamme en veilleuse du comptoir pour allumer leur cigare. En face, le café rival, à l’ombre quand la Rotonde était au soleil, au soleil dès que l’ombre enveloppait la Rotonde ; mais personne jamais ne traversait la rue – à part un créole qui se déplaçait avec le soleil, et une pianiste congestionnée qui cherchait le frais ; à part aussi celui qui venait de se brouiller avec son groupe, de renier son art et ses frères, de changer de couleur pour les ombres, ou d’idéal politique. Sur l’autre angle du boulevard, enfin, le restaurant Baty, où – laissant les étrangers arracher à des journaux de leur pays une charcuterie qu’il eût suffi de montrer à la glace pour lire, sur elle imprimé, l’éditorial de Bergen ou de Kiev – venaient nourrir leur âme de Bourgueil et de portugaises Vincent d’Indy, Bernard Naudin, et à la terrasse le principal entrepreneur des pompes funèbres du quartier que saluaient de leur corbillard les cochers des convois, nombreux si près du cimetière. J’étais sûr avant la guerre de rencontrer Zelten dans ce triangle maçonnique, à la seule heure où coulent enfin dans les verres à boire les couleurs des bocaux des pharmacies, où chaque table reçoit alternée la visite des chiens pour le sucre, des sourds-muets pour les deux sous, de ces dames pour le briquet ou pour le franc cinquante de leur taxi, et celle de Rosita dégrafée, exigeant de chaque inconnu qu’il dessinât au stylo sur son album, les yeux fermés, un cochon. Si vous aimiez l’aventure, il suffisait d’aller répondre au téléphone, des voix étrangères vous y parlaient dans une langue inconnue. C’est sur cette fourmilière que Damalli avait formé le projet de se laisser tomber par mépris et par vengeance, et il avait loué une chambre au cinquième, mais, effrayé par la bouche du Métro, il s’était orienté vers la carrière de parachutiste qui l’avait rendu riche et célèbre. À la table même où j’étais assis ce soir, j’avais eu pour voisin quelques secondes un dîneur à pardessus qui réclamait toujours du bœuf gros sel et du bœuf gros poivre. On a su depuis que c’était Trotsky, et personne dans l’établissement n’en conçut la moindre surprise, car personne du café – et de ce café seul, et peut-être de ce lieu seul au monde – ne désespère du voisin le plus malpropre, le plus pauvre, le plus grossier au point de croire qu’il ne peut devenir un jour roi ou tyran.
J’attendais Zelten avec quelque angoisse, car non seulement il allait m’aider à percer le mystère S. V. K., mais parce qu’il était, de mes nombreux camarades allemands, le premier que je revoyais, et aussi le plus cher. Dans quelques minutes, lorsqu’il allait marcher sur moi, sa silhouette de face semblable comme toutes les silhouettes humaines à la tranche d’une clef, je saurais donc ce qu’il ouvrait, ce qu’il fermait, et si je devais me faire à l’idée que l’Allemagne pour moi n’existait plus. Or, comme tous les Français, par peur peut-être de l’eau, ma pensée appuyait volontiers vers le continent. J’étais prêt à en faire le sacrifice, mais j’avais l’impression que je vivrais difficilement sans l’Allemagne, et je me sentais parfois, tous les fils qui me liaient à mes amis de Berlin, de Dresde ou de Munich tranchés, désorienté sur mon côté allemand et comme le chien auquel on a coupé à droite la moustache-antenne qui lui donne sa seconde vue et sa seconde ouïe. L’Allemagne est un grand pays humain et poétique, dont la plupart des Allemands se passent parfaitement aujourd’hui, mais dont je n’avais point trouvé encore l’équivalent, malgré les recherches qui m’ont conduit à Cincinnati et à Grenade. L’Allemagne est une vallée où débouchent, au milieu d’un populaire parfois sans goût et de chefs sans grande conduite, comme le métro dans la terrasse de la Rotonde, des souterrains où les Allemands se croient malins de murer à la fois les armes soustraites au Contrôle et les vérités de leur pays, mais où nous étions pas mal en Europe à vouloir cogner. L’Allemagne est une grande plaine créée pour les invasions, et où la France d’ailleurs, depuis quarante ans, n’a pu expédier que la cohorte semestrielle de huit boursiers d’agrégation, mais j’avais été l’un d’eux et je ne renonçais pas à ma conquête. Un pays où les espèces sentimentales sont à ce point matérielles qu’il est aussi nécessaire d’en posséder les appellations que celles du pain et de la bière, mais j’avais besoin d’une race où les mots qui signifient Âme ou Intime, ou Moteur animal, sont les premiers du Baedeker, au vocabulaire pour cochers. J’avais gardé de Zelten, qui le personnifiait pour moi, un souvenir qui ne m’avait jamais permis de l’englober dans cette haine pour l’injustice et l’Allemagne que tous les Français, à part ce collectionneur de timbres d’Asnières qui légua ses Îles Maurice orange et ses Hawaï zébrés à Guillaume II en pleine attaque de Verdun, ont ressentie pendant cinq ans. Au moment où mon Allemagne avait sombré le plus profondément, il y avait toujours eu pour moi une bouée au-dessus du gouffre, qui m’indiquait sa place et qui était Zelten.
Zelten avait tous ces défauts superbes et voyants dont on ornait chez nous les Allemands jusqu’en 1870, et qu’il va bien falloir trouver un autre peuple pour porter, s’ils s’entêtent à vouloir être chauves, rapaces et pratiques : il avait des cheveux blonds en boucles, il sacrifiait chaque minute de sa vie à des chimères, il descendait habillé dans les bassins pour poser la main sur le jet d’eau ou remettre sous la bonne aile le bec du cygne endormi : il était l’Allemagne. Il ressemblait aussi peu que possible à ces écrivains modèles que la Wilhelmstrasse distribua dès 1914 sur ce qu’elle appelait les centres poétiques de l’univers, Boston, Syracuse ou Délos, de même qu’elle fit circuler des couples géants, amoureux et fidèles au Riggi, à Stockholm, à La Havane, dans les capitales sentimentales, afin de soutenir le prestige de la poésie et de l’amour allemands. Alors que ses compatriotes semblent maintenant avoir pour chaque ordre d’action ou de pensée une commande distincte, la boîte de vitesses en Zelten n’existait pas, et quand par exemple il devint sportif, tous les gestes qu’on accomplit nu et sans pensée se trouvèrent chez lui amalgamés aux actes qui commandent le plus de vêtements et de dévotion : il ne se baignait dans le Rhin qu’en plongeant du pont d’où Schumann s’était jeté ; il sautait à cheval le mur dont était tombé Beethoven dans la chute qui causa, dit-on, sa surdité… Il était de taille moyenne, mais beau, surtout au jour, ce qui le désespérait, car il n’arrivait guère à se lever avant cinq heures ; – mais, au coucher du soleil encore, les femmes-peintres de la Rotonde qui devaient épouser un baron balte pour assurer un père légal à leur enfant, les étudiantes russes qui s’étaient résolues à épouser un Français pour obtenir, ainsi naturalisées, le droit d’exercer en France la médecine, hésitaient à sa vue… Il avait des facilités en tout, sport, éloquence, peinture, excepté dans le madrigal et le triolet qu’il s’obstinait à vouloir transplanter dans la poésie rhénane… Je l’avais connu à Munich, alors que plein de raison déjà, à l’âge où je me hasardais à fumer des Abdullah et à boire de l’anisette, il avait épuisé morphine, cocaïne et quelques autres remèdes de Dieu moins connus, tels que l’épine de Mossoul et le swab. Dans les environs des bars, il se donnait pour agent de renseignements, sachant que ces résines suintent de préférence autour des greffes internationales un peu louches, flattant l’Algérien chargé de la propagande en Algérie pour obtenir du kif, et l’adjudant du bureau M pour ses tablettes de bétel dur… Des drogues peu coupables, telles que la grenadine et le maple sirup, qu’il avait obtenues d’un déserteur américain, lui versaient d’ailleurs, en raison de leur source, la même exaltation. Dès que l’esprit de bonheur, du moindre bonheur, soufflait sur lui, il arrivait en une seconde à une estime immodérée de lui-même, car il tenait un compte raisonné de tous ses actes, qu’il accomplissait d’ailleurs d’instinct, et les souvenirs de toutes ses bonnes actions s’épanouissaient à la moindre tiédeur : l’année qu’il avait sacrifiée à un ouvrier malade, le sentiment de n’avoir jamais transigé sur ce qu’il croyait son talent, même pour acclimater le triolet… À la première contrariété et au moindre gel par contre, cette estime se muait en le mépris le plus complet de Zelten et de son existence, car les souvenirs infamants arrivaient en foule ; car il avait emprunté secrètement à une caisse qui n’était pas la sienne, car il avait quelque peu caressé sa belle-sœur Barbara. Il y avait des chances pour que le mouvement du balancier en sept ans se fût, grâce à sept hivers et à sept étés, amplifié jusqu’à l’admiration et à la haine, pour que le comte de Zelten eût sauvé deux ou trois ennemis de la mort, sacrifié sa fortune, donné son sang pour une transfusion, et, d’autre part, fût devenu alcoolique, ait eu raison finalement de Barbara… Brouillé avec son père, en constatant le jour où il voulait le voler que ce père n’avait pas pris le nom de son fils pour mot du coffre-fort… Endormant ce même père au laudanum pour l’embrasser sans qu’il s’en doutât… – C’était si émouvant – me dit-il – il sentait l’opéré !… Tel était l’agent que m’expédiaient dans ce petit café, comme pour un rendez-vous du deuxième bureau, Goethe, Nietzsche et quelques autres… cependant qu’un convoi funèbre se hâtait dans le crépuscule vers l’arbre qui fait partie à la fois de l’avenue et du cimetière Montparnasse, et me fournissait le moyen de reconnaître le nombre exact de Français ou de Françaises distribués dans la foule de la terrasse, car les Français seuls au monde saluent les morts dans la rue…
Soudain je ressentis l’appel qui prévient les suggestionnés de l’approche de l’hypnotiseur. Il va sans dire que Zelten avait un pouvoir magnétique, et m’avait même une fois endormi… Pendant la guerre, à deux ou trois reprises, j’avais cru percevoir cette succion d’un esprit, parfois tellement vive qu’elle semblait venir de la tranchée d’en face. Zelten, si je me laissais guider aujourd’hui par ce message, prenait en ce moment le tramway vert au quai d’Orsay ; il l’échangeait maintenant à l’École militaire pour le tramway jaune ; il utilisait en cette minute la section chevauchante avec plaque rouge du boulevard des Invalides ; il allait descendre de la deuxième voiture qui stopperait devant la Rotonde…
En effet, il en descendit.
Il en descendit, à reculons, et pour aider à en extraire un pensionnat de fillettes, embrassant la dernière et la plus petite. À mesure qu’il approchait de moi, cette jeunesse de silhouette qui m’avait permis de le reconnaître disparaissait de chaque point de son corps sur lequel se posaient mes yeux, et les petites filles ne s’étaient pas encore évanouies dans l’ombre, qu’elle s’était évanouie. De plus près, je constatai que son côté gauche avait souffert, à gauche il avait des cheveux gris, des rides, des pattes-d’oie ; tout ce qu’il avait pu imaginer pour ne pas laisser la vie et la beauté tomber de lui s’était réduit pendant huit ans à faire la part de la guerre et du feu… On voyait du premier coup d’œil, pauvre Zelten, que ce n’était pas un gaucher ! Ainsi revint Zelten vers nous, ramenant comme ces poules qui disparaissent à la campagne toute une couvée du tramway, et il me tendit les deux mains, tenant à ce que le côté sacrifié participât à cette fête, et s’il avait eu du laudanum, je n’y eus pas coupé d’un baiser… Puis il s’assit en me heurtant comme un cheval qui rejoint au brancard son collègue cheval, reformant après tant d’années le vieil attelage avec lequel nous avions tiré bien des fardeaux, excepté la haine et la lamentation. Nous nous taisions, mais il est facile de savoir comment bat le cœur de celui qui donne tout le sucre au premier chien et cent sous au premier sourd-muet… C’est ce moment précis, naturellement, que choisit le hasard pour faire passer une Alsacienne en costume… Zelten sourit…
– Eh bien, dit-il enfin, tu l’as, cette fois, ton Alsace ! Celle que je t’avais donnée ne te suffisait plus ?
Voilà dix-sept ans, en pension, à Munich, il avait imaginé un moyen de clore nos disputes au sujet de l’Alsace-Lorraine. Il arriva un matin avec un puzzle qui était une carte d’Alsace collée sur carton et découpée par district.
– Il faut vider cette histoire du Reichsland, avait-il ajouté, du moins entre nous deux. J’ai la même carte découpée. Quand je t’en jugerai digne, toi ou ton pays, quand je serai pris d’un accès d’amitié, pour toi ou pour ton pays, je te céderai un district. Fais comme, moi. Quel bel exemple nous donnerions à l’Europe si dans six mois tu avais toute ma carte et moi toute la tienne !