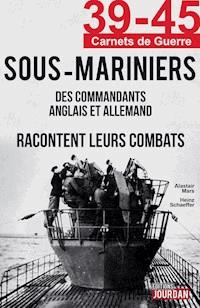
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Qui étaient les officiers de la marine au cours de la Seconde guerre mondiale ?
L’Anglais Alastair Mars et son « Unbroken » coula plus de 30 000 tonnes de navires ennemis, prit part à des opérations secrètes, survécut à quelques 400 mines sous-marines, sans compter les innombrables attaques d’avions et de bateaux, attaqua seul douze navires de guerre et détruisit deux croiseurs lourds. L’Allemand Schaeffer nous raconte son U-977 et l’incroyable odyssée qui le mena des côtes de Norvège à l’Argentine en échappant aux flottes alliées. Deux commandants de submersibles, un Anglais et un Allemand, dans des récits simples mais poignants, nous racontent l’histoire souvent dramatique de leurs campagnes sous-marines.
Deux témoignages qui font partie des plus impressionnants de la dernière guerre.
EXTRAIT
Un après-midi de décembre 1941, gris et déprimant, ma femme se blottit contre moi dans le taxi qui nous conduit de la gare au Victoria Park Hôtel. De temps en temps, je la sens frissonner ; le froid n’y est pour rien mais une infinie tristesse se dégage de la ville de Barrow. En ce qui me concerne, je suis trop ému pour être impressionné par la laideur de cette partie du Laneashire industriel. Enfin, après trois ans pendant lesquels je me suis morfondu comme commandant d’un sous-marin d’instruction, je m’apprête à prendre le commandement de l’« Unbroken ». La femme de Tubby Linton, un de nos sous-mariniers les plus célèbres, l’a baptisé il y a quelques mois ; son installation est presque terminée. Dieu seul sait ce que l’avenir me réserve. Quoi qu’il en soit, le futur ne sera pas pire que la période que je viens de traverser : morne répétition d’exercices d’entraînement. Chose bien naturelle, Ting, ma femme, voit les choses sous un autre jour. Sans parler d’autres considérations : une femme qui attend un bébé redoute de voir partir son mari.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alastair Mars entre dans les forces de la Royal Navy en 1932, âgé d’à peine 17 ans. Il s’est particulièrement illustré en tant que commandant du sous-marin HMS Unbroken lors de la Bataille de la Méditerranée pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1952, il est renvoyé de la Royal Navy, accusé d’insubordination et de désertion. Il consacre le reste de sa vie à l’écriture, et meurt en 1985.
Heinz Schaeffer fut le commandant du sous-marin Unterseeboot 977 de mars à août 1945.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
39-45 Sous-Mariniers
Alastair Mars - Heinz Schaeffer
A la mémoire impérissable du lieutenant John Renwick Haig Haddow et de tous les sous-mariniers morts au champ d’honneur.
PROLOGUE
NAISSANCE D’UN SOUS-MARIN
Un après-midi de décembre 1941, gris et déprimant, ma femme se blottit contre moi dans le taxi qui nous conduit de la gare au Victoria Park Hôtel. De temps en temps, je la sens frissonner ; le froid n’y est pour rien mais une infinie tristesse se dégage de la ville de Barrow. En ce qui me concerne, je suis trop ému pour être impressionné par la laideur de cette partie du Laneashire industriel. Enfin, après trois ans pendant lesquels je me suis morfondu comme commandant d’un sous-marin d’instruction, je m’apprête à prendre le commandement de l’« Unbroken ». La femme de Tubby Linton, un de nos sous-mariniers les plus célèbres, l’a baptisé il y a quelques mois ; son installation est presque terminée. Dieu seul sait ce que l’avenir me réserve. Quoi qu’il en soit, le futur ne sera pas pire que la période que je viens de traverser : morne répétition d’exercices d’entraînement. Chose bien naturelle, Ting, ma femme, voit les choses sous un autre jour. Sans parler d’autres considérations : une femme qui attend un bébé redoute de voir partir son mari.
J’ai vingt-six ans et je déborde d’enthousiasme ; plus vulgairement, je suis « mordu », un peu inquiet aussi. C’est une lourde responsabilité que j’assume : la vie de trente-deux officiers et marins dépend, dans une large mesure, de mes capacités de chef de bord. Dans un sous-marin, par cinquante brasses de fond, inutile de vouloir rattraper une erreur ; on n’a pas le temps de faire son mea culpa. L’équipage représente les bras, le commandant le cerveau ; son rôle est celui de l’artificier qui dévisse la fusée d’une bombe non explosée. Sous réserve qu’il ait la dextérité et l’habileté nécessaires, il désamorcera la fusée sans dommage, mais encore faut-il que le cerveau transmette les directives convenables.
Cette fois, mon tour est venu de frissonner, mais, avec la belle confiance propre à la jeunesse, je chasse ces pensées moroses. Une pensée surtout me préoccupe : quand prendrai-je la mer avec l’« Unbroken » ?
Arrivés à l’hôtel, nous vérifions nos valises et nous nous dirigeons vers le bar. Une bande de vieux amis nous y accueille : Tubby Linton qui attend de conduire le sous-marin « Turbulent » en Méditerranée, Paul Skelton qui s’apprête à livrer un nouveau sous-marin à la marine turque, le capitaine de frégate Maitland-Makgill-Crichton – aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il n’a pas droit à un surnom – commandant le destroyer « Ithurial » et d’autres encore. Mais c’est de revoir Paul Skelton qui me fait le plus de plaisir.
Fils de l’évêque anglican de Lincoln, il est entré en même temps que moi à l’Ecole navale de Dartmouth ; tout au long de nos carrières respectives, notre amitié ne s’est jamais démentie. Mince, cheveux noirs, carrure athlétique, Skelton est le type même de l’officier de marine. Ensemble, nous avons ri et souffert ; ensemble, nous avons conquis nos grades d’enseignes de vaisseau, opté pour l’armée sous-marine ; ensemble, nous stationnions en Chine et avons survécu en Méditerranée au massacre de nos sous-marins, au début de la guerre. C’est un fait, sous-mariniers – officiers ou matelots – se sentent solidaires ; ils forment une sorte de franc-maçonnerie dans la marine proprement dite. Il y a parmi eux un esprit de camaraderie comme il n’en existe nulle part ailleurs. A mes yeux, Paul Skelton est le nec plus ultra des hommes d’élite que sont les sous-mariniers.
Personne n’a oublié l’annonce par Chamberlain de la déclaration de guerre, un après-midi de septembre 1939. Ce dimanche-là, officier navigant sur le sous-marin « Regulus », j’étais à Hong-Kong, à l’United Services Club, en compagnie d’amis. En s’excusant, un serveur chinois vint m’avertir qu’on me demandait au téléphone ; Cheale, le timonier du « Regulus » m’appelait : « Je regrette de vous déranger, Sir, mais le ballon a crevé… »
Je rejoignis la table, commandai une nouvelle tournée, puis lâchai la nouvelle.
Quelques exclamations, puis le silence. Nous n’avions pas grand-chose à ajouter ; en outre, nous avions une bonne raison, plus sérieuse encore, de nous taire. Nous pensions aux autres sous-mariniers de la Navy : chacun à un tel, chacun à un ami ;
Déjà, en Angleterre, les bateaux patrouillaient dans les eaux familières de la mer du Nord et de la Manche…
Six ans plus tard, jour pour jour, la guerre terminée, je prenais un whisky-soda dans le carré du sous-marin « Tudor ». Il quittait l’Extrême-Orient pour l’Angleterre. Sam Porter, son commandant, et moi, étions parmi les rares sous-mariniers survivants de l’avant-guerre. Machinalement, à l’aide de l’annuaire naval, nous comptions les présents. Le résultat fut confondant. Un sur dix seulement servait encore dans les sous-marins ; quelques-uns avaient été atteints par la limite d’âge ; maladies et fatigues avaient sévi, mais la plupart étaient morts. Nous avions perdu des amis par dizaines.
Parmi les disparus : Tubby Linton, Victoria Cross, D.S.O., D.S.C., et Paul Skelton…
Des trois commandants qui, un soir de novembre 1941, trinquaient dans le bar du Victoria Park Hôtel, à Barrow, je suis le seul auquel la chance ait souri. Ce soir-là, il est vrai, nous parlions de tout autre chose que du futur ; réfugiés dans la quiétude du passé, nous riions, plaisantions et levions nos verres. Je regagnai mon lit, mais seulement très tard dans la nuit.
Les chantiers Vickers, à Barrow, constituent une ville à part : cité du bruit et de l’acier, création de dément, cauchemar surréaliste. Sur les immenses cales de lancement, les coques à demi terminées de tous les types de navires imaginables, depuis le croiseur de 8.000 tonnes jusqu’au sous-marin presque pitoyable par sa fragilité. Tout autour, vaguement menaçants, les grues géantes, les ponts roulants, les bigues monstrueuses. Et puis, écrasant même les grues de leur masse, les halls de montage des machines lourdes et légères, des canons, des groupes électriques et des accumulateurs, les magasins d’armement, d’équipement, de pièces de rechange, les ateliers du gréement, de la tôlerie. Enfin, le plus grand de tous, le cœur du chantier, la fonderie gigantesque où l’amalgame de la chaleur et du minerai engendre chaque pièce de chaque navire qui quitte le chantier naval. Au-dessus de tout, pénétrant partout, le bruit : cris, grondements, hurlements et râles du travail, heurts de l’acier, halètements des hauts fourneaux, crissements discordants des grues et des ponts roulants, entrechocs des pièces métalliques, cacophonie assourdissante. Le pire de tout, la vibration furieuse des riveteuses qui vous ébranle de la tête aux pieds.
En compagnie de Paul Skelton, sur les chemins cahoteux du chantier, je me dirige vers l’« Unbroken ». Il porte le numéro de code P. 42. Je le regarde, ahuri. Rouge de rouille, il est loin d’être terminé. Kiosque et superstructure sont en place, mais le canon manque ; la tôlerie du pont est à demi posée, les périscopes sont absents et la grande brèche rectangulaire qui bée dans la coque prouve que les moteurs ne sont pas installés. Au lieu du sous-marin neuf et fuselé que j’attendais, celui-ci ressemble à une épave démantelée, remontée du fond de l’océan. Seules les bernacles et les algues manquent pour parfaire le tableau.
Tourné vers Paul Skelton, je crie et cherche à me faire entendre malgré le bruit.
— Ainsi, on voudrait que je fasse flotter cette passoire, si j’ai bien compris ?
Paul rit, met ses mains en porte-voix et hurle à mon oreille :
— Non, heureusement ! Ce sont les chantiers qui s’en chargent. Tu n’assumes aucune responsabilité tant que le bateau ne prend pas la mer.
Un homme en bleu de travail, l’air soucieux, passe. Paul s’interrompt et le hèle :
— Eh, Jock !
L’inconnu s’approche, me toise ; fort d’une longue expérience, dominant le tumulte, il claironne :
— Je vois ce que c’est ; inutile de m’expliquer : ce monsieur appartient à l’équipage de ce sous-marin et il a des doutes…
J’acquiesce en ricanant. L’Ecossais crache expertement dans la boue et ajoute :
— Il y a quarante ans que nous mettons des sous-marins au monde. Rassurez-vous !
Je le regarde avec respect et comprends, pour la première fois, que le chantier naval est autre chose qu’un amalgame de bruit et d’acier. Tout bateau qui quitte Barrow emporte un peu de Jock avec lui, sous forme de la sécurité d’un rivet, de la résistance d’une tôle épaisse ou de l’habile agencement de l’installation électrique. Sa salopette lui tient lieu d’uniforme ; ses décorations sont ses cicatrices et ses cals.
Dites-le lui et il éclatera de rire, mais, en lui-même, il sait, non sans fierté, que sans lui et sans le travail de ses compagnons dans les chantiers de Barrow menacés par les bombes, il n’y aurait ni gloire guerrière ni victoires navales.
Humblement, je suis Paul Skelton jusqu’au bâtiment qui abrite les bureaux ; j’ai désormais confiance : l’ordre surgira du chaos. Bientôt l’atmosphère morne de ce mois de novembre s’effacera devant un printemps radieux et ensoleillé.
J’adresse un télégramme à l’Amirauté et l’informe que j’ai pris le commandement du P.42. Le lendemain, j’en envoie un autre pour demander des précisions sur la date d’arrivée de l’équipage. Par retour, je reçois la liste des noms et des dates d’arrivée des principaux membres de mon futur équipage ; noms alignés sur une feuille de papier, anonymes, sauf un seul : celui de l’enseigne de deuxième classe John Haddow. Il a servi sous mes ordres à bord du sous-marin d’entraînement H. 44 et je me félicite qu’on l’ait affecté à l’« Unbroken ». Les autres ne sont encore pour moi que des numéros matricules, mais Haddow est un excellent officier, il a fait ses preuves et je sais que je puis compter sur lui.
Finalement, officiers et hommes d’équipage arrivent. Une fois cantonnés à terre, la vie sérieuse commence. L’« Unbroken » n’est plus « mon » bâtiment mais le « nôtre » ; notre succès et notre existence dépendent désormais du bon fonctionnement de chaque organe du bateau ; chacun de nous est responsable pour sa part. Nous contrôlons, recontrôlons, vérifions, revérifions chaque rivet, chaque clavette, de la tête des périscopes jusqu’à la base de la quille ! En gênant le moins possible les ouvriers qui achèvent le montage – j’ai pour eux le plus grand respect : ils en savent plus sur les secrets de la construction des sous-marins que je n’en saurai jamais – nous les regardons installer les machines, essayer les moteurs et les tubes lance-torpilles, poser le canon de 76 sur son affût.
L’équipage de l’« Unbroken » n’est encore qu’une mosaïque de noms et de visages étrangers mais je n’en ai cure ; pour l’instant, je ne vois en eux que des marins et des techniciens, sachant qu’une fois en mer j’apprendrai à les connaître en tant que personnalités individuelles. Dans l’espace restreint d’un sous-marin où chacun vit coude à coude, inutile de prétendre s’isoler. En un rien de temps, du commandant au dernier des matelots sans spécialité, chacun connaît les habitudes, les travers, les amours, les haines, les signes distinctifs, le lieu d’origine, le métier exercé avant la guerre, les jurons de prédilection, les opinions politiques et religieuses, la vie et les pensées intimes de chacun. Si cela vous amuse, libre à vous de penser : quelle admirable fraternité humaine ! C’est exact, partiellement tout au moins, mais, croyez-moi, inévitablement le moment viendra où vous adresserez à Dieu cette prière : « Faites que je puisse m’isoler, ne serait-ce que cinq minutes, faites que je voie d’autres visages que ceux que j’ai sous les yeux ! »
Il est une chose, une seule que j’aimerais connaître : la façon dont les membres de mon équipage réagiront devant le danger. Or, c’est précisément ce que je ne puis savoir. A vrai dire, eux non plus ne savent pas comment je me comporterai ! Je l’ignore moi-même.
DECEMBRE. – Le mois de Pearl Harbour. – La marine américaine vient de subir un coup dur et les événements ultérieurs obscurciront encore le voile de ténèbres suspendu au-dessus du monde civilisé : l’invasion japonaise en Malaisie, le torpillage du « Repulse » et du « Prince of Wales », la chute de Hong-Kong, la Birmanie menacée, la moitié de la Malaisie occupée. En revanche, contrebalançant ces catastrophes, la huitième armée chasse Rommel de Bengazi, les Russes tiennent les Allemands en échec aux portes de Moscou et de Leningrad, la R. A. F. endommage le « Gneisenau » et le « Scharn-horst », nos sous-marins pénètrent dans l’Océan Arctique, coulent treize cargos, et des commandos effectuent un raid sur les Lofoten.
Entre-temps, l’aménagement de l’« Unbroken » s’achève. Les périscopes descendent dans leurs puits, on installe les moteurs ; en cale sèche, la cale rouillée est décapée, puis recouverte d’enduit. Enfin, l’asdic, le détecteur de sous-marins dont l’importance est vitale, est mis en place. Bâtiments de surface et sous-marins en sont munis. Sur un destroyer, par exemple, les ondes ultra-sonores qu’il émet permettent, en calculant le temps mis par l’écho, de détecter et de déterminer vitesse, cap et proximité d’un sous-marin. De même, sur un sous-marin, l’asdic sert aux mêmes fins mais il opère en sens inverse, c’est-à-dire qu’il indique la présence, la rapidité, etc., des bâtiments de surface. Une fois l’asdic installé et son fonctionnement vérifié, il faut penser à une infinité de détails qui vont de la disposition des parquets aux nappes et aux rouleaux de papier hygiénique. Ensuite, nous embarquons nos armes offensives : huit torpilles, fuseaux bleus ; chacune est terminée par un cône contenant quatre cent cinquante kilos d’explosifs.
Un matin tout gris, traversé de flocons de neige, on remorque l’« Unbroken » à travers le bassin du chantier pour un dernier essai. Pour la première fois, l’équipage occupe les postes de plongée, l’équivalent des postes de combat des vaisseaux de surface. En guise de passagers, nous emmenons des « huiles » : directeurs du chantier, officiers et observateurs de l’Amirauté.
Je me penche sur le tube porte-voix :
— Ouvrez les purges du six et du un.
Dans les ballasts, l’eau se rue chassant l’air, et l’« Unbroken » s’enfonce légèrement dans l’eau du bassin. J’ordonne d’ouvrir les autres purges jusqu’au moment où nous flottons, maintenus en surface par l’air du ballast quatre ; puis, sur le pont, je ferme le robinet du porte-voix, descends à reculons l’échelle du kiosque, referme sur moi le panneau supérieur, pousse les taquets et les bloque. Descendant l’échelle, j’arrive dans le poste central ; derrière moi, le timonier ferme le panneau inférieur du kiosque.
— Hissez le périscope !
Avec un sifflement il surgit de son puits.
— Rien à signaler, lieutenant Taylor ?
— Tout va bien, Sir.
Je rabats les poignées du périscope, regarde les bâtiments des chantiers qui se profilent sur l’objectif, puis ordonne :
— Ouvrez la purge du ballast 4 !
Lewis, l’ingénieur mécanicien, actionne un levier ; l’air s’échappe du ballast 4. Lentement, nous nous immergeons dans l’eau du bassin. Quand les aiguilles du manomètre d’immersion franchissent la marque 3 mètres, je jette un ordre :
— Fermez la purge du ballast 4 !
Emmagasiné dans le réservoir, l’air forme un ballon et maintient le navire suspendu dans l’eau. L’« Unbroken » est entièrement immergé ; seuls dépassent les trois mètres du tube du périscope qui saillent étrangement au beau milieu du bassin. Nous sommes en immersion.
— Sir, fuite importante au panneau avant.
Exagération manifeste ! Si la fuite était si grave, le bateau piquerait du nez ; or, ce n’est pas le cas.
— Appuyez-le.
Il faut bien qu’ils s’habituent à obturer de petites voies d’eau et, qui sait, aussi des plus grandes ! Archie Baxter, le contremaître du chantier Vickers, court à l’avant pour donner des conseils.
Une moitié de l’équipage vérifie, revérifie, épiant les indices de fuites possibles ; l’autre moitié procède à la corvée du déplacement du centre de gravité pour corriger l’assiette. Pour les marins, l’opération consiste à transporter dix tonnes de gueuses de fonte d’un bout à l’autre du bateau. En une heure et demie tout est terminé et nous pouvons remonter.
— Paré à faire surface !
Taylor ordonne :
— Vérifiez la fermeture des purges.
La réponse arrive :
— Purges fermées, Sir,
J’acquiesce, satisfait
— Surface !
Taylor s’écrie :
— Chassez aux ballasts un et six.
Lewis, le premier-maître mécanicien, ouvre deux des chasses particulières. A raison de 1.800 kilos par cm2, l’air traverse les tubulures et se rue dans les ballasts avant et arrière, chassant l’eau et se substituant à elle. Nous montons vers la surface. Osborne, le timonier, ouvre le panneau supérieur du kiosque ; escaladant l’échelle, je débouche sur le pont ruisselant.
La plongée statique est finie. Si seulement nos plongées futures pouvaient être aussi simples !
Le 28 janvier, l’officier commandant la base de Barrow-in-Furness nous donne l’ordre de prendre la mer : « Rallier Holy Loch sous escorte du H. M. S. Cutty Sark 3 ».
La matinée est pâle, grise ; le vent joue avec la flamme et le pavillon blanc de la marine de guerre. L’écluse du bassin s’ouvre. Nous apercevons notre escorteur, le « Cutty Sark », qui prend la mer. Les amarres qui nous relient au dock sont larguées et nous nous éloignons. Hardies, les vagues viennent battre l’étrave en dansant. Nous agitons les mains pour saluer les hommes qui ont construit l’« Unbroken » et ils nous répondent par des ovations.
— Faites-leur en voir, capitaine !
— N’ayez crainte, nous nous en chargeons.
Quand précédés par la lueur bleue du feu de poupe masqué du « Cutty Sark », nous pénétrons dans l’estuaire de la Clyde, l’obscurité est tombée. Nous passons la nuit dans le Holy Loch, accostés au « Forth », un dépôt flottant, puis, dans l’aube maussade et blanchâtre, nous nous rendons dans les eaux du Galeroch, le célèbre « banc d’essais » des sous-marins.
Les essais en plongée se succèdent, à allure relativement réduite pour commencer, puis à pleine vitesse – huit noeuds et demi en ce qui nous concerne. A cette allure, lorsque les barres font brutalement prendre de la pointe à un sous-marin, en quelques secondes vous passez de l’immersion périscopique à trente mètres ; faute d’être sur vos gardes, quelques secondes de plus et vous allez vous piquer sur le fond. Toute la journée, les essais se poursuivent : plongée périscopique, retour en surface. Je donne l’ordre : « Les barres toutes à descendre ». L’étrave s’incline vers le bas et l’« Unbroken » prend une pointe de 15 degrés. Qu’une telle pointe soit normale, certes pas, sauf lorsqu’un sous-marin veut gagner à grande vitesse une immersion profonde. Plus bas… encore, toujours plus bas… jusqu’à ce que les barres le redressent. Pourvu, mon Dieu, que l’« Unbroken » retrouve son assiette ! Heureusement pour nous, c’est chaque fois ce qui se produit ; nos remerciements muets vont aux techniciens des chantiers de Barrow.
Pendant le retour à Holy Loch, je signe un reçu par lequel je reconnais avoir pris livraison d’un sous-marin en parfait état de marche. Une pensée me traverse l’esprit : « L’Amirauté, en autorisant un simple lieutenant de vaisseau à signer un reçu, donnant décharge à Vickers d’un sous-marin dont le coût s’établit aux alentours de deux cent cinquante mille livres, témoigne d’une confiance exemplaire ». Il est également vrai que je l’accepte à mes risques et périls.
Le 20 février, tandis que l’« Unbroken » fend les eaux tranquilles du Holy Loch, un message me parvient : « Fille née hier. Mère et enfant en bonne santé ». Quarante-huit heures plus tard, l’« Unbroken », minuscule fragment de l’Angleterre en guerre, met cap au sud pour « rechercher et détruire l’ennemi partout où il sera possible de le découvrir ».
CHAPITRE I
Derrière nous, le cap Saint-Vincent disparaît dans la mer. Au large de Cadix, nous faisons route sur le cap Trafalgar ; encore vingt-quatre heures et nous serons à Gibraltar.
Dix heures et demie. L’obscurité et le silence ont pris possession du carré. J’ouvre le col de ma vareuse et m’allonge sur la banquette qui me tient lieu de lit.
Je me tourne sur le matelas raide et dur ; je voudrais être déjà à Gibraltar ; j’y trouverai du courrier, des nouvelles de ma femme et de ma fille que je n’ai jamais vue. June, c’est le nom que nous lui avons donné d’un commun accord. A qui ressemble-t-elle ? J’espère que Ting a maintenant quitté la clinique et qu’elle a rejoint sa tante à Aldeburgh. Je me demande aussi ce qui se passe en Angleterre, ce que font Paul Skelton et Tubby Linton. Mais le temps me manque pour y réfléchir car, au même moment, la voix de Taylor retentit dans le porte-voix :
— Postes de combat !
Que se passe-t-il ? La sonnerie d’alarme transmet l’ordre d’un bout à l’autre du bateau. Je saute à bas de la banquette, prends mes jumelles sur la table, traverse d’un pas mal assurré le poste central, gravis l’échelle et débouche dans la baignoire. J’entends Taylor ordonner un changement de cap.
La lune luit très haut au sud, la mer est d’huile, la brise à peine perceptible. Penché sur le porte-voix, Taylor se tourne vers moi :
— Bâtiment feux masqués, à bâbord, Sir. Je change de route de manière à l’intercepter.
Dans le tube, il poursuit :
— Zéro la barre, comme ça.
La voix de l’homme de barre :
— Route au zéro-sept-zéro.
Taylor prend ses lorgnettes :
— Tenez, Sir, le voilà : gisement trente tribord.
Je lève mes jumelles sur le même plan que les siennes. La surface noire de la mer occupe la moitié inférieure de l’oculaire, le gris foncé du ciel encombré de nuages l’autre moitié. Au centre, sur la ligne d’horizon, nettement délimitée, la silhouette d’un petit bâtiment non éclairé. Je me souviens soudain de l’avertissement que nous avons reçu : « …des chalutiers armés, camouflés en innocents bateaux de pêche, patrouillent dans le secteur ». Normalement, ils ne devraient pas opérer si loin de leurs ports d’attache, mais il semble que, soit le gouvernement de Vichy, soit celui de Madrid autorise implicitement les Allemands à utiliser leurs mouillages. Sérieuse menace pour la navigation alliée, un chalutier de cette sorte représente un grave péril pour un petit sous-marin. Doté d’un asdic et transportant des charges de fond, il est, de plus, armé d’un canon dont la portée l’emporte sur celle du nôtre ; enfin, son faible tirant d’eau le rend difficilement vulnérable aux torpilles. En principe, nous ne rencontrerons pas d’unités amies avant demain ; raison de plus pour que le bateau qui apparaît sur la ligne d’horizon soit un chalutier ennemi. A vrai dire, les chances ne sont pas toutes contre nous. Grâce au radar – il ne nous rend guère plus de services qu’une maxime écrite au tableau noir – nous pourrons néanmoins approcher à un millier de mètres, lâcher une bordée de dix obus ou tenter notre chance à la torpille…
Taylor ordonne la demi-plongée, c’est-à-dire le remplissage des ballasts 2, 3, 4 et 5 ; nous flottons, soutenus par l’air contenu dans les seuls ballasts 1 et 6. Par suite de renfoncement, la silhouette de l’« Unbroken » est moins visible et nous sommes prêts à plonger rapidement.
A mon tour, j’ordonne :
— Aux postes de combat artillerie.
Les cinq canonniers, rassemblés au pied du kiosque dès l’alerte, montent sur le pont et rallient leur pièce. Silencieusement, doucement, sans perte de temps, ils ouvrent la culasse, les caisses étanches de pont ; chacune contient dix obus. Haddow, l’officier canonnier chargé de diriger le tir, m’a déjà rejoint dans la baignoire ; Osborne, le timonier, de même. Les servants forment la chaîne entre la soute à munitions et la pièce. Haddow se penche touné vers le canon :
Alerte trente tribord… Bâtiment en vue… Hausse zéro-trois-zéro… Dérive douze gauche… Obus de combat. Chargez !
Le tube pivote sur son affût.
— Pièce chargée,
Haddow signale :
— Paré.
Silence. Les nerfs tendus, nous attendons. Ceux qui m’entourent entendent, j’en suis certain, les battements de mon cœur. Les secondes passent ; à mesure que la distance diminue, le doute se dissipe : le bâtiment inconnu est bien un chalutier. Et je me demande : « Quel que soit ton nom, nous vois-tu ? »
Une voix sonore annonce depuis le poste central :
— Tubes parés.
Puis celle de l’opérateur de l’asdic :
— Gisement deux-cinq tribord… Bateau à une seule hélice… Moteur alternatif… Quatre-vingt-dix tours minute.
Preuve supplémentaire qu’il s’agit bien d’un chalutier : j’en déduis que le navire approche à raison de neuf nœuds.
— Osborne, faites-lui le signal de reconnaissance.
La lampe Aldis braque son faisceau lumineux dans la direction du chalutier.
— Signal transmis, Sir.
Pas de réponse. Nous signalons une deuxième, puis une troisième fois. Sans résultat. L’autre cherche-t-il à nous attirer plus près ? Maintenant, nous avons le droit d’ouvrir le feu.
— Ordonnez-lui de stopper, en code international.
Nous sommes maintenant si proches que le faisceau de la lampe éclaire le chalutier à la manière d’un petit projecteur. Le navire est apparemment anglais.
Si ce bateau est l’un des nôtres, que fait-il ? Ne serait-ce pas plutôt un ennemi qui joue au plus fin ? Mille mètres à peine nous séparent, et il peut nous balayer avec ses mitrailleuses…
— Haddow !
— Sir ?
— Tirez un coup de semonce sur son avant.
Un éclair, un rugissement : un obus de trois inches hulule s’abat à deux cents mètres environ de l’étrave, puis ricoche. Cette fois, le résultat est atteint : du coup, on répond à nos signaux. De manière à nous convaincre, une nouvelle fois nous envoyons le signal d’identification ; de nouveau, la réponse est la bonne. Le bateau est bien anglais, mais il s’en faut que j’exulte. D’abord, je suis furieux : le commandement, à Gibraltar, n’a même pas jugé bon de nous avertir de la présence d’un chalutier dans les parages ; ensuite, sa façon de patrouiller et le délai qu’il met à répondre à nos signaux sont loin de me satisfaire. Sur le moment, j’estime même que le bateau mérite d’être envoyé par le fond.
Nous changeons de cap pour passer sur son arrière ; mais à ce moment, un nuage de fumée s’échappe de la cheminée du chalutier. Lui aussi change de cap et file droit sur nous.
— Grand Dieu, mais il va nous éperonner !
— Paré à plonger… En avant toute… Lancez une fusée !
A la lumière de la fusée de reconnaissance, canonniers, timonier et veilleurs descendent précipitamment, suivis de Haddow. Je reste seul sur le pont, en compagnie de Taylor qui me dit :
— Si nous plongeons, ils vont nous balancer des charges de fond.
— Ma foi, j’en ai bien peur.
Soudain, sans avertissement, un éclair s’échappe du canon du chalutier ; un obus passe en sifflant au-dessus de nos têtes. Le bateau tire de nouveau.
Nous sommes dans de jolis draps : si nous restons en surface, ils vont nous faire sauter ; si nous plongeons, ils nous grenaderont. Pourtant, le bateau est bien un Anglais… sauf si l’ennemi connaît nos signaux de reconnaissance. Réfléchissant rapidement, je hurle :
— Timonier, la passerelle !
Osborne surgit du panneau du kiosque, sa lampe à la main, traînant le fil derrière lui.
— Envoyez, en deux mots, le signal le mieux senti que vous connaissiez.
Le faisceau éclaire la mer.
— Exécuté, Sir.
En effet, le chalutier est bien un Anglais ; comme s’il obéissait au signal incongru d’Osborne, le voilà qui change de cap et s’éloigne ; en même temps, il lâche une fusée, puis deux autres. Suspendues à leur parachute, lentement elles redescendent et tombent dans la mer. Le chalutier vient de tirer des fusées éclairantes. C’est la pire des imbécillités dont j’aie été le témoin depuis bien des années ! Le bateau nous voit distinctement ; les fusées ne servent strictement à rien sinon à attirer les U-Boots qui patrouillent dans un rayon de quarante kilomètres. Je donne libre cours à mon mécontentement en traitant de tous les noms le capitaine du chalutier et en le vouant aux cent mille diables. (A l’arrivée à Gibraltar, j’ai constaté qu’il avait un grade supérieur au mien, mais, malgré tout, il présenta ses excuses pour l’incident. Par la même occasion, j’appris qu’au cours de sa patrouille, son bateau avait abattu un Folke Wulf. Cette fois, je ne pus m’empêcher de lui demander : « Avec quoi ? Des fusées éclairantes, peut-être ? »
L’ordre rétabli, je redescends au carré. Haddow s’y trouve et je lui dis :
— Ainsi, vous avez tiré votre premier obus sous l’effet de la colère ?
En bon officier canonnier qu’il est, Haddow secoue la tête en signe de dénégation.
— Dommage ! Une si belle occasion.
Assis sur le bord de la banquette, soudain je me sens submergé par une vague de tristesse incommensurable. La cause en est moins l’émotion que j’ai éprouvée au cours des dernières quarante-cinq minutes – c’est le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’alerte donnée par Taylor – que la réaction qui en résulte. J’ai l’impression d’avoir été plus ou moins frustré, de m’être rendu ridicule. Je profère un juron qui s’adresse au monde entier, puis je m’étends ; bientôt, je m’endors.
Je dois encore apprendre que le lot d’un commandant de sous-marin est une longue succession de déceptions, de désillusions ; de temps à autre, une réalisation concrète fait fonction de stimulant.
Par une belle journée, calme et tranquille, l’« Unbroken » approche des colonnes d’Hercule, pénètre dans la baie d’Algésiras et débouche face à Gibraltar, blotti au pied de sa forteresse.
Au premier plan, les jetées grises, longues, familières, du port artificiel ; accostées, les unités de la Task Force H : le vieux cuirassé « Renown », le croiseur de bataille « Rodney », le porte-avions « Eagle » et quelques destroyers. Dans l’angle sud du bassin, près de la cale sèche, le bâtiment-base des sous-marins, le ravitailleur « Maidstone », notre casernement temporaire, est amarré. L’Angleterre n’a que ces navires pour défendre le secteur ouest méditerranéen et une bonne partie de l’Atlantique contre les intrus : Allemands, Italiens et, s’il le fallait, contre les unités de la marine de Vichy.
Il me semble que, pour pénétrer dans le port, l’« Unbroken » a fière allure : la peinture grise de la coque a résisté et un pavillon tout neuf, démesurément grand, flotte au mât ridiculement petit. Les matelots partagent la satisfaction de leur commandant ; ils sont au garde-à-vous, aussi raides que des fusiliers-marins, alignés sur le pont : pantalons à patte d’éléphant, jerseys blancs à col roulé. Nous défilons sous la masse du « Renown », du « Rodney » et de l’« Eagle ». Les coups de sifflet des maîtres d’équipage retentissent en guise de salutation. Nous nous rengorgeons ; aussi gros que soient ces bateaux, le plus simplement du monde nous pourrions envoyer n’importe lequel d’entre eux par le fond. En revanche, ils auraient moins de chance de nous détecter et moins encore de nous couler. Privés de leur escorte de destroyers, ils sont désarmés en face d’un sous-marin, fût-il l’« Unbroken », dont le tonnage est moitié moindre de celui des submersibles de type courant. Un légitime motif de fierté pour un jeune commandant !
Le « Maidstone » à laquelle nous nous amarrons, est un atelier flottant ; rien n’y manque : torpilles, munitions, eau potable, provisions, mazout, pièces de rechange, en un mot tout ce qu’il faut pour réparer. A bord, il y a des mécaniciens, des électriciens, des artificiers, des charpentiers, des médecins, même un dentiste ; ils ont à leur disposition des ateliers, des fonderies, des salles d’opérations remarquablement outillées. On n’a guère chanté les louanges des ravitailleurs, mais il est de fait que nos sous-marins et, par conséquent, la conduite de la guerre en Méditerrannée, leur doivent beaucoup.
A notre arrivée sur la « Maidstone », l’activité est réduite. Le bâtiment n’a pas à proprement parler de flottille à ravitailler. Il fait en quelque sorte office de plaque tournante pour les sous-marins entrant dans la Méditerranée ou en revenant, pour ceux qui viennent d’Afrique, rentrent en Angleterre ou vice-versa. Enfin, il approvisionne deux sous-marins de transport qui ravitaillent Malte assiégée.
En gravissant la coupée de la « Maidstone », je caresse l’espoir qu’on nous autorisera à effectuer une patrouille d’entraînement depuis Gibraltar, avant de nous envoyer dans la Méditerranée ; mais le capitaine de vaisseau G.A.W. Voelcker, commandant du bord, me réserve une surprise. Les mains derrière le dos, il arpente sa cabine, l’air sombre et préoccupé. Voelcker, grand, mince, volubile, devait par la suite périr dans la Manche sur le « Charybdis ». Et voila ce qu’il m’apprend :
En quelques mois, les sous-marins anglais opérant dans la Méditerranée ont anéanti la moitié des renforts en hommes, munitions et blindés envoyés d’Italie aux forces ennemies d’Afrique du Nord. La dixième flottille, basée à Malte, s’est taillée la part du lion dans ce massacre ; ces navires sont commandés, il est vrai, par des hommes tels que Wanklyn, Tompkinson et Cayley. Leur chef est le grand tacticien de l’arme sous-marine, le capitaine de vaisseau (maintenant contre-amiral) G.W.G. Simpson, familièrement surnommé « Shrimp Simpson ». Aucune armée au monde ne pouvait supporter des pertes analogues à celles que la dixième flottille a infligées aux forces de Rommel. Ainsi qu’il fallait s’y attendre, les aviations allemande et italienne se sont acharnées sur la base sous-marine de Malte, à tel point que le pilonnage causa des morts par milliers et que les survivants de la flottille durent s’enfuir à Alexandrie. Une fois libéré de la menace que représentaient nos sous-marins, Rommel étoffa ses forces ; elles devaient lui permettre de déclencher sa dernière grande offensive (par la suite il allait effectivement repousser la huitième armée jusqu’en Egypte, enlever Tobrouk et Mersa Matruh et s’approcher d’Alexandrie). De nouveau, les restes de la dixième flottille durent fuir et se réfugier à Beyrouth ; de même, la première flottille, décimée, dont la base permanente était Alexandrie. C’est au cours de ce repli que le plus grand ravitailleur de sous-marins anglais, la « Medway », fut coulé. Par bonheur, la moitié des torpilles qu’il transportait avait été expédiée par voie de terre ; sinon les opérations sous-marines dans la Méditerranée orientale eussent été paralysées.
Même maintenant, c’est-à-dire en avril, la situation est critique ; les deux sous-marins qui ont pénétré dans la Méditerranée, quelques jours avant notre arrivée à Gibraltar, ont été envoyés par le fond. Wanklyn et Tompkinson sont portés disparus, les épaves de nos navires jonchent le fond de la mer. De la dixième flottille, il ne reste que l’« Una » aux ordres de Pat Norman, le « P-34 », commandé par Harrison, et l’« Umbra », commandant Lynch Maydon ; encore sont-ils à l’autre bout de la Méditerranée. Somme toute si l’« Unbroken » arrive à Malte, il sera le seul sous-marin encore à flot dans un cimetière de coques démantelées par les bombes et les mines.
Ma première réaction à l’exposé des faits est la suivante :
— Parfait ! Nous partirons donc droit pour Malte et nous ferons des étincelles.
Mais le commandant Voelcker secoue la tête en signe de dénégation :
— Non, vous ne pourriez même pas pénétrer dans le port de la Valette ; en dehors des bombardements terribles auxquels l’île est soumise, l’ennemi l’a isolée par un barrage de mines. Les chenaux « dragués » sont farcis d’engins de toute espèce, fruits de l’esprit inventif allemand et italien. Nous ignorons comment nous y prendre pour enlever certaines mines plus compliquées encore. Même si nous le savions, nous ne serions pas plus avancés : tous nos dragueurs sont coulés. En engageant ses escadres aériennes de Méditerranée, l’adversaire a réussi à nous empêcher d’utiliser efficacement Malte. Mais dès qu’il relâchera son effort, dès que nous disposerons d’une poignée d’avions, et que nous nous en servirons, votre heure sonnera.
Je me retire, dépité, le cœur lourd.
Pourtant, deux sous-marins rescapés de Malte ont réussi contre toute attente à gagner Gibraltar vaille que vaille. On les répare sommairement avant qu’ils ne repartent pour l’Angleterre. L’un d’eux est le submersible polonais « Sokol », aux ordres de Boris Karnicki. Il a été durement étrillé en mer et à Malte ; qu’il ait pu rallier Gibraltar tient du miracle. L’autre, l’« Unbeaten », commandé par Teddy Woodward, s’est traîné sur une batterie jusqu’à la baie d’Algésiras ; une bombe a mis la seconde batterie hors service. Ni Karnicki, ni Woodward n’ont, on le conçoit, envie de raconter leurs expériences. Le souvenir des massacres et des pilonnages est encore trop proche pour qu’ils consentent à en parler. Et puis, il est des choses qu’il est préférable d’ignorer.
Le « Maidstone » est un monument à la gloire de l’ingéniosité de ceux qui l’ont conçu. Malgré sa taille, il semblerait à première vue impossible de loger dans sa coque autant de commodités. En ce qui nous concerne, le plus agréable est certainement l’espace vital dont disposent officiers et hommes d’équipage des sous-marins au repos : vastes postes qui aident les matelots à triompher de la claustrophobie, cabines individuelles, chacune dotée d’un cosy, pour les officiers, projections de films, distractions en tous genres. Et cependant, notre existence n’a rien d’une partie de plaisir. Un navire quel qu’il soit ne sera jamais trop paré et les journées passent, avec l’aide des techniciens du « Maidstone », en contrôles, vérifications, graissages, huilages. Tout cela en prévision de l’instant, béni entre tous, où j’ordonnerai « feu » et où une torpille fendra l’eau en direction d’une unité ennemie.
Le carré du « Maidstone » est presque vide et j’en profite pour boire un whisky, seul au bar. Je me sens abattu ; fixant mon verre, je déplore que « ma » guerre soit aussi totalement dépourvue d’intérêt : pas d’aventure, rien qui vous fasse sortir de vous-même, aucune distraction et l’impression d’être inutile.
Je serais aussi bien chez moi avec Ting, qu’en train de perdre mon temps à Gibraltar, dans l’attente d’un événement.
L’arrivée d’un planton m’arrache à mon soliloque.
— Je m’excuse, Sir, le commandant vous demande dans sa cabine.
Qu’est-ce que cela signifie ? Encore des bonnes paroles pour justifier le fait qu’on ne nous envoie pas à Malte ?
— Bien, j’y vais.
C’est sans gaieté de cœur que je me dirige vers la chambre du commandant Voelcker.
Il est seul et m’invite à m’asseoir.
— Mars, vous n’ignorez pas que votre bâtiment est le seul sous-marin qui soit disponible dans le secteur ?
Question de pure forme : selon moi, elle n’exige pas de réponse. Le commandant sourit, puis reprend :
— Vous vous y connaissez en bateaux pneumatiques ?
— Non, Sir. Je sais seulement qu’il s’agit de canots, genre canoë, en tissu caoutchouté.
— D’ici une semaine, vous serez chargé d’une mission spéciale…
Mon cœur bat.
— Le secret absolu est indispensable. Je vous le dis, mais à vous seul. Il s’agit de débarquer des agents sur le littoral français, quatre en tout. Vous serez absent quatre semaines environ. Votre tâche consiste à les conduire à pied d’oeuvre et à vous assurer qu’ils atteignent bien le rivage dans leurs canots. Une chose encore : n’ayant probablement jamais vu de sous-marin de leur vie, ils vous gêneront plutôt qu’autre chose. C’est regrettable, mais nous n’y pouvons rien. Leur chef est un dur, un certain Churchill.
Voyant ma mine ahurie, Voelcker éclate de rire.
— Non, pas celui-là ! Le capitaine Peter Churchill. Plus tard vous ferez sa connaissance et celle de ses têtes brûlées. A propos, nous avons quelques bateaux pneumatiques ici. Si cela vous amuse, exercez-vous à vous en servir.
Un sourire. Voelcker conclut :
— C’est tout, pour l’instant.
Un vrai roman de cape et d’épée. Un thème en or pour un romancier ! Je cours à ma cabine et convoque Taylor.
— A dater d’aujourd’hui, nous devons être prêts à partir dans les cinq jours. Patrouille de longue durée : un mois, plus une quinzaine de battement si nécessaire. Pendant la moitié de la patrouille, nous transporterons cinq passagers, deux canots pneumatiques et des équipements supplémentaires. Il faudra trouver de la place à l’avant pour les loger. Sachez enfin qu’il ne s’agit pas d’une patrouille ordinaire ; pour l’instant je ne connais pas les détails de l’opération qui doit être tenue secrète – pensez aux espions – tant que les canots ne seront pas embarqués. Quand nous en serons là, je me charge d’instruire l’équipage. En attendant, que ceci reste entre nous ; Thirsk et Haddow eux-mêmes doivent l’ignorer. Entendu ?
Une lueur s’allume dans la pupille de Taylor. Me voilà renseigné : c’est précisément ce genre de choses qu’il attendait.
— Entendu, Sir, comptez sur moi.
— Encore une chose, Taylor.
— Oui, Sir.
— Cette patrouille est notre première. Donc, si quelque chose vous chiffonne, venez m’en parler.
— Certainement, Sir. Et où allons-nous, si je puis me permettre ?
— Pour l’instant, je ne le sais pas moi-même.
Il s’en va, tout excité à la perspective de faire des étincelles.
Je rejoins le carré. A vrai dire, je n’ai plus grand-chose à faire. Ainsi que je puis le constater, le sous-marin est fin prêt et j’ai tout lieu d’être satisfait. En dehors de la mise au point des détails de l’opération, je ne suis d’aucune utilité pour la préparation du bâtiment. Les intéressés s’en chargeront, chacun dans sa partie ; le second est responsable de l’ensemble. J’envoie chercher Thirsk et Haddow et leur demande :
— Une partie de canot, cet après-midi, vous dit quelque chose ?
Sceptique, Haddow fait remarquer :
— Il fait frisquet pour faire de la voile, ne trouvez-vous pas, Sir ?
Thirsk renchérit :
— Ce n’est pas du tout le temps qu’il faut.
— Possible, mais il s’agit d’autre chose : d’une partie de canot pneumatique. Bougrement excitant !
Incrédules, Thirsk et Haddow se regardent ; le premier prend son courage à deux mains, puis hasarde :
— La mer est un peu agitée, Sir.
— Aucune importance ! Donc, cet après-midi, nous prendrons un canot pneumatique sur le « Maidstone » et nous l’essaierons. C’est follement amusant, paraît-il…
Ils ne sont pas convaincus pour autant et j’ajoute :
— Considérez cela comme un ordre.
Un fort vent souffle, venant de l’Atlantique ; il arrache à Thirsk et Haddow des réflexions du genre : « Je vous l’avais bien dit », et je les encourage en leur racontant que j’ai souvent descendu des rapides au Canada et qu’en comparaison notre partie de canot est un enfantillage. Le bateau est amarré à un appontement. L’armature me paraît bien fragile, compte tenu de la taille du canot. Néanmoins, nous prenons place à l’intérieur et pagayons dans les eaux abritées jusqu’à ce que nous ayons appris à le manœuvrer. Haig Haddow, transi, tremble comme un nouveau-né abandonné dans une forêt et je l’autorise à rentrer. A mon avis, le seul moyen d’apprécier la navigabilité du canot, c’est d’affronter la houle, de l’autre côté du môle. Paul Thirsk m’accompagne à son corps défendant. Nous avons dépassé d’une centaine de mètres la jetée et les eaux calmes qu’elle isole, quand soudain, l’engin commence à onduler, comme si l’armature était cassée. Nous remettons le cap vers le rivage ; effectivement, mes craintes sont fondées : le bateau se retourne et nous projette à l’eau. Un juron de Thirsk consacre la perte d’un briquet flambant neuf qu’il avait déposé sur le plancher ; en outre, la certitude que Haig Haddow, à l’abri et au sec sur le môle, se tient les côtes en nous voyant, accentue encore sa mauvaise humeur. La mer est plus creuse et le courant plus fort que nous ne l’avions supposé et il nous faut une demi-heure pour conduire l’esquif en sûreté. Gentiment, Haig Haddow nous aide à hisser le rafiot sur la grève ; il s’abstient de tout commentaire. Paul Thirsk ne peut s’empêcher de faire remarquer :
— Fameuse, cette partie de canot, n’est-ce pas, Sir ?
Ça vous a plu ?
Joe Cowell, chef des opérations à bord du « Maidstone » me présente à Peter Churchill. De taille moyenne, les cheveux noirs, le regard intelligent et expressif, rien, si ce n’est un certain charme et l’autorité qui se dégagent de sa personne, ne le distinguerait du commun des mortels. C’est incontestablement un homme de caractère, calme et raisonné, capable aussi de brusques accès de violence, l’occasion aidant.
Le complot se trame dans la chambre du captain S…, commandant de la flotille sous-marine ; nous devons débarquer quatre agents secrets sur la côte sud de la France non occupée : deux à Antibes, les deux autres sur un point dont le choix est laissé à ma discrétion. Churchill les accompagnera à terre mais reviendra ensuite à bord. Une fois la mission effectuée, mais pas avant, pour nous récompenser de notre bonne conduite, nous sommes autorisés à jouer les corsaires, pendant quelques jours, dans le golfe de Gênes.
La perspective d’opérer dans la baie d’Antibes me préoccupe ; souvenir de vacances que j’y ai passées, le nombre de barques de pêche qui sillonnent la baie est resté gravé dans ma mémoire. La guerre a très probablement modifié cet état de choses, mais il n’en est pas moins vrai qu’entrer et sortir de la baie, aux proportions exiguës, sera une manœuvre délicate. Il ne fait aucun doute qu’il nous faudra pénétrer dans le golfe, car, ainsi que j’ai pu m’en convaincre, seuls les trajets courts par mer calme, sont à la portée des canots pneumatiques. Néanmoins, je me tais : ces questions seront résolues ultérieurement sur place.
Le maintien du secret le plus absolu est un impératif catégorique. Certes, personne n’ignore que nous nous préparons en vue d’opérations clandestines à effectuer sur le littoral de l’Europe occupée par l’ennemi, mais nous irions droit au suicide si les Allemands apprenaient où doit porter le prochain coup. En conséquence, je décide, sans en informer le captain S…, de brouiller les pistes.
Avec, dans la poche, les ordres de patrouille – l’objectif est désigné sous le chiffre W.1VLP. 13 – j’envoie chercher Paul Thirsk.
— Dites-moi, possédons-nous les cartes côtières de la côte occidentale d’Afrique, de Gibraltar à la Sierra-Leone ?
— Non, Sir. Mais nous disposons de toutes celles de la Méditerranée et de celles qui couvrent les routes Gibraltar-Angleterre, Suez-Colombo-Mombasa.
— Bien. Alors procurez-vous les autres à l’arsenal et faites-les livrer directement à bord. Ensuite, vérifiez et corrigez-les dans le poste central.
— Bien, Sir. Mais est-il essentiel qu’on me voie faire ?
— Précisément, c’est ce que je veux ; soyez aussi « mystérieux » que faire se peut. Compris ?
Thirsk sourit :
— Entendu, Sir.
L’« Unbroken » est le seul sous-marin en opérations à Gibraltar. La préparation de la patrouille en est facilitée. Le « Maidstone » peut donc se consacrer entièrement à nous. Le travail le plus important consiste à faire le niveau des batteries ; leur capacité est, à peu de chose près, trois mille fois celle d’un vulgaire accumulateur d’automobile, et de deux cent vingt-cinq à quatre cent cinquante litres d’eau distillée sont nécessaires au remplissage. Les torpilles sont préparées et nous embarquons gas-oil, huile de graissage, eau potable et provisions. Les sous-marins, c’est un fait, sont l’objet de la sollicitude de l’Amirauté. Magasin et réfrigérateur regorgent de victuailles : œufs, bacon, beurre, bœuf, mouton, porc, agneau, foie de veau, fromage, corned-beef, farine, pommes de terre, carottes en boîtes, tomates, betteraves, poisson, cacao, potages comprimés, lait, fruits, langues de bœuf en conserve, jambon, pommes de terre déshydratées et, enfin, de la salade en veux-tu en voilà… Nous avons des provisions en conserve, fraîches ou déshydratées pour un mois et, le cas échéant, nous pourrions subsister quinze jours de plus sur nos stocks de biscuits et de « singe ». Pendant qu’on hisse caisses et cartons à bord, la sempiternelle question « Où allons-nous mettre tout cela ? » se pose. Je sais, quant à moi, qu’une bonne partie échouera dans le compartiment des torpilles, au grand dam des matelots qui y dorment.
Taylor, c’est visible, commence à se préoccuper de notre lieu de destination. Il me demande :
— Sir, puis-je vous demander où nous allons ?
— Je regrette, mais je préfère garder le secret.
— Bien, Sir… Cet après-midi, nous devons embarquer deux canots pneumatiques. Désirez-vous parler à l’équipage à l’heure du déjeuner, avant l’arrivée des bateaux ?
— Bonne idée. Rassemblement donc à onze heures quarante-cinq.
— Entendu, Sir. Cependant, une chose me chiffonne.
— Et laquelle ?
— Des bruits courent ; il paraît que nous devons effectuer une patrouille au large de la côte occidentale d’Afrique, en direction de Dakar.
— Ah, tiens ! Merci du renseignement. Quand je m’adresserai à l’équipage, je leur dirai un mot des bobards.
Après l’heure du thé, le 11 avril, Peter Churchill et ses hommes montent à bord. Faisant partie officiellement de l’effectif, le soin de pourvoir à leurs besoins incombe donc à Haddow. Churchill se voit assigner la quatrième banquette de la chambre ; solution pratique, car, bien que nous soyons quatre officiers dont moi, en mer l’un de nous est toujours de quart ; quand il redescend, il occupe la couchette du camarade qui le relève. En définitive, une banquette est libre en permanence. Les quatre acolytes de Peter Churchill sont logés dans les postes occupés par les maîtres et les matelots ; d’où surpopulation du compartiment des torpilles. Leurs bagages sont embarqués ; ils comprennent des armes de sabotage que Haddow, officier canonnier, examine en connaisseur. Pour une fois, la curiosité a du bon ; il y a entre autres des bombes-crayons, dont le tube est rempli de plastic, destinées à être fixées sous la carlingue d’un avion. Le principe est celui du baromètre : la charge explose lorsque l’appareil atteint une altitude donnée et que la pression diminue. Churchill et ses hommes l’ignorent, mais les variations de pression sont chose fréquente à l’intérieur d’un sous-marin ; les bombes-crayons pourraient tout aussi bien exploser durant le trajet et ce serait la catastrophe. On les renvoie à terre en moins de temps qu’il n’en a fallu pour les monter à bord.
Le départ est fixé à cinq heures de l’après-midi. Le temps d’enfiler mes effets de « mer » : vieux pantalons, gilet fourré de kapok, serviette tenant lieu d’écharpe, vieille casquette, et de prendre mes jumelles, je vais prendre congé du commandant Voelcker. Tandis que nous conversons, Joe Cowell arrive en courant :
— Désolé, Sir, mais il va falloir que Mars attende. Le commissaire est allé à terre en emportant les clés du coffre ; impossible d’avoir de l’argent. J’ai envoyé une voiture avec mission de le ramener.
C’est la première fois que j’entends parler d’argent. Peu après, en s’excusant, le commissaire arrive, porteur de quatre ceintures noires, de celles que l’on porte à même la peau ; chacune contient un million de francs. C’est avec cet attirail – quatre millions sous le bras – que je franchis la passerelle conduisant à l’« Unbroken » et que je gravis l’échelle de la baignoire.
Taylor vient signaler :
— Paré à appareiller !
Bien ! On y va !





























