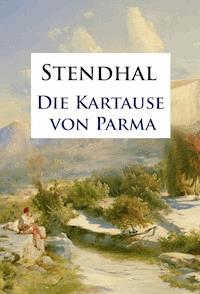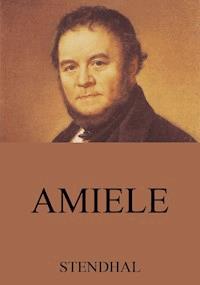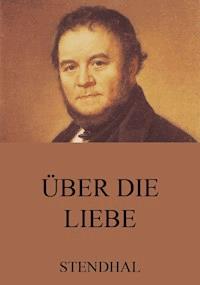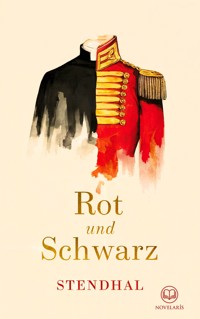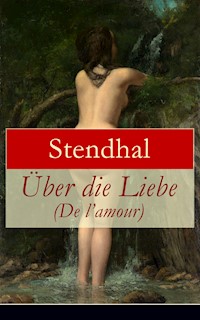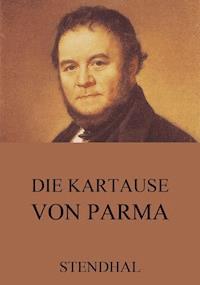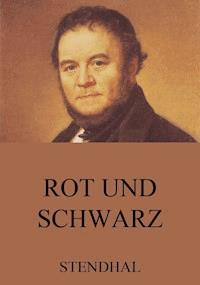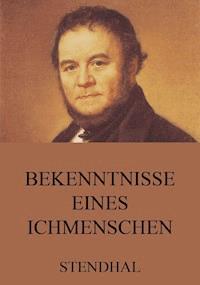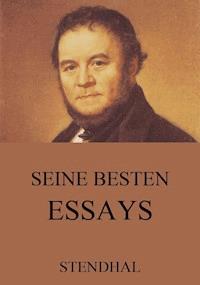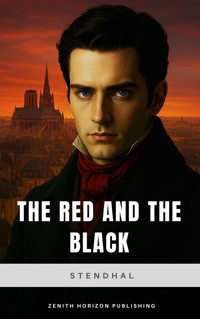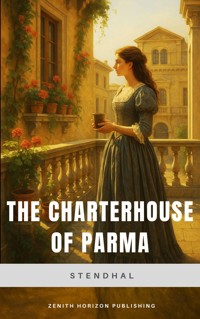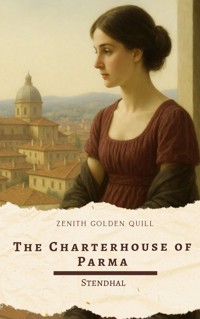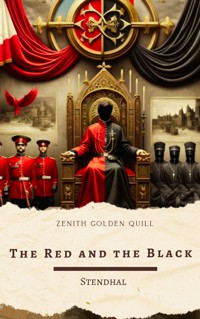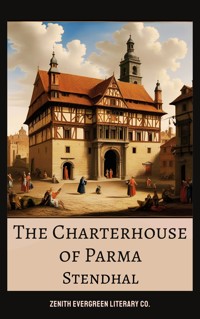6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Les Souvenirs d'égotisme sont une oeuvre autobiographique de Stendhal. Ils ont été rédigés en 1832, lors du séjour de leur auteur à Civitavecchia. Stendhal y raconte minutieusement sa vie à Paris après la chute de Napoléon, de 1821 à 1830. Le récit est resté inachevé et n'a été publié qu'en 1892 par Casimir Stryienski. Le titre signifie que Stendhal veut explorer sa propre personne et tenter de se connaître lui-même. L'égotisme n'est donc pas synonyme d'égoïsme - l'égoïsme en constitue plutôt un danger. Extrait : Je me logeais à Paris, rue de Richelieu, dans un Hôtel de Bruxelles, n 47, tenu par un M. Petit, ancien valet de chambre de l'un des MM. de Damas. La politesse, la grâce, l'à-propos de ce M. Petit, son absence de tout sentiment, son horreur pour tout mouvement de l'âme qui avait de la profondeur, son souvenir vif pour des jouissances de vanité qui avaient trente ans de date, son honneur parfait en matière d'argent, en faisaient à mes yeux le modèle parfait de l'ancien Français. Je lui confiai bien vite les 3000 francs qui me restaient ; il m'en remit malgré moi un bout de reçu que je me hâtai de perdre, ce qui le contraria beaucoup lorsque, quelques mois après ou quelques semaines, je repris mon argent pour aller en Angleterre où me poussa le mortel dégoût que j'éprouvais à Paris...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
TABLE
Stendhal et les Salons de la Restauration
SOUVENIRS D’ÉGOTISME
Chapitre PREMIER
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
LETTRES INÉDITES
I.— A sa sœur Pauline
II.— A la même
III.— A Edouard Mounier
IV.— Au même
V.—A sa sœur Pauline
VI.— A Edouard Mounier
VII.— Au même
VIII.— Au même
IX.— Au même
X.— A son père
XI.— A Edouard Mounier
XII.— Au même
XIII.— Au même
XIV.— Au même
XV.— Au même
XVI.— Au même
XVII.— Au même
XVIII.— Au même
XIX.— A Mélanie Guilbert
XX.— A la même
XXI.— Mélanie Guilbert à Henri Beyle
XXII.— A sa sœur Pauline
XXIII.— A la même
XXIV.— A la même
XXV.— A la même
XXVI.— A la même
XXVII.— A Edouard Mounier
XXVIII.— A sa sœur Pauline
XXIX.— Mélanie Guilbert à Henri Beyle
XXX.— A sa sœur Pauline
XXXI.— A la même
XXXII.— A la même
XXXIII.— A la même
XXXIV.— Mélanie Guilbert à Henri Beyle
XXXV.— A Martial Daru
XXXVI.— Mélanie Guilbert à Henri Beyle
XXXVII.Mélanie Guilbert à Henri Beyle
XXXVIII. —A sa sœur Pauline
A Monsieur Mounier, auditeur au Conseil d’Etat, secrétaire de
XXXIX.— S. M. l’Empereur et Roi, à Schœnnbrunn
XL.— A sa sœur Pauline A M. Krabe, membre de la
XLI.— Chambre de Guerre et des Domaines
XLII.— A sa sœur Pauline
XLIII.— A Félix Faure
XLIV.— Au même
XLV.—A sa sœur Pauline
XLVI.— A la même
XLVII.— A la même
XLVIII.— A la même
IL.— A Louis Crozet
L.— Au même
LI.— Au même
LII.— Au même
LIII.— Au même
LIV.— Au même
LV.— Au même
LVI.— Au même
LVII.— Au même
LVIII.— Au même
LIX.— Note pour le libraire
LX.— Au baron de Mareste
LXI.— Au même
LXII.— Au même
LXIII.— Au même
LXIV.— Au même
LXV.— A Madame ***
LXVI.— A M. le comte Daru
LXVII.— A madame ***
LXVIII.— Au baron de Mareste
LXIX.— Au même
LXX.— A Métilde ***
LXXI.— A madame ***
LXXII.— Au baron de Mareste
LXXIII.— Au même
LXXIV.— Au même
LXXV.— Au même
LXXVI.— A V. de la Pelouze
LXXVII.— A Alphonse Gousolin
LXXVIII. —Au baron de Mareste
LXXIX.— A M. Viollet-le-Duc
LXXX.— A Alphonse Gousolin
LXXXI.— Au baron de Mareste
LXXXII.— Au même
LXXXIII. —Au même
LXXXIV.—Au même
LXXXV.—Au même
LXXXVI. A M. Levavasseur, éditeur à —Paris
LXXXVII. —Au baron de Mareste
LXXXVIII. Au même —
LXXXIX. —A X***
XC.— Au baron de Mareste
XCI.— Au même
XCII.— A Henri Dupuy
XCIII.— A Sutton-Sharp, à Londres
XCIV.— A Paul de Musset
XCV.— A H. de Balzac
XCVI.— Au Dr Laverdant
Imp. F. Imbert, 7, rue des Canettes.
STENDHAL ET LES SALONS DE LA RESTAURATION
I
Henri Beyle fut un homme d’esprit—c’est en somme le plus clair de sa réputation auprès des gens qui, de son œuvre si variée, si neuve, si personnelle n’ont rien lu. Trouver la preuve de cette affirmation dans les livres de Stendhal ne serait pas difficile—on pourrait ouvrir, presque au hasard, l’un ou l’autre des volumes qu’il publia de 1814 à 1839 et on lirait ces jolis mots à l’allure paradoxale ou ironique, ces aperçus fins et profonds, ces traits suggestifs qui sont comme l’écho des conversations de ce brillant causeur. Mais on ne se donne pas tant de peine—on croit sur parole la renommée et l’on déclare, après tant d’autres, que Beyle fut un homme d’esprit—la phrase est toute faite et très commode, et se répètera encore longtemps.
Aussi bien serait-il peut-être à propos—avant de placer l’auteur de Rouge et Noir dans le milieu intellectuel et littéraire où, vers la quarantième année, il conquit ce titre,—de citer quelques unes des formules qui sont la marque de son individualité.
Nous connaîtrons ainsi Stendhal plus intimement,—ce sera un moyen de nous intéresser davantage a ses succès mondains.
Son esprit a bien des faces et se manifeste très diversement. Le mot, chez lui, est souvent sarcastique, souvent aussi plus doux,—mélancolique et rêveur. Beyle est tout à la fois le disciple de l’utilitaire Helvétius, du tendre Cabanis, du sec Duclos, et peut-être,— inconsciemment—de ce gentilhomme lettré, le prince de Ligne, cet autre homme d’esprit qui, avant Stendhal, avait tenté une classification des différentes phases de la passion amoureuse.
Les préfaces de Beyle surtout sont pleines de ces façons ingénieuses et satiriques au moyen desquelles il laisse entrevoir sa pensée plutôt qu’il ne l’exprime—et notons que c’est le caractère de son esprit et que cette discrétion dans la forme, sinon dans l’intention, en fait tout le charme.
A-t-il, par exemple, à dire comment il comprend l’amour? Il ne donnera pas une définition, mais il débitera sans emphase, sans élever la voix, ce brillant couplet: «Rougir tout à coup, lorsqu’on vient à songer à certaines actions de sa jeunesse; avoir fait des sottises par tendresse d’âme et s’en affliger, non pas parce qu’on fut ridicule aux yeux du salon, mais bien aux yeux d’une certaine personne dans ce salon; à vingt-six ans être amoureux de bonne foi d’une femme qui en aime un autre, ou bien encore (mais la chose est si rare qu’on ose à peine l’écrire, de peur de retomber dans les inintelligibles…) ou bien encore, en entrant dans le salon où est la femme que l’on croit aimer, ne songer qu’à lire dans ses yeux ce qu’elle pense de nous en cet instant, et n’avoir nulle idée de mettre l’amour dans nos propres regards: voilà les antécédents que je demanderai à mon lecteur. C’est la description de beaucoup de ces sentiments fins et rares qui a semblé obscure aux hommes à idées positives. Comment faire pour être clair à leurs yeux? Leur annoncer une hausse de cinquante centimes, ou un changement dans le tarif des douanes de la Colombie.»
La citation est un peu longue, mais on est entraîné une fois qu’on a commencé, et n’eût-il pas été dommage de laisser dans le livre ce dernier trait satirique?
Quelquefois l’ironie va plus loin: «L’empire des convenances, qui s’accroît tous les jours plus encore par l’effet de la crainte du ridicule qu’à cause de la pureté de nos mœurs, a fait du mot qui sert de titre à cet ouvrage[1] une parole qu’on évite de prononcer toute seule, et qui peut même sembler choquante.»
Voici une courte appréciation littéraire: «Les vers furent inventés pour aider la mémoire. Plus tard on les conserva pour augmenter le plaisir par la vue de la difficulté vaincue. Les garder aujourd’hui dans l’art dramatique, reste de barbarie. Exemple: l’ordonnance de la cavalerie, mise en vers par M. de Bonnay.»
Puis la note poétique: «Bologne, 17 août 1817. Ave Maria (Twilight), en Italie, heure de la tendresse, des plaisirs de l’âme et de la mélancolie: sensation augmentée par le son de ces belles cloches. Heures des plaisirs qui ne tiennent aux sens que par les souvenirs. [2]»
Et, enfin, cette rare pensée: «La beauté est une promesse de bonheur.»
Après un séjour de sept années en Italie—on sait que Beyle, en 1814, ayant tout perdu, se réfugia à Milan—voilà l’homme qui va se mêler à la société de Paris et faire son chemin dans le monde.
Nel mezzo del cammin di nostra vita.
II
Nous sommes donc à la fin de l’année 1821. Beyle, victime d’une accusation du gouvernement autrichien qui le croyait affilié à la secte des Carbonari, est obligé de quitter Milan, sa patrie d’élection, la ville qui, pour lui, pour son cœur, sera toujours le souvenir attendri de ses débuts dans les armées de Bonaparte, de ses premières amours, de ses premiers plaisirs, et de son initiation définitive aux sensations des arts,—la peinture et surtout la musique.
Dans les Souvenirs d’Égotisme, Stendhal dit en parlant d’un voyage qu’il fit en Angleterre (1821): «J’étais ivre de gaîté, de bavardage et de bière à Calais. Ce fut la première infidélité au souvenir de Milan.» Il se reproche cet excès de joie au moment où il vient de quitter cette bien-aimée Lombardie et aussi cette «divine Métilde» qui occupa absolument sa vie, de 1818 à 1824[3]; mais avant d’être à tout jamais le Milanese de la pierre tombale du cimetière Montmartre, il fera bien d’autres infidélités au souvenir de Milan et particulièrement pendant les quelques années de vie à Paris, qui précédèrent son entrée dans la carrière consulaire—de 1821 à 1830. Il s’oubliera plus d’une fois au milieu des philosophes, des lettrés, des gens d’esprit, ou des hommes simplement célèbres qu’il va rencontrer. C’est à ce moment qu’il entre en relations avec le comte Destutt de Tracy, l’auteur de l’Idéologie, Benjamin Constant, Mérimée, Victor Jacquemont, le général Lafayette, Charles de Rémusat, encore un tout jeune homme, mais «mûr dès la jeunesse», suivant le mot de Sainte-Beuve, Fauriel, Cuvier, Thiers, Béranger, Aubernon, Beugnot, Delécluze, le baron Gérard, en somme presque tout le clan libéral de la Restauration. On comprend qu’il ait pu trouver quelques compensations à ce qu’il avait perdu.
L’art de «marcher au bonheur», il le cherchera aussi, quoi qu’on en ait, dans le succès auprès des plus intellectuels de ses contemporains et il le trouvera, sans trop se faire d’illusion.
A cette époque Beyle avait déjà publié plusieurs volumes. En 1814 parurent les Lettres adressées de Vienne en Autriche sur Haydn, suivies d’une vie de Mozart et de considérations sur Métastase et l’état présent de la musique en Italie, sous le pseudonyme d’Alexandre-César Bombet—le nom de Stendhal ne fut inventé que plus tard; on le trouve pour la première fois sur la couverture de Racine et Shakespeare, en 1823. Ces lettres eurent quelques succès, car l’auteur fut accusé de plagiat—Sainte-Beuve a fait à peu près justice de cette accusation dans une note de son étude sur Stendhal. Beyle s’est inspiré— sans l’avouer, il est vrai,—des Haydine de Carpani pour une partie de son travail, mais en somme on reconnaît bien vite sa manière et surtout ses idées dans ce livre très audacieux et très nouveau. Dès cette première publication Beyle commence contre la vanité française sa petite guerre, où l’on doit voir surtout son amour exagéré du caractère italien, et expose ses principes sur la musique—avertissant ainsi le lecteur qu’il n’écrira jamais pour le distraire simplement, mais qu’il lui communiquera des observations personnelles fondées sur une sorte de psychologie comparée et cosmopolite.
En 1817, il donne deux autres ouvrages: Histoire de la peinture en Italie, par M. B. A. A., et Rome, Naples et Florence ou esquisses sur l’état actuel de la société, les mœurs, les arts et la littérature, etc., etc., de ces villes célèbres (sans nom d’auteur.)
L’Histoire de la Peinture en Italie est capitale dans l’œuvre de Beyle; on y relève bien des fautes de goût—par exemple une admiration soutenue pour Canova—mais il s’en dégage cette théorie des milieux, des climats et des tempéraments, déjà indiquée dans Montesquieu et étudiée par Cabanis, qui a depuis fait fortune. Cette théorie est exposée par Beyle le plus souvent en un tour vif et spirituellement concis. «Le peintre, écrit-il (chapitre XCIII), qui fera Brutus envoyant ses fils à la mort, ne donnera pas au père la beauté idéale du sanguin, tandis que ce tempérament fera l’excuse des jeunes gens. S’il croit que le temps qu’il faisait à Rome le jour de l’assassinat de César est une chose indifférente, il est en arrière de son siècle. A Londres, il y a des jours où l’on se pend.»
M. Taine, dans la préface de sa Littérature Anglaise, explique les mérites de Stendhal et la portée de l’œuvre du «grand psychologue.» Il reconnaît devoir beaucoup à ce précurseur. Beyle est, en effet, un trait d’union entre le dix-huitième siècle et M. Taine; il apporte une large part d’idées nouvelles et d’applications originales dans cette étude des rapports du physique et du moral.
«On n’a pas vu, dit M. Taine, que sous des apparences de causeur et d’homme du monde, il expliquait les plus compliqués des mécanismes internes, qu’il mettait le doigt sur les grands ressorts, qu’il importait dans l’histoire du cœur des procédés scientifiques, l’art de chiffrer, de décomposer, et de déduire…. on l’a jugé sec et excentrique…. et cependant c’est dans ses livres qu’on trouvera encore aujourd’hui les essais les plus propres à frayer la route que j’ai tâché de décrire.»
Rome, Naples et Florence, c’est une sorte de journal de voyage écrit au jour le jour, comme plus tard les Promenades dans Rome (1829), et les Mémoires d’un Touriste (1838).
Beyle y parle de tout en artiste, en dilettante, en mondain. Ici le scénario d’un ballet de Vigano, là une anecdote italienne qui renouvelle la psychologie par l’imprévu des situations, et partout ce désir de communiquer au lecteur l’enthousiasme si sincère et si vibrant que l’auteur éprouve dès qu’il est de l’autre côté des Alpes. «Quels transports de joie! quels battements de cœur! Que je suis encore fou à vingt-six ans! Je verrai donc cette belle Italie! Mais je me cache soigneusement du ministre: les eunuques sont en colère permanente contre les libertins. Je m’attends même à deux mois de froid à mon retour. Mais ce voyage me fait trop de plaisir; et qui sait si le monde durera trois semaines?[4]»
De plus, il a en portefeuille son livre: De l’Amour, écrit au crayon à Milan «dans les intervalles lucides».
Comme causeur, Beyle apportait aussi un élément assez rare à cette époque: son cosmopolitisme. A la suite des armées de Napoléon, de 1806 à 1812, il avait voyagé en Allemagne, en Autriche, en Russie; en 1817 et en cette même année 1821, il avait vu l’Angleterre. Pendant ses séjours d’Italie, il s’était rencontré avec Lord Byron, Brougham, Hobhouse, à qui fut dédié le quatrième chant de Childe Harold, Monti, le poète, Canova, Mayer, Rossini, Paccini, etc.[5].
Il pouvait donc bien dire à ces Parisiens qu’il allait étonner, autant que charmer:
Vengo adesso di Cosmopoli.
Le littérateur avait, on le voit, un bagage considérable,—et sa réputation assez restreinte, sans doute, atténuée par l’anonymat, bornée en somme à ces happy few auxquels seulement il daignait s’adresser, était suffisante pour lui servir de «billet d’entrée» dans un des salons les plus en vue, le salon du comte Destutt de Tracy.
Quel bonheur pour Beyle d’entrer en relations avec cet homme qu’il admirait depuis si longtemps et qui avait eu tant d’influence sur son esprit. «Je lis avec la plus grande satisfaction les cent douze premières pages de Tracy aussi facilement qu’un roman», écrit-il dans son Journal à la date du 1er janvier 1805. Et chaque fois qu’il découvre une nouvelle idée, le nom de Tracy revient sous sa plume. «Je n’aurais rien fait pour mon bonheur particulier, tant que je ne serais pas accoutumé à souffrir d’être mal dans une âme, comme dit Pascal. Creuser cette grande pensée, fruit de Tracy».[6].
Beyle avait fait envoyer à M. de Tracy un exemplaire de son Histoire de la peinture en Italie—le jeune écrivain était, en 1817, de passage à Paris. Il eut le bonheur de recevoir la visite de l’auteur de l’Idéologie.
«Il passa une heure avec moi. Je l’admirais tant que probablement je fis fiasco, par excès d’amour.»
Je trouve, dans une notice de Mignet, un trait de caractère de M. de Tracy qui montre que, sans nul doute, les appréhensions de Beyle,—à cette époque, du moins—étaient peu fondées.
«Les sentiments de M. de Tracy étaient droits et hauts comme son âme. Il cachait un cœur passionné sous des dehors calmes. Il y avait en lui un désir vrai du bien, un besoin d’être utile qui passait fort avant la satisfaction d’être applaudi… Il se plaisait avec les jeunes gens, et ceux qui donnaient des espérances par leurs talents rencontraient le solide appui de ses conseils et de son attachement[7].»
Aussi, à son retour d’Italie, Beyle trouva-t-il un accueil aimable dans le salon de la rue d’Anjou. Stendhal nous fait pénétrer dans cette société brillante.
Le doyen du salon était le général Lafayette, allié des Tracy.
«Une haute taille, dit Beyle, et au haut de ce grand corps une figure imperturbable, froide, insignifiante comme un vieux tableau de famille, cette tête couverte d’une perruque à cheveux courts mal faite. Cet homme vêtu de quelque habit gris et entrant, en boitant un peu et s’appuyant sur un bâton, dans le salon de madame de Tracy, était le général Lafayette en 1821.»
Et, brusquement, le portrait devient anecdotique et tourne au vaudeville.
«M. de Lafayette, dans cet âge tendre de soixante-quinze ans, a le même défaut que moi; il se passionne pour une jeune Portugaise de dix-huit ans qui arrive dans le salon de madame de Tracy, il se figure qu’elle le distingue, il ne songe qu’à elle, et ce qu’il y a de plaisant, c’est que souvent il a raison de se le figurer. Sa gloire européenne, l’élégance foncière de ses discours, malgré leur apparente simplicité, ses yeux gris qui s’animent dès qu’ils se trouvent à un pied d’une jolie poitrine, tout concourt à lui faire passer gaîment ses dernières années.»
Tout en parlant du général, Beyle nous fait voir, comme en profil, la maîtresse de la maison, «cette femme adorable, dit-il, et de moi aimée comme une mère, non, mais comme une ex-jolie femme.»
Elle se scandalise parfois du ton ironique de Stendhal, mais elle sait le défendre.
«Il était convenu qu’elle avait un faible pour moi. Il y a une étincelle en lui, dit-elle un jour à une dame qui se plaignait de la simplicité sévère et franche avec laquelle je lui disais que tous ces ultra-libéraux étaient bien respectables pour leur haute vertu, sans doute, mais du reste incapables de comprendre que deux et deux font quatre.»
A côté de Destutt de Tracy, de la comtesse de Tracy, du général Lafayette, on aperçoit toute une réunion, qui est l’élément jeune de ce grave cénacle, «à droite en entrant, dans le grand salon», sur un «beau divan bleu.» C’est là que sont assises «quinze jeunes filles de douze à dix-huit ans et leurs prétendants: M. Charles de Rémusat et M. François de Corcelles.»
Victor Jacquemont fait aussi partie de cette société. «Victor me semble un homme de la plus grande distinction….. Il devint mon ami, et, ce matin (1832), j’ai reçu une lettre qu’il m’écrit de Kachemyr, dans l’Inde.»
Beyle, au moment où il écrivait ces lignes, en juin 1832, allait perdre cet ami, et la lettre dont il parle est la dernière qu’il reçut de Victor Jacquemont.
Il ajoute à ce croquis un trait qui, à ses yeux, devait évidemment diminuer un peu son admiration.
«Son cœur n’avait qu’un défaut—une envie basse et subalterne pour Napoléon.»
Et ce petit travers n’est pas une invention de Beyle—il se trompe quelquefois, mais jamais quand il s’agit d’impressions—car je lis dans la troisième partie du Journal de Jacquemont: «Les louanges que j’entends chanter, pendant l’élégant dîner du magistrat, M. Taylor, à Bonaparte, dieu de la liberté, me donnent des accès de jacobinisme et d’ultracisme.»
Les relations de Beyle et de Jacquemont n’en furent pas moins excellentes et les lettres que le voyageur adresse à son ami prouvent que la sympathie était réciproque.
Beyle nomme encore quelques autres personnes qu’on trouvait à ces soirées du dimanche. Georges Washington Lafayette «vrai citoyen des Etat-Unis d’Amérique, parfaitement pur de tout idée aristocratique,» et Victor de Tracy, fils du comte, alors major d’infanterie. «Nous l’appelions barre de fer—c’est la définition de son caractère. Brave, plusieurs fois blessé en Espagne sous Napoléon, il a le malheur de voir en toutes choses le mal.»
De la femme de Victor de Tracy, cette charmante Sarah Newton, Beyle ne dit que quelques mots: «Jeune et brillante, un modèle de la beauté délicate anglaise, un peu trop maigre.» Et on regrette de n’avoir pas l’explication de ces épithètes. On connaît cette femme d’esprit et de talent, par un article des Causeries du lundi[8], sur ses Essais, œuvre posthume, publiée en 1852. Sarah Newton est l’amie de madame de Coigny, qui lui donnait pour emblème une hermine, avec ces mots: Douce, blanche et fine, et l’auteur du Voyage à Compiègne d’où se détache cette jolie phrase blâmée par Cuvillier-Fleury[9] et défendue par Sainte-Beuve: «Nous sommes descendues vers un moulin dont j’aimerais à être la meunière; l’eau est si claire qu’elle a l’air d’être doublée de satin vert, tant elle réfléchit avec netteté les arbres qui entourent le moulin.»
Beyle parle dans une de ses lettres[10] du malheur qu’il eût de déplaire toujours aux personnes auxquelles il voulait trop plaire, pensant sans doute à cette période de sa vie. Fort bien accueilli au début, il sentit que peu à peu la bienveillance de M. de Tracy lui échappait. «J’ai vécu, dit-il, dix ans dans ce salon, reçu poliment, estimé, mais tous les jours moins lié, excepté avec mes amis. C’est là un des défauts de mon caractère qui fait que je ne m’en prends pas aux hommes de mon peu d’avancement.»
Il y avait peut-être plusieurs raisons à cette froideur de Destutt de Tracy, surnommé, nous dit Mignet, Têtu de Tracy. Le philosophe était évidemment un peu effrayé de certaines théories stendhaliennes, et l’homme du monde, des bruits malveillants qui couraient sur le compte de Beyle. Mais nous aurons peut-être la solution de ce petit problème, si nous suivons le causeur dans d’autres milieux, et particulièrement chez madame Cabanis et chez la Pasta.
III
Beyle avait vu, dans le salon de la rue d’Anjou, madame Cabanis. M. de Tracy avait été fort intimement lié avec Cabanis, c’était, nous dit Mignet «une amitié fondée sur une forte tendresse, une estime sans bornes et de communes opinions.» Lorsque Cabanis mourut, en 1808, c’est, par une attention délicate, à M. de Tracy que l’Académie française songea pour le remplacer, voulant que celui des deux amis qui survivait vînt succéder à l’autre et prononçât son éloge.
M. de Tracy mena Beyle chez madame Cabanis, rue des Vieilles-Tuileries, «au diable.» C’était un salon bourgeois où Stendhal ne se sentait pas à l’aise. La plupart des gens qu’il y rencontre ne l’intéressent pas.
C’est là qu’il voit un sculpteur, un instant célèbre sous la Restauration—M. Dupaty, auteur du Louis XIII de la place Royale, et mari de la fille de madame Cabanis, cette fille «haute de six pieds et malgré cela fort aimable.»
«M. Dupaty me faisait grand accueil, dit Beyle, comme écrivain sur l’Italie, et auteur d’une Histoire de la Peinture. Il était plus difficile d’être plus convenable, et plus vide de chaleur, d’imprévu, d’élan, etc., que ce brave homme. Le dernier des métiers, pour ces Parisiens si soignés, si proprets, si convenables, c’est la sculpture.»
Là aussi il fit la connaissance de Fauriel, la seule personne de ce salon qui ait trouvé grâce devant lui et dont il admire la sincérité littéraire. «C’est, dit-il, avec Mérimée et moi, le seul exemple à moi connu de non charlatanisme parmi les gens qui se mêlent d’écrire. Aussi M. Fauriel n’a-t-il aucune réputation.»
Dans ce salon—sorte de terrain neutre—Stendhal se montrait plus hardi qu’à la rue d’Anjou.
C’est aux Vieilles-Tuileries qu’un soir il effaroucha M. de Tracy—voici en quelle circonstance.
Beyle avait pour interlocuteurs le calme idéologue et M. Thurot, l’helléniste dont il fait, en quelques lignes, une caricature assez drôle: «Honnête homme, mais bien bourgeois, bien étroit dans ses idées, bien méticuleux dans toute sa petite politique de ménage. Le but unique de M. Thurot, professeur de grec, était d’être membre de l’Académie des Inscriptions. Par une contradiction effroyable, cet homme qui ne se mouchait pas sans songer à ménager quelque vanité qui pouvait influer, à mille lieues de distance, sur sa nomination à l’Académie, était ultra-libéral.»
M. de Tracy et M. Thurot demandèrent à Beyle quelle était sa politique et voici la réponse qu’il leur fit: «Dès que je serais au pouvoir, je réimprimerais les livres des émigrés déclarant que Napoléon a usurpé un pouvoir qu’il n’avait pas en les rayant. Les trois quarts sont morts,—je les exilerais dans les départements des Pyrénées et deux ou trois voisins. Je ferais cerner ces quatre ou cinq départements par deux ou trois petites armées qui, pour l’effet moral, bivouaqueraient au moins six mois de l’année. Tout émigré qui sortirait de là serait impitoyablement fusillé.—Leurs biens rendus par Napoléon, vendus en morceaux non supérieurs à deux arpents.—Les émigrés jouiraient de pensions de mille, deux mille et trois mille francs par an. Ils pourraient choisir un séjour dans les pays étrangers.»
Les figures de MM. Thurot et de Tracy s’allongeaient pendant l’explication de ce plan. Tant d’audace était un crime impardonnable.
Nous arrivons au second grief de M. de Tracy.
Un jour, une dame, que Stendhal appelle Céline, lui dit: «M…, l’espion, a dit chez M. de Tracy.—Ah! voilà M. Beyle qui a un habit neuf, on voit bien que Madame Pasta vient d’avoir un bénéfice».
«Cette bêtise plut. M. de Tracy ne me pardonnait pas ma liaison publique (autant qu’innocente) avec cette actrice célèbre».
IV
Madame Sarah-Bernhardt a fait un jour un joli et triste conte[11], dont la morale est que seuls des gens de talent les acteurs mouraient tout entiers. Qui donc aujourd’hui parle de la Pasta? Et pourtant son succès fut immense—le Tout-Paris de la Restauration alla l’entendre; et ce fut l’unique actrice que l’on osât jamais comparer à Talma.
Le grand tragédien la reconnut presque pour rivale. «Talma n’a pas balancé à dire une chose vraie, sans pour cela qu’il compromît la valeur de son mérite. Il répétait souvent, en parlant de madame Pasta, qu’elle faisait naturellement ce que, lui, n’était parvenu à faire qu’à force de travail et à la fin de sa carrière[12].»
Beyle aussi essaye une comparaison entre la cantatrice et Talma; ce morceau résume admirablement toutes les impressions du dilettante qu’on trouve éparses dans la Vie de Rossini[13] et dans les Mélanges d’art et de littérature, œuvre posthume publiée en 1867 par R. Colomb.
«Ma grande affaire, comme celle de tous mes amis en 1821, était l’Opera Buffa. Madame Pasta y jouait Tancrède, Othello, Roméo et Juliette, d’une façon qui non seulement n’a jamais été égalée, mais qui n’avait certainement jamais été prévue par les compositeurs de ces opéras.
«Talma, que la postérité élèvera peut-être si haut, avait l’âme tragique, mais il était si bête qu’il tombait dans les affectations les plus ridicules… Le succès de Talma commença par la hardiesse, il eut le courage d’innover, le seul des courages qui soit étonnant en France…
«Il n’y avait de parfait dans Talma que sa tête et son regard vague.
«Je trouvai le tragique qui me convenait dans Kean[14] et je l’adorai. Il remplit mes yeux et mon cœur. Je vois encore là devant moi Richard III et Othello.
«Mais le tragique dans une femme, où pour moi il est le plus touchant, je ne l’ai trouvé que chez madame Pasta, et là, il était pur, parfait, sans mélange. Chez elle, elle était silencieuse et impassible. En rentrant, elle passait deux heures sur son canapé à pleurer et à avoir des accès de nerfs.
«Toutefois, ce talent tragique, était mêlé avec le talent de chanter. L’oreille achevait l’émotion commencée par les yeux[15].»
Une dizaine d’années plus tard, George Sand, voyageant en compagnie d’Alfred de Musset, entendit la Pasta à Venise—et ses impressions notées dans l’Histoire de ma vie, montrent que Beyle n’exagère rien. Stendhal ne nous donne pas de portrait physique de la Pasta. George Sand, moins psychologue, la décrit avec quelque détail, aussi le passage suivant sera-t-il bien à sa place ici:
«La Pasta était encore belle et jeune sur la scène. Petite, grasse et trop courte de jambes, comme le sont beaucoup d’Italiennes, dont le buste magnifique semble avoir été fait aux dépens du reste, elle trouvait le moyen de paraître grande et d’une allure dégagée, tant il y avait de noblesse dans ses attitudes et de science dans sa pantomime. Je fus bien désappointée de la rencontrer le lendemain, debout sur sa gondole, et habillée avec la trop stricte économie, qui était devenue sa préoccupation constante. Cette belle tête de camée que j’avais vue de près aux funérailles de Louis XVIII, si fine et si veloutée, n’était plus que l’ombre d’elle-même. Sous son vieux chapeau et son vieux manteau, on eût pris la Pasta pour une ouvreuse de loges. Pourtant elle fit un mouvement pour indiquer à son gondolier l’endroit où elle voulait aborder, et dans ce geste, la grande reine, sinon la divinité, reparut[16].»
L’amour de Beyle pour l’Italie et pour la musique—et aussi l’espoir de rencontrer des Milanais qui lui parleraient de Métilde—le conduisirent tout naturellement chez la Pasta. De plus, Stendhal était là dans l’atmosphère qui lui convenait pour écrire la Vie de Rossini, qui parut en 1824.
Beyle habitait alors l’hôtel des Lillois, rue de Richelieu, nº 63—dans cette même maison demeurait la célèbre cantatrice. Le soir, en sortant de quelque réunion mondaine ou du théâtre, vers minuit, il entrait chez la Pasta, où se donnait rendez-vous une nombreuse société—J.-J. Ampère, Fauriel, entre autres, et tous les Italiens plus ou moins exilés de passage à Paris.
Beyle, silencieux, rêveur, dans ce salon, songeait moins à la femme qu’à l’artiste—non qu’il le voulût peut-être, mais il avait vu et compris que tel devait être son rôle. Il s’explique très sincèrement sur sa prétendue liaison avec la Giuditta.
Comme le comte de Tracy, la Pasta fut une de ces personnes auxquelles Stendhal eut le malheur de vouloir trop plaire. Il en prit son parti et se consola de ce que «la chose se fût bornée à la plus stricte et plus dévouée amitié,» de part et d’autre.
Mais Beyle n’en resta pas moins, aux yeux de la société de la rue d’Anjou, l’amant de la cantatrice.
L’opinion qu’on avait de Stendhal était toujours extrême—il a eu de vrais amis et de vrais ennemis; les amis étaient ceux qui le connaissaient—les ennemis ceux qui le connaissaient mal. Sainte-Beuve, qui ne peut être accusé de tendresse pour Beyle, nous donne là-dessus un précieux témoignage. «Que cet homme, qui passait pour méchant auprès de ceux qui le connaissaient peu, était aimé de ses amis! Que je sais de lui des traits délicats et d’une âme toute libérale![17]» Et les mêmes amis, les mêmes ennemis existent, encore aujourd’hui, qu’on peut diviser en catégories analogues.
Beyle raconte, dans la Vie de Henri Brulard, que chez certaines personnes, il ne pouvait plus dire qu’il avait vu passer un cabriolet jaune dans la rue sans avoir le malheur d’offenser mortellement les hypocrites et même les niais. Il eut à subir de réels affronts: madame de Lamartine, à Florence, évita de le recevoir[18]. Cette réputation, exagérée à plaisir, lui valut le surnom de Méphistophélès, que lui donnèrent quelques-uns de ses amis. «Au fond, dit-il, je surprenais ou scandalisais toutes mes connaissances; j’étais un monstre ou un dieu.»
Et ces jugements sur l’homme ressemblaient fort aux jugements qu’on portait sur le littérateur.
Ainsi, pour bien des gens, Beyle n’était qu’un ignorant. Il n’avait pas, il est vrai, une science très sûre, mais au moins il avait beaucoup d’esprit et incontestablement beaucoup d’idées personnelles, quoique discutables parfois. Il n’apprenait jamais aux autres que ce qu’il avait senti ou éprouvé lui-même—est-ce là pourtant un mérite médiocre? Au sujet de cette réputation d’ignorance il raconte une jolie anecdote: «Un des étonnements du comte Daru était que je pusse écrire une page qui fît plaisir à quelqu’un. Un jour, il acheta de Delaunay, qui me l’a dit, un petit ouvrage de moi qui, à cause de l’épuisement de l’édition, se vendait quarante francs. Son étonnement fut à mourir de rire, dit le libraire.
—«Comment! quarante francs!
—«Oui, M. le comte, et par grâce; et vous ferez plaisir au marchand en ne le prenant pas à ce prix.
—«Est-il possible! disait l’Académicien en levant les yeux au ciel: Cet enfant, ignorant comme une carpe!
«Il était parfaitement de bonne foi. Les gens des antipodes, regardant la lune lorsqu’elle n’a qu’un petit croissant pour nous, se disent: Quelle admirable clarté! la lune est presque pleine! M. le comte Daru, membre de l’Académie française, associé de l’Académie des sciences, etc., etc., et moi nous regardions le cœur de l’homme, la nature, etc., de côtés opposés.»
Et par ce petit récit, ne pouvons-nous pas, en même temps, nous faire une idée de la conversation de Beyle? N’est-ce pas là un charmant spécimen de sa façon ingénieuse d’expliquer les choses, ce qui pour lui est presque toujours s’expliquer soi-même.
C’est dans cet égoïsme psychologique qu’il excelle, et nous ne lui en ferons pas un reproche.
Un de ses amis nous dit, dans une notice peu connue: «Jamais il ne sut ce que c’était que l’esprit préparé. Il inventait en causant tout ce qu’il disait… il trouvait à chaque instant de ces traits imprévus qui ne peuvent être le résultat de l’étude[19].»
L’anecdote sur le comte Daru ne répond-elle pas à ce joli signalement que nous donne Arnould Frémy?
Beyle n’avait pas porte ouverte seulement chez M. de Tracy—Mme Cabanis ou la Pasta, il était encore reçu chez M. Cuvier, chez Mme Ancelot, chez le baron Gérard, chez Mme de Castellane, où il rencontre Thiers qu’il trouve trop effronté, bavard, Mignet, sans esprit, Béranger qu’il admire pour son caractère, Aubernon et Beugnot. Mais il sera plus intéressant de parler des dimanches de Delécluze, le critique d’art des Débats, où Stendhal se montre sous un jour nouveau.
V
Chez Etienne Delécluze, Beyle devait rencontrer la société qui lui convenait. Dans le salon de la rue d’Anjou, il était glacé par la froideur de M. de Tracy, chez Mme Cabanis, gêné par le ton bourgeois; et enfin, chez la Pasta il se laissait aller au «bonheur du silence»;—il lui suffisait d’écouter les autres et d’entendre bourdonner à ses oreilles ces syllabes milanaises qui l’attendrissaient.
Aux réunions de Delécluze, il trouva enfin la liberté d’allure et le franc parler dont il avait besoin pour être tout à fait lui-même.
Ces réceptions du dimanche, composées d’hommes exclusivement, étaient fort suivies et très brillantes. Nous le savons non seulement par Beyle, mais par Delécluze qui, dans ses Souvenirs de soixante années, nomme tous ses amis—et la seule liste de ces personnes prouve combien il dut se dépenser d’esprit dans le modeste appartement du journaliste.
On y voyait J.-J. Ampère, le critique en voyage, comme il s’est intitulé dans quelques-uns de ses livres où il initiait les français aux littératures étrangères; Albert Stapfer, l’élève de Guizot; Sautelet, cet intelligent libraire-éditeur, qui eut une fin tragique à laquelle Mérimée fait allusion dans sa brochure sur Stendhal; Paul-Louis Courier, dont les conseils encouragèrent Beyle à publier Racine et Shakespeare; le baron de Mareste l’homme du monde de ce cénacle de gens de lettres, où il avait un rôle charmant: écouter et comprendre; Adrien de Jussieu, le silencieux botaniste qui était la galerie et disait en prenant congé du maître de la maison: «Ils ont été bien amusants aujourd’hui» ou «ça n’a pas été aussi amusant que dimanche dernier.» Et enfin, the last and not the least, Prosper Mérimée, que Beyle avait rencontré, en 1821, chez Joseph Lingay, le professeur de rhétorique du futur auteur de Colomba. La première impression de Stendhal ne fut pas très favorable. «Pauvre jeune homme en redingote grise et si laid avec son nez retroussé» dit-il de Mérimée. Et il ajoute: «ce jeune homme avait quelque chose d’effronté et d’extrêmement déplaisant, ses yeux petits et sans expression avaient un air toujours le même et cet air était méchant. Telle fut la première vue du meilleur de mes amis actuels. Je ne suis pas trop sûr de son cœur, mais je suis sûr de ses talents.»
«Je ne sais, dit Stendhal, qui me mena chez M. de L’Etang—(c’est le pseudonyme transparent qu’il donne à Delécluze).—Il s’était fait donner un exemplaire de l’Histoire de la Peinture en Italie, sous prétexte d’un compte-rendu dans le Lycée—un de ces journaux éphémères qu’avait créé à Paris le succès de l’Edinburgh Review.
«Il désira me connaître, on me mena donc chez M. de. L’Etang, un dimanche à deux heures. C’est à cette heure incommode qu’il recevait. Il tenait donc académie au sixième étage d’une maison qui lui appartenait à lui et à ses sœurs, rue Gaillon.» Beyle se trompe, il ne faut jamais trop se fier à lui quand il s’agit de «descriptions matérielles,»—la maison de Delécluze était rue de Chabanais, au coin de la rue Neuve-des-Petits-Champs et l’appartement au quatrième. Mais continuons: «De ses petites fenêtres, on ne voyait qu’une forêt de cheminées en plâtre noirâtre. C’est pour moi une des vues les plus laides, mais les quatre petites chambres qu’habitait M. de L’Etang étaient ornées de gravures et d’objets d’art curieux et agréables. Il y avait un superbe portrait du cardinal de Richelieu que je regardais souvent. A côté était la grosse figure lourde, pesante, niaise de Racine. C’était avant d’être aussi gras que ce grand poète avait éprouvé les sentiments dont le souvenir est indispensable pour faire Andromaque ou Phèdre.»
Nous retrouvons ici le ton sarcastique de Racine et Shakespeare, cette brochure que Stendhal allait publier; c’est chez Delécluze que Beyle «la trompette à la fois et le général d’avant-garde de la nouvelle révolution littéraire[20]» discuta les théories condensées dans ces quelques pages agressives, l’un des premiers documents à consulter pour l’histoire du romantisme.
Passons maintenant à Delécluze lui-même et à son entourage. «Je trouvai chez M. de L’Etang, devant un petit mauvais feu, car ce fut, ce me semble, en février 1822 qu’on m’y mena—huit ou dix personnes qui parlaient de tout. Je fus frappé de leur bon sens, de leur esprit, et surtout du tact fin du maître de la maison qui, sans qu’il y parût, dirigeait la discussion de façon à ce qu’on ne parlât jamais trois à la fois ou que l’on n’arrivât pas à de tristes moments de silence.»
Beyle, en somme, a été assez malmené par Delécluze dans ses Souvenirs de soixante années, au point que Sainte-Beuve, prend la défense de Stendhal[21]. Il trouve Delécluze souverainement injuste pour Beyle.
«Sa sévérité étrange, ajoute-t-il, pour un si ancien ami et un si piquant esprit appelle la nôtre à son égard et la justifierait, s’il en était besoin—». Et en note, ce post-scriptum qui se cache pour être mieux vu: «Je sais quelqu’un qui a dit:
«Delécluze est parfois un béotien émoustillé, mais il y a toujours le béotien.»
Stendhal ne pouvait pas ne pas voir le béotien qu’il y avait en Delécluze—mais ce n’est qu’après avoir dit tout le bien possible de son nouvel ami qu’il laisse entrevoir ce côté ridicule du personnage: «M. de L’Etang, dit-il, est un caractère dans le genre du bon vicaire de Wakefield. Il faudrait pour en donner une idée toutes les demi-teintes de Goldsmith ou d’Addison.
«Il a toutes les petitesses d’un bourgeois. S’il achète pour trente-six francs une douzaine de mouchoirs chez le marchand du coin, deux heures après, il croit que ses mouchoirs sont une rareté, et que pour aucun prix on ne pourrait en trouver de semblables à Paris.»
Peut-on noter un travers avec plus d’imprévu et plus d’esprit? Il serait trop cruel pour Delécluze de retranscrire ici quelques uns de ses jugements sur Stendhal.
Et Beyle se résume en une page exquise, dans laquelle oubliant le béotien, il ne voit plus que le plaisir qu’il a éprouvé dans «l’Académie» de la rue de Chabanais.
«Je ne saurais exprimer trop d’estime pour cette société. Je n’ai jamais rien rencontré, je ne dirai pas de supérieur, mais même de comparable. Je fus frappé le premier jour et vingt fois peut-être pendant les trois ou quatre ans qu’elle a duré, je me suis surpris à faire ce même acte d’admiration.
«Une telle société n’est possible que dans la patrie de Voltaire, de Molière, de Courier…..
«La discussion y était franche sur tout et avec tous. On était poli chez M. de L’Etang, mais à cause de lui. Il était souvent nécessaire qu’il protégeât la retraite des imprudents qui, cherchant une idée nouvelle, avaient avancé une absurdité trop marquante.»
C’est chez Delécluze que Beyle lança pour la première fois ces mots brillants qui firent sa réputation d’homme d’esprit et qu’on retrouve dans sa correspondance et ailleurs:
Le principe du romantisme «est d’administrer au public la drogue juste qui lui fera plaisir dans un lieu et à un moment donnés.» Définition que Baudelaire a prise pour lui et à son compte.
Et la contre-partie: «Le classicisme présente aux peuples la littérature qui donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands pères.»
«L’Alexandrin un cache-sottise.»
C’est là aussi qu’il scandalisa bien des gens par des théories païennes dans lesquelles il entre beaucoup plus d’enfantillage et d’impertinence que de conviction profonde; ici Beyle est la dupe de ses préjugés; à cet égard il a tenu à se montrer irréconciliable devant ses contemporains.
Dans ses œuvres et même ses œuvres (comme la Vie de Henri Brulard ou les Souvenirs d’Egotisme) écrites librement, puisqu’elles ne devaient être publiées selon son désir, qu’après sa mort, à le bien lire, il n’est pas l’homme que nous laissent entrevoir George Sand[22] et Mérimée.
Mérimée si fin, si perspicace, semble avoir été dupé à son tour, et avoir cherché à prendre trop au sérieux certaines boutades de son ami.
VI
C’était pour Beyle un apprentissage, que cette vie de Paris, dans ces mondes très différents. Il se révéla causeur plein d’idées nouvelles et de formules inédites, chez les uns; chez les autres—contre-partie naturelle—il fut jugé homme dangereux et révolutionnaire en morale autant qu’en politique.
Pour lui la question n’était pas là. Il laissait dire, et se contentait d’observer, préoccupé constamment de trouver «la théorie du cœur humain» et de «peindre ce cœur par la littérature.»
Il s’essayait sur ce public restreint, ne se donnant pas tout entier; il conservait toute son indépendance.
Jamais il ne voulut cultiver un salon, cela contrariait trop ses habitudes. Il faisait des apparitions et n’était jamais assidu. Il ne songeait pas à s’assurer une situation, comme on l’a dit, il n’était déjà plus ambitieux que littérairement. Aussi sacrifia-t-il tout à cette passion dominante. En ne se mêlant pas trop aux coteries, il sut garder toute son originalité pour le jour où, enfin, maître de lui-même, il se résume en une œuvre—une œuvre capitale qui ne pouvait être pensée et conçue qu’après une longue expérience.
C’est en 1830 qu’il écrira le Rouge et le Noir, avant de s’exiler à Civita-Vecchia, avant d’aller occuper son poste modeste de consul de France dans cette triste ville italienne.
Stendhal dira, en 1835, après avoir réfléchi à la situation qu’il aurait pu obtenir, s’il avait su profiter de ses relations: «Je regrette peu l’occasion perdue. Au lieu de dix, j’aurais vingt mille, au lieu de chevalier, je serais officier de la Légion d’honneur, mais j’aurais pensé trois ou quatre heures par jour à ces platitudes d’ambition qu’on décore du nom de politique; j’aurais fait beaucoup de bassesses…..
«La seule chose que je regrette, c’est le séjour de Paris.»
Et il se reprend bien vite: «Mais je serais las de Paris, en 1836, comme je suis las de ma solitude, parmi les sauvages de Civita-Vecchia[23].»
Ainsi, il a le bonheur de garder un plus agréable souvenir de ses années passées dans les cercles littéraires de Paris, car il ne croyait pas qu’il n’est pire misère que de se rappeler les temps heureux dans les jours de douleur; comme Alfred de Musset, il reniait cette pensée du poète florentin.
CASIMIR STRYIENSKI.
Jersey, septembre 1892.
SOUVENIRS D’ÉGOTISME
CHAPITRE PREMIER[24]
Mero[25], 20 juin 1832.
Pour employer mes loisirs dans cette terre étrangère, j’ai envie d’écrire un petit mémoire de ce qui m’est arrivé pendant mon dernier voyage à Paris, du 21 juin 1821 au… novembre 1830; c’est un espace de neuf ans et demi. Je me gronde moi-même depuis deux mois, depuis que j’ai digéré la nouvelleté de ma position pour entreprendre un travail quelconque. Sans travail, le vaisseau de la vie humaine n’a point de lest.
J’avoue que le courage d’écrire me manquerait si je n’avais pas l’idée qu’un jour ces feuilles paraîtront imprimées et seront lues par quelque âme que j’aime, par un être tel que Madame Roland ou M. Gros, le géomètre[26]. Mais les yeux qui liront ceci s’ouvrent à peine à la lumière, je suppose que mes futurs lecteurs ont dix ou douze ans.
Ai-je tiré tout le parti possible, pour mon bonheur, des positions où le hasard m’a placé pendant les neuf ans que je viens de passer à Paris? Quel homme suis-je? Ai-je du bon sens? Ai-je du bon sens avec profondeur?
Ai-je un esprit remarquable? En vérité, je n’en sais rien. Encore par ce qui m’arrive au jour le jour, je pense rarement à ces questions fondamentales, et alors mes jugements varient comme mon humeur. Mes jugements ne sont que des aperçus.
Voyons si, en faisant mon examen de conscience, la plume à la main, j’arriverai à quelque chose de positif et qui reste longtemps vrai pour moi. Que penserai-je de ce que je me sens disposé à écrire en le relisant vers 1835, si je vis? Sera-ce comme pour mes ouvrages imprimés? J’ai un profond sentiment de tristesse quand, faute d’autre livre, je les relis.
Je sens, depuis un mois que j’y pense, une répugnance réelle à écrire uniquement pour parler de moi, du nombre de mes chemises, de mes accidents d’amour-propre. D’un autre côté, je me trouve loin de la France[27], j’ai lu tous les livres qui ont pénétré dans ce pays. Toute la disposition de mon cœur était d’écrire un livre d’imagination sur une intrigue d’amour arrivée à Dresde, en août 1813, dans une maison voisine de la mienne, mais les petits devoirs de ma place m’interrompent assez souvent, ou, pour mieux dire, je ne puis jamais, en prenant mon papier, être sûr de passer une heure sans être interrompu. Cette petite contrariété éteint net l’imagination chez moi. Quand je reprends ma fiction, je suis dégoûté de ce que je pensais. A quoi un homme sage répondra qu’il faut se vaincre soi-même. Je répliquerai: il est trop tard, j’ai 4. ans; après tant d’aventures, il est temps de songer à achever la vie le moins mal possible.
Ma principale objection n’était pas la vanité qu’il y a à écrire sa vie. Un livre sur un tel sujet est comme tous les autres; on l’oublie bien vite, s’il est ennuyeux. Je craignais de déflorer les moments heureux que j’ai rencontrés, en les décrivant, en les anatomisant. Or, c’est ce que je ne ferai point, je sauterai le bonheur.
Le génie poétique est mort, mais le génie du soupçon est venu au monde. Je suis profondément convaincu que le seul antidote qui puisse faire oublier au lecteur les éternels Je que l’auteur va écrire, c’est une parfaite sincérité.
Aurai-je le courage de raconter les choses humiliantes sans les sauver par des préfaces infinies? Je l’espère.
Malgré les malheurs de mon ambition, je ne me crois point persécuté par eux, je les regarde comme des machines poussées, en France, par la Vanité et ailleurs par toutes les passions, la vanité y comprise.
Je ne me connais point moi-même, et c’est ce qui, quelquefois, la nuit, quand j’y pense, me désole. Ai-je su tirer un bon parti des hasards au milieu desquels m’a jeté et la toute-puissance de Napoléon (que toujours j’adorai) en 1810, et la chute que nous fîmes dans la boue en 1814, et notre effort pour en sortir en 1830? Je crains bien que non, j’ai agi par humeur, au hasard. Si quelqu’un m’avait demandé conseil sur ma propre position, j’en aurais souvent donné un d’une grande portée; des amis, rivaux d’esprit, m’ont fait compliment là-dessus.
En 1814, M. le comte Beugnot, ministre de la police, m’offrit la direction de l’approvisionnement de Paris. Je ne sollicitais rien, j’étais en admirable position pour accepter, je répondis de façon à ne pas encourager M. Beugnot, homme qui a de la vanité comme deux Français; il dut être fort choqué.
L’homme qui eut cette place s’en est retiré au bout de quatre ou cinq ans, las de gagner de l’argent, et, dit-on, sans voler. L’extrême mépris que j’avais pour les Bourbons—c’était pour moi, alors, une boue fétide—me fit quitter Paris peu de jours après n’avoir pas accepté l’obligeante proposition de M. Beugnot. Le cœur navré par le triomphe de tout ce que je méprisais et ne pouvais haïr, n’était rafraîchi que par un peu d’amour que je commençais à éprouver pour madame la comtesse Dulong, que je voyais tous les jours chez M. Beugnot et qui, dix ans plus tard, a eu une grande part dans ma vie. Alors elle me distinguait, non pas comme aimable, mais comme singulier. Elle me voyait l’ami d’une femme fort laide et d’un grand caractére, madame la comtesse Beugnot. Je me suis toujours repenti de ne pas l’avoir aimée. Quel plaisir de parler avec intimité à un être de cette portée!
Cette préface est bien longue, je le sens depuis trois pages; mais je dois commencer par un sujet si triste et si difficile que la sagesse me saisit déjà, j’ai presque envie de quitter la plume. Mais, au premier moment de solitude, j’aurais des remords.
Je quittai Milan pour Paris, le.. juin 1821, avec une somme de 3,500 francs, je crois, regardant comme unique bonheur de me brûler la cervelle quand cette somme serait finie. Je quittais, après trois ans d’intimité, une femme que j’adorais, qui m’aimait et qui ne s’est jamais donnée à moi.