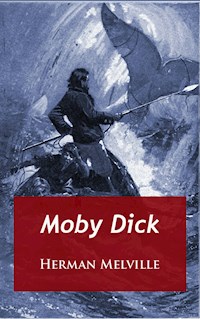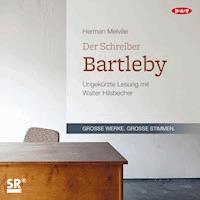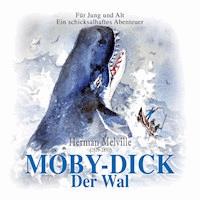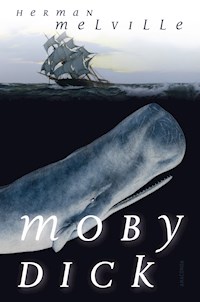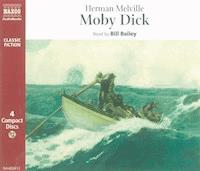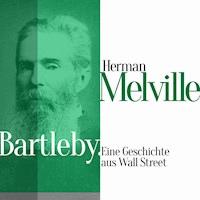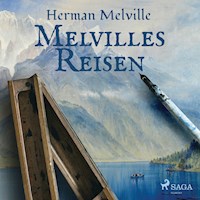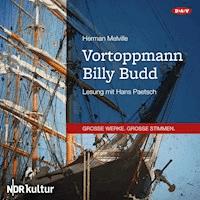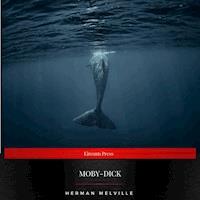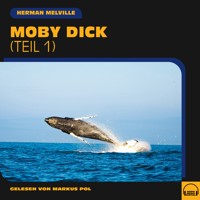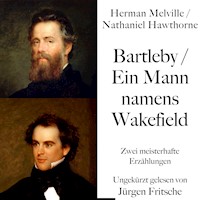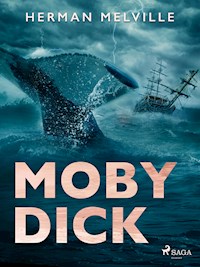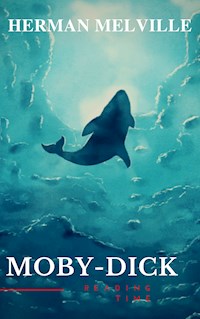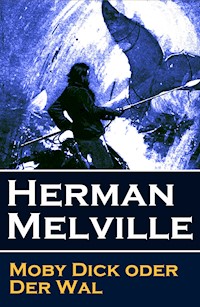Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Herman Melville, du haut de ses vingt-cinq ans, nous raconte la rencontre avec un peuple étonnant du Pacifique
Nuku-Hiva, une île de l'archipel des Marquises, Pacifique. Deux tribus y vivent, l'une douce et pacifique, l'autre cannibale. Après avoir fui le navire baleinier, deux fugitifs sont recueillis par l'une des tribus. Taïpi est la relation d'une aventure qu'a connue Herman Melville avec l'un de ses coéquipiers après une campagne éprouvante de chasse à la baleine. Ils sont très bien accueillis et vivent en harmonie avec leurs hôtes sur cette île paradisiaque.
Un récit documentaire qui nous fait explorer la Polynésie, ses autochtones et sa splendeur d’antan !
EXTRAIT
Six mois en mer ! Oui, six mois sans avoir vu la terre, à courir après la baleine, sous le soleil brûlant de l’Équateur, ballottés par les vagues du Pacifique avec le ciel au-dessus de nos têtes, l’Océan autour de nous et rien d’autre !
Depuis des semaines nos provisions de denrées fraîches sont épuisées, nous n’avons pas un légume ; les beaux régimes de bananes qui décoraient autrefois l’entrepont ont disparu ; disparues aussi les oranges délicieuses qui pendaient à nos vergues ! Il ne nous reste plus que des conserves et des biscuits.
Oh ! revoir un brin d’herbe tendre, humer les senteurs du sol ! N’y a-t-il rien de frais autour de nous, rien de vert sur quoi reposer nos yeux ? Si, l’intérieur des flancs du navire est peint en vert mais d’une couleur si terne qu’elle ne peut évoquer l’idée des feuilles d’arbres ou des prairies ; même l’écorce du bois qui nous sert de combustible a été dévorée par le porc du capitaine…, d’ailleurs, depuis lors, le porc a été mangé.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
On va, d'îles en îles, on tombe amoureux de ces polynésiens, on admire l'eau écarlate, on nage dans ces eaux chaudes, on vit sur ces plages qui n'existent plus et quand la dernière page arrive, c'est le dernier rivage qui s'estompe. On sait qu'on rentre au port, que s'en est fini de l'exil, du périple en mer du sud. On regrette alors que le voyage n'ait pas été plus long... -
Tolbiac, Babelio
Finalement, Melville nous en dit bien plus sur l'Occident, et le regard eurocentriste (qui comprend aussi l'Amérique, qu'on se le dise) au XIXe siècle que sur la Polynésie. Un chef-d'oeuvre. -
Usurpateur, Babelio
À PROPOS DE L’AUTEUR
Herman Melville, né le 1er août 1819 à Pearl Street, au sud-est de Manhattan (New York), mort le 28 septembre 1891 à New York, est un romancier, essayiste et poète américain. Pratiquement oublié de tous à sa mort, Melville est redécouvert dans les années 1920 à travers son œuvre maîtresse
Moby Dick. Il est désormais considéré comme l'une des plus grandes figures de la littérature américaine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLAAEFrance
Herman Melville
Taïpi
Récit des îles Marquises
CLAAE
Illustration de la couverture : Polynesian Warrior © Erica Guilane-Nachez
© CLAAE 2016
Tous droits réservés. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle.
CLAAEFRANCE
EAN eBook : 9782379110207
Chapitre 1
Six mois en mer ! Oui, six mois sans avoir vu la terre, à courir après la baleine, sous le soleil brûlant de l’Équateur, ballottés par les vagues du Pacifique avec le ciel au-dessus de nos têtes, l’Océan autour de nous et rien d’autre !
Depuis des semaines nos provisions de denrées fraîches sont épuisées, nous n’avons pas un légume ; les beaux régimes de bananes qui décoraient autrefois l’entrepont ont disparu ; disparues aussi les oranges délicieuses qui pendaient à nos vergues ! Il ne nous reste plus que des conserves et des biscuits.
Oh ! revoir un brin d’herbe tendre, humer les senteurs du sol ! N’y a-t-il rien de frais autour de nous, rien de vert sur quoi reposer nos yeux ? Si, l’intérieur des flancs du navire est peint en vert mais d’une couleur si terne qu’elle ne peut évoquer l’idée des feuilles d’arbres ou des prairies ; même l’écorce du bois qui nous sert de combustible a été dévorée par le porc du capitaine…, d’ailleurs, depuis lors, le porc a été mangé.
Il n’y a plus qu’un seul habitant dans la cage à poules : c’était autrefois un coq jeune et hardi qui exerçait magnifiquement sa toute-puissante royauté.
Regardez-le maintenant : il reste toute la journée perché sur une de ses pattes et se détourne avec dégoût du grain moisi et de l’eau croupie qui forment sa pitance ; sans doute regrette-t-il ses compagnes qui lui ont été enlevées, une à une ; mais il ne les regrettera plus longtemps car Mungo, notre cuisinier nègre, m’a dit hier que le sort du pauvre Pedro est fixé ; son corps amaigri sera porté dimanche sur la table du capitaine et, bien avant la nuit, aura fait, avec le cérémonieux habituel, les délices de cet estimable officier.
Qui pourrait se montrer assez cruel pour désirer la mort de l’infortuné Pedro ? Pourtant les matelots ne cessent de la souhaiter car ils prétendent que le capitaine ne dirigera pas le bâtiment vers la terre tant qu’il aura en perspective un repas de chair fraîche. Or, ce malheureux volatile est seul maintenant à pouvoir le lui fournir. Quand il l’aura dévoré, le capitaine reviendra à la raison. Je ne te veux pas de mal, Pedro, mais puisque tu es condamné à subir, tôt ou tard, le sort de toute ta race et, puisque la fin de ton existence doit donner le signal de notre délivrance, je souhaite, moi aussi, qu’on te torde le cou, car j’ai un désir infini de revoir la terre ferme !
Le vieux bâtiment lui-même aspire à se retrouver sur son ancre et Jack Lewis a répondu tout net, l’autre jour, au capitaine qui critiquait sa man?uvre :
— Voyez-vous, cap’taine, j’suis aussi bon pilote qu’on les fait, mais personne ne peut plus gouverner not’ vieille barque ; all’ sent la terre proche et n’veut plus s’laisser mener à l’inverse !
Pauvre bateau ! Il a l’air piteux ! Sa peinture brûlée par le soleil, se gonfle et se fendille ; il traîne du goémon dans son sillage, d’horribles mollusques se sont accrochés à sa poupe et, chaque fois qu’une vague se soulève, on voit sur sa quille des morceaux de cuivre déchiquetés.
Pauvre bateau ! Tu roules et tu tangues sans répit depuis six mois. Mais prends courage, car j’espère te voir bientôt à l’ancre dans quelque baie aux rivages verdoyants à l’abri des vents mauvais.
*
— Hourrah ! les garçons ! Voilà qui est décidé ! La semaine prochaine, nous nous dirigeons vers les îles Marquises ! Les îles Marquises ! Quelles visions ce seul nom n’évoque-t-il pas ! Des houris enivrantes, des banquets de cannibales, des bois de cocotiers, des rochers de corail, des chefs tatoués et des temples de bambou ; puis des vallées riantes, plantées d’arbres à pain, des canots sculptés dansant sur des idoles, des rites païens et des sacrifices humains.
Telles furent les étranges idées mêlées qui me hantèrent à partir de ce moment car j’éprouvai une irrésistible curiosité à l’égard de ces îles que les anciens voyageurs avaient si magnifiquement décrites.
Le groupe vers lequel nous naviguions (bien qu’il doive être compris parmi les premières découvertes européennes dans les mers du Sud, puisqu’il fut visité dès l’année 1595) est toujours peuplé d’êtres aussi étranges et aussi sauvages que jamais.
Les missionnaires, animés de l’esprit divin, se sont rendus sur leurs côtes superbes, mais ils les ont abandonnés à leurs idoles de bois et de pierre. Mais combien intéressantes sont les circonstances dans lesquelles ces îles ont été découvertes !
Elles avaient surgi devant Mendanna qui croisait devant leurs eaux à la recherche d’une région féconde en or, et, pendant un instant, l’Espagne avait pu croire son rêve réalisé. En l’honneur du marquis de Mendoza, alors vice-roi du Pérou, sous les auspices duquel le marin naviguait, il leur donna un nom qui dénotait quel était le rang de son maître et lorsqu’il rentra chez lui, il fit une description à la fois grandiose et vague de leur beauté. Mais ces îles qui n’avaient pas été troublées depuis des années retombèrent dans leur obscurité et ce n’est que récemment qu’on a appris quelques détails les concernant.
Peu de renseignements ont été donnés sur cet archipel intéressant si l’on en excepte les quelques allusions qui y ont été faites dans des récits de voyages à travers les mers du Sud. Cook, dans ses nombreuses expéditions autour du monde, a juste effleuré leurs côtes et nous ne les connaissons que par de vagues descriptions.
Au cours des dernières années, des bâtiments américains et anglais envoyés dans le Pacifique pour y pêcher la baleine ont parfois, lorsqu’ils étaient à court de provisions, jeté l’ancre dans le vaste port qui se trouve dans une des îles ; mais la crainte des indigènes, fondée sur le souvenir du sort affreux que beaucoup de Blancs avaient subi dans ces parages, a empêché les équipages de se mêler suffisamment aux habitants pour apprendre quelles sont leurs m?urs et leurs coutumes. Bref, il n’y a pas dans tout le Pacifique, de groupes d’îles découvertes depuis quelque temps que l’on connaisse aussi mal que les Marquises et il m’est agréable de penser que mon récit contribuera à arracher le voile qui couvre cette belle et romanesque région.
Chapitre 2
Je n’oublierai jamais les dix-huit ou vingt jours pendant lesquels les vents équatoriaux nous poussèrent doucement vers les îles. Lorsque nous chassions la baleine nous croisions à quelque vingt degrés à l’ouest de Gallipagas, aussi nous suffit-il, lorsque notre destination fut fixée, de maintenir le bâtiment sous le vent qui fit le reste. Le pilote ne se donnait pas la peine de gouverner ; il s’installait confortablement à son poste où il somnolait. La fidèle Dolly, semblable à l’un de ces êtres, qui agissent au mieux quand ils sont livrés à eux-mêmes, suivait sa route sans se tromper.
Quelle délicieuse période de langueur nous passâmes ainsi. Il n’y avait rien à faire, ce qui s’accordait au mieux avec notre paresse naturelle. Nous abandonnâmes complètement l’avant du bateau, étendîmes un prélart au-dessus du pont et y passâmes toutes nos journées. Chacun de nous semblait être sous l’influence d’un narcotique. Même les officiers de quart qui auraient dû ne jamais s’asseoir, essayaient en vain de se tenir debout et se voyaient obligés de s’appuyer à la rambarde en regardant la mer. On ne pouvait songer à lire car dès que l’on prenait un volume on s’endormait aussitôt.
Bien qu’il me fût impossible de me soustraire à la torpeur générale, je parvenais, de temps à autre à secouer celle qui m’envahissait, pour admirer la beauté du paysage. Le ciel offrait une grande étendue d’un bleu pâle, sauf à l’horizon où l’on pouvait apercevoir les légères draperies de nuages dont la forme et les couleurs ne variaient jamais. Les longs flots cadencés du Pacifique déferlaient, surmontés de petites vagues qui étincelaient au soleil. De temps à autre un banc de poissons volants, effrayés par le passage du navire, s’élevait, puis retombait, en cascade d’argent, dans la mer. On voyait alors le superbe albacore aux flancs chatoyants décrire une courbe dans sa chute et disparaître à la surface de la lame qui le recueillait. Au loin se creusait le sillage profond de la baleine et, plus près le requin vorace, ce sinistre rôdeur des eaux, se glissait vers nous et nous contemplait d’un ?il mauvais. Parfois quelque monstre informe mollement bercé par les vagues, s’enfonçait dans l’onde à notre approche et disparaissait à notre vue.
Mais ce qu’il y avait de plus impressionnant dans tout ce décor, c’était le silence presque ininterrompu qui régnait dans le ciel et sur l’eau ; on n’entendait rien que le bruit de la mer fendue par l’étrave.
Quand nous approchâmes de la terre, je saluai avec joie l’apparition de nombreux oiseaux qui, criant et tournoyant, accompagnèrent le bâtiment et vinrent parfois se poser sur nos vergues et nos mâts. Le bandit de l’air que l’on nomme à juste titre l’épervier des vaisseaux, avec son bec rouge et son plumage noir, nous survolait en décrivant des cercles de plus en plus rapprochés jusqu’à ce que nous puissions apercevoir les étranges lueurs qui s’allumaient dans ses yeux ; puis, comme satisfait par ce qu’il avait vu, il remontait dans le ciel et se perdait au loin. Bientôt d’autres signes de la proximité d’un rivage, devinrent apparents et nous ne tardâmes pas à entendre l’exclamation joyeuse prononcée de la manière traînante qu’affectionnent les marins : « Te…erre ! »
Le capitaine bondit sur le pont et réclama à grands cris sa longue-vue ; le second, d’une voix plus stridente encore, appela la vigie pour lui demander le point. Le cuisinier nègre montra sa tête crépue à une écoutille et Boatswain, le chien, se précipita en avant en aboyant furieusement.
Terre ! Oui, c’était elle : une ligne bleue irrégulière et à peine perceptible délimitait vaguement les hauteurs de Nuku-Hiva… Cette île, bien qu’elle soit généralement considérée comme étant une des Marquises, forme, au dire de certains navigateurs, avec les îles de Rooka et de Ropo, un groupe à part qui a reçu le nom de Washington. Elles sont disposées en triangle et se trouvent à 8° 38’ et 9° 32’ latitude sud, 139° 20’ et 140° 10’ longitude ouest de Greenwich. On se rendra compte immédiatement qu’il est superflu de les considérer comme formant un archipel séparé car elles se trouvent dans le voisinage immédiat des autres, à moins d’un degré nord-ouest de celles-ci ; leurs habitants parlent le dialecte des îles Marquises et leur religion, leurs costumes, sont identiques.
La seule raison pour laquelle elles ont pu être arbitrairement distinguées peut être attribuée à ce fait étrange que leur existence était inconnue jusqu’en 1791, époque à laquelle elles furent signalées par le capitaine Ingraham de Boston, Massachusetts, près de deux siècles après la découverte des îles voisines par l’agent du vice-roi du Pérou.
En dépit de cette particularité, je suivrai l’exemple de la plupart des voyageurs et je considérerai ces îles comme faisant partie des Marquises.
Nuku-Hiva est la plus importante de tout l’archipel car c’est la seule où les habitants ont l’habitude de stopper ; elle est en outre connue comme étant l’endroit où l’audacieux capitaine Porter ravitaillait ses bâtiments pendant la guerre anglo-américaine et d’où il exécutait des sorties contre la grande flottille, armée pour la pêche de la baleine, qui naviguait sous pavillon ennemi dans les mers environnantes.
Cette île a environ quarante kilomètres de long et presque autant de large. Elle a trois bons ports sur sa côte ; le plus grand et le meilleur, est appelé par les habitants du voisinage Tyohée et a été baptisé : Massachusetts par le capitaine Porter. Parmi les tribus qui résident sur les côtes des autres anses, ainsi que parmi les voyageurs, il est habituellement connu sous le nom donné à l’île elle-même : Nuku-Hiva.
Les habitants se sont corrompus au contact des Européens ; mais en ce qui concerne leurs coutumes et leur mode d’existence, ils gardent leur caractère primitif et sont demeurés à peu près dans la situation où les premiers hommes blancs les ont trouvés. Les clans hostiles qui résident dans les coins les plus reculés de l’île et qui entretiennent rarement des communications avec les étrangers, n’ont en rien modifié leur état d’autrefois.
Le point d’atterrissage que nous désirions atteindre se trouvait dans la baie de Nuku-Hiva. Nous avions aperçu le contour des montagnes vers le coucher du soleil, de sorte que, après avoir navigué toute la nuit sous une brise légère, nous nous trouvâmes fort près de l’île le lendemain ; mais comme le port que nous cherchions était sur sa face opposée, nous fûmes obligés de longer le rivage pendant un certain temps, ce qui nous permit d’apercevoir des vallées en fleurs, des gorges profondes, des cascades et des taillis dissimulés, çà et là, par des rochers au-delà desquels, lorsque nous les avions dépassés, apparaissaient de nouveaux et merveilleux décors.
Ceux qui se rendent pour la première fois dans les mers du Sud sont généralement surpris par l’aspect des îles telles qu’on les voit du large. D’après les descriptions vagues que l’on a faites de leur beauté, beaucoup de personnes sont enclines à se les figurer sous la forme de plaines fertiles, ombragées par des bosquets délicieux, arrosées par des sources jaillissantes et peu élevées au-dessus du niveau de la mer.
Sa réalité est très différente : on aperçoit des côtes rocheuses, battues par les flots qui se brisent en écumant, contre les hautes falaises, coupées de gorges profondes qui laissent voir des vallées boisées, séparées par des crêtes montagneuses aux pentes herbeuses. Vers midi nous approchâmes de l’entrée du port et nous longeâmes le promontoire qui la coupe pour pénétrer dans la baie de Nuku-Hiva. Aucune description n’est capable d’en révéler la beauté, mais, à ce moment, je ne la voyais pas car je n’avais d’yeux que pour le drapeau tricolore français qui flottait sur six vaisseaux, dont les coques noires et les canons montraient qu’ils appartenaient à la marine de guerre.
Ils étaient à l’ancre dans ce ravissant petit golfe où leur présence paraissait absolument anormale. Mais nous ne tardâmes pas à apprendre ce qui les y avait amenés. Tout le groupe des îles venait d’être pris par l’amiral Dupetit-Thouars, au nom de l’invincible nation française.
Ce renseignement nous fut donné par un individu étrange, un véritable vagabond des mers du Sud qui s’approcha de notre navire dans une baleinière dès que nous pénétrâmes dans la baie.
Quelques personnes bienveillantes qui se trouvaient à la coupée l’aidèrent à monter à bord, car notre visiteur était dans cet état d’ébriété où un homme se montre à la fois cordial et inutile.
Bien qu’il fût dans l’impossibilité de se tenir droit et de traverser le pont, il offrit ses services au pilote pour nous procurer un bon atterrissage ; mais notre capitaine mit ses talents en doute et refusa de croire à sa science de navigateur.
Cependant le nouveau venu était décidé à jouer un rôle et, après de nombreux efforts, il réussit à s’introduire dans le canot de sauvetage où il se soutint en s’accrochant à un filin et où il commença à donner des ordres avec une extrême volubilité ponctuée de gestes fort originaux. Bien entendu personne ne lui obéit, mais comme il était impossible de le faire taire, ce bizarre individu, lorsque nous longeâmes les bâtiments de la flotte française, donna une véritable représentation aux officiers de ces navires. Nous apprîmes par la suite qu’il avait été lieutenant dans la marine anglaise, mais qu’il avait déshonoré son uniforme au cours d’une croisière, puis avait déserté et avait passé plusieurs années à errer parmi les îles du Pacifique. S’étant par hasard trouvé à Nuku-Hiva lorsque les Français en avaient pris possession, il avait été nommé pilote par les autorités nouvelles.
Tandis que nous avancions lentement dans la baie, de nombreux canots sortirent des plages environnantes et nous nous trouvâmes bientôt au milieu d’une véritable flottille de petits bateaux occupés par des indigènes qui cherchaient à monter à notre bord et se bousculaient dans leurs efforts infructueux. De temps en temps les bouts-dehors de leurs légères chaloupes s’emmêlaient et menaçaient de faire culbuter les embarcations, ce qui provoquait une confusion impossible à décrire.
Je n’avais certainement jamais entendu d’aussi étranges cris, ni vu des gestes aussi désordonnés. On aurait cru que les insulaires allaient se couper la gorge alors qu’ils s’efforçaient simplement de dégager leurs barques.
Parmi les canots une quantité de noix de coco flottaient en groupes circulaires se soulevant ou s’abaissant au rythme des vagues et insensiblement s’approchaient de notre bâtiment.
Comme je me penchais avec curiosité par-dessus bord pour essayer de comprendre ce bizarre phénomène, une des masses flottantes qui était très en avant des autres, attira mon attention ; je distinguai en son centre une sorte de sphère brune qui tournait et sautait d’une façon singulière, et je m’aperçus bientôt qu’elle ressemblait étonnamment au crâne d’un sauvage.
Je vis ensuite deux yeux et je compris que nous avions affaire à un commerçant qui avait trouvé cette méthode peu banale d’apporter ses produits au marché. Il avait attaché toutes les noix les unes aux autres avec des morceaux de leurs fibres partiellement attachées à l’écorce, puis, se mettant au centre de ce collier, il faisait avancer le tout en nageant.
Je fus quelque peu étonné de constater qu’il n’y avait pas une seule femme parmi les indigènes qui nous entouraient. J’ignorais à cette époque que, en vertu du tabou1, l’usage des canots était absolument interdit au sexe faible sur toutes les parties de l’île. Une femme était punie de mort si elle était vue entrant dans une embarcation même amarrée au rivage ; quand une dame des îles Marquises veut voyager par mer, il faut qu’elle le fasse à la nage.
Nous étions à un mille et demi environ du fond de la baie quand quelques-uns des insulaires qui étaient parvenus à monter à bord au risque de couler leurs canots, attirèrent notre attention sur un singulier mouvement qui se produisait dans l’eau devant le navire. Tout d’abord je crus qu’il était causé par un banc de poissons qui dansaient à la surface, mais les sauvages nous déclarèrent que c’étaient des Winhenies (jeunes filles), qui venaient nous souhaiter ainsi la bienvenue.
Tandis qu’elles approchaient et que j’observais leurs mouvements, le geste de leur bras droit qui soulevait au-dessus de l’eau leur ceinture et leurs longues chevelures sombres qui traînaient derrière elles, j’aurais pu croire que c’étaient des sirènes car elles en avaient l’apparence et la grâce.
Nous étions encore à quelque distance de la côte et nous avancions lentement, nous passâmes au milieu de ces nymphes qui nous entouraient. Beaucoup d’entre elles s’emparèrent des anneaux pour grimper le long des flancs du navire, d’autres, au risque d’être écrasées par lui, se hissèrent à l’aide de filins. Toutes réussirent à atteindre le plat-bord où elles s’accrochèrent ruisselantes d’eau, à demi enveloppées par leurs tresses d’un noir de jais ; elles étaient pleines de gaieté, s’interpellaient les unes les autres et riaient. Elles ne demeurèrent d’ailleurs pas inactives et s’entr’aidèrent pour faire leur toilette.
Leurs luxuriantes chevelures furent roulées serrées aussi étroitement que possible et débarrassées de l’écume marine ; leurs corps furent soigneusement séchés puis enduits d’une huile odorante contenue dans une petite coquille ronde qui passait de main en main. Leur parure fut complétée par quelques plis d’étoffe blanche dont elles entourèrent leur taille. Une fois prêtes, elles n’hésitèrent plus et ne tardèrent pas à gambader sur le pont, plusieurs se penchèrent sur les rambardes ou sur le beaupré, tandis que d’autres s’allongeaient dans les chaloupes.
Leur aspect me stupéfiait ; leur extrême jeunesse, la teinte brun clair de leur peau, leurs traits fins, leurs corps gracieux, leurs membres délicatement attachés, leurs gestes naturels me semblaient aussi étranges que beaux.
La Dolly était positivement prise d’assaut et jamais navire ne fut capturé par une bande de pirates plus irrésistibles ; nous ne pouvions que nous rendre, et pendant tout le reste de son séjour dans la baie, la Dolly et son équipage furent aux mains des sirènes.
Dans la soirée, lorsque nous eûmes jeté l’ancre, le pont fut illuminé avec des lanternes, et ces pittoresques sylphides, ornées de fleurs et vêtues de tappas2, organisèrent un véritable bal.
Elles adoraient la danse et la grâce sauvage, la vivacité de leurs mouvements dépassaient de beaucoup tout ce que j’avais jamais vu. Il y avait un tel abandon voluptueux dans leurs attitudes que je n’oserais essayer de le décrire.
Notre bâtiment était maintenant en proie à l’orgie et à la débauche. La licence la plus hardie et la plus honteuse ivresse y régnèrent, avec de rares intervalles de sobriété, pendant toute la durée de notre séjour. Combien les malheureux sauvages, exposés à des exemples si pernicieux peuvent être à plaindre ! Confiants et sans expérience, ils sont aisément corrompus par la civilisation européenne.
Heureux ceux qui habitent une île non encore découverte, au milieu de l’océan, et n’ont pas subi le contact mauvais de l’homme blanc.
_____________________
1 Loi sacrée.
2 Tissus de fibres fabriqués par les indigènes.
Chapitre 3
Ce fut pendant l’été de 1842 que nous arrivâmes dans les îles et notre bâtiment était à peine depuis quelques jours dans le port de Nuku-Hiva lorsque je me décidai à l’abandonner. On peut comprendre qu’il me fallait avoir de nombreuses et importantes raisons d’agir ainsi si l’on réfléchit que je préférerais courir les risques de me mêler aux sauvages de l’île plutôt que de supporter un nouveau voyage à bord de la Dolly. Pour employer l’expression concise et nette des matelots, j’avais décidé de m’évader.
Or, comme un sens péjoratif s’attache généralement à ce mot, je me dois à moi-même de donner des explications de ma conduite. Lorsque je m’étais enrôlé dans l’équipage de la Dolly, j’avais accepté et signé les règlements du bord. Je m’étais donc engagé à servir en une certaine qualité pendant la durée du voyage et, bien entendu, j’étais forcé de remplir mon contrat. Mais, dans toute convention, si l’une des parties ne tient pas ses engagements, l’autre ne reprend-elle pas véritablement sa liberté ?
Ce principe étant admis, je vais l’appliquer à mon cas. En plusieurs circonstances, non seulement les conditions sous-entendues, mais encore les conditions écrites avaient été violées sur le bateau. Les usages y étaient tyranniques, les malades avaient été négligés d’une façon honteuse, les provisions avaient été parcimonieusement mesurées et les croisières avaient été prolongées au-delà des limites raisonnables. Le capitaine était responsable de ces abus, mais il eût été vain d’espérer, soit qu’il y remédiât, soit qu’il modifiât ses manières d’agir qui étaient arbitrairement brutales. Il ne répondait à ceux qui lui adressaient des plaintes qu’en leur faisant appliquer des coups de garcettes si violents qu’ils réduisaient au silence les plus obstinés.
À qui aurions-nous pu nous adresser pour obtenir justice ? Nous avions laissé la justice et l’équité de l’autre côté du cap et, malheureusement, à de rares exceptions près, l’équipage était composé de malheureux poltrons qui n’étaient pas unis entre eux et qui ne s’entendaient que pour supporter la tyrannie perpétuelle du capitaine. C’eût été folie si deux ou trois d’entre nous avaient essayé de se rebeller sans être soutenus par les autres.
Cet état de choses aurait pu être enduré pendant quelque temps si nous avions eu l’espoir d’être promptement délivrés ; mais quelle triste perspective nous attendait !
La longueur des campagnes de pêche à la baleine au large du cap Horn est proverbiale ; elles s’étendent souvent sur une période de quatre ou cinq années. Des adolescents qui, poussés à la fois par leur goût aventureux et par la dureté des temps, s’embarquent à Montuchet pour entreprendre un voyage d’agrément sur le Pacifique, ne reviennent parfois chez eux que dans leur âge mûr.
Les préparatifs mêmes qui sont faits pour une expédition de ce genre, peuvent à bon droit vous effrayer. Comme le bâtiment ne transporte pas de marchandises, sa cale est pleine de provisions et les propriétaires des navires, qui jouent le rôle de pourvoyeurs, emplissent le garde-manger de mets excellents. Des morceaux de choix de b?uf et porc, de toutes formes et de toutes dimensions, sont salés avec soin et enfermés dans des barils : ils sont coriaces à des degrés divers. On emporte également de l’eau dans de grands tonneaux et on en alloue deux pintes par jour à chaque homme à bord ; un approvisionnement considérable de biscuits de mer, réduits à un état complet de pétrification, afin de les préserver de la moisissure, est également préparé pour les besoins de l’équipage.
Sans parler de leur qualité, l’abondance de ces provisions sur un baleinier est presque incroyable. Parfois, quand j’ai eu l’occasion de descendre dans la cale et de voir les rangées de barils et de tonneaux, dont le contenu devait être consommé en temps voulu par les hommes embarqués, mon c?ur s’est serré.
Bien que, en général, un bâtiment qui n’a pas eu la chance de rencontrer des baleines, continue sa croisière jusqu’à ce qu’il lui reste à peine assez de vivres pour rentrer à son port d’attache, il y a des cas où des capitaines obstinés échangent les fruits de leur labeur contre de nouveaux approvisionnements dans quelque ville des côtes du Chili ou du Pérou et recommencent leur voyage avec un zèle et une persévérance inlassables.
C’est en vain que leurs armateurs leur envoient des rappels urgents : ils ont prononcé un v?u et, s’ils ne peuvent remplir leur vaisseau de blanc de baleine, ils ne regagneront jamais les côtes américaines. J’ai entendu parler d’un bateau qui, au bout de plusieurs années d’absence fut considéré comme perdu ; d’après les dernières nouvelles qu’on avait reçues de lui, il avait rencontré une de ces îles flottantes du Pacifique dont les déplacements sont relevés avec soin dans chaque nouvelle édition des cartes marines. Toutefois, après un long temps, la Persévérance, car tel était son nom, fut signalée à l’extrémité de la terre ; ses voiles étaient rapiécées, ses espars étaient étayés avec de vieux bouts de bois et ses cordages étaient noués ou épissés partout. Son équipage était composé d’une vingtaine de vieux loups de mer qui se traînaient avec peine sur le pont. Le bout de tous les filins, à l’exception des drisses, était amarré au cabestan, de sorte que toutes les man?uvres étaient faites mécaniquement. Sa coque était tapissée de coquillages, trois requins apprivoisés nageaient dans son sillage pour se régaler des restes que leur jetait le cuisinier, et de grandes bandes de bonites et d’albacores la suivaient.
Tel est le récit que j’ai entendu faire au sujet de ce navire et je ne l’ai jamais oublié ; je ne sais ce qu’il est devenu par la suite, mais il n’est jamais rentré à son port d’attache et je suppose qu’il erre encore !…
Ceci dit concernant la longueur habituelle de ces voyages, quand j’aurai ajouté que nous n’étions en mer que depuis quinze mois, le lecteur comprendra que l’avenir me paraissait peu encourageant, étant donné surtout que j’avais toujours eu le pressentiment, qui s’était jusqu’alors vérifié, que notre expédition serait malheureuse.
Je puis déclarer sur l’honneur que, quelque temps après être rentré chez moi, à l’issue de toutes mes aventures, j’appris que la Dolly croisait toujours dans le Pacifique, qu’elle n’avait pas fait de pêches fructueuses et que la plupart des hommes de son équipage l’avaient abandonnée. Sa croisière dura environ cinq ans. Mais j’en reviens à ce qui me concerne.
Tenant compte des circonstances et ne voyant aucune probabilité d’améliorer mon sort tant que je demeurerais à bord de la Dolly, je me résolus à la quitter et je me mis en devoir d’obtenir tous les renseignements possibles sur l’île et ses habitants, afin de dresser mon plan d’évasion.
Je vais exposer le résultat de cette enquête pour que mon récit en devienne plus clair : La baie de Nuku-Hiva a l’apparence d’un fer à cheval et sa circonférence est d’environ quinze kilomètres. On y accède du côté de la mer par une étroite entrée flanquée, à droite et à gauche, de deux îlots jumeaux, en forme de cônes qui s’élèvent à une hauteur de cinq cents pieds ; le rivage décrit ensuite une large courbe.
À partir du bord de la mer, le sol s’élève uniformément de tous côtés en pentes verdoyantes et les collines se transforment progressivement en montagnes majestueuses dont les hauteurs ferment l’horizon. La beauté de la grève est rehaussée par de profondes et romantiques vallées qui paraissent toutes prendre naissance en un point central d’où elles descendent jusqu’au rivage et dont les extrémités supérieures se perdent dans l’ombre des montagnes.
Le long de chacune d’elles court un ruisseau clair qui prend parfois la forme d’une petite cascade, puis plus loin, celle d’une chute importante et finit par se glisser dans la mer.
Les habitations des indigènes, construites en bambous jaunes, entrelacés avec goût et couvertes des longues feuilles du palmier, sont disséminées irrégulièrement dans ces vallées, sous les ombrages des cocotiers.
Rien ne peut égaler le grandiose décor de cette baie. Vue de notre bâtiment alors qu’il était à l’ancre dans le port, elle présentait l’aspect d’un vaste amphithéâtre naturel et j’ai souvent éprouvé en la contemplant un sentiment de regret à la pensée que semblable beauté était cachée aux yeux des admirateurs de la Nature. À côté de cette baie, les côtes de l’île sont creusées de plusieurs autres petits golfes auxquels aboutissent des vallées larges et verdoyantes. Elles sont habitées par des tribus distinctes de sauvages qui, tout en parlant la même langue et en ayant la même religion et les mêmes lois, ont, de temps immémorial, combattu les uns contre les autres.
Les montagnes qui les séparent et qui s’élèvent habituellement à deux ou trois mille pieds au-dessus du niveau de la mer, définissent géographiquement le territoire de chacune de ces tribus hostiles : celles-ci ne les franchissent jamais que pour voler ou faire la guerre. La ravissante vallée de Hapa est voisine de la baie de Nuku-Hiva et leurs habitants entretiennent les meilleures relations. De l’autre côté de Hapa, au contraire, s’ouvre la vallée des terribles Taïpis, ennemis invincibles des deux autres tribus. Ces guerriers célèbres inspirent une effroyable terreur aux autres insulaires. Leur nom même éveille la crainte, car dans le langage des îles Marquises il signifie qui aime la chair humaine. Il est étrange que ce titre ait été décerné exclusivement à cette tribu, car tous les autres indigènes de ce pays sont cannibales. Il stigmatise sans doute la férocité particulière de ce clan. Les Taïpis jouissent d’une incontestable notoriété dans toutes les îles ; les indigènes de Nuku-Hiva faisaient souvent en pantomime, à notre équipage, le récit de leurs sinistres exploits et montraient les cicatrices des blessures qu’ils avaient reçues au cours de leurs rencontres désespérées avec eux.
Quand nous descendions à terre, ils cherchaient à nous effrayer en nous désignant l’un d’entre eux sous le nom de Taïpi et paraissaient fort surpris de ne pas nous voir fuir. Il était amusant de constater avec quel empressement ils se défendaient contre toute accusation de cannibalisme tout en dénonçant leurs ennemis comme très friands de chair humaine ; mais j’aurai souvent l’occasion de rappeler cette particularité.
Bien que je fusse convaincu que les habitants de notre baie avaient les mêmes goûts que ceux des autres tribus, je ne pouvais m’empêcher d’éprouver une répugnance invincible envers les Taïpis.
Même avant de venir aux Marquises, j’avais entendu raconter par des marins qui y avaient atterri, des histoires révoltantes concernant ces sauvages, par exemple l’aventure arrivée au capitaine de la Catherine, qui s’était, peu de mois auparavant, risqué à pénétrer dans la baie, avait été saisi par les indigènes, emporté dans leur vallée où il n’avait échappé à une mort affreuse que par l’intervention providentielle d’une jeune fille qui l’aida à s’échapper. J’avais également entendu parler d’un navire anglais qui, après une croisière fatigante, avait essayé d’entrer dans la baie de Nuku-Hiva. Arrivé à deux ou trois milles de terre, il vit venir à sa rencontre un grand canot rempli d’indigènes qui offrirent au capitaine de le piloter. Celui-ci, ne connaissait pas les lieux, accepta volontiers cette proposition et le navire suivit le canot qui le conduisit dans une anse ravissante où il jeta l’ancre.
Dans la nuit qui suivit, les perfides Taïpis, qui avaient attiré le malheureux bâtiment, l’envahirent par centaines et en massacrèrent tout l’équipage.
Chapitre 4
Lorsque je me fus irrévocablement décidé à quitter clandestinement le bateau et que j’eus recueilli sur la baie tous les renseignements que je pouvais être en mesure d’obtenir, j’examinai avec soin tous les plans d’évasion qui se présentaient à moi, car je voulais agir avec prudence dans une aventure où un échec était susceptible d’entraîner de si désagréables conséquences.
La pensée d’être repris et ramené à bord m’était si odieuse que j’étais décidé à ne pas courir, par trop de précipitation, un risque de ce genre.
Je savais que notre estimable capitaine n’accepterait pas volontiers que l’un de ses meilleurs marins s’exposât aux dangers d’un séjour prolongé parmi les sauvages de l’île et j’étais certain que, si je disparaissais, il n’hésiterait pas à leur offrir un important métrage de calicot imprimé pour me faire appréhender.
Il irait peut-être même jusqu’à leur promettre une carabine et, en ce cas, la population de la baie tout entière serait sur mes traces. M’étant assuré que par mesure de précaution les insulaires se groupaient au fond des vallées et évitaient, sauf en cas de guerre, de se rendre sur les parties élevées des côtes, j’en conclus que si je parvenais, sans être aperçu, à me glisser vers les montagnes, je pourrais aisément y demeurer en vivant de fruits, jusqu’au départ du bâtiment. Or, cet événement ne pourrait manquer de m’être connu sans retard, puisque je dominerais le port tout entier.
Cette idée me séduisit et je me plus à m’imaginer assis sous un cocotier à la crête de la montagne, à proximité d’un groupe de bananiers, tandis que la Dolly évoluait pour sortir de la baie. Il y avait évidemment un revers à cette agréable perspective : je pourrais tomber sur une bande de ces Taïpis, buveurs de sang, dont l’appétit aiguisé par l’air de cette région élevée, les pousserait à me dévorer.
Mais il était impossible d’éviter cette éventualité et j’étais prêt à courir quelques risques; de plus, je comptais sur mon habileté pour échapper aux cannibales.
J’étais décidé à ne confier mes projets à aucun de mes camarades et, encore moins, à en inviter un à m’accompagner. Mais il se trouva qu’un soir, alors que j’étais assis sur le pont, occupé à réfléchir à mes divers plans, j’aperçus un marin appuyé contre le plat-bord et plongé dans une profonde rêverie. C’était un garçon de mon âge environ pour lequel j’avais beaucoup d’estime, car Toby – c’était ainsi qu’il se faisait appeler à bord et il n’avait jamais voulu nous apprendre son véritable nom – en était digne en tous points. Il était actif, complaisant, brave, franc et exprimait ses sentiments avec une netteté courageuse. En maintes occasions, je l’avais aidé à sortir des complications où cette franchise l’entraînait et, soit pour cette raison, soit à cause de certaines affinités qui existaient entre nous, il avait toujours paru rechercher ma société.
Nous avions passé ensemble bien des heures au quart que nous allégions par des chants, des récits ou des imprécations contre le pénible destin qui nous était commun. Comme moi, Toby avait été élevé dans un milieu tout différent et sa conversation permettait souvent de s’en rendre compte encore qu’il prît grand soin de le dissimuler. Il appartenait à cette catégorie de vagabonds, qu’on rencontre parfois en mer, qui ne révèlent pas leur origine, ne parlent jamais de leur famille et parcourent le globe comme poussés par une force mystérieuse à laquelle ils ne peuvent résister.
L’aspect extérieur de Toby était séduisant, car tandis que la plupart des matelots de l’équipage étaient aussi grossiers de corps que d’esprit, il était petit, mince et souple. Son teint olivâtre avait encore été foncé par le soleil ; des boucles d’un noir de jais entouraient son front et faisaient paraître encore plus sombres ses grands yeux.
C’était un garçon étrange, nerveux et mélancolique, presque morose et dont le caractère vif le jetait parfois dans de véritables transports de fureur.
Le pouvoir qu’un esprit ardent possède sur des caractères faibles est extraordinaire et j’ai vu de forts gaillards, non dépourvus de courage, reculer devant cet adolescent lorsqu’il était en proie à une de ses colères. Mais celles-ci étaient assez rares et servaient simplement à mon brave camarade de dérivatif contre les ennuis quotidiens.
Personne ne voyait jamais rire Toby ; il souriait parfois d’un air sarcastique qui contrastait avec son imperturbable gravité. Depuis quelque temps j’avais constaté que la mélancolie de Toby avait beaucoup augmenté et je l’avais vu regarder la terre d’un air triste. Je savais qu’il détestait le navire et je pensais qu’il s’en évaderait volontiers si l’occasion s’en présentait ; mais la tentative était si périlleuse que je me croyais seul à bord capable d’y songer ; ce en quoi je me trompais… Quand j’aperçus Toby appuyé contre le plat-bord et plongé dans ses pensées, il m’apparut que le sujet de ses méditations pouvait être le même que le mien. S’il en est ainsi, me dis-je, n’est-ce pas celui de tous mes compagnons que je choisirais le plus volontiers pour partager mon aventure ? Pourquoi n’aurais-je pas quelqu’un près de moi qui m’aiderait à supporter les dangers et les fatigues ?
Ces idées traversèrent rapidement mon esprit et je me demandai pour quelle raison elles ne m’étaient pas venues plus tôt ; mais il n’était pas trop tard !
Je frappai sur l’épaule de Toby pour le tirer de sa rêverie et il nous suffit de peu de mots pour nous mettre d’accord.
En une heure nous eûmes réglé les préliminaires de notre entente et élaboré un plan ; nous scellâmes nos engagements par un cordial serrement de mains, puis, afin de ne pas faire naître les soupçons, chacun de nous regagna son hamac pour y passer sa dernière nuit sur la Dolly.
Le lendemain, l’équipe de tribord à laquelle nous appartenions tous deux, devait descendre à terre ; nous décidâmes de nous séparer aussitôt des autres hommes sans exciter leurs soupçons et de prendre le chemin des montagnes.
Vus du navire, leurs sommets paraissaient inaccessibles, mais, çà et là, des éperons s’en détachaient ; l’un d’eux nous semblait plus praticable que les autres et nous convînmes de le gravir, persuadés qu’il nous permettrait de parvenir ensuite jusqu’à la cime. Nous repérâmes donc sa situation avec soin.
Nous avions l’intention de nous cacher jusqu’après le départ du bâtiment, puis de nous mêler aux indigènes de Nuku-Hiva, de rester dans l’île tant que le séjour nous en paraîtrait agréable, enfin de la quitter à la première occasion favorable.