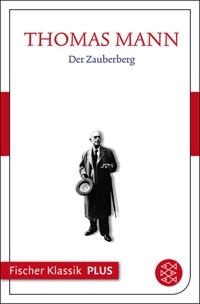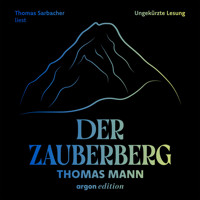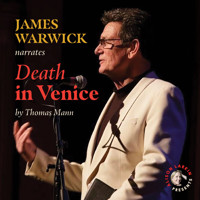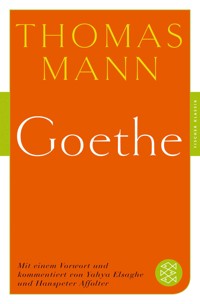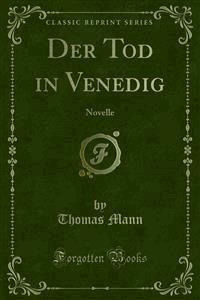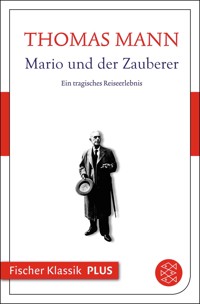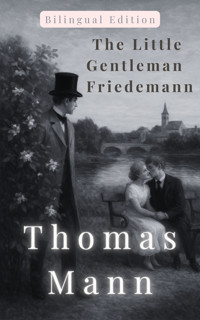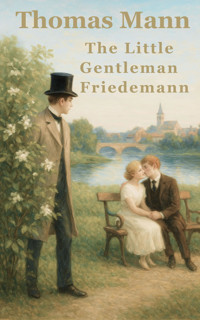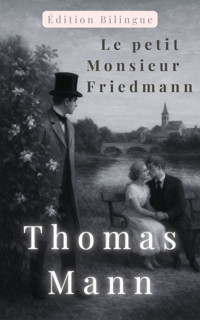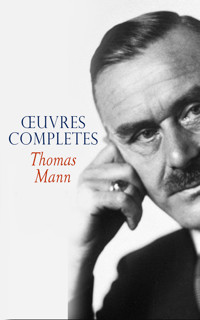
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Thomas Mann est l'une des grandes consciences littéraires européennes du XXᵉ siècle. Né à Lübeck en 1875, il analyse très tôt les valeurs et les fractures de la bourgeoisie allemande. Issu d'une famille dont il scrutera avec acuité les contradictions, il connaît la célébrité dès son premier grand roman. Exilé pendant le nazisme, engagé contre le totalitarisme, il incarne l'intellectuel humaniste de son temps. Lauréat du prix Nobel de littérature en 1929, son œuvre conjugue rigueur formelle, ironie morale et interrogation incessante sur la décadence, l'art, la maladie et la responsabilité de l'écrivain face à l'Histoire. Ses livres explorent la tension entre esprit et vie, ordre et chaos, désir et devoir, tout en offrant une méditation toujours actuelle sur l'identité européenne. Leur puissance analytique, alliée à une narration fascinante, explique pourquoi ils demeurent intensément lus, étudiés et aimés aujourd'hui. Cette édition rassemble l'intégralité des romans, offrant une vision complète et cohérente d'un univers romanesque monumental. Parmi eux, sept titres s'imposent comme des jalons essentiels de la littérature mondiale. Les Buddenbrook retrace le déclin d'une famille de négociants sur plusieurs générations : chronique sociale d'une précision implacable, le livre fait du temps un agent tragique et inaugure le grand roman moderne de la bourgeoisie. La Montagne magique, située dans un sanatorium alpin, transforme l'immobilité en laboratoire d'idées ; à travers la maladie, Mann interroge le sens de la vie, du progrès et de la mort, dans une œuvre à la fois philosophique et romanesque. Avec Mort à Venise, le conflit entre beauté, désir et discipline morale atteint une intensité bouleversante : cette méditation sur l'art et la passion est devenue un mythe littéraire universel. Le Docteur Faustus transpose la légende de Faust dans l'Allemagne du XXᵉ siècle ; le pacte avec le diable y devient une allégorie glaçante de la compromission intellectuelle et politique. Le vaste cycle de Joseph et ses frères revisite le récit biblique en fresque humaniste, alliant érudition, humour et profondeur psychologique, et redonnant une modernité saisissante aux mythes fondateurs. Dans Les Confessions de l'imposteur Felix Krull, Mann adopte un ton ludique et ironique : l'ascension d'un escroc charmant devient une réflexion brillante sur l'identité, le mensonge et le théâtre social. Enfin, Lotte à Weimar offre un dialogue subtil avec Goethe ; à travers le retour de Charlotte Buff, l'auteur interroge la mémoire, la création et la légende littéraire elle-même. Classiques par leur ambition formelle et leur lucidité morale, ces œuvres continuent d'éclairer notre présent, faisant de cette édition un accès privilégié à l'un des sommets de la littérature moderne. Cette traduction a été assistée par une intelligence artificielle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Thomas Mann - Œuvres Completes
Table des matières
Romans
Les Buddenbrook
Première partie
I
« Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est... »
« Eh bien, le diable même, c'est la question, ma très chère demoiselle! »
Mme Buddenbrook, assise à côté de sa belle-mère sur le canapé droit, laqué de blanc et décoré d'une tête de lion dorée, dont les coussins étaient recouverts d'un tissu jaune clair, jeta un coup d'œil à son mari, assis à côté d'elle dans un fauteuil, et vint en aide à sa petite fille, que son grand-père tenait sur ses genoux près de la fenêtre.
« Tony ! » dit-elle, « je crois que Dieu... »
Et la petite Antonie, âgée de huit ans et de constitution délicate, vêtue d'une petite robe en soie très légère aux reflets changeants, la jolie tête blonde légèrement détournée du visage de son grand-père, regardait dans la pièce d'un air pensif, sans rien voir, et répéta : « Qu'est-ce que c'est ? » dit-elle lentement : « Je crois que Dieu », ajouta-t-elle rapidement, le visage s'éclairant : « ... m'a créée avec toutes les créatures », elle avait soudainement trouvé le bon chemin et racontait maintenant, rayonnante de bonheur et sans s'arrêter, tout l'article, fidèle au catéchisme tel qu'il venait d'être révisé et publié en 1835 avec l'accord d'un sénat haut placé et sage. Quand on était lancé, pensait-elle, c'était comme quand on descendait la « montagne de Jérusalem » en hiver sur la petite luge à main avec ses frères : les pensées s'envolaient et on ne pouvait pas s'arrêter, même si on le voulait.
« Sans oublier les vêtements et les chaussures », dit-elle, « la nourriture et les boissons, la maison et la cour, la femme et les enfants, les champs et le bétail... » Mais à ces mots, le vieux M. Johann Buddenbrook éclata simplement de rire, de son rire clair et étouffé qu'il avait secrètement gardé en réserve. Il riait de plaisir de pouvoir se moquer du catéchisme, et c'était probablement dans ce seul but qu'il avait organisé ce petit examen. Il s'informa sur les champs et le bétail de Tony, lui demanda combien elle demandait pour le sac de blé et lui proposa de faire affaire avec elle. Son visage rond, rose et bienveillant, auquel il ne pouvait donner aucune expression de méchanceté, même avec la meilleure volonté du monde, était encadré par des cheveux poudrés de blanc comme neige, et quelque chose qui ressemblait à une petite tresse très discrète tombait sur le large col de sa veste gris souris. À soixante-dix ans, il était resté fidèle à la mode de sa jeunesse ; il avait seulement laissé tomber les galons entre les boutons et les grandes poches, mais il n'avait jamais porté de pantalons longs de sa vie. Son double menton large reposait sur le jabot de dentelle blanche, avec un air de confort.
Tout le monde avait ri avec lui, surtout par respect pour le chef de famille. Mme Antoinette Buddenbrook, née Duchamps, gloussait exactement comme son mari. C'était une dame corpulente avec d'épaisses boucles blanches au-dessus des oreilles, une robe rayée de noir et de gris clair sans bijoux, qui trahissait sa simplicité et sa modestie, et avec des mains toujours belles et blanches, dans lesquelles elle tenait un petit pompadour en velours sur ses genoux. Au fil des ans, ses traits étaient devenus étrangement similaires à ceux de son mari. Seule la forme et la vivacité de ses yeux sombres trahissaient un peu ses origines à moitié romanes ; elle venait d'une famille franco-suisse du côté de son grand-père et était née à Hambourg.
Sa belle-fille, la consule Elisabeth Buddenbrook, née Kröger, avait le rire des Kröger, qui commençait par un bruit de lèvres et où elle appuyait son menton sur sa poitrine. Comme tous les Kröger, elle était super élégante, et même si on ne pouvait pas dire qu'elle était belle, sa voix claire et posée, ses mouvements calmes, sûrs et doux donnaient à tout le monde un sentiment de clarté et de confiance. Ses cheveux roux, coiffés en une petite couronne sur le dessus de la tête et en larges boucles artificielles au-dessus des oreilles, s'accordaient avec un teint extrêmement blanc et délicat, parsemé de quelques petites taches de rousseur. Son visage, avec son nez un peu trop long et sa petite bouche, se caractérisait par l'absence totale de creux entre la lèvre inférieure et le menton. Son corsage court aux manches bouffantes, suivi d'une jupe étroite en soie vaporeuse à fleurs claires, laissait apparaître un cou d'une beauté parfaite, orné d'un ruban d'atlas sur lequel scintillait une composition de gros brillants.
Le consul se pencha en avant dans son fauteuil avec un mouvement un peu nerveux. Il portait une veste couleur cannelle avec de larges revers et des manches en forme de massue qui se resserraient autour des mains juste en dessous des poignets. Son pantalon était fait d'un tissu blanc lavable et orné de rayures noires sur les côtés. Une cravate en soie épaisse et large, qui remplissait tout le décolleté du gilet coloré, était nouée autour du col rigide dans lequel son menton se nichait... Il avait les yeux bleus et attentifs de son père, même si son regard était peut-être plus rêveur ; mais ses traits étaient plus sérieux et plus marqués, son nez était fort et aquilin, et ses joues, sur lesquelles poussaient des moustaches blondes et bouclées, étaient beaucoup moins pleines que celles du vieux.
Madame Buddenbrook se tourna vers sa belle-fille, lui serra le bras d'une main, regarda son giron en riant et dit :
« Toujours le même, mon vieux, Bethsy... ? » « Toujours », dit-elle comme « Tejours ».
La consulesse se contenta de menacer silencieusement de sa main délicate, faisant tinter doucement son bracelet en or, puis elle fit un geste caractéristique de la main, allant du coin de sa bouche à sa coiffure, comme pour repousser une mèche de cheveux égarée.
Le consul dit alors, avec un mélange de sourire conciliant et de reproche dans la voix :
« Mais papa, tu te moques encore une fois de ce qu'il y a de plus sacré !... »
Ils étaient assis dans la « salle panoramique », au premier étage de la vaste maison ancienne de la Mengstraße, que la société Johann Buddenbrook avait achetée il y a quelque temps et dans laquelle la famille n'habitait pas depuis longtemps. Les tapisseries solides et élastiques, séparées des murs par un espace vide, représentaient de vastes paysages aux couleurs douces, comme la fine moquette qui recouvrait le sol, une idylle dans le style du XVIIIe siècle, avec des vignerons joyeux, des laboureurs affairés, de jolies bergères parées de rubans, tenant dans leurs bras des agneaux propres au bord d'un étang miroitant ou embrassant tendrement des bergers... Un coucher de soleil jaunâtre dominait la plupart de ces tableaux, en harmonie avec le revêtement jaune des meubles laqués de blanc et les rideaux de soie jaune devant les deux fenêtres.
Par rapport à la taille de la pièce, il n'y avait pas beaucoup de meubles. La table ronde aux pieds fins, droits et légèrement ornés d'or n'était pas devant le canapé, mais contre le mur opposé, en face du petit harmonium sur lequel était posé un étui à flûtes. À part les fauteuils rigides régulièrement répartis le long des murs, il n'y avait qu'une petite table à couture près de la fenêtre et, en face du canapé, un secrétaire fragile et luxueux, recouvert de bibelots.
À travers une porte vitrée, en face des fenêtres, on pouvait voir la pénombre d'une salle à colonnes, tandis que sur la gauche, en entrant, se trouvait la haute porte à battants blancs menant à la salle à manger. Mais sur l'autre mur, dans une niche semi-circulaire et derrière une porte en fer forgé brillant artistiquement ajourée, le poêle crépitait.
Car le froid était arrivé tôt. Dehors, de l'autre côté de la rue, à la mi-octobre, les feuilles des petits tilleuls qui entouraient le cimetière Marienkirchhof avaient déjà jauni, le vent sifflait autour des imposants angles gothiques de l'église et une pluie fine et froide tombait. Pour Madame Buddenbrook, l'aînée, on avait déjà installé les doubles fenêtres.
C'était jeudi, le jour où, comme d'habitude, la famille se réunissait toutes les deux semaines ; mais aujourd'hui, en plus des membres de la famille qui vivaient en ville, on avait invité quelques bons amis de la maison à un déjeuner tout simple, et on était maintenant assis, vers quatre heures de l'après-midi, dans la pénombre, à attendre les invités...
La petite Antonie ne s'était pas laissée déranger par son grand-père pendant sa descente en luge, mais avait juste poussé sa lèvre supérieure, toujours un peu proéminente, encore plus loin sur la lèvre inférieure en faisant la moue. Elle était maintenant arrivée au pied de la « montagne de Jérusalem », mais incapable de s'arrêter brusquement, elle avait continué sa course un peu trop loin...
« Amen », dit-elle, « je sais quelque chose, grand-père ! »
« Tiens ! Elle sait quelque chose ! » s'écria le vieil homme, faisant semblant d'être rongé par la curiosité. « Tu as entendu, maman ? Elle sait quelque chose ! Personne ne peut me dire... »
« Si c'est un coup chaud », dit Tony en hochant la tête à chaque mot, « c'est l'éclair qui frappe. Mais si c'est un coup froid, c'est le tonnerre qui frappe ! »
Elle croisa alors les bras et regarda les visages souriants comme quelqu'un qui est sûr de son succès. Mais M. Buddenbrook était en colère contre cette sagesse, il voulait absolument savoir qui avait enseigné cette stupidité à l'enfant, et lorsqu'il s'avéra que c'était Ida Jungmann, la jeune fille récemment engagée pour s'occuper des petits, originaire de Marienwerder, le consul dut prendre la défense d'Ida.
« Tu es trop sévère, papa. Pourquoi ne pourrait-on pas avoir ses propres idées fantaisistes sur ce genre de choses à cet âge... »
« Excusez-moi, mon cher !... Mais c'est une folie ! Tu sais bien que je n'aime pas qu'on embrouille l'esprit des enfants ! Quoi, le tonnerre gronde ? Alors le tonnerre va bientôt frapper ! Allez-vous-en avec votre Prusse... »
Le truc, c'est que le vieux monsieur n'aimait pas trop Ida Jungmann. Il n'était pas borné. Il avait vu un peu du monde, s'était rendu en 1813 avec un attelage à quatre chevaux dans le sud de l'Allemagne pour acheter du blé en tant que fournisseur de l'armée prussienne, avait séjourné à Amsterdam et à Paris et, en homme éclairé, ne considérait pas comme condamnable tout ce qui se trouvait en dehors des portes de sa ville natale aux pignons. Mais en dehors des relations commerciales, dans les relations sociales, il était plus enclin que son fils, le consul, à fixer des limites strictes et à rejeter les étrangers. C'est pourquoi, lorsqu'un jour, ses enfants revinrent d'un voyage en Prusse occidentale et amenèrent avec eux cette jeune fille – elle n'avait alors que vingt ans – comme une sorte d'enfant Jésus, une orpheline, fille d'un aubergiste décédé juste avant l'arrivée des Buddenbrook à Marienwerder, le consul dut subir une réprimande de son père pour cette pieuse farce, au cours de laquelle le vieil homme ne parla presque que français et bas allemand... D'ailleurs, Ida Jungmann s'était révélée efficace dans les tâches ménagères et dans ses relations avec les enfants, et sa loyauté et sa conception prussienne des classes sociales la rendaient en fait parfaitement apte à occuper son poste dans cette maison. C'était une personne aux principes aristocratiques, qui faisait une distinction très nette entre la haute société et la petite bourgeoisie, entre la classe moyenne et la classe moyenne inférieure. Elle était fière d'appartenir à la haute société en tant que servante dévouée et n'aimait pas voir Tony se lier d'amitié avec une camarade de classe qui, selon Mamsell Jungmann, n'appartenait qu'à la classe moyenne...
À ce moment-là, la Prussienne elle-même apparut dans le hall à colonnes et entra par la porte vitrée : une fille assez grande, à la silhouette osseuse, vêtue d'une robe noire, aux cheveux lisses et au visage honnête. Elle tenait par la main la petite Klothilde, une enfant extrêmement maigre vêtue d'une robe en calicot à fleurs, aux cheveux ternes et cendrés et à l'air calme de vieille fille. Elle venait d'une branche de la famille qui n'avait rien, était la fille d'un neveu du vieux Buddenbrook qui bossait comme inspecteur agricole près de Rostock et, comme elle avait le même âge qu'Antonie et était une fille docile, elle avait été élevée ici.
« Tout est prêt », dit Mamsell Jungmann en rougissant, car à l'origine, elle ne savait pas du tout prononcer le « r ». « Klothildchen a bien aidé dans la cuisine, Trina n'a presque rien eu à faire... »
M. Buddenbrook sourit d'un air moqueur dans son jabot en entendant la prononciation bizarre d'Ida, mais le consul caressa la joue de sa petite nièce et dit :
« C'est bien, Thilda. Il faut prier et travailler. Notre Tony devrait prendre exemple sur elle. Elle a trop souvent tendance à l'oisiveté et à l'exubérance... »
Tony baissa la tête et regarda son grand-père, car elle savait bien qu'il la défendrait, comme d'habitude.
« Non, non », dit-il, « relève la tête, Tony, courage! Ce qui convient à certains ne convient pas à tous. Chacun à sa manière. Thilda est sage, mais nous ne sommes pas à mépriser non plus. Je parle raisonnable, Bethsy ? »
Il se tourna vers sa belle-fille, qui avait l'habitude d'approuver ses goûts, tandis que Mme Antoinette, plus par prudence que par conviction, prenait généralement le parti du consul. Ainsi, les deux générations se donnèrent la main, comme dans un chassez-croisez.
« Tu as tout à fait raison, papa », dit la consule. « Tony s'efforcera de devenir une femme intelligente et compétente... Les garçons sont-ils rentrés de l'école ? » demanda-t-elle à Ida.
Mais Tony, qui regardait par la fenêtre depuis les genoux de son grand-père, s'écria presque en même temps :
« Tom et Christian remontent la Johannisstraße... et M. Hoffstede... et l'oncle docteur... »
Le carillon de Sainte-Marie se mit à jouer un choral : pang ! ping, ping – pung ! assez faux, de sorte qu'on ne pouvait pas vraiment reconnaître ce que c'était, mais plein de solennité, et tandis que la petite et la grande cloche annonçaient joyeusement et dignement qu'il était quatre heures, la cloche de la porte à claire-voie résonnait aussi dans le grand couloir, et c'était bien Tom et Christian qui arrivaient, avec les premiers invités, Jean Jacques Hoffstede, le poète, et le docteur Grabow, le médecin de famille.
II
Monsieur Jean Jacques Hoffstede, le poète de la ville, qui avait sûrement quelques rimes dans sa poche pour cette journée, n'était pas beaucoup plus jeune que Johann Buddenbrook, l'aîné, et, à part la couleur verte de sa veste, habillé dans le même style. Mais il était plus mince et plus agile que son vieil ami et avait de petits yeux vifs et verts et un long nez pointu.
« Merci beaucoup », dit-il après avoir serré la main des messieurs et fait quelques-uns de ses compliments les plus raffinés aux dames, en particulier à la consule, qu'il admirait énormément, des compliments que la nouvelle génération ne savait tout simplement plus faire et qui étaient accompagnés d'un sourire agréablement calme et engageant. « Merci beaucoup pour votre aimable invitation, Mesdames et Messieurs. Ces deux jeunes gens », dit-il en désignant Tom et Christian, qui se tenaient à ses côtés vêtus de blouses bleues et de ceintures de cuir, « nous les avons rencontrés dans la Königstraße, le docteur et moi, alors qu'ils sortaient de leurs études. Un garçon formidable, Madame la Consule ? Thomas est quelqu'un de sérieux et de solide ; il deviendra sans aucun doute commerçant. Christian, en revanche, me semble être un peu touche-à-tout, non ? Un peu incroyable... Mais je ne cache pas mon engouement. Il fera des études, je pense ; il est drôle et brillant... »
Monsieur Buddenbrook a pris sa tabatière en or.
« C'est un singe ! Ne devrait-il pas devenir poète, Hoffstede ? »
Mademoiselle Jungmann rabattit les rideaux de la fenêtre l’un sur l’autre, et bientôt la pièce fut baignée dans la lumière quelque peu vacillante, mais discrète et agréable, des bougies du lustre en cristal et des candélabres posés sur le secrétaire.
« Alors, Christian », dit la consul, dont les cheveux brillaient d'un éclat doré, « qu'as-tu appris cet après-midi ? » Et il s'avéra que Christian avait eu des cours d'écriture, de calcul et de chant.
C'était un petit garçon de sept ans qui ressemblait déjà de manière presque ridicule à son père. Il avait les mêmes yeux assez petits, ronds et enfoncés, le même nez fortement proéminent et courbé était déjà reconnaissable, et sous les pommettes, quelques rides indiquaient déjà que la forme du visage ne conserverait pas toujours son embonpoint enfantin actuel.
« On a beaucoup ri », se mit-il à babiller, tandis que ses yeux passaient d'une personne à l'autre dans la pièce. « Écoutez ce que M. Stengel a dit à Siegmund Köstermann. » Il se pencha en avant, secoua la tête et parla avec insistance dans le vide : « Extérieurement, mon cher enfant, extérieurement, tu es lisse et léché, oui, mais intérieurement, mon cher enfant, tu es noir... » Et il dit ça en omettant le « i » et en prononçant « noir » comme « nor » – avec un visage sur lequel se lisait le mécontentement face à cette lisse et cette élégance « extérieures » avec un comique si convaincant que tout le monde éclata de rire.
« Charmant ! s'écria-t-il. Incomparable ! Il faut connaître Marcellus Stengel ! Exactement comme ça ! Non, c'est vraiment trop délicieux ! »
Thomas, qui n'avait pas ce talent, se tenait à côté de son jeune frère et riait sans jalousie et de bon cœur. Ses dents n'étaient pas particulièrement belles, elles étaient petites et jaunâtres. Mais son nez était remarquablement fin et ses yeux et la forme de son visage ressemblaient beaucoup à ceux de son grand-père.
On s'était en partie assis sur les chaises et le canapé, on discutait avec les enfants, on parlait du froid matinal, de la maison... M. Hoffstede admirait sur le secrétaire un magnifique encrier en porcelaine de Sèvres en forme de chien de chasse tacheté de noir. Le docteur Grabow, un homme de l'âge du consul, avec un long visage aimable et doux qui souriait entre ses rares favoris, regardait les gâteaux, les pains aux raisins et les différents petits pots de sel remplis qui étaient exposés sur la table. C'était le « sel et le pain » que la famille avait reçu de ses proches et amis pour son déménagement. Mais comme il fallait montrer que ce cadeau ne venait pas de gens modestes, le pain était fait de pâtisseries sucrées, épicées et lourdes, et le sel était dans un récipient en or massif.
« Je vais avoir du boulot », dit le docteur en montrant les sucreries et en menaçant les enfants. Puis, hochant la tête, il souleva un élégant service à sel, poivre et moutarde.
« De Lebrecht Kröger », dit M. Buddenbrook en souriant. « Toujours généreux, mon cher parent. Je ne lui ai pas offert la même chose quand il a construit sa maison de jardin devant la porte du château. Mais il a toujours été ainsi... noble ! généreux ! un gentleman à la mode... »
La cloche avait retenti plusieurs fois dans toute la maison. Le pasteur Wunderlich arriva, un vieil homme trapu vêtu d'une longue robe noire, les cheveux poudrés et le visage blanc, agréable et joyeux, dans lequel brillaient deux yeux gris et vifs. Veuf depuis de nombreuses années, il se considérait comme un célibataire de la vieille école, tout comme le grand courtier, M. Grätjens, qui l'accompagnait et tenait constamment une de ses mains maigres devant ses yeux, comme une longue-vue, comme s'il examinait un tableau ; c'était un connaisseur d'art reconnu de tous.
Le sénateur docteur Langhals et sa femme, amis de longue date de la maison, arrivèrent aussi, sans oublier le négociant en vins Köppen, avec son grand visage rouge foncé qui dépassait de ses manches rembourrées, et sa femme, tout aussi corpulente...
Il était déjà plus de quatre heures et demie lorsque les Kröger arrivèrent enfin, les parents comme les enfants, le consul Kröger avec ses fils Jakob et Jürgen, qui avaient le même âge que Tom et Christian. Et presque en même temps qu'eux arrivèrent aussi les parents de la consul Kröger, le grossiste en bois Oeverdieck et sa femme, un vieux couple tendre qui avait l'habitude de s'appeler par des petits noms très amoureux devant tout le monde.
« Les gens bien arrivent en retard », dit le consul Buddenbrook en embrassant la main de sa belle-mère.
« Eh bien, que tout le monde soit également honoré ! » s’exclama Johann Buddenbrook en faisant un large geste du bras en direction de la parenté des Kröger, tout en serrant la main du vieil homme…
Lebrecht Kröger, le cavalier à la mode, grande figure distinguée, avait encore les cheveux légèrement poudrés, mais était habillé à la mode. Deux rangées de boutons en pierres précieuses brillaient sur son gilet de velours. Justus, son fils, avec ses petites pattes et sa moustache retroussée, ressemblait beaucoup à son père par sa silhouette et son comportement ; il avait aussi les mêmes gestes ronds et élégants.
Personne ne s'assit, mais tout le monde resta debout, attendant le plat principal, en discutant de choses et d'autres. Et Johann Buddenbrook, l'aîné, offrit son bras à Madame Köppen en disant d'une voix claire :
« Bon, si nous avons tous de l'appétit, mesdames et messieurs... »
Mamsell Jungmann et la servante avaient ouvert la porte à battants blanche de la salle à manger, et lentement, avec une lenteur confiante, la compagnie s'y rendit ; on pouvait s'attendre à un repas copieux chez les Buddenbrook...
III
Quand tout le monde a commencé à se lever, le jeune maître de maison a mis la main sur le côté gauche de sa poitrine, où un papier craquait, et le sourire sociable a soudainement disparu de son visage pour laisser place à une expression tendue et inquiète, et quelques muscles ont joué sur ses tempes, comme s'il serrait les dents. Il fit quelques pas vers la salle à manger, mais s'arrêta, cherchant du regard sa mère qui, aux côtés du pasteur Wunderlich, était l'une des dernières à franchir le seuil.
« Excusez-moi, cher pasteur... Juste deux mots, maman ! » Et tandis que le pasteur lui faisait un signe de tête enjoué, le consul Buddenbrook ramena la vieille dame dans la salle à manger et la conduisit à la fenêtre.
« Pour faire court, une lettre de Gotthold est arrivée », dit-il rapidement et à voix basse, en regardant ses yeux sombres et interrogateurs et en sortant de sa poche le papier plié et cacheté. « C'est son écriture... C'est la troisième lettre, et papa n'a répondu qu'à la première... Que faire ? Elle est arrivée à deux heures, et j'aurais dû la remettre à papa depuis longtemps, mais dois-je gâcher son humeur aujourd'hui ? Qu'en dites-vous ? Il est encore temps de le prier de sortir... »
« Non, tu as raison, Jean, attends ! » dit Madame Buddenbrook en saisissant rapidement le bras de son fils, comme elle avait l'habitude de le faire. « Que peut-il bien y avoir dedans ! » ajouta-t-elle avec inquiétude. « Il ne cède pas, ce garçon. Il s'obstine à vouloir cette indemnité pour sa part de la maison... Non, non, Jean, pas encore... Ce soir peut-être, avant d'aller se coucher... »
« Que faire ? » répéta le consul en secouant la tête, baissée. « J'ai moi-même souvent voulu demander à papa de céder... Il ne faut pas donner l'impression que moi, le demi-frère, je me suis installé chez mes parents et que je complote contre Gotthold... Je dois aussi éviter de donner cette impression à mon père. Mais pour être honnête... je suis quand même associé. Et puis, Bethsy et moi payons pour l'instant un loyer tout à fait normal pour le deuxième étage... Quant à ma sœur à Francfort, eh bien, l'affaire est réglée. Son mari reçoit déjà, du vivant de papa, une indemnité, un quart seulement du prix d'achat de la maison... C'est une affaire avantageuse que papa a très habilement conclue et qui est très réjouissante pour l'entreprise. Et si papa se montre si distant envers Gotthold, c'est parce que... »
« Non, c'est absurde, Jean, ta position dans cette affaire est claire. Mais Gotthold pense que moi, sa belle-mère, je ne m'occupe que de mes propres enfants et que je l'éloigne délibérément de son père. C'est ce qui est triste... »
« Mais c'est de sa faute ! » s'écria presque fort le consul, avant de baisser la voix en jetant un regard vers la salle à manger. « C'est de sa faute, cette triste situation ! Juge par toi-même ! Pourquoi n'a-t-il pas pu être raisonnable ? Pourquoi a-t-il fallu qu'il épouse cette demoiselle Stüwing et qu'il reprenne le... magasin... » Le consul rit avec agacement et embarras à ces mots. « C'est une faiblesse, l'aversion de papa pour le magasin ; mais Gotthold aurait dû respecter cette petite vanité... »
« Oh, Jean, le mieux serait que papa cède ! »
« Mais puis-je le conseiller ? » murmura le consul en portant la main à son front dans un geste agité. « Je suis personnellement intéressé, et c'est pourquoi je devrais dire : papa, paie. Mais je suis aussi associé, je dois représenter les intérêts de l'entreprise, et si papa ne pense pas avoir l'obligation, face à un fils désobéissant et rebelle, de retirer la somme du capital d'exploitation... Il s'agit de plus de onze mille thalers courants. C'est beaucoup d'argent... Non, non, je ne peux pas le conseiller... mais je ne peux pas non plus le déconseiller. Je ne veux rien savoir de tout ça. Seule la scène avec papa me met mal à l'aise ... »
« Il se fait tard, Jean. Viens, on t'attend... »
Le consul rangea le papier dans la poche de sa veste, offrit son bras à sa mère et, côte à côte, ils franchirent le seuil de la salle à manger éclairée, où les invités venaient de terminer de s'installer autour de la longue table.
Sur le fond bleu ciel du papier peint, des statues de dieux blancs ressortaient de manière presque plastique entre de minces colonnes. Les lourds rideaux rouges des fenêtres étaient tirés et, dans chaque coin de la pièce, huit bougies brûlaient sur un haut candélabre doré, sans compter celles qui se trouvaient dans des chandeliers en argent sur la table. Au-dessus du buffet massif, en face de la pièce avec vue sur le paysage, était accroché un grand tableau représentant un golfe italien, dont les tons bleutés étaient particulièrement mis en valeur par cet éclairage. De puissants canapés à dossier rigide en damas rouge étaient disposés le long des murs.
Toute trace d'inquiétude et d'agitation avait disparu du visage de Madame Buddenbrook lorsqu'elle s'assit entre le vieux Kröger, qui trônait près de la fenêtre, et le pasteur Wunderlich.
« Bon appétit ! » dit-elle avec un petit signe de tête rapide et chaleureux, en jetant un rapide coup d'œil sur toute la table jusqu'aux enfants...
IV
« Comme je l'ai dit, chapeau, Buddenbrook ! » La voix puissante de M. Köppen couvrit les conversations générales lorsque la servante aux bras nus et rouges, vêtue d'une jupe épaisse à rayures, sous sa petite coiffe blanche posée à l'arrière de la tête, avec l'aide de Mamsell Jungmann et de la fille de la consule à l'étage, avait servi la soupe chaude aux herbes accompagnée de pain grillé et que tout le monde commençait à manger délicatement à la cuillère.
« Chapeau ! Cette ampleur, cette noblesse... Je dois dire qu'on peut bien vivre ici, je dois dire... » Monsieur Köppen n'avait pas mal tourné chez les anciens propriétaires de la maison ; il n'était pas riche depuis longtemps, ne venait pas vraiment d'une famille patricienne et ne pouvait malheureusement pas encore se défaire de certaines faiblesses dialectales, comme la répétition de « je dois dire ».
« Ça n'a rien coûté », remarqua sèchement M. Grätjens, qui était bien placé pour le savoir, en regardant attentivement le golf à travers sa main en coupe.
On avait formé une rangée aussi colorée que possible et interrompu la chaîne des parents par des amis de la famille. Mais cela n'avait pas été facile à réaliser, et les vieux Oeverdieck étaient assis comme d'habitude presque sur les genoux l'un de l'autre, se faisant des signes de tête complices. Le vieux Kröger, quant à lui, trônait entre la sénatrice Langhals et Madame Antoinette, distribuant ses gestes et ses plaisanteries réservées aux deux dames.
« Quand la maison a-t-elle été construite ? » demanda M. Hoffstede par-dessus la table au vieux Buddenbrook, qui discutait d'un ton jovial et un peu moqueur avec Madame Köppen.
« En... attends... Vers 1680, si je ne me trompe pas. Mon fils connaît mieux ces dates, d'ailleurs... »
« Quatre-vingt-deux », confirma le consul, qui était assis plus bas, sans dame de compagnie, à côté du sénateur Langhals. « Elle a été achevée en 1682, pendant l'hiver. C'est à cette époque que Ratenkamp & Komp. a commencé à connaître un essor fulgurant... C'est triste de voir le déclin de l'entreprise au cours des vingt dernières années... »
La conversation s'est arrêtée pendant une demi-minute. On a regardé son assiette et pensé à cette famille autrefois si brillante qui avait construit et habité la maison et qui, appauvrie, délabrée, avait déménagé...
« Oui, c'est triste », dit l'agent immobilier Grätjens ; « quand on pense à la folie qui a causé la ruine... Si seulement Dietrich Ratenkamp n'avait pas pris ce Geelmaack comme associé à l'époque ! Dieu sait que j'ai levé les bras au ciel quand il a commencé à gérer les affaires. Je sais de source sûre, mesdames et messieurs, à quel point il spéculait dans le dos de Ratenkamp et signait des lettres de change ici et là au nom de l'entreprise... Finalement, tout était fini... Les banques se méfiaient, il manquait des garanties... Vous n'avez pas idée... Qui contrôlait l'entrepôt ? Geelmaack peut-être ? Ils ont vécu là comme des rats, année après année ! Mais Ratenkamp ne s'en souciait pas... »
« Il était comme paralysé », dit le consul. Son visage avait pris une expression sombre et fermée. Penché en avant, il remuait sa cuillère dans sa soupe et jetait de temps en temps un bref coup d'œil vers le bout de la table avec ses petits yeux ronds et enfoncés.
« Il marchait comme sous le poids d'une pression, et je pense qu'on peut comprendre cette pression. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'associer avec Geelmaack, qui apportait très peu de capital et dont personne ne disait du bien ? Il a dû ressentir le besoin de rejeter une partie de cette terrible responsabilité sur quelqu'un d'autre, car il sentait que la fin était inéluctable... Cette entreprise avait fait faillite, cette vieille famille était dépassée. Wilhelm Geelmaack n'a certainement fait que donner le coup de grâce... »
« Vous pensez donc, cher consul », dit le pasteur Wunderlich avec un sourire pensif en servant du vin rouge à sa femme et à lui-même, « que même sans l'arrivée de Geelmaack et son comportement extravagant, tout se serait passé comme ça s'est passé ? »
« Probablement pas », répondit le consul d'un air pensif, sans s'adresser à personne en particulier. « Mais je crois que Dietrich Ratenkamp devait nécessairement et inévitablement s'associer à Geelmaack pour que le destin s'accomplisse... Il a dû agir sous la pression d'une nécessité implacable... Ah, je suis convaincu qu'il connaissait à moitié les agissements de son associé, qu'il n'était pas non plus totalement ignorant de la situation dans son camp. Mais il était paralysé... »
« Bon, assez, Jean », dit le vieux Buddenbrook en posant sa cuillère. « C'est encore une de tes idées... »
Le consul leva son verre vers son père avec un sourire distrait. Mais Lebrecht Kröger dit :
« Non, profitons plutôt du présent joyeux ! »
Il saisit avec précaution et élégance le goulot de sa bouteille de vin blanc, sur le bouchon de laquelle était posé un petit cerf en argent, la pencha légèrement sur le côté et examina attentivement l'étiquette. « C.F. Köppen », lut-il en faisant un signe de tête au négociant en vins ; « ah oui, que serions-nous sans vous ! »
Les assiettes de Meissen à bord doré furent changées, Madame Antoinette observant attentivement les mouvements des servantes, et Mamsell Jungmann donnait des ordres dans le porte-voix qui reliait la salle à manger à la cuisine. Le poisson fut servi, et tandis que le pasteur Wunderlich se servait avec précaution, il dit :
« Cette joyeuse présence ne va pas de soi. Les jeunes gens qui se réjouissent ici avec nous, les anciens, ne pensent sans doute pas qu'il ait pu en être autrement... Je peux dire que j'ai souvent pris part personnellement au destin de nos Buddenbrook... Chaque fois que je vois ces objets » – et il se tourna vers Madame Antoinette en prenant une des lourdes cuillères en argent sur la table –, « je me demande s'ils ne font pas partie de ceux que notre ami, le philosophe Lenoir, sergent de Sa Majesté l'empereur Napoléon, avait entre les mains en 1806... et je me souviens de notre rencontre dans la rue Alf, Madame... »
Madame Buddenbrook baissa les yeux avec un sourire mi-embarrassé, mi-nostalgique. Tom et Tony, qui n'aimaient pas manger de poisson et avaient suivi attentivement la conversation des grands, s'écrièrent presque à l'unisson : « Oh oui, raconte, grand-maman ! » Mais le pasteur, qui savait qu'elle n'aimait pas raconter elle-même cet incident un peu gênant pour elle, commença à sa place la vieille petite histoire que les enfants auraient volontiers écoutée pour la centième fois et que l'un ou l'autre ne connaissait peut-être pas encore...
« Bref, imaginez : c'est un après-midi de novembre, il fait froid et il pleut, Dieu merci, je remonte la rue Alfstraße après avoir fait une course officielle et je pense à ces temps difficiles. Le prince Blücher était parti, les Français étaient dans la ville, mais on ne remarquait pas vraiment l'agitation qui régnait. Les rues étaient calmes, les gens restaient chez eux et faisaient attention. Le maître boucher Prahl, qui se tenait devant sa porte, les mains dans les poches, et qui avait dit de sa voix la plus tonitruante : « C'est quand même trop grave, c'est quand même trop grave ! », avait simplement été frappé à la tête... Eh bien, je pense : tu veux aller voir les Buddenbrook, un peu de réconfort leur ferait du bien ; le mari est alité avec une plaie à la tête et Madame va devoir s'occuper des soldats logés chez eux. »
« À ce moment précis, qui est-ce que je vois venir vers moi ? Notre très chère Madame Buddenbrook. Mais dans quel état ! Elle court sous la pluie sans chapeau, elle a à peine jeté un châle sur ses épaules, elle se précipite plus qu'elle ne marche, et sa coiffure est complètement en bataille... Non, c'est vrai, Madame ! On ne pouvait plus vraiment parler de coiffure. »
«Quelle agréable surprise! » dis-je et je me permets de la retenir par la manche, car je pressens quelque chose de mauvais... « Où vas-tu si vite, ma chère ? » Elle me remarque, elle me regarde, elle s'écrie : « C'est toi... adieu ! Tout est fini ! Je vais me jeter dans la Trave ! »
« Attention ! » dis-je en sentant que je pâlis. « Ce n'est pas un endroit pour vous, ma chère ! Que s'est-il passé ? » Et je la tiens aussi fermement que le respect le permet. « Que s'est-il passé ? » s'écrie-t-elle en tremblant. « Vous êtes au-dessus de l'argenterie, Wunderlich ! Voilà ce qui s'est passé ! Et Jean est allongé avec sa rose sur la tête et ne peut pas m'aider ! Et il ne pourrait pas m'aider même s'il était debout ! Vous volez mes cuillères, mes cuillères en argent, voilà ce qui s'est passé, Wunderlich, et je vais me jeter dans la Trave ! »
« Bon, je soutiens notre amie, je lui dis ce qu'on dit dans ces cas-là, « Courage », je lui dis, « ma chère ! » et « Tout ira bien ! » et « Nous allons parler aux gens, reprenez-vous, je vous en supplie, et allons-y ! » Et je la conduis dans la rue jusqu'à sa maison. Dans la salle à manger, on trouve la milice, telle que Madame l'a laissée, une vingtaine d'hommes qui s'occupent du grand coffre où se trouve l'argenterie.
« À qui puis-je m'adresser, je demande poliment, messieurs ? » Eh bien, ils se mettent à rire et s'écrient : « À nous tous, papa ! » Mais alors, l'un d'eux s'avance et se présente, un homme grand comme un arbre, avec une moustache noire cirée et de grandes mains rouges qui dépassent des manchettes froissées. « Lenoir », dit-il en saluant de la main gauche, car il tient dans la droite un paquet de cinq ou six cuillères en argent, « Lenoir, sergent. Que désire Monsieur ? »
« Monsieur l'officier ! » dis-je en visant le point d'honneur. « Le fait de vous occuper de ces choses est-il compatible avec votre brillante fonction ?... La ville ne s'est pas fermée à l'empereur... » – « Que voulez-vous ? » répond-il. « C'est la guerre ! Les gens ont besoin de vaisselle... »
« Vous devriez faire preuve de considération », l'interrompis-je, car une idée me vient à l'esprit. « Cette dame », dis-je, car que dire dans une telle situation, « la maîtresse de maison, elle n'est pas allemande, elle est presque votre compatriote, elle est française... » – « Comment, française ? », répète-t-il. Et que pensez-vous que ce vieux briscard ajoute ? « Une émigrée, donc ? dit-il. Mais alors, c'est une ennemie de la philosophie ! »
Je suis sidéré, mais je retiens mon rire. « Vous êtes, dis-je, un homme intelligent, comme je le vois. Je répète qu'il ne me semble pas digne de vous de vous occuper de ces choses ! » Il se tait un instant, puis, soudain, il rougit, jette ses six cuillères dans le coffre et s'écrie : « Mais qui vous dit que j'avais l'intention de faire autre chose que de les regarder un peu ?! C'est mignon, ça ! Si l'un ou l'autre de ces gens devait emporter un morceau en souvenir... »
« Eh bien, ils ont quand même pris assez de souvenirs avec eux, et aucune justice humaine ou divine n'a pu les en empêcher... Ils ne connaissaient sans doute pas d'autre dieu que ce terrible petit homme... »
V
« Vous l'avez vu, Monsieur le Pasteur ? »
Les assiettes furent à nouveau changées. Un énorme jambon pané, rouge brique, apparut, fumé, cuit, accompagné d'une sauce brune et acidulée à l'échalote et d'une telle quantité de légumes que tout le monde aurait pu se rassasier avec un seul plat. Lebrecht Kröger se chargea de le découper. Les coudes légèrement relevés, les longs index tendus vers le dos du couteau et de la fourchette, il découpait avec soin les morceaux juteux. Le chef-d'œuvre de la consule Buddenbrook, le « pot russe », un mélange pétillant et alcoolisé de fruits en conserve, fut également servi.
Non, le pasteur Wunderlich regrettait de n'avoir jamais vu Bonaparte. Mais le vieux Buddenbrook et Jean Jacques Hoffstede l'avaient vu en personne ; le premier à Paris, juste avant la campagne de Russie, lors d'un défilé dans la cour du château des Tuileries, le second à Dantzig...
« Mon Dieu, non, il n'avait pas l'air sympathique », dit-il en portant à sa bouche, les sourcils levés, une bouchée de jambon, de choux de Bruxelles et de pommes de terre qu'il avait composée sur sa fourchette. « D'ailleurs, il se serait comporté de manière très joyeuse à Dantzig. On racontait alors une anecdote... Il passait ses journées à taquiner les Allemands, et pas qu'un peu, mais le soir, il jouait avec ses généraux. « N'est-ce pas, Rapp », disait-il en prenant une poignée d'or sur la table, « les Allemands aiment beaucoup ces petits Napoléons ? » – « Oui, plus que le Grand ! » répondait Rapp... »
Dans l'hilarité générale qui s'ensuivit – car Hoffstede avait bien raconté l'anecdote et avait même un peu mimé l'expression du visage de l'empereur –, le vieux Buddenbrook dit :
« Sans blague, avec tout le respect que je dois à sa grandeur personnelle... Quelle personnalité ! »
Le consul secoua sérieusement la tête.
« Non, non, nous, les jeunes, on ne comprend plus l'admiration que l'on peut porter à l'homme qui a assassiné le duc d'Enghien, qui a massacré huit cents prisonniers en Égypte... »
« Tout cela est peut-être exagéré et faux », dit le pasteur Wunderlich. « Le duc était peut-être un homme imprudent et séditieux, et en ce qui concerne les prisonniers, leur exécution était probablement la décision mûrement réfléchie et nécessaire d'un conseil de guerre correct... » Et il parla d'un livre publié quelques années auparavant, qu'il avait lu, l'œuvre d'un secrétaire de l'empereur, qui méritait toute son attention...
« Peu importe », insista le consul en nettoyant une bougie qui vacillait dans le chandelier devant lui. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas l'admiration pour cet homme inhumain ! En tant que chrétien, en tant qu'homme de foi, je ne trouve pas dans mon cœur la place pour un tel sentiment. »
Son visage avait pris une expression calme et enthousiaste, il avait même légèrement penché la tête sur le côté – on aurait vraiment dit que son père et le pasteur Wunderlich se souriaient tout doucement.
« Oui, oui », sourit Johann Buddenbrook, « mais les petits Napoléon n'étaient pas mal, hein ? Mon fils est plus fan de Louis-Philippe », ajouta-t-il.
« En admiration ? » répéta Jean Jacques Hoffstede d'un ton un peu moqueur... « Une association curieuse ! Philippe Égalité et l'admiration... »
« Eh bien, je pense que nous avons beaucoup à apprendre de la monarchie de Juillet, bon sang... » Le consul parlait avec sérieux et enthousiasme. « La relation amicale et utile du constitutionnalisme français avec les nouveaux idéaux pratiques et les intérêts de l'époque... est quelque chose de vraiment génial... »
« Les idéaux pratiques... eh bien... » Le vieux Buddenbrook jouait avec sa boîte en or pendant une pause qu'il accordait à sa mâchoire. « Les idéaux pratiques... non, je ne suis pas du tout pour ! » Il retomba dans son dialecte par dépit. « Les établissements commerciaux, les établissements techniques et les écoles de commerce poussent comme des champignons, et le lycée et l'éducation classique sont soudainement considérés comme des bêtises, et tout le monde ne pense plus qu'aux mines... à l'industrie... et à gagner de l'argent... Bravo, tout ça, bravo ! Mais un peu stupide, d'un autre côté, à long terme, non ? Je ne sais pas pourquoi ça me dérange... Je n'ai rien dit, Jean... La monarchie de Juillet est une bonne chose... »
Le sénateur Langhals, mais aussi Grätjens et Köppen, étaient du côté du consul... Oui, vraiment, il fallait avoir le plus grand respect pour le gouvernement français et les efforts similaires en Allemagne... M. Köppen a répété « Attention ». Il était devenu encore plus rouge pendant le repas et reniflait bruyamment ; le visage du pasteur Wunderlich, lui, restait blanc, fin et alerte, même s'il buvait tranquillement un verre après l'autre.
Les bougies se consumaient lentement, lentement, et de temps en temps, lorsque leurs flammes vacillaient dans le courant d'air, un léger parfum de cire flottait sur la table.
On était assis sur des chaises lourdes à haut dossier, on mangeait de bons plats copieux avec de l'argenterie lourde, on buvait de bons vins lourds et on disait ce qu'on pensait. On en venait vite aux affaires et on tombait involontairement de plus en plus dans le dialecte, dans cette façon de s'exprimer agréablement lourde, qui semblait avoir en soi la concision commerciale et la négligence aisée, et qui était parfois exagérée avec une autodérision bon enfant. On ne disait pas « à la bourse », on disait tout simplement « à la bourse »... en prononçant le r comme un ä court et en faisant une grimace complaisante.
Les dames n'avaient pas suivi longtemps la discussion. Madame Kröger leur donna la parole en expliquant de la manière la plus appétissante les meilleures façons de cuisiner la carpe au vin rouge... « Quand elles sont coupées en morceaux réguliers, ma chère, mettez-les dans la casserole avec des oignons, des clous de girofle et des biscottes, puis ajoutez un peu de sucre et une cuillère de beurre et mettez le tout sur le feu... Mais ne les lavez pas, ma chère, gardez tout le sang, pour l'amour de Dieu... »
Le vieux Kröger faisait les blagues les plus sympas. Mais le consul Justus, son fils, assis à côté du docteur Grabow, plus bas, près des enfants, avait entamé une conversation taquine avec la servante Jungmann ; elle plissait ses yeux bruns et, comme d'habitude, tenait son couteau et sa fourchette à la verticale, les balançant légèrement d'avant en arrière. Même les Oeverdieck étaient devenus très bruyants et animés. La vieille consul avait inventé un nouveau mot affectueux pour son mari : « Mon petit chéri ! » disait-elle en secouant sa coiffe avec chaleur.
La conversation se concentra sur un sujet unique lorsque Jean Jacques Hoffstede aborda son thème favori : le voyage en Italie qu’il avait entrepris quinze ans plus tôt avec un riche parent hambourgeois. Il parla de Venise, de Rome et du Vésuve, évoqua la Villa Borghèse, où feu Goethe aurait écrit une partie de son Faust, s’extasia sur les fontaines de la Renaissance qui offraient une fraîcheur bienfaisante, sur les allées soigneusement taillées où il faisait si bon flâner, et quelqu’un mentionna le grand jardin sauvage que les Buddenbrook possédaient juste derrière la porte du château…
« Oui, ma foi ! » dit le vieil homme. « Je m'en veux encore de ne pas avoir pris la décision de le faire aménager un peu plus humainement à l'époque ! Je l'ai récemment traversé à nouveau – c'est une honte, cette jungle ! Quelle belle propriété, si l'herbe était entretenue, si les arbres étaient joliment taillés en forme de cônes et de cubes... »
Mais le consul protesta avec ferveur.
« Pour l'amour de Dieu, papa ! J'aime me promener dans les broussailles en été, mais tout serait gâché pour moi si la belle nature sauvage était taillée de manière aussi lamentable... »
« Mais si la nature m'appartient, j'ai bien le droit de l'aménager comme je veux... »
« Oh papa, quand je m'allonge dans les hautes herbes sous les buissons luxuriants, j'ai plutôt l'impression d'appartenir à la nature et de n'avoir aucun droit sur elle... »
« Krischan, ne m'embête pas trop », s'écria soudain le vieux Buddenbrook, « Thilda, ça ne fait de mal à personne... emballe comme sept batteuses, la fille... »
Et vraiment, c'était étonnant de voir les capacités que cette enfant calme et maigre au visage long et âgé développait en mangeant. À la question de savoir si elle voulait une deuxième soupe, elle avait répondu lentement et humblement : « Oui, s'il vous plaît ! » Elle avait choisi deux fois deux des plus gros morceaux de poisson et de jambon, accompagnés d'une grande quantité d'accompagnements, s'était penchée avec précaution et myopie sur son assiette et avait tout mangé sans précipitation, en silence et à grandes bouchées. Aux paroles du vieux maître de maison, elle répondit seulement d'une voix traînante, aimable, étonnée et naïve : « Dieu – On–k–el– ? » Elle ne se laissa pas intimider, elle mangea, même si ça ne marchait pas et même si on se moquait d'elle, avec l'appétit instinctivement vorace des pauvres parents à la table des riches, souriant avec insouciance et remplissant son assiette de bonnes choses, patiente, tenace, affamée et maigre.
VI
Puis vint, dans deux grands plats en cristal, le « Plettenpudding », un mélange en couches de macarons, de framboises, de biscuits et de crème aux œufs ; mais au bout de la table, l'ambiance s'enflamma, car les enfants avaient reçu leur dessert préféré, le pudding de Noël flambé.
« Thomas, mon fils, sois gentil », dit Johann Buddenbrook en sortant son gros trousseau de clés de la poche de son pantalon. « Dans la deuxième cave à droite, le deuxième compartiment, derrière le Bordeaux rouge, deux bouteilles, tu vois ? » Et Thomas, qui savait s'y prendre pour ce genre de tâches, partit en courant et revint avec les bouteilles toutes poussiéreuses et recouvertes de toile. À peine le vieux malvoisie doré et sucré comme du raisin avait-il coulé dans les petits verres à dessert que le pasteur Wunderlich se leva et, tandis que la conversation s'était tue, commença à porter un toast avec des formules agréables, son verre à la main. Il parlait, la tête légèrement penchée sur le côté, un sourire fin et amusé sur son visage blanc, bougeant sa main libre avec de petits gestes gracieux, dans le ton libre et agréable qu'il aimait aussi utiliser en chaire... « Eh bien, mes chers amis, je vous invite à vider avec moi un verre de ce bon vin pour trinquer à la prospérité de nos hôtes si respectés dans leur nouvelle et magnifique demeure, à la prospérité de la famille Buddenbrook, tant pour les membres présents que pour ceux qui sont absents... Vive ! »
« Les membres absents ? » pensa le consul en s'inclinant devant les verres que l'on levait vers lui. « S'agit-il seulement de ceux qui sont à Francfort et peut-être des Duchamp à Hambourg, ou bien le vieux Wunderlich a-t-il une arrière-pensée... ? » Il se leva pour trinquer avec son père, en le regardant chaleureusement dans les yeux.
Mais le courtier Grätjens se leva alors de sa chaise, ce qui lui prit un certain temps ; lorsqu'il eut terminé, il porta un verre à la société Johann Buddenbrook et à sa croissance, son essor et sa prospérité futurs, à la gloire de la ville, de sa voix quelque peu stridente.
Et Johann Buddenbrook remercia pour toutes ces paroles aimables, d'abord en tant que chef de famille, puis en tant que directeur de la maison de commerce, et envoya Thomas chercher une troisième bouteille de malvoisie, car le calcul selon lequel deux suffiraient s'était avéré faux.
Lebrecht Kröger prit aussi la parole. Il se permit de rester assis, car cela donnait une impression encore plus conciliante, et se contenta de gesticuler de la tête et des mains de la manière la plus aimable qui soit, tout en portant son toast aux deux dames de la maison, Mme Antoinette et la consule.
Mais quand il eut terminé, que le pudding était presque fini et que le malvoisie touchait à sa fin, M. Jean Jacques Hoffstede se leva lentement, s'éclaircit la voix et, sous un « Ah ! » général, les enfants, en bas, applaudirent avec joie.
« Oui, excusez-moi! Je ne pouvais m'empêcher... », dit-il en touchant légèrement son nez pointu et en sortant un papier de la poche de son manteau... Un profond silence s'installa dans la salle.
La feuille qu'il tenait dans ses mains était très colorée, et à partir d'un ovale formé à l'extérieur de fleurs rouges et de nombreux arabesques dorés, il lut les mots :
« À l'occasion de notre participation amicale à la joyeuse fête d'inauguration de la maison nouvellement acquise avec la famille Buddenbrook. Octobre 1835. »
Puis il se retourna et commença d'une voix déjà un peu tremblante :
Il s'inclina, et un applaudissement unanime et enthousiaste éclata.
« Charmant, Hoffstede ! s'écria le vieux Buddenbrook. À ta santé ! Non, c'était vraiment adorable ! »
Mais lorsque la consule but un verre avec le poète, un léger rougissement colora son teint délicat, car elle avait remarqué la révérence courtoise qu'il lui avait faite lors de la « Vénus Anadyomène »...
VII
La gaieté générale avait maintenant atteint son apogée, et M. Köppen ressentit le besoin évident d'ouvrir quelques boutons de son gilet ; mais cela n'était malheureusement pas possible, car même les vieux messieurs ne se permettaient pas une telle chose. Lebrecht Kröger était toujours assis aussi droit à sa place qu'au début du repas, le pasteur Wunderlich restait blanc et élégant, le vieux Buddenbrook s'était certes un peu penché en arrière, mais conservait la plus grande décence, et seul Justus Kröger était visiblement un peu ivre.
Où était le docteur Grabow ? La consule se leva discrètement et s'éloigna, car les places de Mamsell Jungmann, du docteur Grabow et de Christian étaient désormais libres, et un gémissement étouffé semblait résonner dans la salle à colonnes. Elle quitta rapidement la salle derrière la serveuse qui avait servi le beurre, le fromage et les fruits – et effectivement, là, dans la pénombre, sur le banc rembourré circulaire qui entourait la colonne centrale, le petit Christian était assis, allongé ou recroquevillé et gémissait doucement et de manière déchirante.
« Oh mon Dieu, Madame ! » dit Ida, qui se tenait à ses côtés avec le docteur, « Christian, le petit garçon, est tellement mal... »
« J'ai la nausée, maman, j'ai une sacrée nausée ! » gémit Christian, tandis que ses yeux ronds et enfoncés au-dessus de son nez trop grand allaient et venaient nerveusement. Il n'avait prononcé le mot « sacrée » que par désespoir, mais la consule dit :
« Quand on utilise de tels mots, le bon Dieu nous punit en nous rendant encore plus malades ! »
Le docteur Grabow prit son pouls ; son visage bienveillant semblait être devenu encore plus long et plus doux.
« Une petite indigestion... rien de grave, Madame la Consule ! » la rassura-t-il. Puis il continua d'un ton lent et pédant : « Le mieux serait de le mettre au lit... un peu de poudre pour enfants, peut-être une tasse de thé à la camomille pour le faire transpirer... Et un régime strict, Madame la Consule ? Comme je l'ai dit, un régime strict. Un peu de pigeon, un peu de pain français... »
« Je ne veux pas de pigeon ! » s'écria Christian, hors de lui. « Je ne veux plus jamais rien manger ! J'ai la nausée, j'ai une nausée terrible! » Ces mots forts semblaient lui apporter un réel soulagement, tant il les prononçait avec ferveur.
Le docteur Grabow sourit, d'un sourire indulgent et presque mélancolique. Oh, le jeune homme allait bien recommencer à manger ! Il allait vivre comme tout le monde. Comme ses pères, ses parents et ses connaissances, il allait passer ses journées assis et consommer quatre fois plus de mets raffinés et copieux... Eh bien, que Dieu le garde ! Lui, Friedrich Grabow, n'était pas celui qui allait bouleverser les habitudes de vie de toutes ces braves familles de commerçants aisés et confortables. Il viendrait quand on l'appellerait et recommanderait un régime strict pendant un jour ou deux – un peu de pigeon, une tranche de pain français... oui, oui – et assurerait en toute bonne conscience que cela n'avait aucune importance pour cette fois. Malgré son jeune âge, il avait tenu dans sa main celle de nombreux braves citoyens qui avaient mangé leur dernier morceau de viande fumée, leur dernière dinde farcie et qui, soudainement et par surprise dans leur fauteuil de bureau ou après quelques souffrances dans leur vieux lit solide, avaient rendu l'âme. Une crise cardiaque, disait-on alors, une paralysie, une mort soudaine et imprévue... oui, oui, et lui, Friedrich Grabow, aurait pu leur compter toutes les nombreuses fois où « il n'y avait rien eu », où il n'avait peut-être même pas été appelé, où, peut-être seulement après le dîner, de retour au bureau, un petit vertige étrange s'était manifesté... Eh bien, que Dieu les garde ! Lui, Friedrich Grabow, n'était pas du genre à bouder les dindes farcies. Ce jambon pané à la sauce à l'échalote était délicieux, bon sang, et puis, alors qu'on avait déjà le ventre plein, le pudding aux macarons, aux framboises et à la mousse d'œufs, oui, oui... « Un régime strict, comme je l'ai dit, Madame la Consule ? Un peu de pigeon, un peu de pain français... »
VIII
Dans la salle à manger, c'était l'effervescence.
« Bon appétit, mesdames et messieurs, bon appétit ! De l'autre côté, un cigare attend les amateurs et une gorgée de café pour nous tous et, si Madame est généreuse, une liqueur... Les billards, à l'arrière, sont à la disposition de tous, bien sûr ; Jean, tu te charges de nous conduire dans l'arrière-bâtiment... Madame Köppen, l'honneur... »