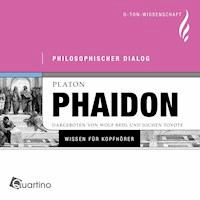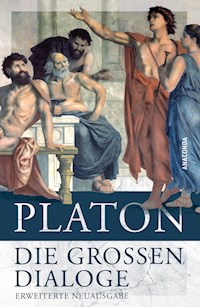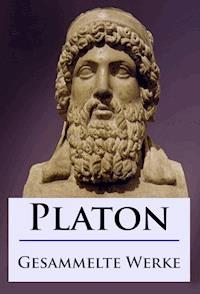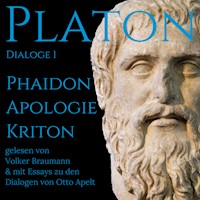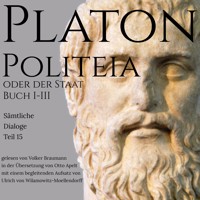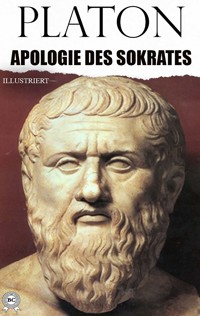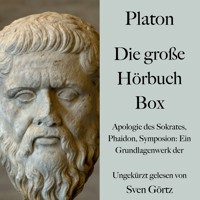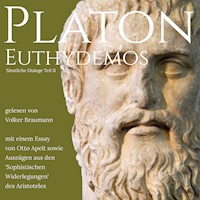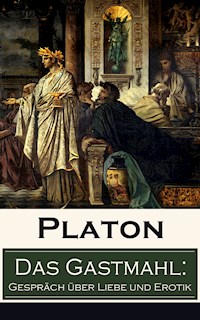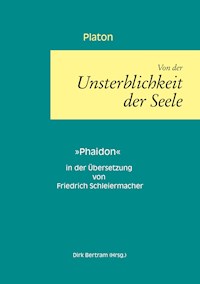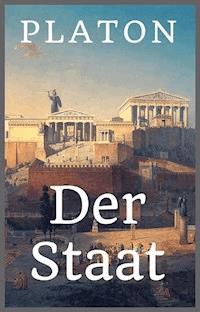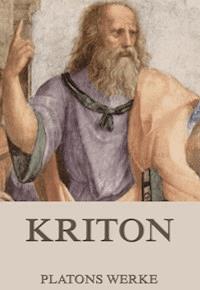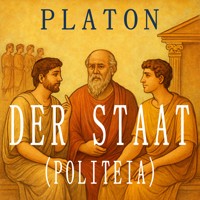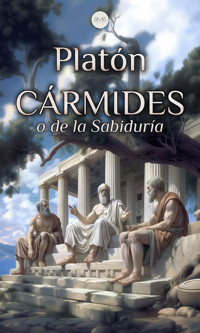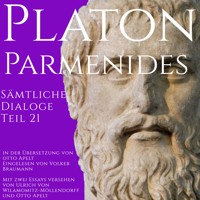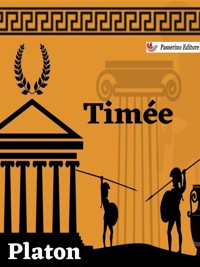
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passerino
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Timée est un dialogue écrit par
Platon, qui traite de sujets tels que la nature du cosmos, de l'âme et de la connaissance. Les quatre personnages du Timée, Socrate, Critias, Hermocrate et Timée de Locres, sont réunis pour un festin, lié à la fête des Panathénées et aux concours rhapsodiques qui s’y déroulaient ; Platon file donc, tout au long du prologue, la métaphore d’une exécution rhapsodique, chaque personnage prenant le relais du discours du précédent, selon l’antique tradition établie par Solon.
Platon (428/427 av. J.-C. - 348/347 av. J.-C.) était un philosophe et mathématicien grec de l'Antiquité, considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de la philosophie occidentale. Il était un élève de Socrate et le fondateur de l'Académie de Platon, l'une des premières institutions d'enseignement supérieur en Occident.
Platon a écrit de nombreux dialogues philosophiques, dans lesquels il utilise la méthode socratique pour explorer des questions fondamentales de la philosophie, telles que la nature de la réalité, de la connaissance, de la justice et de la moralité. Il a également développé sa propre philosophie, qui a influencé de manière significative la pensée occidentale.
Traduction, notices et notes par
Émile Chambry.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Platon
Timée
table des matières
Notice sur le « Timée »
Timée
Notice sur le « Timée »
Argument.
Outre une introduction dialoguée, le Timée comprend trois sections. La première est le mythe de l’Atlantide (19 a-27 c) ; les deux autres ont pour objet la formation du monde (27 c-69 a) et celle de l’âme et du corps de l’homme (69 a-fin).
Introduction.
Socrate s’était entretenu la veille avec Timée et Hermocrate et un autre personnage qui n’est pas nommé. L’entretien avait roulé sur la politique : Socrate leur avait exposé quelle était, d’après lui, la constitution la plus parfaite. On a cru longtemps que cet entretien est celui qui fait l’objet de la République, et il paraît bien certain que c’est à sa doctrine politique que Platon a voulu rattacher le Timée ; mais ce n’est pas le dialogue de la République qu’il a voulu rappeler ici. Un assez long intervalle s’est écoulé entre les deux ouvrages. En outre, le résumé de l’entretien de la veille que Socrate donne pour complet est loin de comprendre tous les sujets traités dans la République ; il a lieu aux Panathénées, et non aux Bendidies, et les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. On peut en conclure qu’il s’agit dans le Timée d’un entretien fictif sur la politique, sujet sur lequel Platon revint certainement bien des fois au cours de son enseignement.
1 er section : l’Atlantide.
Socrate se demande ensuite si l’État qu’il a décrit correspond à quelque chose de réel. Il appartient d’en décider à des hommes comme Timée, Critias et Hermocrate, qui sont à la fois des philosophes et des politiques rompus aux affaires. C’est Critias qui donne la réponse. La constitution que tu proposes, dit-il à Socrate, a existé autrefois à Athènes. Je le tiens de mon ancêtre Critias, ami de Solon. Solon, retour d’Égypte, lui raconta qu’un vieux prêtre égyptien lui avait appris que, neuf mille ans auparavant, Athènes avait eu les plus belles institutions politiques et qu’elles avaient servi de modèle à celles des Égyptiens, chez qui se retrouve encore aujourd’hui la séparation des classes que tu recommandes dans ta république. En ce temps-là, Athènes produisit des hommes héroïques, qui défendirent l’Europe et l’Asie contre les rois de l’Atlantide, grande île qui émergeait au-delà des colonnes d’Héraclès. Ces rois entreprirent de soumettre à leur domination tous les peuples riverains de la Méditerranée. Ils furent battus par les seuls Athéniens, et leur défaite fut suivie d’un cataclysme qui engloutit subitement leur île, et avec elle l’armée des Athéniens.
Le mythe de l’Atlantide a soulevé d’innombrables controverses. Les uns ont cru que l’Atlantide avait réellement existé, d’autres que le récit était une invention de Platon, mais reposait sur des données véritables, d’autres l’ont considéré comme une allégorie. Dernièrement, un savant géologue, P. Termier, a prouvé qu’un vaste effondrement s’était produit à la fin de l’âge quaternaire à l’ouest du détroit de Gibratar. Mais l’antiquité ne s’en est certainement pas doutée, et Platon lui-même n’a pu le deviner. Il se trouve qu’il a jadis existé une terre là où Platon a placé son mythe et que son invention n’est pas dénuée de fondement, du moins en ce qui concerne l’existence d’un continent en face des côtes du Maroc et du Portugal. Mais si Platon est tombé juste en imaginant le continent de l’Atlantide, c’est sans doute par un pur hasard. En tout cas, le fait était trop ancien, pour qu’il en fût resté quelque trace, même dans les plus anciennes traditions de l’Égypte.
2 e section : La Cosmologie de Platon.
En terminant, Critias se déclarait prêt à compléter son récit et à montrer en détail que la cité idéale de Socrate avait bien réellement existé au temps des Atlantes. Mais l’exposition de Critias est remise à plus tard. Auparavant, Timée, le plus savant d’entre eux en astronomie, va exposer la formation de l’univers, puis celle de l’homme. Pourquoi, entre le premier récit de Critias et celui qu’il fera plus tard dans l’ouvrage qui porte son nom, Platon a-t-il intercalé une exposition du système du monde et de la création de l’homme ? Il semble que l’exposition de Timée déborde infiniment le sujet proposé par Socrate et qu’elle ne s’y rattache que par un lien très lâche. C’est qu’avant d’aborder le problème politique et social, Platon a tenu à montrer la place que l’homme tient dans l’univers et ce qu’est l’univers lui-même ; car l’homme est un univers en réduction, un microcosme assujetti aux mêmes lois que le macrocosme. Et ainsi cette question préliminaire a pris une place prépondérante, et Platon en a pris occasion de présenter une explication générale du monde. Il ne s’est jamais piqué d’une stricte logique dans le plan de ses ouvrages ni d’y mettre l’unité rigoureuse que les modernes requièrent dans les leurs.
La base du système que Timée va exposer est la théorie des Idées. Il faut d’abord, dit Timée, se poser cette double question : en quoi consiste ce qui existe toujours, et ce qui devient toujours et n’est jamais ? Ce qui existe toujours, ce sont les Idées, appréhensibles à l’intelligence, et ce qui devient toujours est l’univers, qui ne peut être connu que par conjecture. Aussi n’y a-t-il pas de science de la nature. On n’en peut donner que des explications plus ou moins vraisemblables.
Partons de ce principe que l’auteur de l’univers, étant bon et sans envie, a voulu que toutes choses fussent autant que possible semblables à lui-même, c’est-à-dire bonnes. C’est pour cela qu’il a fait passer le monde du désordre chaotique à l’ordre. Pour cela, il mit l’intelligence dans l’âme et l’âme dans le corps et fit du monde un animal doué d’une âme et d’une intelligence, et il forma cet animal sur un modèle qui embrasse en lui tous les animaux intelligibles. Ce qui a commencé d’être est nécessairement corporel et ainsi visible et tangible ; mais, sans feu, rien ne saurait être visible, ni tangible sans quelque chose de solide, ni solide sans terre. Aussi le dieu prit d’abord, pour former l’univers, du feu et de la terre. Pour les unir, il prit deux moyens termes formant une proportion avec ces deux éléments. Si le corps de la terre eût été une surface, un seul moyen terme aurait suffi ; mais c’était un corps solide, et, comme les solides sont joints par deux médiétés et jamais par une seule, le dieu a mis l’eau et l’air entre le feu et la terre et les a fait proportionnés l’un à l’autre, en sorte que ce que le feu est à l’air, l’air le fût à l’eau, et que ce que l’air est à l’eau, l’eau le fût à la terre. Chacun des quatre éléments est entré tout entier dans la composition du monde : son auteur l’a composé de tout le feu, de toute l’eau, de tout l’air et de toute la terre, pour qu’il fût un, qu’il ne restât rien d’où aurait pu naître quelque chose de semblable et qu’il échappât ainsi à la vieillesse et à la maladie, rien ne pouvant l’attaquer du dehors.
Il donna au monde la forme sphérique, qui est la plus parfaite de toutes, et il en arrondit et polit la surface extérieure, parce que le monde n’avait besoin ni d’yeux, puisqu’il ne restait rien de visible en dehors de lui, ni d’oreilles, puisqu’il n’y avait plus rien à entendre, ni d’aucun organe, puisque rien n’en sortait ni n’y entrait de nulle part, n’y ayant rien en dehors de lui. Il lui donna un mouvement approprié à son corps, un mouvement de rotation si lui-même, sans changer de place.
L’Âme du monde.
Au centre, il mit une âme, qui s’étend partout et enveloppe même le corps de l’univers. Pour la former, il prit la substance indivisible et toujours la même et la substance divisible qui devient toujours, et, en les combinant, il en fit une troisième substance intermédiaire, qui participe la fois de la nature du Même et de celle de l’Autre ; il la plaça entre les deux premières et les combina toutes en une forme unique, qu’il divisa en sept parties ; puis il remplit les intervalles en coupant encore des parties sur le mélange primitif et en les plaçant dans les intervalles, de manière qu’il y eût dans chacun deux médiétés, l’une surpassant les extrêmes et surpassées par eux de la même fraction de chacun d’eux, l’autre surpassant un extrême du même nombre dont elle est surpassée par l’autre. De ces liens introduits dans les premiers intervalles résultèrent de nouveaux intervalles de un plus un demi, de un plus un tiers, de un plus un huitième, que Dieu remplit à nouveau, épuisant ainsi tout son mélange.
Cette description de l’âme ne paraîtra pas claire au lecteur. C’est que le texte non plus n’est pas clair. On peut croire que Platon résume ici des leçons, développées devant ses auditeurs, sans se soucier assez de les rendre intelligibles à ses lecteurs. Quand il présente ses idées sous forme de mythe, il semble prendre plaisir à les dérober sous une forme énigmatique. Souvenons-nous du fameux nombre nuptial de la République, qui a fait couler des flots d’encre, sans qu’on soit encore bien sûr aujourd’hui qu’on l’a découvert exactement. Platon avait appris des Pythagoriciens que les nombres auxquels se réduisent les lois de la nature sont la seule chose fixe et certaine dans le changement perpétuel de toutes choses. Aussi est-ce au nombre qu’il a recours pour expliquer le monde et l’âme du monde. Il faut se figurer la composition des trois ingrédients qui la constituent comme une bande de matière souple que le démiurge divise en parties exprimées par des nombres qui forment deux proportions géométriques de quatre termes chacune : 1, 2, 4, 8 et 1, 3, 9, 27. Il faut se représenter ces nombres comme placés sur un seul rang, dans l’ordre : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27. Les intervalles qui séparent ces nombres sont remplis par d’autres nombres jusqu’à ce qu’on arrive à une série composée de notes musicales aux intervalles d’un ton ou d’un demi-ton. La série qui en résulte comprend quatre octaves, plus une sixte majeure et ne va pas plus loin, parce que Platon l’a arrêtée au chiffre 27, cube de 3. Nous ne pouvons entrer ici dans les calculs compliqués qu’a faits Platon, et dont la clé a été donnée par Bœckh (Kleine Schriften, 3, 1866). Son travail a été complété par H. Martin, Zeller, Dupuis, Archer-Hind, Fraccaroli, Rivaud, Taylor dans son commentaire du Timée (1928) et Cornford dans son édition commentée (1937) du même ouvrage. Nous renvoyons à ces auteurs ceux qui voudront pénétrer exactement la pensée de Platon et résoudre toutes les difficultés qu’elle présente à des lecteurs modernes.
Ayant ainsi composé l’âme, le démiurge coupa sa composition en deux dans le sens de la longueur ; il croisa chaque moitié sur le milieu de l’autre, les courba en cercle, imprima au cercle extérieur le mouvement de la nature du Même, au cercle intérieur le mouvement de la nature de l’Autre, et donna la prééminence à la révolution du Même. Seule, il la laissa sans la diviser. Au contraire, il divisa la révolution extérieure en six endroits et en fit sept cercles inégaux, correspondant à chaque intervalle du double et du triple, de façon qu’il y en eût trois de chaque sorte. Il ordonna à ces cercles d’aller en sens contraire les uns des autres, trois avec la même vitesse, les quatre autres avec des vitesses différentes, tant entre eux qu’avec les trois premières, mais suivant une proportion réglée.
Les cercles dont il vient d’être question sont ceux que décrivent les sept planètes. La durée de leurs révolutions était, pour les platoniciens, d’un mois pour la lune, d’un an pour le soleil, Vénus et Mercure, d’un peu moins de deux ans pour Mars, d’un peu moins de douze ans pour Jupiter, d’un peu moins de trente ans pour Saturne.
Lorsqu’il eut achevé la composition de l’âme, Dieu disposa au-dedans d’elle tout ce qui est corporel, et les ajusta ensemble en les liant centre à centre. Or l’âme, étant à la fois de la nature du Même, de l’Autre et de la nature intermédiaire, peut ainsi se former des opinions solides et véritables, si elle entre en contact avec des objets sensibles, et parvenir à l’intellection et à la science, si elle entre en contact avec des objets rationnels.
Le Temps.
Le modèle du monde étant un animal éternel, le démiurge s’efforça de rendre le monde éternel aussi, dans la mesure du possible, et lui donna le temps, image mobile de l’immobile éternité. C’est pour cela qu’il fit naître le soleil, la lune et les cinq planètes. Quand chacun des êtres qui devaient coopérer à la création du temps eut été placé dans son orbite appropriée, ils se mirent à tourner dans l’orbite de l’Autre, qui est oblique (c’est l’écliptique), qui passe au travers de l’orbite du Même (l’équateur) et qui est dominée par lui. Et pour qu’il y eût une mesure claire de la lenteur et de la vitesse relatives avec laquelle ils opèrent leurs huit révolutions, le dieu alluma dans le cercle qui occupe le second rang en partant de la terre une lumière que nous appelons le soleil. C’est ainsi que naquirent le jour et la nuit.
Les quatre espèces d’êtres vivants.
À la naissance du temps, le monde ne contenait pas tous les animaux qui sont dans le modèle éternel. Dieu y mit alors toutes les formes que l’intelligence aperçoit dans l’animal éternel. Elles sont au nombre de quatre : la première est la race céleste des dieux, la seconde la race ailée, la troisième la race aquatique, la quatrième celle des animaux qui marchent. Il composa l’espèce divine presque entière de feu, pour qu’elle fût brillante et belle ; il la fit ronde, afin qu’elle ressemblât à l’univers, et la mit dans l’intelligence du Meilleur, afin qu’elle l’accompagnât. Il la distribua dans toute l’étendue du ciel et assigna à tous ces dieux deux mouvements, l’un à la même place, l’autre en avant. Quant aux dieux adorés du vulgaire, Platon en parle avec une ironie non déguisée : il faut, dit-il, s’en rapporter à ceux qui en ont parlé avant nous.
Pour les autres espèces d’animaux, comme il ne pouvait les façonner lui-même sans les rendre égales aux dieux, il chargea les dieux subalternes de les former, en mêlant le mortel à l’immortel. Reprenant alors le cratère où il avait d’abord mélangé et fondu l’âme de l’univers, il y versa ce qui restait des mêmes éléments et le partagea en autant d’âmes qu’il y a d’astres. Toutes ces âmes, à leur première incarnation, furent traitées de même ; mais, suivant leur conduite, elles devaient être réintégrées dans leur astre, ou passer dans des corps de femmes ou d’animaux. Les dieux subalternes empruntèrent donc au monde des parcelles de feu, de terre, d’eau et d’air et ils formèrent pour chaque individu un corps unique, où ils enchaînèrent les cercles de l’âme immortelle. Ceux-ci ne pouvant d’abord maîtriser le corps ou être maîtrisés par lui, il s’ensuit que l’intelligence n’y apparaît que lorsque l’accord se fait, avec l’âge. Lorsqu’une bonne éducation s’y joint, l’homme devient complet et parfaitement sain. Les dieux enchaînèrent les deux révolutions divines dans un corps sphérique, la tête, à laquelle ils donnèrent pour véhicule tout le corps. À la partie antérieure de la tête ils adaptèrent le visage et les yeux. Des yeux s’écoule un feu qui ne brûle pas, la lumière, et ce feu, rencontrant celui qui vient des objets, donne la sensation de la vue. C’est par la combinaison de ces deux feux se rencontrant sur une surface polie que s’expliquent les images formées par les miroirs. De tous les présents des dieux, la vue est le plus précieux : ils nous l’ont fait, afin qu’en contemplant les révolutions de l’intelligence dans le ciel, nous réglions sur elles les révolutions de notre propre pensée. L’ouïe et la voix nous ont été données aussi pour la même fin.
Jusqu’ici, nous n’avons considéré dans la formation du monde que l’action de l’intelligence : il faut y ajouter celle de la nécessité ; car la génération de ce monde est le résultat de l’action combinée de la nécessité et de l’intelligence.
Le lieu.
Reprenons donc notre explication. Nous avons jusqu’à présent distingué le modèle intelligible et toujours le même, et la copie visible et soumise au devenir. Il faut y ajouter une troisième espèce, qui est comme le réceptacle et la nourrice de tout ce qui naît. Les quatre éléments se changent sans cesse l’un dans l’autre ; mais ce en quoi chacun d’eux naît et apparaît successivement pour s’évanouir ensuite, c’est quelque chose qui demeure identique, une forme invisible qui reçoit toutes choses, sans revêtir elle-même une seule forme semblable à celles qui entrent en elles, et qui participe de l’intelligible d’une manière fort obscure, saisissable seulement par une sorte de raison bâtarde. On peut l’appeler le lieu.
Les corps composés de triangles.
Avant la formation du monde, tous les éléments étaient secoués au hasard, mais occupaient déjà des places différentes. Dieu commença par leur donner une configuration distincte au moyen des idées et des nombres. D’abord il est évident que le feu, la terre, l’eau et l’air sont des corps. Or les corps ont pour éléments des triangles d’une infinie petitesse. Ces triangles sont scalènes ou isocèles. Les scalènes engendrent en se combinant trois solides, la pyramide, l’octaèdre, l’icosaèdre ; les isocèles un seul, le cube. De ces solides dérivent les quatre corps élémentaires : le cercle est le germe de la terre, la pyramide celui du feu, l’octaèdre celui de l’air et l’icosaèdre celui de l’eau. La terre ne peut pas se transformer en une autre espèce, mais les trois autres éléments le peuvent. Comment se fait-il que les éléments ne cessent pas de se mouvoir et de se traverser les uns les autres ? C’est que le circuit de l’univers, comprenant en lui les diverses espèces, est circulaire et tend naturellement à revenir sur lui-même. Aussi comprime-t-il tous les corps et il ne permet pas qu’il reste aucun espace vide, et cette compression pousse les petits corps dans les intervalles des plus grands et fait que les plus grands forcent les petits à se combiner, et ainsi tous se déplacent pour gagner la place qui leur convient.
Diverses espèces de corps.
Il y a diverses espèces de feu, d’air et d’eau. L’or, le cuivre, le vert-de-gris sont des variétés d’eau ; la grêle, la glace, la neige en sont d’autres, les sucs aussi ; le vin, l’huile, le miel, le verjus sont formés de feu et d’eau. La terre comprimée par l’air forme la pierre, la soude et le sel.
Les sensations.
Les différents corps entrant en contact avec le nôtre y font naître des impressions accompagnées ou non de sensations. L’impression que cause le feu est quelque chose d’acéré ; car il est tranchant et réduit les corps en morceaux et par là produit la chaleur. L’impression contraire à celle de la chaleur vient des liquides qui entourent notre corps et s’efforcent d’y pénétrer ; ils compriment l’humidité qui est en nous ; celle-ci se défend en se poussant en sens contraire : de là le frisson et le tremblement.
La dureté est la qualité des objets auxquels notre chair cède, et la mollesse celle de ceux qui cèdent à notre chair. Ceux-là cèdent qui reposent sur une petite base ; ceux-là résistent qui ont des bases quadrangulaires et sont par là solidement assis. Le lourd est ce qui, d’après l’opinion vulgaire, tombe vers le bas, et le léger ce qui monte vers le haut. Mais, en réalité, il n’y a ni haut ni bas, puisque le monde est sphérique. Ce qui est vrai, c’est que le semblable attire son semblable, et que, lorsque deux corps sont soulevés en même temps par la même force, nécessairement le plus petit cède plus facilement à la contrainte, tandis que le plus grand résiste et cède difficilement. On dit alors qu’il est lourd et se porte vers le bas, et que le petit est léger et se porte vers le haut. Pour les impressions de lisse et de rugueux, c’est la dureté jointe à l’inégalité des parties qui produit la dernière, et l’égalité des parties unie à la densité qui produit la première. Quant aux impressions communes à tout le corps, elles arrivent à la conscience, quand un organe facile à mouvoir les transmet tout autour de lui. S’il est difficile à mouvoir, l’impression reste en lui et le sujet n’en a pas la sensation. Quand l’impression est contre nature et violente, il y a douleur ; plaisir, quand il y a retour à l’état normal. L’impression qui se produit avec aisance ne cause ni douleur, ni plaisir.