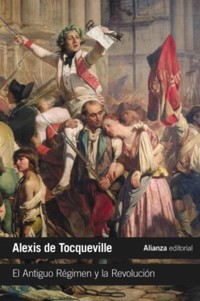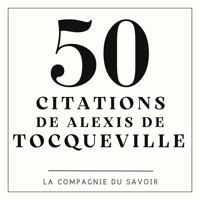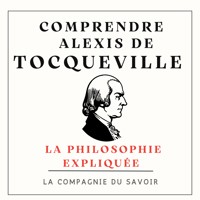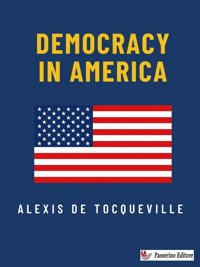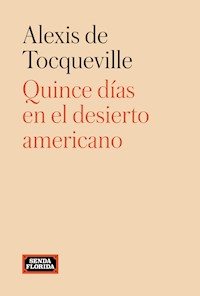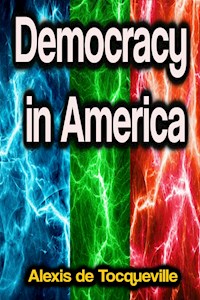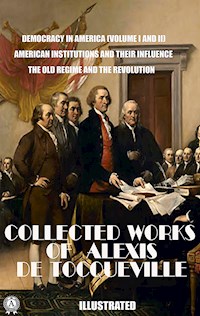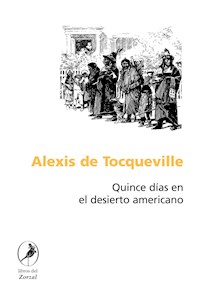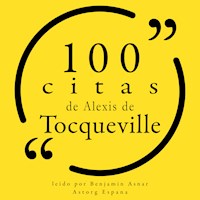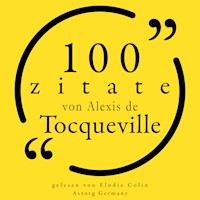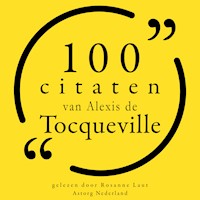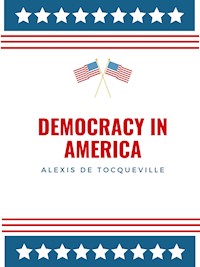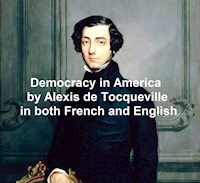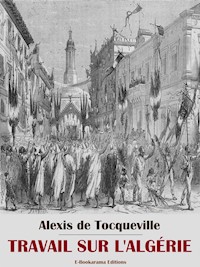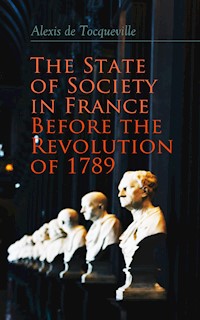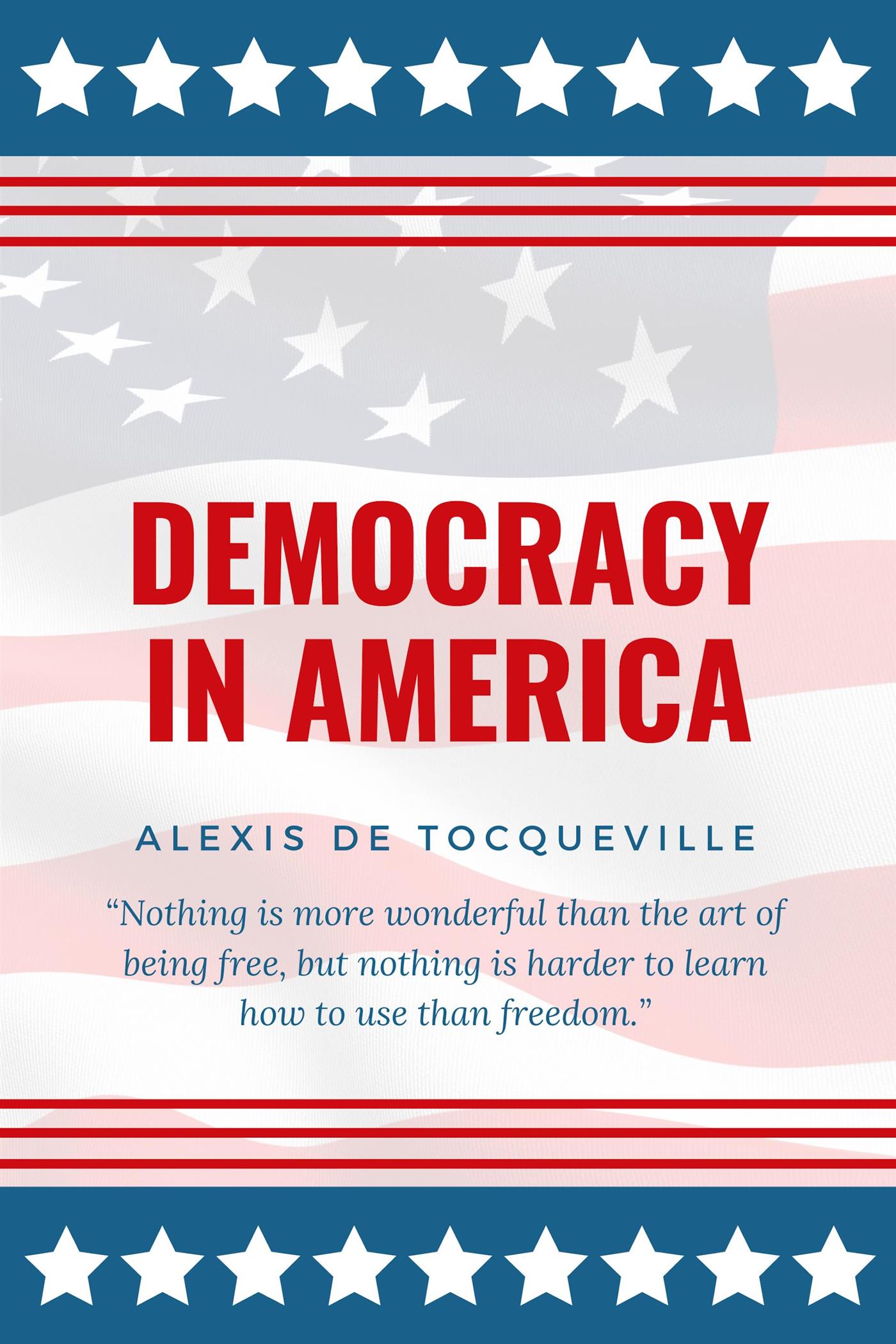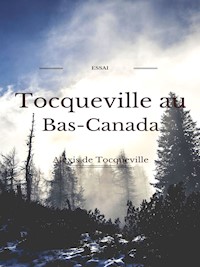
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les écrits d'Alexis de Tocqueville comptent de multiples pages consacrées à la population, à la destinée historique et à la situation politique et culturelle du Bas Canada dans l'Empire Britannique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tocqueville au Bas- Canada
Tocqueville au Bas-CanadaPrésentation par Jacques ValléePremière partieÉcrits datant du voyage en Amérique 1831-1832Écrit sur le Steamboat « The Superior » commencé le 1er août 1831.Sur les grands lacs et aux chutes du NiagaraMontréal et QuébecCanadaVers le sudDeuxième partieAprès le retour en Europe 1832-18591833. Sur les échecs de la colonisation française1838. Sur la rébellion de 37 (Compiègne)1847. Remarques incidentes sur le rapport Durham1856. L’ancien régime au Canada1857. Une conversation avec Lord ElginAPPENDICENotes biographiquesPage de copyrightTocqueville au Bas-Canada
Alexis de Tocqueville
Présentation par Jacques Vallée
Alexis de Tocqueville, en publiant en 1835 une magistrale étude, La Démocratie en Amérique, allait devenir, aux yeux de beaucoup, le plus grand analyste de la société américaine et de ses institutions politiques ; au fédéralisme, a même écrit Pierre Ellion Trudeau, il a donné son « expression classique » ) Mais on a aussi écrit que, lors de leur passage a Québec en 1831, le même Tocqueville et son ami Gustave de Beaumont, pris par une soudaine fièvre nationaliste, s’étaient par moments comportés comme de véritables agitateurs, s’enflammant à troubler une population jugée encore trop apathique.
N’est-ce pas à Québec qu’on voit Tocqueville affirmer « que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple, c’est d’être conquis » ?
N’est-ce pas là qu’on le voit craindre que « les classes intermédiaires et supérieures de la population canadienne abandonnent les basses classes et se laissent entraîner dans le mouvement anglais » ?
N’y a-t-il pas également voulu voir ces « Français du Canada », comme il lui arrivait, à lui aussi, de les appeler, « reconquérir complètement leur nationalité »
N’y a-t-il pas enfin un instant appelé de ses vœux « l’homme de génie qui comprendrait, sentirait et serait capable de développer les passions nationales du peuple », dont il entrevoyait le proche réveil ? Tocqueville, le plus illustre défenseur du fédéralisme, cherchant, plus de trente ans avant l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, un vent de soulèvement chez l’une des « deux nations ennemies », qui habitent le Canada, ce serait là certes une de ces ironies de l’histoire qui méritent qu’on en livre les multiples aspects à la curiosité du lecteur québécois d’aujourd’hui.
Les données essentielles du dossier sont accessibles. On trouve déjà dans les diverses éditions de Tocqueville, en plus de ses œuvres majeures, une grande partie des lettres qu’il a écrites d’Amérique, les multiples cahiers remplis de ses notes de voyage et la plupart des écrits et discours où à travers les années il a fait mention de la réalité canadienne. Une pièce d’importance qui y manque, une lettre sur la révolte de 1837, a naguère été publiée par la Canadian Historical Review. L’édition Gallimard des Œuvrescomplètes, entreprise en 1951 sous la direction de J.-P. Mayer, n’a mentionné jusqu’ici, parmi les inédits qui restent à connaître, hormis certains papiers de Beaumont, aucune pièce de grand intérêt pour nous.
Ces précieuses observations de Tocqueville sur les réalités canadiennes, observations éparses au hasard des pages d’une œuvre considérable, il ne restait donc qu’à les rassembler, à les mettre en ordre (un ordre rigoureusement chronologique), à y ajouter les annotations utiles, enfin à les faire paraître : telle a été notre seule tâche.
Tocqueville et Beaumont n’ont passé que quelques jours au Bas-Canada. Les deux jeunes aristocrates qui avaient officiellement comme mission d’étudier le système pénitentiaire des États-Unis consacrèrent, en fait, l’essentiel de leur séjour en Amérique du Nord (5 mai 1831-20 février 1832) à pénétrer un système démocratique du plus grand intérêt pour deux Français qui, avec la Révolution de 1830, venaient de vivre une autre des mutations prolongeant la Révolution française. Les premières semaines après leur arrivée à New York ayant surtout été employées à la visite de prisons, les voilà qui, au début de juillet, se lancent dans un long périple qui d’Albany, Schenectady, Utica, Syracuse, Auburn, Canandaigua, les conduit à Buffalo et à Détroit où, à la recherche d’authentiques représentants des tribus indiennes, ils vont tenter une expédition dans ce qu’on pouvait encore à l’époque appeler les déserts du Nouveau Monde. C’est à partir de là que nous nous joindrons aux deux voyageurs, puisque c’est à la fin du long récit que fait Tocqueville de leur course à travers bois qu’on assiste à leur première rencontre avec des habitants du Bas-Canada.
Nous les accompagnerons ensuite sur les Grands Lacs (la colonisation française y avait laissé des traces toujours vivantes) avant de les suivre aux Chutes du Niagara, à Montréal et à Québec. Nous les quitterons enfin dès leur retour à Albany, ne retenant du reste du séjour de Tocqueville en Amérique que les moments où il lui arrivera de reprendre en pensée la route du Bas-Canada.
Après avoir pris connaissance des observations de Tocqueville qui précèdent de quelques années les célèbres troubles de 37-38, il appartient à chacun des lecteurs de déterminer le poids qu’il entend leur accorder. Les uns voudront surtout s’employer à reprocher au politologue qui ne se donne pas la peine de connaître la province anglaise de la colonie, qui ne s’embarrasse pas d’un surplus de données économiques, qui ignore tant de sommités, depuis le gouverneur Aylmer jusqu’à Louis-Joseph Papineau, de ne donner de notre situation politique un tableau qui ne soit ni bien neutre ni bien complet. Les autres préféreront accorder une oreille attentive à l’observateur des sociétés qui, sans s’y être spécialement préparé, conduit un peu par le hasard, arrive chez nous et, avec un enthousiasme ne manquant pas de lucidité, nous livre les impressions les plus vives, les perceptions les plus profondes qu’il a de nous, de notre sort.
Dans la deuxième partie du dossier, on trouvera quelques autres textes où Tocqueville, revenu en Europe, fait montre d’un intérêt épisodique envers une réalité canadienne interprétée de moins en moins pour elle-même et de plus en plus en fonction des questions que se pose notre auteur à propos de la société française : telle est la portée qu’il faut attribuer aussi bien aux mentions du rapport Durham suscitées par les discussions parlementaires sur la colonisation en Algérie qu’aux notes sur la centralisation administrative au Canada révélatrices pour l’historien de l’état d’esprit le plus profond de l’ancien régime français.
On y trouvera aussi de larges extraits de la Démocratie en Amérique. Les uns font allusion au la petit peuple » , qui « comme les débris d’un peuple ancien perdu au milieu des flots d’une nation nouvelle » vit une sorte de frileux repli sur les rives du Saint-Laurent. Les autres, qu’il nous a paru utile de reproduire, nous entretiennent du régime fédéral, du contexte social qui le rend possible aux États-Unis, des avantages, des vices aussi, (ces deux termes sont de Tocqueville) qui sont inhérents a ce régime. À chacun de juger par lui-même, sur pièces, jusqu’où vaut telle étiquette reçue qu’en ce pays on a collée à Tocqueville : faut-il en effet faire de lui avant tout un théoricien des constitutions défendant au nom de la théorie des contrepoids l’archétype du fédéralisme, en un moi et dans le sens le plus étroit, un simple constitutionnaliste ? Mais ce serait nier ipso facto la dimension la plus profonde d’Une pensée moins juridique que fondamentalement sociologique, comme l’a admirablement montré Raymond Aron qui voit dans l’auteur de La Démocratie, à l’égal des Comte, des Durkheim, des Weber, des Marx, l’un des grands fondateurs de la sociologie.
C’est précisément en Tocqueville le sociologue qui est soucieux d’affirmer qu’on ne saurait apprécier un régime politique sans constamment tenir compte des conditions qui concrètement définissent la société où il s’insère. C’est le sociologue qui est ainsi amené à penser que les intérêts communs ne suffisent pas au main tien d’une confédération. Il s’explique : « Pour qu’une confédération subsiste longtemps, il n’est pas moins nécessaire qu’il y ait homogénéité dans la civilisation que dans les besoins de divers peuples qui la composent. »
C’est le sociologue qui affirme que les États-Unis « divisés comme ils le sont en vingt-quatre souverainetés distinctes constituent cependant un peuple unique. »
C’est le sociologue qui pense que « le lien du langage est peut-être le plus fort et le plus durable qui puisse unir les hommes. »
C’est le sociologue qui croit que « les peuples se ressentent toujours de leur origine » et qui déclare aussitôt après : « S’il nous était possible de remonter jusqu’aux éléments de leur histoire, je ne doute pas que nous ne puissions y découvrir la cause première des préjugés, des habitudes, des passions dominantes, de tout ce qui compose enfin ce qu’on appelle le caractère national. »
C’est le sociologue qui nous livre le cœur de sa pensée en des termes qui ne permettent enfin aucune ambiguïté :
« Ce qui maintient un grand nombre de citoyens sous le même gouvernement, c’est bien moins la volonté raisonnée de demeurer unis que l’accord instinctif et en quelque sorte involontaire qui résulte de la similitude des sentiments et de la ressemblance des opinions.
« Je ne conviendrai jamais que les hommes forment une société par cela seul qu’ils reconnaissent le même chef et obéissent aux mêmes lois ; il n’y a de société que quand des hommes considèrent un grand nombre d’objets sous le même aspect ; lorsque sur un grand nombre de sujets, ils ont les mêmes opinions ; quand enfin les mêmes faits font naître en eux les mêmes impressions et les mêmes pensées. »
Loin de nous l’idée d’embrigader Tocqueville dans une nouvelle cause : qu’il ait un jour souhaité voir les habitants du Bas-Canada « reconquérir complètement leur nationalité » ne permet pas d’affirmer que dans le difficile débat qui divise aujourd’hui Canadiens et Québécois, il accepterait de marcher derrière le drapeau de l’indépendance. Mais sous prétexte qu’on s’est donné pour credo politique de « faire contrepoids », on ne saurait s’arroger de droits de propriété sur l’œuvre extraordinairement riche d’Alexis de Tocqueville. La récupération post mortem repose trop souvent sur l’éxégèse la plus primitive. Laissons donc au théologien, à Thomas d’Aquin, le soin de baptiser in absentia l’immuable païen qu’est toujours pour nous Aristote. Après tout, saint Thomas était un homme du Moyen Âge.
Jacques VALLÉE
Première partie
Écrits datant du voyage en Amérique 1831-1832
Quinze jours dans le désert.
Écrit sur le Steamboat « The Superior » commencé le 1er août 1831.
Une des choses qui piquaient le plus vivement notre curiosité en venant en Amérique, c’était de parcourir les extrêmes limites de la civilisation européenne et même, si le temps nous le permettait, de visiter quelques-unes de ces tribus indiennes qui ont mieux aimé fuir dans les solitudes les plus sauvages que de se plier à ce que les blancs appellent les délices de la vie sociale. Mais il est plus difficile qu’on ne croit de rencontrer aujourd’hui le désert. À partir de New York et à mesure que nous avancions vers le nord-ouest, le but de notre voyage semblait fuir devant nous. Nous parcourions des lieux célèbres dans l’histoire des Indiens ; nous rencontrions des vallées qu’ils ont nommées ; nous traversions des fleuves qui portent encore le nom de leurs tribus mais partout, la hutte du sauvage avait fait place à la maison de l’homme civilisé. Les bois étaient tombés, la solitude prenait une vie.
Cependant nous semblions marcher sur les traces des indigènes. Il y a dix ans, nous disait-on, ils étaient ici ; là, cinq ans ; là, deux ans. Au lieu où vous voyez la plus belle église du village, nous racontait celui-ci, j’ai abattu le premier arbre de la forêt. Ici, nous racontait un autre, se tenait le grand conseil de la Confédération des Iroquois. – Et que sont devenus les Indiens, disais-je ? – Les Indiens, reprenait notre hôte, ils ont été je ne sais trop où, par-delà les Grands Lacs. C’est une race qui s’éteint ; ils ne sont pas faits pour la civilisation : elle les tue.
L’homme s’accoutume à tout. À la mort sur les champs de bataille, à la mort dans les hôpitaux, à tuer et à souffrir. Il se fait à tous les spectacles. Un peuple antique, le premier et le légitime maître du continent américain, fond chaque jour comme la neige aux rayons du soleil et disparaît à vue d’œil de la surface de la terre. Dans les mêmes lieux et à sa place, une autre race grandit avec une rapidité plus étonnante encore. Par elle les forêts tombent, les marais se dessèchent ; des lacs semblables à des mers, des fleuves immenses s’opposent en vain à sa marche triomphante. Les déserts deviennent des villages, des villages deviennent des villes. Témoin journalier de ces merveilles, l’Américain ne voit dans tout cela rien qui l’étonne. Cette incroyable destruction, cet accroissement plus surprenant encore lui paraît la marche habituelle des événements de ce monde. Il s’y accoutume comme à l’ordre immuable de la nature.
C’est ainsi que, toujours en quête des sauvages et du désert, nous parcourûmes les 360 milles qui séparent New York de Buffalo.
Le premier objet qui frappa notre vue fut un grand nombre d’Indiens, qui s’étaient réunis ce jour-là à Buffalo pour recevoir le paiement des terres qu’ils ont livrées aux États-Unis.
Je ne crois pas avoir jamais éprouvé un désappointement plus complet qu’à la vue de ces Indiens. J’étais plein des souvenirs de M. de Chateaubriand et de Cooper et je m’attendais à voir dans les indigènes de l’Amérique des sauvages sur la figure desquels la nature avait laissé la trace de quelques-unes de ces vertus hautaines qu’enfante l’esprit de liberté, Je croyais rencontrer en eux des hommes dont le corps avait été développé par la chasse et la guerre et qui ne perdaient rien à être vus dans leur nudité. On peut juger de mon étonnement en rapprochant ce portrait de celui qui va suivre :
Les Indiens que je vis ce soir-là avaient une petite stature ; leurs membres, autant qu’on en pouvait juger sous leurs vêtements, étaient grêles et peu nerveux ; leur peau, au lieu de présenter une teinte de rouge cuivre, comme on le croit communément, était bronze foncé de telle sorte qu’au premier abord, elle semblait se rapprocher beaucoup de celle des mulâtres. Leurs cheveux noirs et luisants tombaient avec une singulière roideur sur leurs cols et sur leurs épaules. Leurs bouches étaient en général démesurément grandes, l’expression de leur figure ignoble et méchante. Leur physionomie annonçait cette profonde dépravation qu’un long abus des bienfaits de la civilisation peut seul donner. On eût dit des hommes appartenant à la dernière populace de nos grandes villes d’Europe. Et cependant c’étaient encore des sauvages. Aux vices qu’ils tenaient de nous, se mêlait quelque chose de barbare et d’incivilisé qui les rendait cent fois plus repoussants encore.
Ces Indiens ne portaient pas d’armes, ils étaient couverts de vêtements européens ; mais ils ne s’en servaient pas de la même manière que nous. On voyait qu’ils n’étaient point faits à leur usage et se trouvaient encore emprisonnés dans leurs replis. Aux ornements de l’Europe, ils joignaient les produits d’un luxe barbare, des plumes, d’énormes boucles d’oreilles et des colliers de coquillages. Les mouvements de ces hommes étaient rapides et désordonnés, leur voix aiguë et discordante, leurs regards inquiets et sauvages. Au premier abord, on eût été tenté de ne voir dans chacun d’eux qu’une bête des forêts à laquelle l’éducation avait bien pu donner l’apparence d’un homme, mais qui n’en était pas moins restée un animal. Ces êtres faibles et dépravés appartenaient cependant à l’une des tribus les plus renommées de l’ancien monde américain. Nous avions devant nous, et c’est pitié de le dire, les derniers restes de cette célèbre Confédération des Iroquois dont la mâle sagesse n’était pas moins connue que le courage et qui tinrent longtemps la balance entre les deux plus grandes nations européennes.
On aurait tort toutefois de vouloir juger la race indienne sur cet échantillon informe, ce rejeton égaré d’un arbre sauvage qui a crû dans la boue de nos villes. Ce serait renouveler l’erreur que nous commîmes nous-mêmes et que nous eûmes l’occasion de reconnaître plus tard.
Le soir nous sortîmes de la ville et à peu de distance des dernières maisons nous aperçûmes un Indien couché sur le bord de la route. C’était un jeune homme. Il était sans mouvement et nous le crûmes mort. Quelques gémissements étouffés qui s’échappaient péniblement de sa poitrine nous firent connaître qu’il vivait encore et luttait contre une de ces dangereuses ivresses causées par l’eau-de-vie. Le soleil était déjà couché, la terre devenait de plus en plus humide. Tout annonçait que ce malheureux rendrait là son dernier soupir, à moins qu’il ne fût secouru. C’était l’heure où les Indiens quittaient Buffalo pour regagner leur village ; de temps en temps un groupe d’entre eux venait à passer près de nous. Ils s’approchaient, retournaient brutalement le corps de leur compatriote pour le reconnaître et puis reprenaient leur marche sans daigner répondre à nos observations. La plupart de ces hommes eux-mêmes étaient ivres. Il vint enfin une jeune Indienne qui d’abord sembla s’approcher avec un certain intérêt. Je crus que c’était la femme ou la sœur du mourant. Elle le considéra attentivement, l’appela à haute voix par son nom, tâta son cœur et, s’étant assurée qu’il vivait, chercha à le tirer de sa léthargie. Mais comme ses efforts étaient inutiles, nous la vîmes entrer en fureur contre ce corps inanimé qui gisait devant elle. Elle lui frappait la tête, lui tortillait le visage avec ses mains, le foulait aux pieds. En se livrant à ces actes de férocité, elle poussait des cris inarticulés et sauvages qui, à cette heure, semblent encore vibrer dans mes oreilles. Nous crûmes enfin devoir intervenir et nous lui ordonnâmes péremptoirement de se retirer. Elle obéit, mais nous l’entendîmes en s’éloignant pousser un éclat de rire barbare.
Revenus à la ville nous entretînmes plusieurs personnes du jeune Indien. Nous parlâmes du danger imminent auquel il était exposé ; nous offrîmes même de payer sa dépense dans une auberge. Tout cela fut inutile. Nous ne pûmes déterminer personne à s’en occuper. Les uns nous disaient : Ces hommes sont habitués à boire avec excès et à coucher sur la terre. lis ne meurent point pour de pareils accidents. D’autres avouaient que probablement l’Indien mourrait ; mais on lisait sur leurs lèvres cette pensée à moitié exprimée : Qu’est-ce que la vie d’un Indien ? C’était là le fond du sentiment général. Au milieu de cette société si policée, si prude, si pédante de moralité et de vertu, on rencontre une insensibilité complète, une sorte d’égoïsme froid et implacable lorsqu’il s’agit des indigènes de l’Amérique. Les habitants des États-Unis ne chassent pas les Indiens à cor et à cri ainsi que faisaient les Espagnols du Mexique. Mais c’est le même sentiment impitoyable qui anime ici comme partout ailleurs la race européenne.
Combien de fois dans le cours de nos voyages n’avons-nous pas rencontré d’honnêtes citadins qui nous disaient le, soir, tranquillement assis au coin de leur foyer : Chaque jour le nombre des Indiens va décroissant. Ce n’est pas cependant que nous leur fassions souvent la guerre, mais l’eau-de-vie que nous leur vendons à bas prix en enlève tous les ans plus que ne pourraient faire nos armes. Ce monde-ci nous appartient, ajoutaient-ils, Dieu, en refusant à ses premiers habitants la faculté de se civiliser, les a destinés par avance à une destruction inévitable.
Les véritables propriétaires de ce continent sont ceux qui savent tirer parti de ses richesses.
Satisfait de son raisonnement, l’Américain s’en va au temple où il entend un ministre de l’Évangile lui répéter que les hommes sont frères et que l’être éternel qui les a tous faits sur le même modèle, leur a donné à tous le devoir de se secourir.
Le 19 juillet à dix heures du matin, nous montâmes sur le bateau à vapeur l’Ohio, nous dirigeant vers Détroit. Une brise très forte soufflait du nord-ouest et donnait aux eaux du lac Érié toutes les apparences de l’agitation des vagues de l’Océan. À droite s’étendait un horizon sans bornes, à gauche nous serrions les côtes méridionales du lac dont souvent nous nous approchions jusqu’à la portée de la voix. Ces côtes étaient parfaitement plates et différaient de celles de tous les lacs que j’avais eu occasion de visiter en Europe. Elles ne ressemblaient pas non plus aux bords de la mer. D’immenses forêts les ombrageaient et formaient autour du lac comme une ceinture épaisse et rarement interrompue. De temps en temps cependant le pays change tout à coup d’aspect. Au dé tour d’un bois on aperçoit la flèche élégante d’un clocher, des maisons éclatantes de blancheur et de propreté, des boutiques. Deux pas plus loin, la forêt primitive et en apparence impénétrable reprend son empire et réfléchit de nouveau son feuillage dans les eaux du lac.
Ceux qui ont parcouru les États-Unis trouveront dans ce tableau un emblème frappant de la société américaine. Tout y est heurté, imprévu ; partout l’extrême civilisation et la nature abandonnée à elle-même se trouvent en présence et en quelque sorte face à face. C’est ce qu’on ne s’imagine point en France. Pour moi, dans mes illusions de voyageur – et quelle classe d’hommes n’a pas les siennes – je me figurais tout autre chose. J’avais remarqué qu’en Europe, l’état plus ou moins retiré dans lequel se trouvait une province ou une ville, sa richesse ou sa pauvreté, sa petitesse ou son étendue exerçaient une influence immense sur les idées, les mœurs, la civilisation tout entière de ses habitants et mettaient souvent la différence de plusieurs siècles entre les diverses parties du même territoire.
Je m’imaginais qu’il en était ainsi à plus forte raison dans le Nouveau Monde et qu’un pays, peuplé d’une manière incomplète et partielle comme l’Amérique, devait présenter toutes les conditions d’existence et offrir l’image de la société à tous les âges. L’Amérique, suivant moi, était donc le seul pays où l’on pût suivre pas à pas toutes les transformations que l’état social fait subir à l’homme et où il fût possible d’apercevoir comme une vaste chaîne qui descendit d’anneau en anneau depuis l’opulent patricien des villes jusqu’au sauvage du désert. C’est là, en un mot, qu’entre quelques degrés de longitude je comptais trouver encadrée l’histoire de l’humanité tout entière.
Rien n’est vrai dans ce tableau. De tous les pays du monde l’Amérique est le moins propre à fournir le spectacle que j’y venais chercher. En Amérique, plus encore qu’en Europe, il n’y a qu’une seule société. Elle peut être riche ou pauvre, humble ou brillante, commerçante ou agricole, mais elle se compose partout des mêmes éléments. Le niveau d’une civilisation égale a passé sur elle. L’homme que vous avez laissé dans les rues de New York, vous le retrouvez au milieu des solitudes presque impénétrables : même habillement, même esprit, même langue, mêmes habitudes, mêmes plaisirs. Rien de rustique, rien de naïf, rien qui sente le désert, rien même qui ressemble à nos villages. La raison de ce singulier état de choses est facile à comprendre. Les portions de territoires les plus anciennement et les plus complètement peuplées sont parvenues a un haut degré de civilisation, l’instruction y a été prodiguée à profusion, l’esprit d’égalité y a répandu une teinte singulièrement uniforme sur les habitudes intérieures de la vie. Or, remarquez-le bien, ce sont précisément ces mêmes hommes qui vont peupler chaque année le désert. En Europe, chacun vit et meurt sur le sol qui l’a vu naître. En Amérique, on ne rencontre nulle part les représentants d’une race qui se serait multipliée dans la solitude après y avoir longtemps vécu ignorée du monde et livrée à ses propres efforts. Ceux qui habitent les lieux isolés y sont arrivés d’hier. Ils y sont venus avec les mœurs, les idées, les besoins de la civilisation. lis ne donnent à la vie sauvage que ce que l’impérieuse nature des choses exige d’eux. De là les plus bizarres contrastes. On passe sans transition d’un désert dans la rue d’une cité, des scènes les plus sauvages aux tableaux les plus riants de la vie civilisée.
Si la nuit vous surprenant ne vous force pas de prendre gîte au pied d’un arbre, vous avez grande chance d’arriver dans un village où vous trouverez tout, jusqu’aux modes françaises et aux caricatures des boulevards. Le marchand de Buffalo et de Détroit en est aussi bien approvisionné que celui de New York, les fabriques de Lyon travaillent pour l’un comme pour l’autre. Vous quittez les grandes routes, vous vous enfoncez dans des sentiers à peine frayés. Vous apercevez enfin un champ défriché, une cabane composée de troncs à moitié équarris où le jour n’entre que par une fenêtre étroite, vous vous croyez enfin parvenu à la demeure du paysan américain. Erreur. Vous pénétrez dans cette cabane qui semble l’asile de toutes les misères, mais le possesseur de ce lieu est couvert des mêmes habits que vous, il parle le langage des villes. Sur sa table grossière sont des livres et des journaux ; lui-même se hâte de vous prendre à part pour savoir au juste ce qui se passe dans la vieille Europe et vous demande compte de ce qui vous a le plus frappé dans son pays. Il vous tracera sur le papier un plan de campagne pour les Belges, et vous apprendra gravement ce qui reste à faire pour la prospérité de la France. On croirait voir un riche propriétaire qui est venu habiter momentanément et pour quelques nuits un rendez-vous de chasse. Et, dans le fait, la cabane de bois n’est pour l’Américain qu’un asile momentané, une concession temporaire faite à la nécessité des circonstances. Lorsque les champs qui l’environnent seront entièrement en produit et que le nouveau propriétaire aura le loisir de s’occuper des choses agréables à la vie, une maison plus spacieuse et mieux appropriée à ses besoins remplacera la log-house et servira d’asile à de nombreux enfants qui un jour iront aussi se créer une demeure dans le désert.