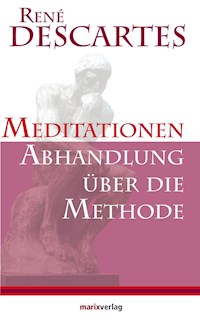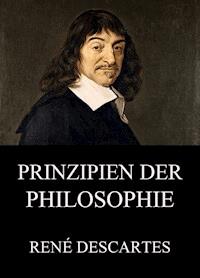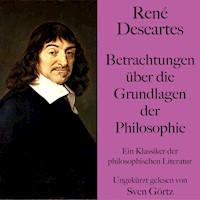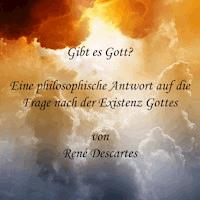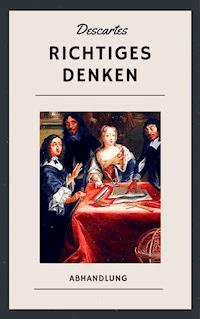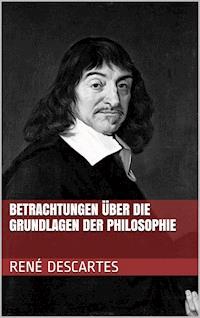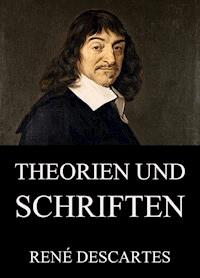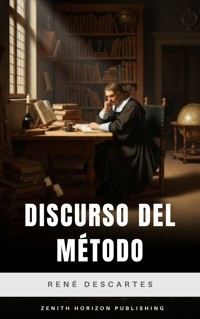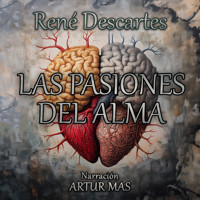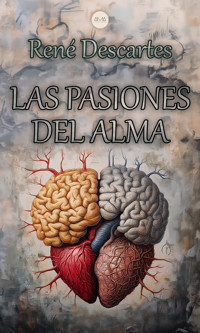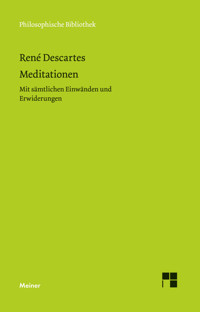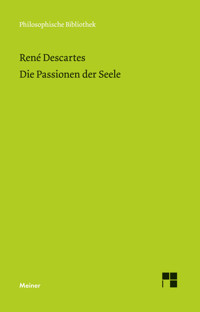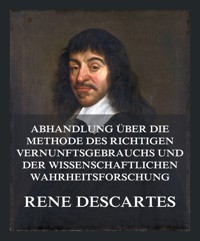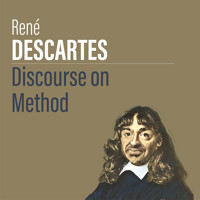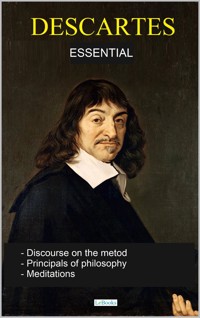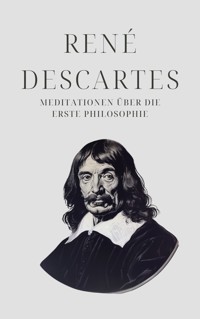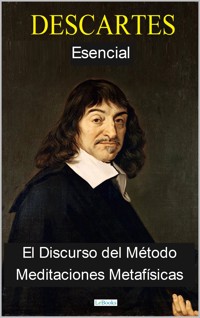1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gérald Gallas
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Traité de la mécanique: Texte établi par Victor Cousin, F. G. Levrault, 1824 (tome V, pp. 431-442). -Abrégé de la musique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Traité de la mécanique et Abrégé de la musique
René Descartes
René Descartes (March 31, 1596 – February 11, 1650), also known as Renatus Cartesius (latinized form), was a highly influential French philosopher, mathematician, scientist, and writer. Dubbed the "Founder of Modern Philosophy", and the "Father of Modern Mathematics", much of subsequent western philosophy is a reaction to his writings, which have been closely studied from his time down to the present day. His influence in mathematics is also apparent, the Cartesian coordinate system being used in plane geometry and algebra being named after him, and he was one of the key figures in the Scientific Revolution. Descartes frequently contrasted his views with those of his predecessors. In the opening section of the Passions of the Soul, a treatise on the Early Modern version of what are now commonly called emotions, he goes so far as to assert that he will write on his topic "as if no one had written on these matters before". Nevertheless many elements of his philosophy have precedents in late Aristotelianism, the revived Stoicism of the 16th century, or in earlier philosophers like St. Augustine. In his natural philosophy, he differs from the Schools on two major points: first, he rejects the analysis of corporeal substance into matter and form; second, he rejects any appeal to ends—divine or natural—in explaining natural phenomena. In his theology, he insists on the absolute freedom of God’s act of creation. Descartes was a major figure in 17th century continental rationalism, later advocated by Baruch Spinoza and Gottfried Leibniz, and opposed by the empiricist school of thought consisting of Hobbes, Locke, Berkeley, and Hume. Leibniz, Spinoza and Descartes were all versed in mathematics as well as philosophy, and Descartes and Leibniz contributed greatly to science as well. As the inventor of the Cartesian coordinate system, Descartes founded analytic geometry, that bridge between algebra and geometry crucial to the invention of calculus and analysis. Descartes's reflections on mind and mechanism began the strain of western thought that much later, impelled by the invention of the electronic computer and by the possibility of machine intelligence, blossomed into, e.g., the Turing test. His most famous statement is: Cogito ergo sum (French: Je pense, donc je suis; English: I think, therefore I am), found in §7 of part I of Principles of Philosophy (Latin) and in part IV of Discourse on the Method (French).
DE
LA MÉCANIQUE.DESQUELS ON PEUT AVEC UNE PETITE FORCE LEVER
L'invention de tous ces engins n'est fondée que sur un seul principe, qui est que la même force qui peut lever un poids, par exemple, de cent livres à la hauteur de deux pieds, en peut aussi lever un de deux cents livres à la hauteur d'un pied, ou un de quatre cents à la hauteur d'un demi-pied, et ainsi des autres, si tant est qu'elle lui soit appliquée.
Et ce principe ne peut manquer d'être reçu si on considère que l'effet doit être toujours proportionné à l'action qui est nécessaire pour le produire; de façon que, s'il est nécessaire d'employer l'action par. laquelle on peut lever un poids de cent livres à la hauteur de deux pieds pour en lever un à la hauteur d'un pied seulement, celui-ci doit peser deux cents livres : car c'est le même de lever cent livres à la hauteur d'un pied, et derechef encore cent à la hauteur d'un pied, que d'en lever deux cents à la hauteur d'un pied, et le même aussi que d'en lever cent à la hauteur de deux pieds.
Or les engins qui servent à faire cette application d'une force qui agit par un grand espace à un poids qu'elle fait lever par un moindre sont la poulie (trochlea), le plan incliné, le coin (cuneus), le tour ou la roue (axis in peritrochio), la vis (cochlea), et le levier (vectis), et autres semblables : car si on ne veut point les rapporter les uns aux autres, on en peut trouver davantage ; et si on les y veut rapporter, il n'est pas besoin d'en mettre tant.
Soit ABC une corde passée autour de la poulie D, à laquelle poulie soit attaché le poids £. Et premièrement, supposant que deux hommes soutiennent ou haussent également chacun un des bouts de cette corde, il est évident que si ce poids pèse deux cents livres, chacun de ces hommes n'emploiera pour le soutenir ou soulever que la force qui lui faut pour soutenir ou soulever cent livres, car chacun n'en porte que la moitié. Faisons après cela que A, l’un des bouts de cette corde, étant attaché ferme à quelque clou, l’autre C soit derechef soutenu par un homme; et il est évident que cet homme en C n’aura besoin, non plus que devant , pour soutenir le poids E, que de la force qu’il faut pour soutenir cent livres, à cause que le clou qui est vers A y fait le même office que l’homme que nous y supposions auparavant. Enfin, posons que cet homme qui est vers C tire la corde pour faire hausser le poids E ; et il est évident que, s’il y emploie la force qu’il faut pour lever cent livres à la hauteur de deux pieds, il fera hausser le poids E, qui en pèse deux cents, de la hauteur d’un pied ; car la corde ABC étant doublée comme elle est, on la doit tirer de deux pieds par le bout C pour faire autant hausser le poids E que si deux hommes la tiroient l’un par le bout A et l’autre par le bout C, chacun de la longueur d’un pied seulement.
Il y a toutefois une chose qui empêche que ce calcul ne soit exact, à savoir la pesanteur de la poulie et la difficulté qu’on peut avoir à faire couler la corde et à la porter, mais cela est fort peu à comparaison de ce qu’on lève et ne peut être estimé qu’à peu près.