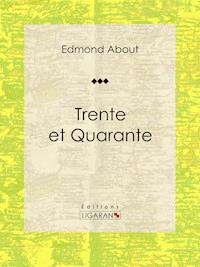
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Lorsqu'on lui présenta les dernières listes de recensement, il y écrivit lui-même, d'une petite écriture sèche et hérissée comme un chaume : Jean-Pierre Bitterlin, de Lunéville ; 60 ans d'âge, 35 ans de services effectifs, 11 campagnes, 2 blessures ; capitaine de 1834, chevalier de 1836, retraité en 1847, médaillé de Sainte-Hélène."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335055825
©Ligaran 2015
Lorsqu’on lui présenta les dernières listes de recensement, il y écrivit lui-même, d’une petite écriture sèche et hérissée comme un chaume :
« Jean-Pierre Bitterlin, de Lunéville ; 60 ans d’âge, 35 ans de services effectifs, 11 campagnes, 2 blessures ; capitaine de 1834, chevalier de 1836, retraité en 1847, médaillé de Sainte-Hélène. »
Sa personne courte et compacte semblait roidie par l’habitude du commandement plus encore que par les années. Il n’avait jamais été ce que les couturières appellent un bel homme ; mais en 1858 il lui manquait un millimètre ou deux pour avoir la taille réglementaire du soldat. Tout me porte à croire que son corps s’était tassé peu à peu sur les grandes routes, à force de mettre un pied devant l’autre : une, deux ! Ses pieds étaient courts et ses mains larges. Sa figure, uniformément rouge, et ridée à petits plis comme un jabot, avait conservé un caractère de fermeté. Ce grand diable de nez, qui la coupait en deux comme les Apennins divisent l’Italie, avait dû faire des malheureuses en 1820. La fine moustache n’était plus souple comme autrefois ; il n’y avait pas de pommade hongroise qui eût la vertu de la dompter : on aurait dit une brosse à dents plantée dans la lèvre supérieure. Elle était toujours noire comme le jais, depuis le dimanche matin jusqu’au mercredi soir ; si elle grisonnait un peu dans les derniers jours de la semaine, c’est que l’art du teinturier n’a pas dit son dernier mot. Quant aux cheveux, c’est autre chose : ils étaient naturellement noirs, et ils l’ont été jusqu’à la fin ; le marchand les avait garantis. L’âge du capitaine, escamoté par une vanité toujours jeune, se trahissait uniquement par les touffes de poils blancs qui s’échappaient de ses oreilles et par les plis de sa figure, plus onduleuse qu’un lac aux premiers frissons du matin. Sa toilette était celle des hommes de trente ans qui brillait vers 1828 : chapeau à bords étroits, col noir grimpant jusqu’aux oreilles, redingote boutonnée sous le menton, pantalon large à gros plis. Les gants qu’il mettait de préférence étaient de fil d’Écosse blanc ; le ruban rouge de sa boutonnière fleurissait opulemment comme un œillet au mois de juin. Sa voix était brève, impérative, et par-dessus tout maussade. Il traînait sur le milieu des phrases et s’arrêtait court à la fin, comme s’il eût commandé l’exercice. Il disait : Comment vous portez… vous ? du même ton qu’il aurait dit : Présentez… arme ! Son caractère était le plus franc, le plus loyal et le plus délicat, mais en même temps le plus aigre, le plus jaloux et le plus malveillant du monde.
L’humeur d’un homme de soixante ans est presque toujours le reflet heureux ou triste de sa vie. Les jeunes gens sont tels que la nature les a faits ; les vieillards ont été façonnés par les mains souvent maladroites de la société. Jean-Pierre Bitterlin avait été le plus joli tambour et le plus joyeux enfant de la France à la bataille de Leipsick. La fortune, qui le traitait en enfant gâté, le fit caporal à seize ans et sergent à dix-sept. Devant ses premiers galons, il rêva, comme tant d’autres, les épaulettes étoilées, le bâton de maréchal, et peut-être quelque chose de mieux. L’impossible était rayé du dictionnaire de l’armée. Un brave garçon sans naissance et sans orthographe pouvait aspirer à tout, si l’occasion lui donnait un coup de main. Bitterlin s’était fait remarquer dès son début par la tenue, l’aplomb, le courage, et toutes ces qualités secondaires qui sont l’argent de poche du soldat français. Il mérite sa première épaulette à Waterloo, mais il ne la reçut que neuf ans plus tard, en Espagne. Dans l’Intervalle, il avait eu cent fois la tentation de quitter le service pour revenir planter ses choux à Lunéville ; mais il n’avait jamais conspiré, quoique mécontent et sergent. Il continuait machinalement et sans goût un métier qu’il avait embrassé par enthousiasme. Le café, le service, la lecture du Constitutionnel et les beaux yeux d’une modiste de Toulouse se partageaient les instants de ce guerrier découragé. Il lisait et relisait l’Annuaire pour compter tous les camarades qui lui avaient passé sur le ventre, et cette lecture lui aigrissait l’esprit. Cependant un je ne sais quoi le retenait au régiment, et il suivait le drapeau comme les chiens suivent leur maître. Il y a dans cette résignation grognonne quelque chose de sublime que les bourgeois ne savent pas admirer. Bitterlin détestait les Bourbons et leur voulait tout le mal imaginable ; mais personne ne les servait plus fidèlement que lui. S’il ne se fit pas tuer pour eux en 1830, il s’en fallut de bien peu : on le porte à l’ambulance des balles avec un lingot de plomb dans la cuisse. Lorsqu’il reprit ses sens, après quinze jours de fièvre et de délire, il se réjouit d’apprendre que le gouvernement était un peu changé. Le désir de revoir sa famille, c’est-à-dire son régiment, abrégea sa convalescence. Il espérait que le temps des grandes guerres allait revenir, et il rêvait l’embrasement de l’Europe, comme tous les vrais soldats. Il n’y eut que des feux de cheminée, et Bitterlin ne fut pas même chargé de les éteindre. Il passa capitaine à l’ancienneté, à son tour de bête, comme il disait en rechignant. Son colonel, qui le remontait de temps à autre, lui prouva que rien n’était désespéré. Capitaine à trente-six ans, il avait l’Afrique devant lui. Il passa la Méditerranée, fit campagne, et rencontra la dysenterie avant d’avoir aperçu l’ennemi. On l’envoya se refaire à Briançon, dans les Hautes-Alpes : sept mois d’hiver, et les torrents au milieu de la rue ! C’est là qu’il épousa par désœuvrement la fille d’un limonadier. À peine marié, il reçut l’ordre de partir pour Strasbourg avec le dépôt : sa femme le suivit dans les bagages. En 1839, fi fut père d’une fille, qui naquit entre le 310e et le 311e kilomètre, sur la route de Strasbourg à Paris. L’enfant vint à bien, et le capitaine espéra un instant que les douceurs de la vie de famille le consoleraient de tous ses mécomptes. Malheureusement sa femme était belle et coquette. Elle se laissa faire la cour sans penser à mal, et Bitterlin connut une sorte de jalousie qu’il n’avait jamais éprouvée en lisant l’Annuaire. Il se cloîtra chez lui, ferma sa porte et montra les dents. On ne le rencontrait que pour affaires de service. Il affectait une politesse raffinée, comme tous les hommes qui ont une supériorité connue au jeu des armes, mais il n’entendait aucunement la plaisanterie. Les jeunes capitaines le plaisantaient pourtant. Il usa deux ou trois écheveaux de patience, puis il se fâcha contre un camarade qui était allé trop loin, et il eut le malheur de le tuer. Personne ne lui donna tort ; l’affaire s’était passée dans les régies. Toutefois il demanda sa retraite à l’âge de quarante-neuf ans. Sa pension, son patrimoine et la petite dot de sa femme composaient au total un revenu d’environ cinq mille francs avec lequel il vint végéter à Paris. Il s’établit au Marais, à quelques pas de la place Royale, mit la petite à Saint-Denis, et s’enferma en tête-à-tête avec sa femme. Cette solitude à deux tua Mme Bitterlin en moins de quatre ans : les anges eux-mêmes se seraient lassés de nourrir le capitaine dans son désert.
Le jour où il rentra chez lui, crotté jusqu’à mi-jambe de cette boue épaisse qui abonde dans les cimetières, il médita une heure ou deux sur le hasard, sur la Providence, sur la destinée et l’avenir des animaux à deux pieds sans plumes ; il se posa quelques-uns de ces gracieux problèmes qu’on ne résout définitivement que d’un coup de pistolet ; maie il ne se tua point : il vivait depuis si longtemps qu’il avait fini par en prendre l’habitude. Sa servante vint lui dire que le déjeuner était prêt ; il se mit à table, et mangea tant bien que mal un morceau.
« Manges, monsieur, manges, lui disait la grosse Agathe en versant une pluie de larmes sur le ragoût de mouton ; il faut prendre force et courage, maintenant qu’il n’y a plus que nous deux au monde, avec mademoiselle qui est à Saint-Denis. »
La grosse Agathe est une montagnarde de l’Oisans, naine et boiteuse. Le limonadier de Briançon l’avait envoyée à sa fille en cadeau d’étrennes, comme un trésor inestimable dans un ménage. Cette créature héroïque et bornée se lève à l’aube en été, à la chandelle en hiver, déjeune d’une messe basse et d’un morceau de pain sec, fait les provisions à la halle et se prend aux cheveux avec les marchandes, va chercher l’eau dans la rue à l’heure où les bornes-fontaines sont ouvertes, blanchit le linge de la maison et le raccommode elle-même, frotte le carreau ronge de l’appartement, polit les meubles comme des miroirs, et s’amuse à étamer les casseroles de la cuisine dans ses moments perdus. Toutes ses pensées sont au ménage, et, pendant les quelques heures qu’elle abandonne au sommeil, elle rêve que le savonnage est trop bleu ou que les fourmis se promènent en longues files dans le garde-manger.
Mais les talents d’Agathe, aussi bien que ses vertus, étaient lettre close pour M. Bitterlin. Il acceptait ses services avec un dédain misanthropique. Au fond de l’âme, il se croyait très généreux de ne pas jeter à la porte une créature si nulle et si disgraciée. Il levait les épaules à toute occasion, essuyait avec défiance son verre étincelant de propreté, et mangeait du bout des dents. Il ne chicanait pas sur la dépense de la maison ; mais chaque fois qu’il vérifiait les comptes, il disait avec une certaine amertume :
« Ma pauvre fille, je crois bien que vous ne me volez pas ; mais quand j’étais lieutenant, la pension me coûtait cinquante francs par mois, et je vivais mieux. »
Agathe fondait en larmes, remerciait son maître de la confiance qu’il lui témoignait, et promettait de se corriger à l’avenir.
Ce maître disgracieux se tint rarement au logis dès qu’il n’eut plus de femme à garder. Lorsqu’il avait fait sa toilette et lu en soupirant le Moniteur de l’Armée, il déjeunait sur le coin d’une table, prenait ses gants et son chapeau, et battait le pavé de Paris jusqu’à six heures du soir. Il s’arrêtait souvent aux Champs-Élysées devant les joueurs de boules, et lorsqu’il avait trouvé l’occasion de railler un maladroit, il s’en allait content. Quelquefois, il entrait dans une salle d’armes du Marais, chez un ancien maître de son régiment, qui le recevait avec les marques de la plus haute estime. Jamais il n’y daigna toucher un fleuret, mais il prouvait volontiers aux élèves et aux amateurs qu’ils tiraient comme des mazettes. Le lieu qu’il fréquentait le plus assidûment était le champ de Mars. La vue des uniformes était pour lui une récréation amère dont il ne se lassait point. Les belles manœuvres lui faisaient plaisir, moins cependant que les manœuvres manquées. Chaque fois qu’un officier se trompait en sa présence, il se frottait les mains à s’emporter la peau, et il passait la langue sur ses moustaches, comme une chèvre lèche un buisson d’épines. Tous les soirs, après son dîner, il s’en allait lire les journaux au café du Pas-de-la-Mule, vers le boulevard Beaumarchais. Les garçons lui servaient le meilleur calé et l’eau-de-vie la plus vieille, parce qu’il était le plus désagréable et le plus exigeant des consommateurs. Il conseillait les joueurs de billard, les joueurs de dames et les joueurs de piquet, sans leur épargner les mauvais compliments ; mais personne ne se fâchait contre lui, car on savait depuis longtemps que tel était son caractère. Lorsqu’on l’invitait à frire une partie, il répondait sèchement qu’il avait d’autres mœurs. Chose étrange ! ses connaissances de café, les seules qu’il eût à Paris, lui pariaient avec d’autant plus de considération qu’il les traitait de plus haut ; les hommes du vulgaire prennent à la lettre l’estime que nous professons pour nous-mêmes et témoignent le plus de déférence à ceux qui leur en montrent le moins.
L’humeur aigre du capitaine devint formellement acide à la suite d’un mauvais procédé de ses anciens camarades : Ils prirent Sébastopol sans lui. Aux premières nouvelles de la guerre de Crimée, il s’était expliqué carrément avec la grosse Agathe sur la situation de la France. « Ma pauvre fille, lui avait-il dit, vous n’entendez rien à ces choses-là, et je ne sais pas pourquoi je vous en parle ; mais il y a des moments où l’on causerait avec son tire-botte, ma parole d’honneur ! La France va se rempoigner avec la Russie : c’est une idée à nous, je pourrais dire à moi. En 1811, à l’âge de treize ans, je disais déjà : « Il faut prendre la Russie. » La Russie me connaît, Agathe ; je l’ai parcourue à pied d’un bout à l’autre. Je me suis mesuré avec elle à la Moskowa. J’ai parlé sa langue ; je la sais encore un peu : Niet ! Da ! Karacko ! Si les Russes me voyaient descendre en Crimée, il y en a peut-être plus d’un qui dirait : « Tiens ! c’est le petit « Bitterlin ! gare dessous ! » Dans cette circonstance, que fera le ministre de la guerre ? croyez-vous qu’il viendra me chercher ! Ah ! bien ouiche ! »
Aucun Français ne s’intéressa plus passionnément que lui aux succès et aux revers des forces alliées. Son ancien régiment, après s’être couvert de gloire au siège de Rome, était parti dans les premiers pour la guerre d’Orient. Bitterlin suivait des yeux, avec un profond sentiment d’envie, toutes les prospérités de ce beau 104e de ligne. Il passait des journées entières à compter des étapes sur la carte de Crimée ou à renverser à coup de crayon les défenses de Sébastopol. Matin et soir, il gourmandait les chefs de l’expédition, parlant à la personne d’Agathe. Lorsqu’un général lui semblait trop prudent à la besogne, il le fourrait sans façon dans le cadre de réserve, montait à cheval à sa place, sabrait tout et se couchait maréchal de France. Toutes les fois que les nouvelles étaient mauvaises, il se promenait dans Paris en haussant les épaules. Cinq ou six habitués du café du Pas-de-la-Mule croyaient fermement que la guerre ne finirait jamais, parce que les hommes spéciaux n’étaient pas là.
Le jour où l’on sut à Paris que la tour Malakoff était prise, il se livra une deuxième bataille dans le cœur du capitaine. D’un côté, la gloire de son cher drapeau, l’honneur du nom français, ce chatouillement délicieux qui enivre un vieux soldat au bruit lointain de la victoire ; de l’autre, l’ennui de n’être rien et de n’avoir rien fait, quand les croix, les grades et les titres pouvaient sur la tête des vainqueurs : tous les sentiments contradictoires qui l’assiégeaient à la fois le secouèrent si rudement, qu’il pleura, sans trop savoir lui-même si c’était de joie ou de douleur. La grosse Agathe, qui n’entendait rien à la politique, lui demanda naïvement si c’était à lui qu’on avait pris la tour Malakoff, et s’il faudrait, pour plus d’économie, supprimer le second plat du déjeuner.
De temps en temps, le capitaine se souvenait qu’il était père, et cette idée, consolante en elle-même, exaspérait son incorrigible chagrin. La paternité lui rappelait fatalement le mariage, et son mariage n’avait pas été plus heureux pour lui que pour les autres. Cet esprit étroit et extrême, imbu des idées les plus fausses et les plus exagérées sur le chapitre de l’honneur, se croyait encore intéressé à découvrir si Mme Bitterlin avait été fidèle à ses devoirs. Doute ridicule, qui éveilla plus d’une fois le capitaine au milieu de la nuit. Sa jalousie n’était pas morte avec sa femme ; elle revenait par accès, comme une fièvre périodique. Le malheureux était homme à rester un quart d’heure devant une glace pour observer sa propre physionomie, et rechercher s’il avait le visage d’un mari trompé. Il roulait incessamment dans son cerveau malade les circonstances qui avaient excité ses soupçons ; il jugeait tous les jours à nouveau un procès interminable, avec une gravité stupide. Lorsque l’innocence de sa femme lui semblait démontrée, il se transportait personnellement au cimetière, et demandait pardon à la pauvre créature de tout le mal qu’il lui avait fait. Mais si au même moment le doute le plus léger lui traversait l’esprit, il montrait le poing à cette tombe pleine de poussière, et il souhaitait de ressusciter sa femme pour lui tordre le cou. Il avait défendu au marbrier de graver sur la pierre les mots sacramentels de bonne épouse ; la place restait en blanc jusqu’à plus ample informé.
Cette incertitude laborieuse ne lui permettait pas de goûter une joie sans mélange dans les embrassements de sa fille. Quoiqu’il n’eût aucune raison raisonnable de supposer qu’il avait signé l’œuvre d’un autre, il remarquait avec un déplaisir croissant que la petite Emma ne lui rassemblerait jamais. Lorsqu’il se décidait à l’aller voir à Saint-Denis, il la trouvait disgracieuse au dernier point sous l’uniforme antique de la maison. Il la baisait sèchement sur le front ; il ne la mangeait pas de caresses avec cet appétit qui distingue les vrais pères. De son côté, l’enfant venait au parloir comme en classe. M. Bitterlin faisait le professeur avec elle ; il la corrigeait comme un devoir.
Le temps des vacances se passait en famille à Auteuil. M. Bitterlin, Agathe et la petite montaient avec leurs paquets dans un omnibus jaune, et descendaient devant une sorte de cité, de ruche, de république bourgeoise, composée de deux cent cinquante appartements et d’autant de Jardins. Les Bitterlin occupaient un troisième, avec vue sur la campagne. Leur Jardin était assez grand pour qu’on pût y faire douze pas dans tous les sens. M. Bitterlin trouvait cette résidence absurde, mais il la garda plusieurs années, pour le plaisir d’en dire du mal. Lorsqu’il était assis sur son banc de gazon, sous son arbre unique, en fumant un cigare d’un sou dont il mangeait la moitié, il regardait jouer Emma dans l’allée qui desservait comme un corridor tous ces jardins d’auberge. Il se demandait ce qu’il y avait de commun entre lui, Bitterlin, maréchal de France manqué, et cette petite fille maigre, aux mains rouges, qui courait en jetant les bras et les jambes.
L’âge ingrat se prolongea pour Mlle Bitterlin bien au-delà des limites ordinaires. À quinze ans sonnés, elle était sinon laide, du moins parfaitement insignifiante, et le capitaine ne se gênait pas pour dire devant elle que les hommes ne feraient jamais de folies pour ses beaux yeux. Mais lorsqu’elle eut terminé son éducation et qu’elle rentra pour toujours à la maison paternelle (c’était, si je ne me trompe, aux vacances de 1856) ; lorsqu’elle échangea l’uniforme sévère de la Légion d’honneur contre une jolie robe d’été, d’une coupe plus moderne, le capitaine fut stupéfait et épouvanté de la transformation qui s’était opérée en elle. Il jura qu’elle était d’une beauté Indécente, et s’attendit pour ses vieux jours à une nouvelle série de tribulations.
La terreur du capitaine, pour être un peu exagérée, ne paraît pas absolument sotte. Elle sera comprise de tous ceux à qui la nature a confié les fonctions gratuites du dragon des Hespérides. Lorsqu’on garde les oranges et qu’on n’en mange pas, on regrette de bonne foi qu’elles soient si belles et si appétissantes. Le cas d’un mari est tout différent : d’abord, les oranges sont pour lui ; ensuite, il a la ressource de les manger toutes, si ses dents sont bonnes, et de laisser le zeste aux voleurs. C’est pourquoi la même corvée qui chargerait de soucis le front d’un père ou d’un frère aîné, apparaît comme un jeu adorable à tous les jeunes maris.
M. Bitterlin, qui s’était cru capable de prendre Sébastopol, ne savait pas s’il serait de force à défendre Emma. Ce n’était pas que la pauvre enfant semblât d’humeur à se laisser prendre, mais elle avait cette séduction irrésistible qui met en mouvement toutes les convoitises du sexe agressif. Les conservateurs des musées, des bibliothèques et de toutes les collections privées ou publiques vous diront qu’il y a dans chaque galerie un tableau, un livre, un bronze, dont la destinée est d’être volé, à l’exclusion de tous les autres. Ici, c’est un Elzévir ou un Alde pas plus grand que la poche, et relié si commodément qu’il vous tombe dans la main comme une noisette mûre. Là, c’est une figurine antique dont la beauté complice attire invinciblement le bras du voleur. Ailleurs, c’est un petit tableau, pur comme le diamant, qui non seulement fascine les gens de profession malhonnête, mais invite la vertu même à le glisser sous son manteau. Le président de Brosses était plus qu’homme de bien, puisqu’il était homme de justice : il faillit pourtant oublier tous ses devoirs devant un petit Corrège qui lui faisait les yeux doux, dans la galerie d’un prince romain. Emma semblait prédestinée au même sort que le petit Elzévir, le petit bronze ou le petit Corrège : Corrège n’a rien peint de plus frais, de plus velouté, de plus savoureux. Sa figure était semée de ce duvet impalpable que la nature répand sur la joue des pêches et sur l’aile des papillons ; poussière de jeunesse et d’innocence que le premier amour efface, et que les beautés fanées remplacent en vain par toutes les poudres du parfumeur. Doublement femme, puisqu’elle était blonde, elle voilait à demi-sous ses longs cils bruns deux grands yeux bleus, riants comme un ciel d’été. Les contours suaves de sa bouche, l’éclat de ses belles lèvres rouges, la blancheur de ses petites dents, légèrement écartées comme chez les enfants, la transparence nacrée de ses narines frémissantes, le dessin exquis de deux mignonnes oreilles qui se noyaient dans l’ombre dorée de ses cheveux, toutes les perfections harmonieuses de son visage formaient un ensemble nullement angélique, mais d’une provocante virginité. Ce n’est pas ainsi que Sasso Ferrato et Carlo Dolci rêvaient la Madone ; c’est ainsi que tous les peintres voudraient représenter Ève, et tous les hommes la rencontrer.
M. Bitterlin avait exprimé grossièrement le vrai caractère de la beauté de sa fille. Rien n’est aussi divers que la beauté des femmes, si ce n’est l’impression qu’elle produit sur nous. Il y a des beautés héroïques qui nous inspirent des sentiments chevaleresques ; des beautés mélancoliques qui nous portent à la rêverie ; des beautés séraphiques qui nous jettent dans le mysticisme et nous conduisent au ciel par les chemins les plus escarpés ; des beautés vénéneuses qui conseillent le crime ; des beautés de ménage qui nous communiquent un désir immodéré d’être pères de famille et conseillers municipaux ; des beautés de kermesse qui nous donnent soif de bière ; des beautés pastorales qui nous font penser à boire du lait. Avec les femmes de Van Ostade, on aimerait à rendre du drap ; avec celles de Téniers, on se résignerait à fumer des pipes ; avec celles de Rubens, on ne détesterait pas de répandre sur la terre une cascade d’enfants joufflus ; avec celles de Van Dyck, on se plairait au métier de roi ; avec celles de Watteau, on mangerait de la crème de meringues dans des gamelles de bois de rose. En présence d’Emma Bitterlin, comme devant certains portraits de Titien et de Raphaël, on oubliait tous les intérêts, tous les devoirs, toutes les ambitions du ciel et de la terre pour ne penser qu’à l’amour.
Comment ce gamin femelle, qui courait comme une araignée à longues pattes dans le phalanstère d’Auteuil, était-il devenu en moins d’un an la femme la plus désirable de Paris ? La nature garde avec un soin jaloux le secret de ces métamorphoses. Une fille sort un beau matin de son adolescence comme d’une coquille dont il ne reste rien. Tous les angles aigus dont la petite Emma semblait hérissée s’émoussèrent en quelques mois. Ses bras se remplirent, sa taille s’arrondit, son buste se modela comme s’il avait été mis en forme dans le moule d’une statue, sa figure se fit. Si ses mains restèrent rouges, ce fut uniquement pour sauver le principe et garder la couleur de la vertu : elles ne demandaient qu’à blanchir au plus tôt, et à devenir ainsi les plus belles mains du monde. Le changement fut si rapide que les compagnes d’Emma purent s’en apercevoir, quoiqu’elles vécussent tous les jours auprès d’elle. Elles éprouvèrent le même étonnement que des voyageurs arrivés la nuit dans un pays inconnu, lorsque le soleil levant leur découvre des forêts, des rochers, des rivières et un paysage délicieux qu’ils ne s’attendaient pas à voir.
L’enfant apprit qu’elle était belle : ce serait grand miracle si une fille était la dernière à s’apercevoir de ces choses-là. Il n’était si petit miroir où elle ne parvint à s’admirer tout entière. Elle se comparait en elle-même à Cendrillon, et elle ne désespérait pas de monter un beau matin dans le grand carrosse d’or, attelé de six chevaux gris souris. Pourquoi non ? Elle souriait à son petit pied en méditant sur cette féerie. Sa première vocation avait été pour le professorat, ce pis-aller des filles qui n’ont ni beauté ni fortune, fille avait rêvé de finir ses jours à Saint-Denis, et d’accomplir entre quatre murs tout le voyage de la vie. On n’eut pas besoin de lui prêcher la résignation aux plaisirs du monde : elle se remontra bientôt à elle-même qu’elle avait une figure trop mondaine pour les fonctions austères de l’enseignement.
Le premier accueil de son père la surprit un peu ; elle comptait sur une ovation domestique, Agathe seule l’admira sans réticence et lui dit qu’elle épouserait quelque fils de roi. Par malheur, il n’était pas probable que les princes viendraient la chercher rue des Vosges, au Marais, et M. Bitterlin semblait peu disposé à la conduire dans le monde. Le seul endroit où il pût la présenter était le café du Pas-de-la-Mule. Ce vieillard égoïste et refrogné avait construit autour de sa vie une muraille de la Chine ; lorsqu’il se vit un trésor à garder, il ne songea qu’à se fortifier davantage. Il craignait que ce petit être séduisant, mignon et portatif, ne fût volé par un larron d’honneur ; l’idée d’en faire don à quelque honnête homme n’était jamais entrée dans son esprit. Il méprisait souverainement cette politique des Anglais et des pères de famille, qui consiste à créer des débouchés pour les produits de leurs maisons. Aussi avare de son sang que de son argent, il trouvait naturel d’économiser pour ses vieux jours ses écus et sa fille. La première mesure qu’il prit fut de donner congé à son propriétaire d’Auteuil ; il craignait les jeunes gens du phalanstère et la liberté de la campagne. Il signifia à l’enfant qu’il ne la perdrait jamais de vue, et qu’elle ne se mettrait pas même à la fenêtre sans lui.
Emma prit en bonne part cette menace et toutes les sévérités de son père : les oisillons se trouvent bien en cage jusqu’au jour où leurs ailes sont venues, et l’on ne sent le besoin de la liberté que lorsqu’on en a l’emploi sous la main. Elle accepta sans murmure toutes les lois que M. Bitterlin crut devoir promulguer dans la maison. Elle se laissa mettre sous clef, elle consentit à ne voir personne, elle joua à la princesse enfermée dans la tour, sans soupçonner qu’à ce jeu elle pouvait gagner les chevrons de vieille fille. La seule chose qui lui causât quelque ennui était la grimace de son père. Elle souffrait de se voir entourée d’un personnage si morose, et elle tenait à honneur de l’apprivoiser un peu. Le désir de plaire, inné chez toutes les femmes, était dominant chez elle, au point que si un indifférent l’avait regardée sans sourire, elle aurait éprouvé comme le sentiment d’une défaite. Elle avait commencé l’apprentissage de la grâce, du temps qu’elle avait sa figure à faire pardonner ; après la métamorphose, die trouvait impertinent qu’on lui fit mauvais visage lorsqu’on n’était ni sourd ni aveugle, et qu’on était son père par-dessus le marché. Elle se mit donc à entourer M. Bitterlin d’un réseau de petits soins et de mignardises où tout autre que le capitaine aurait été pris. Elle lui fit une cour assidue ; elle le câlina comme à la tâche ; elle épuisa pour lui seul cette somme d’amour qu’une fille de dix-sept ans dépense comme elle peut, en caresses aux petits chats et en baisers aux petits oiseaux. Mais plus doucement elle berçait ce vieil enfant, plus il grognait. Toutes ces coquetteries filiales rappelaient à M. Bitterlin d’autres caresses aussi décevantes, dont la sincérité ne lui était pas démontrée. Emma ressemblait à sa mère jusque dans ses baisers, quoique la pauvre femme ne lui eût guère donné de leçons. Chaque geste gracieux, chaque bonne parole de l’enfant réveillait la jalousie posthume du mari et la prudence maussade du père. Le capitaine souffrait réellement lorsqu’il surprenait dans un mouvement d’Emma la gentillesse provocante qu’il avait tant déplorée chez Mme Bitterlin : il confessait à la grosse Agathe, qui n’y comprenait rien, sa peur d’être déshonoré deux fois.
Dans ses accès de misanthropie, il reprochait à l’enfant l’obstination de son sourire et la banalité de son cœur. Un soir qu’elle était un peu rêveuse pendant le dîner : « Attention ! lui cria-t-il, voilà que tu fais de l’œil à la carafe ! » Une autre fois, comme elle l’embrassait en lui prenant la tête dans ses deux mains, il la repoussa durement et s’oublia jusqu’à lui dire : « Tu es lorette ! tu finiras mal ! » Sans comprendre le sens littéral de cette injure, Emma fut froissée dans toutes les délicatesses de son âme, et elle répondit pour la première fois avec un peu de révolte : « Je ne sais pas comment je finirai, mais je ne commence pas trop heureusement. »
La longueur des journées était terrible dans cette vie resserrée sans intimité. On se levait matin, par habitude, sans songer qu’on se donnait ainsi quelques heures de plus à remplir. Emma s’habillait pour tout le jour, fort simplement, mais avec une recherche de propreté dont le capitaine maugréait. Il faisait la guerre aux éponges, et disait sérieusement que chez les femmes, la propreté est la mère de tous les vices. Après déjeuner, le père fumait, tournait, grondait, ouvrait et fermait les fenêtres, regardait l’heure à la pendule et donnait des chiquenaudes au baromètre. Emma se brodait un col, chantait devant le piano droit que sa mère lui avait laissé ; quelquefois elle lisait M. Bitterlin n’y voyait aucun mal, et il permettait à l’enfant le libre usage de sa bibliothèque, rangée dans l’ordre suivant :
La Maison rustique, Dorat, les Trente-sept Codes, Victoires et conquêtes, Voltaire, édition Touquet, l’Abbé Raynal, la Théorie, la Médecine sans médecin, l’Histoire de Napoléon, par Norvins ; les Ruines, par Volney ; l’Imitation de Jésus-Christ, reliée en noir, avec le chiffre de Mme Bitterlin.
Emma n’était ni une sotte ni une Sand, mais un gentil petit esprit féminin, ouvert, enjoué, raisonnable, façonné d’après les meilleurs programmes dans la première maison d’éducation que nous ayons en France : c’est pourquoi les livres de son père l’ennuyaient mortellement, car elle n’y trouvait pas dix lignes à son adresse.
À quatre heures du soir, heure militaire, M. Bitterlin la sortait, comme un palefrenier sort ses bêtes. Il la conduisait à la place Royale ou au jardin des Plantes, rarement sur le boulevard Beaumarchais. Le dimanche on la régalait d’un voyage soit à Vincennes, soit à Bièvre, soit dans quelque autre pays tranquille, où une jolie femme qui passe ne fait point retourner la tête aux promeneurs. Le père et la fille étaient toujours rentrés pour six heures précises, et ils dînaient en tête-à-tête, comme ils avaient déjeuné. Après le dessert, le désœuvrement et l’ennui reprenaient leurs droits, jusqu’à ce que le sommeil s’ensuivît. Dans une de ces heures impossibles à tuer, Emma s’enhardit un soir jusqu’à demander à son père s’il ne lui apprendrait pas quelque jeu amusant, ou s’il ne la conduirait jamais au spectacle ? Cette innocente question effaroucha le tyran du logis comme un appel aux barricades. Il déblatéra sans fin contre le jeu ; dit que c’était le fléau des régiments ; que toutes les dettes et toutes les fautes provenaient du jeu ; qu’un officier modèle, comme il se glorifiait de l’avoir toujours été, ne jouait pas ; aussi n’avait-il fait en trente-cinq ans, ni un centime de dettes, ni un quart d’heure de punition. Quant au théâtre, il n’y trouvait pour lui-même aucun plaisir, et il y voyait du danger pour sa fille. Emma pouvait y rencontrer quelque garçon assez mal élevé pour s’amouracher d’elle, et lui faire la cour : « auquel cas, ajoutait-il, je ne ferai ni une ni deux, et je tuerai le jeune homme, conformément aux lois de l’honneur. »
C’était toujours par des amplifications de ce style que M. Bitterlin formait l’esprit et le cœur de sa fille, pendant les premières heures de la nuit. Aussi la pauvre enfant voyait-elle approcher avec effroi l’instant où l’on ôtait le couvert, et elle traînait le dessert en longueur, lorsqu’il y avait des noix ou des noisettes sur la table. Un soir que la grosse Agathe prenait congé de ses maîtres pour s’aller mettre au lit, Emma lui dit à l’oreille : « Je n’ose pas me plaindre et je m’ennuie trop ; va pleurer pour moi dans ta chambre. »
Vers le milieu de décembre, le capitaine reçut une lettre à l’adresse de sa fille. Il la décacheta vivement et lut ce qui suit :
« Cher petit Désir de plaire,
Me voilà revenue de la campagne ; Henriette aussi, Julie et Caroline aussi. La grave Madeleine m’a fait assavoir qu’elle arriverait demain. Avec toi, sans qui rien n’est bon, le sextuor sera au complet. Maman a décidé que la première réunion des inséparables aurait lieu chez nous. La bonne journée ! J’en saute de joie : n’attribue pas à une autre cause le pâté qui vient de tomber au beau milieu de ma lettre. C’est pour lundi matin. Prie le papa-loup de te faire mener rue Saint-Arnaud, n° 4, avant l’aurore ; on te rapportera dans la tanière après dîner. Nous danserons peut-être, mais à coup sûr nous bavarderons beaucoup, nous rirons comme des folles, et c’est le solide. Il s’agit d’organiser les plaisirs de l’hiver sur une grande échelle, comme disait notre respectable professeur de littérature. J’espère bien que l’on se verra tous les jours, jusqu’au mariage, et encore après. C’est tout un plan de campagne à dresser ; mon frère le soldat, qui vient d’arriver en semestre, nous aidera. Il ne veut pas croire que tu es cent fois plus jolie que moi ; ces lieutenants du génie sont d’une incrédulité choquante. À lundi ! à lundi ! à lundi ! Encore un pâté ! La pâtissière t’embrasse à tour de bras.
LOUISE DE MARANNES. »
M. Bitterlin qui avait été homme, qui avait été jeune, qui avait été aimable, répondit à la compagne d’Emma comme un dogue à un pinson :
« Mademoiselle,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur d’adresser à ma fille, et, quoique très flatté de l’invitation y incluse, je ne crois ni outrepasser mes droits, ni manquer à mes devoirs en vous disant qu’Emma ne va que dans les maisons où va son père, qui, du reste, se trouve mieux au logis que partout ailleurs. Elle mange et rit chez moi autant que sa santé le réclame, et ne songe nullement à ces questions de mariage auxquelles une jeune personne ne saurait être trop étrangère, pour peu qu’elle tienne à sa réputation. Enfin, la fille du capitaine Bitterlin n’est pas faite pour se laisser passer en revue par des lieutenants, eussent-ils même l’avantage d’appartenir à des armes spéciales.
J’ai l’honneur d’être, mademoiselle, votre très humble, très dévoué et très obéissant serviteur. »
Quelques jours après, Emma dit à son père :
« Je suis étonnée que Louise ne m’écrive pas ; elle doit être revenue de la campagne. »
Le capitaine repartit en fronçant le sourcil :
« Elle t’a écrit.
– Ah !
– Des sottises. Je lui ai répondu comme il faut, et je te promets que tu n’entendras plus parler d’elle. »
En effet, ce fut une affaire faite ; et trois ou quatre autres boutades du capitaine isolèrent sa fille aussi parfaitement que si elle n’avait jamais été en pension.
Elle vécut dix-huit mois dans ce vide accablant, en tête-à-tête avec le plus maussade des hommes. Cependant sa santé ne souffrit point, et son humeur même ne fut pas sensiblement altérée. Que la jeunesse est heureuse ! Elle se heurte Impunément à toutes les aspérités de la vie, comme les enfants donnent du front contre l’angle de tous les meubles sans en garder une cicatrice.
La seule amie qui lut restât était la grosse Agathe, fille de peu de ressource, hors de la cuisine. Cette créature falote avait une admiration religieuse pour la beauté de sa maîtresse. Elle lui trouvait des points de ressemblance avec toutes les saintes coloriées qu’elle hébergeait entre les pages de son Paroissien. Lorsqu’on lui permettait de sortir seule avec Emma, soit pour aller à la grand-messe du dimanche, soit pour faire une commission à deux pas du logis, elle se grandissait d’un pied, tant elle était fière. Elle lui dit un jour en sortant de l’église :
« Je ne sais pas comment nous ferons quand tu te marieras. Monsieur ne voudra pas que je le quitte, et je ne saurai jamais me passer de toi. Si l’on pouvait se couper en deux !
– Crois-tu donc que papa songe à me marier ! demanda la petite.
– Tiens ! ça va tout de go. Les filles ne sont pas faites pour autre chose, excepté quand on est une curiosité de la faire comme moi.
– Louise est peut-être mariée à l’heure qu’il est.
– C’est bien possible. Aujourd’hui l’une, demain l’autre. Pas plus tard qu’hier samedi, on en a marié plus de sept à Saint-Paul.
– Mais papa ne connaît personne à Paris.
– Il en a l’air, comme ça, mais je suis bien sûre qu’il a son idée. Demande-lui, si tu es curieuse ; il ne te mangera pas.
– Je n’oserai jamais, Agathe. Rien ne presse, d’ailleurs. Les hommes sont si maussades !
– Pas tous. »
Le même jour, en ôtant le couvert du dîner, Agathe aborda son maître à brûle-pourpoint et lui dit : « Pas vrai, monsieur, que vous pensez quelquefois à marier notre demoiselle ? »
La réponse de M. Bitterlin fut telle que je n’oserai jamais l’écrire. S’il ne battit pas la pauvre créature, c’est parce qu’il sut trouver dans le vocabulaire de la langue française une volée de jurons qui équivalaient à autant de coups. Sa conclusion fut que toutes les femmes étaient des dévergondées, toutes les servantes des entremetteuses, tous les hommes des coquins sans foi ni loi, et qu’il n’avait pas élevé sa fille avec tant de soin pour en faire hommage à un de ces animaux-là.
Cette profession de foi fut si bruyante que tous les habitants de la maison, le portier compris, se couchèrent avec la certitude que Mlle Bitterlin mourrait fille.
Dès ce jour, la consolante Agathe s’efforça de prouver à sa maîtresse la supériorité du célibat : « N’avait-elle pas tout ce qu’on peut désirer au monde ? un bon père, une servante dévouée, une jolie petite chambre à rideaux bleus, un lit bien bordé tous les soirs ; tous les matins, le meilleur café au lait de Paris, et la permission de chanter au piano toute la journée ! C’était le paradis sur terre, et un homme de plus dans la maison n’aurait été qu’un meuble inutile. Les hommes étaient de beaux merles vraiment ! Agathe avait trotté cahin-caha, jusqu’à l’âge de quarante ans sans s’appuyer sur le bras d’un homme, et elle ne s’en trouvait que mieux ! »
À ces raisons, l’enfant n’avait rien à répondre, car elle n’aimait pas.
Le marais est un quartier paisible, qui le serait bien davantage si l’on y rencontrait moins de pensions. Les personnes timides qui viennent chercher le repos vers la rue Saint-Antoine, sont exposées à tomber quatre fois par jour dans les grandes caravanes murmurantes qu’on mène au lycée Charlemagne. Cette belle jeunesse est l’espérance de la patrie et la terreur du voisinage. Il ne faut pas le dire aux parents : les mères et les sœurs ne voudront jamais croire qu’un garçon doux et poli dans sa famille devienne impertinent et grossier dans les rangs de ses camarades. Cependant, les bourgeois qui prêtent à dire ou à rire, les hommes qui ont le nez fait de certaine manière, et toutes les femmes, sans exception, cherchent des détours d’un quart de lieue pour échapper aux quolibets des pensions.
Agathe oublia cette précaution importante, un matin qu’elle était sortie avec Emma. Elle l’avait menée au Paradis des Dames, rue Saint-Antoine, pour choisir une robe d’été. En revenant vers la rue des Vosges, elle aperçut un gros d’écoliers qui s’acheminait au pas accéléré vers la porte du lycée. Pour éviter la rencontre, elle se jeta étourdiment dans la rue Culture-Sainte-Catherine, et elle se trouva prise entre deux interminables pensions, comme entre deux murs parallèles. Les pauvres filles trottèrent sans trop d’accidents jusqu’à moitié de leur course ; tout au plus si les petits garçons qui marchaient en tête risquèrent une observation sur la bobonne d’Emma ; mais à la hauteur du numéro 4, devant la caserne des pompiers, les élèves de rhétorique et de seconde, renforcés de quelques mathématiciens, se serrèrent en rond autour d’elles pour les mitrailler de leurs galanteries :
« Mademoiselle, n’ai-je pas eu l’honneur de danser avec vous à la Closerie des Lilas ?
– Mademoiselle, si je ne craignais de vous compromettre, je vous offrirais un sou de pain d’épice.
– Mademoiselle, daignez accepter mon bras jusqu’à la pension !
– Mademoiselle, demandez ma main au pion, il ne vous la refusera pas.
– Mademoiselle, venez me voir jeudi au parloir ; je m’appelle Samajou.
– Ce n’est pas vrai, mademoiselle, il s’appelle Caboche. »
Je ne sais pas où les maîtres d’étude avaient l’esprit : l’un regardait voler les premières hirondelles, l’autre lorgnait le comptoir d’étain d’une boutique voisine ; tandis qu’Emma, rouge comme une cerise, s’escrimait de ses deux coudes pour faire une trouée dans l’ennemi, et que la grosse Agathe distribuait des coups de poing dans la foule.
« Je te connais beau masque, disait un lettré à la servante ; tu es Vulcain déguisé en femme pour accompagner Vénus à Paris. » Un autre citait de mémoire quelques plaisanteries de haut goût inventées par le bon Panurge à l’usage des dames de son temps.
Une grêle de soufflets qui sembla tomber du ciel vint écarter les assiégeants et mettre les prisonnières en liberté. Emma, brisée de fatigue et de peur, et plus morte que vive, se sentit comme emportée par un grand jeune homme à barbe noire. Elle entendit confusément un mélange épouvantable de clameurs indignées : ah ! oh ! ouh ! Grand lâche ! C’est dégoûtant ! » Elle vit quelques livres pleuvoir autour d’elle sur le pavé de la rue ; puis ses yeux se fermèrent et elle ne vit plus rien.
Lorsqu’elle reprit ses sens, elle était dans une chambre inconnue, Agathe lui faisait respirer un flacon ; un homme beau comme le jour, ou plutôt comme le soir, se tenait à genoux devant elle et lui frappait dans les mains. Elle promena machinalement ses yeux sur les quatre murs, et se vit entourée de grands seigneurs et de grandes dames, dans les cadres les plus magnifiques : « Où suis-je ? » dit-elle.





























