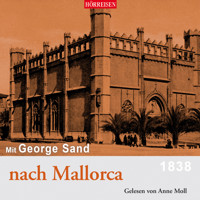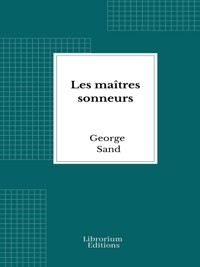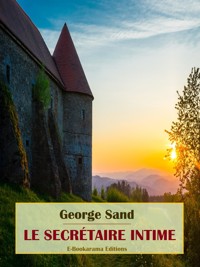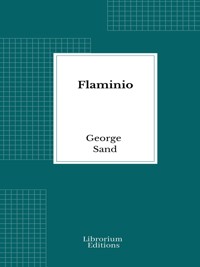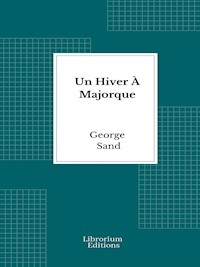Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Alors que son amant, Chopin, est malade, George Sand décide de partir avec lui pour passer l'hiver dans un pays plus chaud
«
Nous arrivâmes à Palma au mois de novembre 1838, par une chaleur comparable à celle de notre mois de juin. Nous avions quitté Paris quinze jours auparavant par un temps extrêmement froid ; ce nous fut un grand plaisir, après avoir senti les premières atteintes de l'hiver, de laisser l'ennemi derrière nous. À ce plaisir se joignit celui de parcourir une ville très caractérisée, et qui possède plusieurs monuments de premier ordre comme beauté ou comme rareté. Mais la difficulté de nous établir vint nous préoccuper bientôt, et nous vîmes que les Espagnols qui nous avaient recommandé Majorque comme le pays le plus hospitalier et le plus fécond en ressources, s'étaient fait grandement illusion, ainsi que nous... »
Un journal de bord qui met en avant les différences culturelles de l’époque
EXTRAIT
Deux touristes anglais découvrirent, il y a, je crois, une cinquantaine d’années, la vallée de Chamonix, ainsi que l’atteste une inscription taillée sur un quartier de roche, à l’entrée de la Mer de Glace. La prétention est un peu forte, si l’on considère la position géographique de ce vallon, mais légitime jusqu’à un certain point, si ces touristes, dont je n’ai pas retenu les noms, indiquèrent les premiers aux poètes et aux peintres ces sites romantiques où Byron rêva son admirable drame de
Manfred. On peut dire en général, et en se plaçant au point de vue de la mode, que la Suisse n’a été découverte par le beau monde et par les artistes que depuis le siècle dernier. Jean-Jacques Rousseau est le véritable Christophe Colomb de la poésie alpestre, et, comme l’a très bien observé M. de Chateaubriand, il est le père du romantisme dans notre langue.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Femme de lettre française,
George Sand a laissé derrière elle une œuvre romanesque remarquable, assortie de contes, de nouvelles, de pièces théâtrales, de textes autobiographiques et d’une immense correspondance. Inspirée par les passions qui ont jalonné sa vie, elle s’est battue aussi bien pour son indépendance, sa liberté de penser que pour ses aspirations politiques républicaines.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Sand
Un hiver à Majorque
CLAAE
2013
© CLAAE 2013
Tous droits réservés. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
EAN ebook : 9782379110122
CLAAE
France
Première partie
—
Deux touristes anglais découvrirent, il y a, je crois, une cinquantaine d’années, la vallée de Chamonix, ainsi que l’atteste une inscription taillée sur un quartier de roche, à l’entrée de la Mer de Glace. La prétention est un peu forte, si l’on considère la position géographique de ce vallon, mais légitime jusqu’à un certain point, si ces touristes, dont je n’ai pas retenu les noms, indiquèrent les premiers aux poètes et aux peintres ces sites romantiques où Byron rêva son admirable drame de Manfred. On peut dire en général, et en se plaçant au point de vue de la mode, que la Suisse n’a été découverte par le beau monde et par les artistes que depuis le siècle dernier. Jean-Jacques Rousseau est le véritable Christophe Colomb de la poésie alpestre, et, comme l’a très bien observé M. de Chateaubriand, il est le père du romantisme dans notre langue.
N’ayant pas précisément les mêmes titres que Jean-Jacques à l’immortalité, et en cherchant bien ceux que je pourrais avoir, j’ai trouvé que j’aurais peut-être pu m’illustrer de la même manière que les deux Anglais de la vallée de Chamonix, et réclamer l’honneur d’avoir découvert l’île de Majorque. Mais le monde est devenu si exigeant, qu’il ne m’eût pas suffi aujourd’hui de faire inciser mon nom sur quelque roche baléarique. On eût exigé de moi une description assez exacte, ou tout au moins une relation assez poétique de mon voyage, pour donner envie aux touristes de l’entreprendre sur ma parole ; et, comme je ne me sentis point dans une disposition d’esprit extatique en ce pays-là, je renonçai à la gloire de ma découverte, et ne la constatai ni sur le granit ni sur le papier.
Si j’avais écrit sous l’influence des chagrins et des contrariétés que j’éprouvais alors, il ne m’eût pas été possible de me vanter de cette découverte, car chacun, après m’avoir lu, m’eût répondu qu’il n’y avait pas de quoi. Et cependant il y avait de quoi, j’ose le dire aujourd’hui, car Majorque est pour les peintres un des plus beaux pays de la terre, et un des plus ignorés. Mais là où il n’y a que la beauté pittoresque à décrire, notre plume littéraire est si pauvre et si insuffisante, que je ne songeai même pas à m’en charger. Il faut le crayon et le burin du dessinateur pour révéler les grandeurs et les grâces de la nature aux amateurs de voyages. Donc, si je secoue aujourd’hui la léthargie de mes souvenirs, c’est parce que j’ai trouvé un de ces derniers matins sur ma table un joli volume intitulé : Souvenirs d’un voyage d’art à l’île de Majorque, par J.-B. Laurens. Ce fut pour moi une véritable joie que de retrouver Majorque avec ses palmiers, ses aloès, ses monuments arabes et ses costumes grecs. Je reconnaissais tous les sites avec leur couleur poétique, et je retrouvais toutes mes impressions effacées déjà, du moins à ce que je croyais. Il n’y avait pas une masure, pas une broussaille, qui ne réveillât en moi un monde de souvenirs, comme on dit aujourd’hui ; et alors je me suis senti, sinon la force de raconter mon voyage, du moins celle de rendre compte de celui de M. Laurens, artiste intelligent, laborieux, plein de rapidité et de conscience dans l’exécution, et auquel il faut certainement restituer tout l’honneur d’avoir découvert l’île de Majorque.
Ce voyage de M. Laurens au fond de la Méditerranée, sur des rives où la mer est parfois aussi peu hospitalière que les habitants, est beaucoup plus méritoire que la promenade de nos deux Anglais au Montanvert. Néanmoins, si la civilisation européenne était arrivée à ce point de supprimer les douaniers et les gendarmes, ces manifestations visibles des méfiances et des antipathies nationales, si la navigation à la vapeur était organisée directement de chez nous vers ces parages, Majorque ferait bientôt grand tort à la Suisse ; car on pourrait s’y rendre en aussi peu de jours, et on y trouverait certainement des beautés aussi suaves et des grandeurs étranges et sublimes qui fourniraient à la peinture de nouveaux aliments.
Pour aujourd’hui, je ne puis en conscience recommander ce voyage qu’aux artistes robustes de corps et passionnés d’esprit. Un temps viendra sans doute où les amateurs délicats, et jusqu’aux jolies femmes, pourront aller à Palma sans plus de fatigue et de déplaisir qu’à Genève.
Longtemps associé aux travaux artistiques de M. Taylor sur les vieux monuments de la France, M. Laurens, livré maintenant à ses propres forces, a imaginé, l’an dernier, de visiter les Baléares, sur lesquelles il avait eu si peu de renseignements, qu’il confesse avoir éprouvé un grand battement de cœur en touchant ces rives où tant de déceptions l’attendaient peut-être en réponse à ses songes dorés. Mais ce qu’il allait chercher là, il devait le trouver, et toutes ses espérances furent réalisées ; car, je le répète, Majorque est l’Eldorado de la peinture. Tout y est pittoresque, depuis la cabane du paysan, qui a conservé dans ses moindres constructions la tradition du style arabe, jusqu’à l’enfant drapé dans ses guenilles, et triomphant dans sa malpropreté grandiose, comme dit Henri Heine à propos des femmes du marché aux herbes de Vérone. Le caractère du paysage, plus riche en végétation que celui de l’Afrique ne l’est en général, a tout autant de largeur, de calme et de simplicité. C’est la verte Helvétie sous le ciel de la Calabre, avec la solennité et le silence de l’Orient. En Suisse, le torrent qui roule partout, et le nuage qui passe sans cesse, donnent aux aspects une mobilité de couleur et pour ainsi dire une continuité de mouvement, que la peinture n’est pas toujours heureuse à reproduire. La nature semble s’y jouer de l’artiste. À Majorque, elle semble l’attendre et l’inviter. Là, la végétation affecte des formes altières et bizarres; mais elle ne déploie pas ce luxe désordonné sous lequel les lignes du paysage suisse disparaissent trop souvent. La cime du rocher dessine ses contours bien arrêtés sur un ciel étincelant, le palmier se penche de lui-même sur les précipices sans que la brise capricieuse dérange la majesté de sa chevelure, et jusqu’au moindre cactus rabougri au bord du chemin, tout semble poser avec une sorte de vanité pour le plaisir des yeux.
Avant de suivre M. Laurens dans son Voyage d’art, nous donnerons une description très succincte de la grande Baléare, dans la forme vulgaire d’un article de dictionnaire géographique. Cela n’est point si facile que cela semble, surtout quand on cherche à s’instruire dans le pays même. La prudence de l’Espagnol et la méfiance de l’insulaire y sont poussées si loin, qu’un étranger ne doit adresser à qui que ce soit la question la plus oiseuse du monde, sous peine de passer pour un agent politique. Ce bon M. Laurens, pour s’être permis de croquer un castillo en ruines dont l’aspect lui plaisait, a été fait prisonnier par l’ombrageux gouverneur, qui l’accusait de lever le plan de sa forteresse1. Aussi notre voyageur, résolu à compléter son album ailleurs que dans les prisons d’État de Majorque, s’est-il bien gardé de s’enquérir d’autre chose que des sentiers de la montagne, et d’interroger d’autres documents que les pierres des ruines. Après avoir passé quatre mois à Majorque, je ne serais pas plus avancé que lui, si je n’eusse consulté le peu de détails qui nous ont été transmis sur ces contrées. Mais là ont recommencé mes incertitudes, car ces ouvrages, déjà anciens, se contredisent tellement entre eux, et, selon la coutume des voyageurs, se démentent et se dénigrent si superbement les uns les autres, qu’il faut se résoudre à redresser quelques inexactitudes, sauf à en commettre beaucoup d’autres. Voici toutefois mon article de dictionnaire géographique, et, pour ne pas me départir de mon rôle de voyageur, je commence par déclarer qu’il est incontestablement supérieur à tous ceux qui le précèdent.
Majorque, que M. Laurens appelle Balearis Major comme les Romains, que le roi des historiens majorquins, le docteur Juan Dameto dit avoir été plus anciennement appelée Clumba ou Columba, se nomme réellement aujourd’hui par corruption Mallorca, et la capitale ne s’est jamais appelée Majorque, comme il a plu à plusieurs de nos géographes de l’établir, mais Palma. Cette île est la plus grande et la plus fertile de l’archipel Baléare, vestige d’un continent dont la Méditerranée doit avoir envahi le bassin, et qui, ayant uni sans doute l’Espagne à l’Afrique, participe du climat et des productions de l’une et de l’autre. Elle est située à vingt-cinq lieues sud-est de Barcelone, à quarante-cinq du point le plus voisin de la côte africaine, et je crois à quatre-vingt-treize ou cent de la rade de Toulon. Sa surface est de mille deux cent trente-quatre milles carrés1, son circuit de cent quarante-trois, sa plus grande extension de cinquante-quatre, et la moindre de vingt-huit. Sa population, qui, en l’année 1787, était de cent trente-six mille individus, est aujourd’hui d’environ cent soixante mille. La ville de Palma en contient trente-six au lieu de trente-deux mille qu’elle comptait à cette époque. La température varie assez notablement suivant les diverses expositions. L’été est brûlant dans toute la plaine ; mais la chaîne de montagnes qui s’étend du nord-est au sud-ouest (indiquant par cette direction son identité avec les territoires de l’Afrique et de l’Espagne, dont les points les plus rapprochés affectent cette inclinaison et correspondent à ses angles les plus saillants) influe beaucoup sur la température de l’hiver. Ainsi, Miguel de Vargas rapporte qu’en rade de Palma, durant le terrible hiver de 1784, le thermomètre de Réaumur se trouva une seule fois à six degrés au-dessus de la glace dans un jour de janvier ; que d’autres jours il monta à seize, et que le plus souvent il se maintint à onze. – Or, cette température fut à peu près celle que nous eûmes dans un hiver ordinaire sur la montagne de Valldemosa, qui est réputée, il est vrai, une des plus froides régions de l’île. Dans les nuits les plus rigoureuses, et lorsque nous avions deux pouces de neige, le thermomètre n’était que de six à sept degrés. À huit heures du matin, il était remonté à neuf ou dix, et à midi il s’élevait à douze ou quatorze. Ordinairement, vers trois heures, c’est-à-dire après que le soleil était couché pour nous derrière les pics de montagnes qui nous entouraient, le thermomètre redescendait subitement à neuf et même à huit degrés.
Les vents de nord y soufflent souvent avec fureur, et, dans certaines années, les pluies d’hiver tombent avec une abondance et une continuité dont nous n’avons en France aucune idée. En général, le climat est sain et généreux dans toute la partie méridionale qui s’abaisse vers l’Afrique, et que préservent de ces furieuses bourrasques du nord la Cordillère médiane et l’escarpement considérable des côtes septentrionales. Ainsi, le plan général de l’île est une surface inclinée du nord-ouest au sud-est, et la navigation, à peu près impossible au nord à cause des déchirures et des précipices de la côte, escarpada y horrorosa, sin abrigo ni resguardo (Miguel de Vargas), est facile et sûre au midi.
Malgré ses ouragans et ses aspérités, Majorque, à bon droit nommée par les anciens l’île dorée, est extrêmement fertile, et ses produits sont d’une qualité exquise. Le froment y est si pur et si beau, que les habitants l’exportent, et qu’on s’en sert exclusivement à Barcelone pour faire la pâtisserie blanche et légère, appelée pan de Mallorca. Les Majorquins font venir de Galice et de Biscaye un blé plus grossier et à plus bas prix, dont ils se nourrissent, ce qui fait que, dans le pays le plus riche en blé excellent, on mange du pain détestable. J’ignore si cette spéculation leur est fort avantageuse. Dans nos provinces du centre, où l’agriculture est la plus arriérée, l’usage du cultivateur ne prouve rien autre chose que son obstination et son ignorance. À plus forte raison en est-il ainsi à Majorque, où l’agriculture, bien que fort minutieusement soignée, est à l’état d’enfance. Nulle part je n’ai vu travailler la terre si patiemment et si mollement. Les machines les plus simples sont inconnues ; les bras de l’homme, bras fort maigres et forts débiles comparativement aux nôtres, suffisent à tout, mais avec une lenteur inouïe. Il faut une demi-journée pour bêcher moins de terre qu’on n’en expédierait chez nous en deux heures, et il faut cinq ou six hommes des plus robustes pour remuer un fardeau que le moindre de nos portefaix enlèverait gaiement sur ses épaules.
Malgré cette nonchalance, tout est cultivé, et en apparence bien cultivé à Majorque. Ses insulaires ne connaissent point, dit-on, la misère ; mais au milieu de tous les trésors de la nature, et sous le plus beau ciel, leur vie est plus rude et plus tristement sobre que celle de nos paysans. Les voyageurs ont coutume de faire des phrases sur le bonheur de ces peuples méridionaux, dont les figures et les costumes pittoresques leur apparaissent le dimanche aux rayons du soleil, et dont ils prennent l’absence d’idées et le manque de prévoyance pour l’idéale sérénité de la vie champêtre. C’est une erreur que j’ai souvent commise moi-même, mais dont je suis bien revenue, surtout depuis que j’ai vu Majorque. Il n’y a rien de si triste et de si pauvre au monde que ce paysan qui ne sait que prier, chanter, travailler et qui ne pense jamais. Sa prière est une formule stupide qui ne présente aucun sens à son esprit, son travail est une opération des muscles qu’aucun effort de son intelligence ne lui enseigne à simplifier, et son chant est l’expression de cette morne mélancolie qui l’accable à son insu, et dont la poésie nous frappe sans se révéler à lui. N’était la vanité qui l’éveille de temps en temps de sa torpeur pour le pousser à la danse, ses jours de fête seraient consacrés au sommeil.
Mais je m’échappe déjà hors du cadre que je me suis tracé. J’oublie que, dans la rigueur de l’usage, l’article géographique doit mentionner avant tout l’économie productive et commerciale, et ne s’occuper qu’en dernier ressort, après les céréales et le bétail, de l’espèce Homme. Dans toutes les géographies descriptives que j’ai consultées, j’ai trouvé, à l’article Baléares, cette courte indication que je confirme ici, sauf à revenir plus tard sur les considérations qui en atténuent la vérité : Ces insulaires sont fort affables – on sait que, dans toutes les îles, la race humaine se classe en deux catégories : ceux qui sont anthropophages et ceux qui sont fort affables –. Ils sont doux, hospitaliers ; il est rare qu’ils commettent des crimes, et le vol est presque inconnu chez eux. En vérité, je reviendrai sur ce texte. Mais, avant tout, parlons des produits, car je crois qu’il a été prononcé dernièrement à la Chambre quelques paroles – au moins imprudentes – sur l’occupation réalisable de Majorque par les Français, et je présume que, si cet écrit tombe entre les mains de quelqu’un de nos députés, il s’intéressera beaucoup plus à la partie des denrées qu’à mes réflexions philosophiques sur la situation intellectuelle des Majorquins.
Je dis donc que le sol de Majorque est d’une fertilité admirable, et qu’une culture plus active et plus savante en décuplerait les produits. Le principal commerce consiste en amandes, en oranges et en cochons. Ô belles plantes hespérides gardées par ces dragons immondes, ce n’est pas ma faute si je suis forcé d’accoler votre souvenir à celui de ces ignobles pourceaux dont le Majorquin est plus jaloux et plus fier que de vos fleurs embaumées et de vos pommes d’or ! Mais ce Majorquin qui vous cultive n’est pas plus poétique que le député qui me lit. Je reviens donc à mes cochons. Ces animaux, cher lecteur, sont les plus beaux de la terre, et le docte Miguel Vargas fait, avec la plus naïve admiration, le portrait d’un jeune porc qui, à l’âge candide d’un an et demi, pesait vingt-quatre arrobes, c’est-à-dire six cents livres. En ce temps-là, l’exploitation du cochon ne jouissait pas, à Majorque, de cette splendeur qu’elle a acquise de nos jours. Le commerce des bestiaux était entravé par la rapacité des assentistes ou fournisseurs, auxquels le gouvernement espagnol confiait, c’est-à-dire vendait l’entreprise des approvisionnements. En vertu de leur pouvoir discrétionnaire, ces spéculateurs s’opposaient à toute exportation de bétail, et se réservaient la faculté d’une importation illimitée. Cette pratique usuraire eut le résultat de dégoûter les cultivateurs du soin de leurs troupeaux. La viande se vendant à vil prix et le commerce extérieur étant prohibé, ils n’eurent plus qu’à se ruiner ou à abandonner complètement l’éducation du bétail. L’extinction en fut rapide. L’historien que je cite déplore pour Majorque le temps où les Maures la possédaient, et où la seule montagne d’Artà comptait plus de têtes de vaches fécondes et de nobles taureaux, qu’on n’en pourrait rassembler aujourd’hui, dit-il, dans toute la plaine de Majorque.
Cette dilapidation ne fut pas la seule qui priva le pays de ses richesses naturelles. Le même écrivain rapporte que les montagnes, et particulièrement celles de Torella et de Galatzó, possédaient de son temps les plus beaux arbres du monde. Certains oliviers avaient quarante-deux pieds de tour et quatorze de diamètre ; mais ces bois magnifiques furent dévastés par les charpentiers de marine qui, lors de l’expédition espagnole contre Alger, en tirèrent toute une flottille de chaloupes canonnières. Les vexations auxquelles les propriétaires de ces bois furent soumis alors, et la mesquinerie des dédommagements qui leur furent donnés engagèrent les Majorquins à détruire leurs bois, au lieu de les augmenter. Aujourd’hui la végétation est encore si abondante et si belle, que le voyageur ne songe point à regretter le passé ; mais aujourd’hui comme alors, et à Majorque comme dans toute l’Espagne, l’abus est encore le premier de tous les pouvoirs. Cependant le voyageur n’entend jamais une plainte, parce qu’au commencement d’un régime injuste le faible se tait par crainte, et, quand le mal est fait, il se tait encore par habitude.
Quoique la tyrannie des assentistes ait disparu, le bétail ne s’est point relevé de sa ruine, et il ne s’en relèvera pas, tant que le droit d’exportation sera limité au commerce des pourceaux. On voit fort peu de bœufs et de vaches dans la plaine, aucunement dans la montagne. La viande est maigre et coriace. Les brebis sont de belle race, mais mal nourries et mal soignées ; les chèvres, qui sont de race africaine, ne donnent pas la dixième partie du lait que donnent les nôtres. L’engrais manque aux terres, et, malgré tous les éloges que les Majorquins donnent à leur manière de les cultiver, je crois que l’algue qu’ils emploient est un très maigre fumier, et que ces terres sont loin de rapporter ce qu’elles devraient produire sous un ciel aussi généreux. J’ai regardé attentivement ce blé si précieux que les habitants ne se croient pas dignes de le manger ; c’est absolument le même que nous cultivons dans nos provinces centrales, et que les paysans appellent blé blanc ou blé d’Espagne ; il est chez nous tout aussi beau, malgré la différence du climat. Celui de Majorque devrait avoir pourtant une supériorité marquée sur celui que nous disputons à nos hivers si rudes et à nos printemps si variables. Et pourtant notre agriculture est fort barbare aussi, et sous ce rapport nous avons tout à apprendre ; mais le cultivateur français a une persévérance et une énergie que le Majorquin mépriserait comme une agitation désordonnée.
La figue, l’olive, l’amande et l’orange viennent en abondance à Majorque ; cependant, faute de chemins dans l’intérieur de l’île, ce commerce est loin d’avoir l’extension et l’activité nécessaires. Cinq cents oranges se vendent sur place environ trois francs; mais, pour faire transporter à dos de mulet cette charge volumineuse du centre à la côte où on les embarque, il faut dépenser presque autant que la valeur première. Cette considération fait négliger la culture de l’oranger dans l’intérieur du pays. Ce n’est que dans la vallée de Sóller et dans le voisinage des criques, où nos petits bâtiments viennent charger, que ces arbres croissent en abondance. Pourtant ils réussiraient partout, et dans notre montagne de Valldemossa, une des plus froides régions de l’île, nous avions des citrons et des oranges magnifiques, quoique plus tardives que celles de Sóller. À la Granja, dans une autre région montagneuse, nous avons cueilli des limons gros comme la tête. Il me semble qu’à elle seule, l’île de Majorque pourrait entretenir de ces fruits exquis toute la France, au même prix que les détestables oranges que nous tirons d’Hyères et de la côte de Gênes. Ce commerce, tant vanté à Majorque, est donc, comme le reste, entravé par une négligence superbe. On peut en dire autant du produit immense des oliviers, qui sont certainement les plus beaux qu’il y ait au monde, et que les Majorquins, grâce aux traditions arabes, savent cultiver parfaitement. Malheureusement, ils ne savent en tirer qu’une huile rance et nauséeuse qui nous ferait horreur, et qu’ils ne pourront jamais exporter en abondance qu’en Espagne, où le goût de cette huile infecte règne également. Mais l’Espagne elle-même est très riche en oliviers, et, si Majorque lui fournit de l’huile, ce doit être à fort bas prix. Nous faisons une immense consommation d’huile d’olive en France, et nous l’avons fort mauvaise à un prix exorbitant. Si notre fabrication était connue à Majorque, et si Majorque avait des chemins, enfin si la navigation commerciale était réellement organisée dans cette direction, nous aurions l’huile d’olive beaucoup au-dessous de ce que nous la payons et nous l’aurions pure et abondante, quelle que fût la rigueur de l’hiver. Je sais bien que les industriels qui cultivent l’olivier de paix en France préfèrent de beaucoup vendre au poids de l’or quelques tonnes de ce précieux liquide que nos épiciers noient dans des foudres d’huile d’œillet et de colza, pour nous l’offrir au prix coûtant ; mais il serait étrange qu’on s’obstinât à disputer cette denrée à la rigueur du climat, si à vingt-quatre heures de chemin nous pouvions nous la procurer meilleure à bon marché. Que nos assentistes français ne s’effraient pourtant pas trop : nous promettrions au Majorquin, et je crois à l’Espagnol en général, de nous approvisionner chez eux et de décupler leur richesse, qu’ils ne changeraient rien à leur coutume. Ils méprisent si profondément l’amélioration qui vient de l’étranger, et surtout de la France, que je ne sais si pour de l’argent (cet argent que, cependant, ils ne méprisent pas en général), ils se résoudraient à changer quelque chose au procédé qu’ils tiennent de leurs père1.
Ne sachant ni engraisser les bœufs, ni utiliser la laine, ni traire les vaches – le Majorquin déteste le lait et le beurre autant qu’il méprise l’industrie –, ne sachant pas faire pousser assez de froment pour oser en manger, ne daignant guère cultiver le mûrier et recueillir la soie, ayant perdu l’art de la menuiserie autrefois très florissant chez lui et aujourd’hui complètement oublié, n’ayant pas de chevaux – l’Espagne s’empare maternellement de tous les poulains de Majorque pour ses armées, d’où il résulte que le pacifique Majorquin n’est pas si sot que de travailler pour alimenter la cavalerie du royaume –, ne jugeant pas nécessaire d’avoir une seule route, un seul sentier praticable dans toute son île, puisque le droit d’exportation est livré au caprice d’un gouvernement qui n’a pas le temps de s’occuper de si peu de chose, le Majorquin végétait et n’avait plus rien à faire qu’à dire son chapelet et rapiécer ses chausses, plus malades que celles de don Quichotte, son patron en misère et en fierté, lorsque le cochon est venu tout sauver. L’exportation de ce quadrupède a été permise, et l’ère nouvelle, l’ère du salut, a commencé. Les Majorquins nommeront ce siècle, dans les siècles futurs, l’âge du cochon, comme les musulmans comptent dans leur histoire l’âge de l’éléphant.
Maintenant, l’olive et la caroube ne jonchent plus le sol ; la figue du cactus ne sert plus de jouet aux enfants, et les mères de famille apprennent à économiser la fève et la patate. Le cochon ne permet plus de rien gaspiller, car le cochon ne laisse rien perdre, et il est le plus bel exemple de voracité généreuse, jointe à la simplicité des goûts et des mœurs, qu’on puisse offrir aux nations. Aussi jouit-il, à Majorque, des droits et des prérogatives qu’on n’avait point songé jusque-là à offrir aux hommes. Les habitations ont été élargies, aérées ; les fruits, qui pourrissaient sur la terre, ont été ramassés, triés et conservés, et la navigation à la vapeur, qu’on avait jugée superflue et déraisonnable, a été établie de l’île au continent. C’est donc grâce au cochon que j’ai visité l’île de Majorque ; car si j’avais eu la pensée d’y aller, il y a trois ans, le voyage, long et périlleux sur les caboteurs, m’y eût fait renoncer. Mais, à dater de l’exportation du cochon, la civilisation a commencé à pénétrer. On a acheté en Angleterre un joli petit steamer, qui n’est point de taille à lutter contre les vents du nord, si terribles dans ces parages, mais qui, lorsque le temps est serein, transporte une fois par semaine deux cents cochons et quelques passagers par-dessus le marché, à Barcelone. Il est beau de voir avec quels égards et quelle tendresse ces messieurs – je ne parle point des passagers – sont traités à bord, et avec quel amour on les dépose à terre. Le capitaine du steamer est un fort aimable homme, qui, à force de vivre et de causer avec ces nobles bêtes, a pris tout à fait leur cri et même un peu de leur désinvolture. Si un passager se plaint du bruit qu’ils font, le capitaine répond que c’est le son de l’or monnayé roulant sur le comptoir. Si quelque femme est assez bégueule pour remarquer l’infection répandue dans le navire, son mari est là pour lui répondre que l’argent ne sent point mauvais, et que, sans le cochon, il n’y aurait pour elle ni robe de soie, ni chapeau de France, ni mantille de Barcelone. Si quelqu’un a le mal de mer, qu’il n’essaie pas de réclamer le moindre soin des gens de l’équipage ; car les cochons aussi ont le mal de mer, et cette indisposition est, chez eux, accompagnée d’une langueur spleenétique et d’un dégoût de la vie qu’il faut combattre à tout prix. Alors, abjurant toute compassion et toute sympathie pour conserver l’existence à ses chers clients, le capitaine en personne, armé d’un fouet, se précipite au milieu d’eux, et derrière lui les matelots et les mousses, chacun saisissant ce qui lui tombe sous la main, qui une barre de fer, qui un bout de corde, en un instant toute la bande muette et couchée sur le flanc est fustigée d’une façon paternelle, obligée de se lever, de s’agiter, et de combattre par cette émotion violente l’influence funeste du roulis. Lorsque nous revînmes de Majorque à Barcelone, au mois de mars, il faisait une chaleur étouffante ; cependant, il ne nous fut point possible de mettre le pied sur le pont. Quand même nous eussions bravé le danger d’avoir les jambes avalées par quelque pourceau de mauvaise humeur, le capitaine ne nous eût point permis, sans doute, de les contrarier par notre présence. Ils se tinrent fort tranquilles pendant les premières heures ; mais, au milieu de la nuit, le pilote remarqua qu’ils avaient un sommeil bien morne, et qu’ils semblaient en proie à une noire mélancolie. Alors on leur administra le fouet, et régulièrement, à chaque quart d’heure, nous fûmes réveillés par des cris et des clameurs si épouvantables, d’une part la douleur et la rage des cochons fustigés, de l’autre les encouragements du capitaine à ses gens et les jurements que l’émulation inspirait à ceux-ci que plusieurs fois nous crûmes que le troupeau dévorait l’équipage. Quand nous eûmes jeté l’ancre, nous aspirions certainement à nous séparer d’une société aussi étrange, et j’avoue que celle des insulaires commençait à me peser presque autant que l’autre ; mais il ne nous fut permis de prendre l’air qu’après le débarquement des cochons. Nous eussions pu mourir dans nos chambres que personne ne s’en fût soucié, tant qu’il y avait un cochon à mettre à terre et à délivrer du roulis. Je ne crains point la mer ; mais quelqu’un de ma famille était dangereusement malade. La traversée, la mauvaise odeur et l’absence de sommeil n’avaient pas contribué à diminuer ses souffrances. Le capitaine n’avait eu d’autre attention pour nous que de nous prier de ne pas faire coucher notre malade dans le meilleur lit de la cabine, parce que, selon le préjugé espagnol, toute maladie est contagieuse ; et comme notre homme pensait déjà à faire brûler la couchette où reposait le malade, il désirait que ce fût la plus mauvaise. Nous le renvoyâmes à ses cochons, et quinze jours après, lorsque nous revenions en France sur le Phénicien, un magnifique bateau à vapeur de notre nation, nous comparions le dévouement du Français à l’hospitalité de l’Espagnol. Le capitaine d’el Mallorquin avait disputé un lit à un mourant ; le capitaine marseillais, ne trouvant pas notre malade assez bien couché, avait ôté les matelas de son propre lit pour les lui donner. Quand je voulus solder notre passage, le Français me fit observer que je lui donnais trop ; le Majorquin m’avait fait payer double. – D’où je ne conclus pas que l’homme soit exclusivement bon sur un coin de ce globe terraqué, ni exclusivement mauvais sur un autre coin. Le mal moral n’est, dans l’humanité, que le résultat du mal matériel. La souffrance engendre la peur, la méfiance, la fraude, la lutte dans tous les sens. L’Espagnol est ignorant et superstitieux ; par conséquent il croit à la contagion, il craint la maladie et la mort, il manque de foi et de charité. – Il est misérable et pressuré par l’impôt ; par conséquent, il est avide, égoïste, fourbe avec l’étranger. Dans l’histoire, nous voyons que là où il a pu être grand, il a montré que la grandeur était en lui ; mais il est homme, et dans la vie privée, là où l’homme doit succomber, il succombe. J’ai besoin de poser ceci en principe avant de parler des hommes tels qu’ils me sont apparus à Majorque, car aussi bien j’espère qu’on me tient quitte de parler davantage des olives, des vaches et des pourceaux. La longueur même de ce dernier article n’est pas de trop bon goût. J’en demande pardon à ceux qui pourraient s’en trouver personnellement blessés, et je prends maintenant mon récit au sérieux ; car je croyais n’avoir rien à faire ici, qu’à suivre M. Laurens pas à pas dans son Voyage d’art, et je vois que beaucoup de réflexions viendront m’assaillir malgré moi en repassant par la mémoire dans les âpres sentiers de Majorque.
Mais, puisque vous n’entendez rien à la peinture, me dira-t-on, que diable alliez-vous faire sur cette maudite galère ? – Je voudrais bien entretenir le lecteur le moins possible de moi et des miens ; cependant je serai forcé de dire souvent, en parlant de ce que j’ai vu à Majorque, moi et nous ; moi et nous, c’est la subjectivité accidentelle, sans laquelle l’objectivité majorquine ne se fût point révélée sous de certains aspects, sérieusement utiles peut-être à révéler maintenant au lecteur. Je prie donc ce dernier de regarder ici ma personnalité comme une chose toute passive, comme une lunette d’approche à travers laquelle il pourra regarder ce qui se passe en ces pays lointains desquels on dit volontiers avec le proverbe : J’aime mieux croire que d’y aller voir. Je le supplie en outre d’être bien persuadé que je n’ai pas la prétention de l’intéresser aux accidents qui me concernent. J’ai un but quelque peu philosophique en les retraçant ici, et, quand j’aurai formulé ma pensée à cet égard, on me rendra la justice de reconnaître qu’il n’y entre pas la moindre préoccupation de moi-même.
Je dirai donc sans façon à mon lecteur pourquoi j’allai dans cette galère, et le voici en deux mots : c’est que j’avais envie de voyager.
— Et, à mon tour, je ferai une question à mon lecteur : « Lorsque vous voyagez, cher lecteur, pourquoi voyagez-vous ? »
— Je vous entends d’ici me répondre ce que je répondrais à votre place : « Je voyage pour voyager. »
— Je sais bien que le voyage est un plaisir par lui-même, mais enfin, qui vous pousse à ce plaisir dispendieux, fatigant, périlleux parfois, et toujours semé de déceptions sans nombre ?