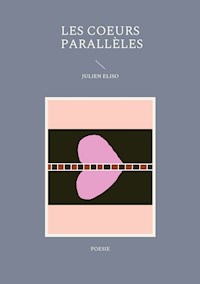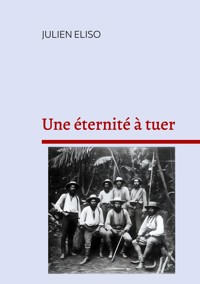
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Parti en Amazonie pour cartographier le territoire de la Guyane en 1874, Evan revient à Paris réellement transformé. Une nouvelle vie débute alors pour lui. Rien ne sera plus jamais comme avant et l'avenir lui réservera bien des tourments et des surprises, l'emmenant même, aussi étrange que cela puisse paraître, jusqu'au vingt-deuxième siècle en proie à une dictature technologique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité.
Sigmund Freud, Essais de Psychanalyse
L’immortalité est une idée sans avenir.
Albert Camus, Carnets
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Épilogue
Chapitre 1
Il ne me reste plus que peu de temps à vivre et c'est un soulagement.
Je m'appelle Evan Le Buec. Je suis né en 1846 à Brest pendant la Monarchie de Juillet, sous le règne de Louis-Philippe. J'ai été élevé dans un milieu modeste et aimant. Mon père était marin-pêcheur à son compte, patron de quelques matelots. Ma mère, quant à elle, pratiquait la couture pendant les longues absences de son mari. Elle veillait également au bien-être de ses cinq enfants. Je suis le benjamin de cette famille.
Nous vivions tous ensemble dans une maison aux murs blanchis à la chaux et aux volets bleus. Celle-ci se dressait sur une côte bordée de rochers qui formaient une muraille crénelée. Elle avait un jardin carré, un potager ainsi qu’un enclos où on élevait des cochons.
La ville de ma naissance a eu une influence déterminante sur ma vie entière car j'ai grandi dans le berceau de l'océan et j'ai contracté une passion immodérée pour tout ce qui a trait au domaine maritime et à la navigation en particulier.
J'habite désormais à Paris et au moment où je me prépare à vous raconter les moindres détails de ma vie si singulière, si étrange, nous sommes en 2122. Je sais que cela paraît impossible d’un point de vue physiologique sachant que tout Homme a une vie limitée dans le temps sur cette terre. En outre, à l'époque où j'ai vu le jour, il n'était pas possible de vivre aussi longtemps qu’aujourd'hui. En effet, désormais, la médecine a réussi à dépasser l’espérance de vie au-dessus des cinq cent cinquante ans.
Ne pensez pas que je suis atteint de névrose ou que je suis un être fantasque. Le récit que je me prépare à vous faire est authentique.
À partir de l'âge de 13 ans, mon père m'a appris tous les rudiments qui permettent de devenir un bon marin. Il m'emmenait souvent à son retour en pleine mer. Je dois dire que ses leçons étaient souvent assez rudes et âpres car, non seulement mon père avait une forte personnalité dure comme le sol granitique de la Bretagne, mais il voulait aussi faire de moi le digne héritier de ses connaissances maritimes. J'ai donc reçu une solide instruction allant dans ce sens. Et mon père a ressenti beaucoup de fierté lorsque j'ai intégré un lycée militaire et naval au cours de mon adolescence.
En 1867, pendant mes études, une rencontre a bouleversé ma vie sans que je n'en soupçonne rien à ce moment-là. J’en ai pris conscience quelques années plus tard, après la guerre franco-prussienne qui a ébranlé notre pays.
Un soir, je me suis rendu dans un estaminet du centre-ville de Brest et j'ai engagé la conversation avec un certain Jules Crevaux. Ce dernier m'a raconté qu'il étudiait à l'école de médecine navale non loin d’ici. Nous avons eu une longue discussion sur la situation de la France qui traversait de multiples crises. Nous avons aussi immanquablement parlé de la mer et des voyages ainsi que de nos ambitions respectives. En 1868, l’année d’après, je l'ai recroisé bon nombre de fois, le soir toujours, dans ce débit de boissons ou d'autres étudiants se mêlaient et échangeaient comme nous sur divers sujets.
Au cours d’une de ces soirées, pendant lesquelles nos esprits voguaient avec jubilation sur les vapeurs de l’alcool, il a sorti un document de sa poche; il s’agissait d’une carte maritime. Il m’a alors montré du doigt plusieurs zones sur celle-ci.
Il m'a dit, l’air à la fois déterminé et songeur :
« Je rêve de découvrir les habitants et les paysages de certains pays lointains. Je veux leur apporter une aide médicale, un peu de notre civilisation et apprendre de nouvelles mœurs. Je désire ardemment entretenir des relations bénéfiques et fructueuses avec eux. »
Ses discours relevaient d’une certaine philanthropie mais surtout d’un profond humanisme digne des Hommes de la Renaissance.
Je lui ai fait part de mon engouement :
« J'aimerais bien t’accompagner si l’occasion se présentait ou du moins en faire tout autant. Mon expérience dans la navigation et toute mon éducation m’y incitent. »
Nous nous sommes revus un jour et il m'a annoncé que ses études et ses diplômes lui offraient l’opportunité d’embarquer quinze jours plus tard, sur un navire qui accosterait en Afrique puis en Amérique du Sud.
Je l'ai beaucoup envié mais j'allais connaître le même sort car j’intègrerai bientôt l’équipage d’un bateau de commerce. Mon père m’avait recommandé pour ce voyage grâce à certaines de ses relations.
J’ai donc embarqué et traversé plusieurs mers ou océans. J'ai découvert notamment le pourtour de la Méditerranée, l'Afrique du Nord et l’océan Indien. Puis la guerre franco-allemande de 1870 m’a contraint, comme tous les jeunes de mon âge, à m'engager. Nous avons subi les conséquences de la volonté d'expansion de l'Empire prussien. J'ai été envoyé sur le front de l'Est, le pire.
Peu de temps après avoir été mobilisé, j'ai été blessé à la jambe, ce qui m'a valu de longs mois d'inertie jusqu'à ce que la gangrène me menace. Heureusement, je suis parvenu à m'en sortir. La France a cependant perdu certaines parties de son territoire avec la cession à la Prusse de l'Alsace et d’une partie de la Lorraine en 1871.
Trois ans plus tard, en 1874, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai retrouvé, alors que j’étais en fonction dans l’armée et les affaires étrangères, Jules Crevaux au sein de la division navale de l'Atlantique Sud ! Un des navires était en partance pour l'Amérique du Sud, précisément la Guyane. La mission consistait à explorer cette terre peu connue et à établir de nombreux repérages tant sur le plan de la cartographie que sur celui de l'anthropologie.
Parmi l'équipage, Jules s'est avancé vers moi, les yeux écarquillés de stupéfaction, et m’a dit :
«Salut l'ami ! Quelle joie de vous revoir ici! Cela va rendre le voyage et l'expédition des plus agréables. Je suis content d'avoir un ami à bord.
- C’est une grande joie de vous retrouver. Je ne vous lâcherai pas d'une semelle, ai-je répondu jovialement.
- Sachez que je suis ici en tant que médecin major, et vous ?
- Je suis quartier-maître.
- Si vous souffrez du voyage, je suis votre homme pour prendre soin de vous. Vous n'aurez qu'à demander… Je vais pouvoir assouvir ma passion pour l'Amérique du Sud. Il me reste tant de choses à voir, à apprendre. Il ne s’agit pas d'une simple mission : c’est la promesse d'un enrichissement culturel et personnel, dit-il avec feu.
- Je ne suis jamais allé là-bas, ai-je dit.
- Je connais pour ma part un peu le territoire. Je serai votre ange- gardien, comptez sur moi !
Le bateau a appareillé. La traversée de l'Atlantique a duré de longues semaines éprouvantes mais notre soif de curiosité nous conférait toute la force nécessaire pour surmonter toute difficulté. J'avais l'impression d'être dans l'équipage de Christophe Colomb en 1492 et cela me rappelait que Vincent Pinson avait découvert la Guyane en 1499.
À notre arrivée, j'ai dû superviser l'organisation des marchandises et la logistique puis remettre de l'ordre à bord du bateau en donnant des instructions à mes matelots. Je devais rejoindre Jules Crevaux quelques jours plus tard.
Mon ami représentait une aide précieuse sur le plan médical. Toute une suite d'hommes, de militaires ou de civils, ainsi que des guides se sont rendus au sud de Cayenne. Nous n’avions pour matériel que quelques chevaux, mulets, pirogues qui allaient nous permettre d'emprunter tout un réseau de rivières et de fleuves.
Nous avons très vite souffert de la chaleur et de l'humidité étouffante. Nos corps suintaient. Ce climat malsain de la Guyane est réputé pour avoir découragé toute exploration. Il fallait être fou pour accepter une telle expédition mais Crevaux avait été mandaté par Jules Ferry. Je sentais que rien ne ferait obstacle à sa volonté. Sa cadence était d'ailleurs rapide et difficile à soutenir. Il était habité par une volonté extraordinaire, aiguillée par une intense curiosité intellectuelle.
Nous l'avons suivi dans les impénétrables forêts hostiles guyanaises où l'on entendait divers animaux. Ceux-ci émettaient des cris parfois peu rassurants. Des singes hurleurs ou des toucans perçaient l’air de leurs sons stridents et répétés tout en demeurant invisibles. De nombreux moustiques, formant des nuées autour de nos visages en sueur, nous assaillaient sans relâche. Et nous avancions sur des cours d'eau difficilement praticables car des souches d'arbres nous barraient sans cesse la route. Nous nous sommes arrêtés au crépuscule sur des rives où, à coups de machette, nous avons dégagé des entrelacs de végétation qui laissaient à peine pénétrer la lumière dans la forêt.
À l'aide de ses instruments et de ses cartes très imprécises, Jules Crevaux consignait dans des carnets, des cahiers ou sur de grandes feuilles de papier, absolument toutes les données de ce territoire. Il avait les yeux constamment rivés sur sa boussole et d'anciennes cartes établies par des explorateurs du passé. De plus, des guides interprètes l’aidaient à réaliser de nouvelles topographies.
Un de nos objectifs était de délimiter un secteur afin d'en établir, au prix de longues journées de marche, ses frontières jusqu’alors peu précises.
Pour la plupart d'entre nous, une angoisse nous étreignait la gorge dans ce milieu vierge, à mille lieues de notre civilisation occidentale. La forêt, dense, épaisse, nous étouffait au sens propre comme au sens figuré. Nos vêtements étaient constamment trempés à cause du taux d’humidité. Le ciel disparaissait dans des cathédrales immenses de végétation constituées d'arbres séculaires, de fougères, de lianes, de mangroves, de bananiers, de cacaoyers, de digitales. Il y avait également des ficus, des palmiers des Bermudes, bref, un éventail incommensurable de spécimens d’arbres, de plantes et de fleurs.
Alors que nous progressions difficilement à travers des branchages sur lesquels se promenaient parfois des araignées, des iguanes ou des serpents, j'ai soudain ressenti une vive douleur, plus exactement une piqûre effroyable à la base du cou. Je souffrais énormément. J’ai tout de suite pensé à la morsure d’un reptile ou à celle d’une tarentule ou à la piqûre d’une sorte de taon. J'ai poussé un cri retentissant. Mes compagnons se sont retournés mais je suis resté stoïque malgré la persistance de cette douleur. J’ai simplement dit que je m’étais tordu le pied pour ne pas les alarmer, ce qui n’était pas très malin, je dois le dire.
Au bout de deux heures, j'ai passé la main sur ma nuque. Ma peau était boursouflée. Un œdème informe, que je sentais sous mes doigts, s’était formé. Je n’ai rien dit car je ne voulais pas ralentir la marche mais je commençais sérieusement à m'inquiéter. Et j'avais de plus en plus chaud. J’avais l’impression que mon sang cuisait et bouillait dans les moindres veines et artères de mon corps. J’avais une très forte fièvre. Mes jambes étaient très lourdes. Mon souffle difficile. Je mettais tout cela aveuglément sur le compte du climat équatorial dans le seul but de me rassurer.
Rapidement, j'ai eu des hallucinations. Je voyais des ombres et des multitudes d’insectes ou des animaux imaginaires. J’ai fini par tituber de plus en plus. Mes jambes flageolaient. Puis je suis tombé subitement, je me suis affalé de tout mon poids, au pied d’un énorme palétuvier, entouré de plantes grasses.
À moitié conscient, j'entendais la voix - qui me semblait très lointaine - de mon ami Jules Crevaux : « Tenez bon, mon vieux ! Je vais vous examiner attentivement. Ce n’est pas le moment de flancher ! » Il a confirmé que j'avais une forte fièvre et il a constaté que j’avais une étrange protubérance sur la nuque. Il faut savoir que Crevaux - c'est ce qu'il m'avait expliqué pendant la traversée de l’Atlantique - avait rédigé une thèse de doctorat sur les maladies liées aux forêts tropicales. C’était un spécialiste. Il avait eu l'occasion, plusieurs années auparavant, de soigner des autochtones et des résidents français sur plusieurs continents.
Mes camarades, sur les conseils de mon ami médecin, ont fabriqué une civière de fortune élaborée avec des branches et des feuilles épaisses. Un mulet avait pour fonction de tracter ce brancard très artisanal. J’entendais mes compagnons poser les questions suivantes avec anxiété : « Comment allons-nous le soigner ? Nous sommes très loin de tout. N'y aurait-il pas un village à proximité? »
Certains se sont ensuite exclamés en chœur : « sa peau est toute rouge, il a des boutons sur tout le corps ! »
Mes compagnons ont continué de marcher pendant un certain temps qui m'a paru une éternité. Je passais par des phases d'éveil et de somnolence proches du coma. On me donnait cependant à boire régulièrement et on m'avait recouvert d'un mélange de boue et de feuilles humides pour tenter de faire baisser et de maintenir ma température corporelle.
Un des guides indigènes s'est mis à pousser un cri strident dans la forêt. Ce jaillissement guttural a provoqué en moi un grand frisson. Je me suis évanoui complètement en l’entendant.
Lorsque j'ai rouvert les yeux, des indigènes que je ne connaissais pas, m'entouraient. Ils parlaient avec volubilité et tenaient un conciliabule mais leur langage m’était bien sûr incompréhensible. Ils répétaient sans cesse un même mot qui tout au long de leurs litanies : « Quelcotal ! »
Jules Crevaux a demandé à l'interprète ce que cela signifiait. Quelqu’un le lui a dit mais je n’ai rien pu en saisir. On m'a ensuite conduit dans une sorte de hutte car mes compatriotes avaient trouvé un village dans cette immense forêt. Les tribus vivaient là, reculées et dissimulées au cœur de la jungle.
Dans l'habitat sommaire, fait de boue séchée, de branches, de feuillage et de lianes, on me redressa en position assise. Ma tête tournait considérablement ; mes yeux étaient légèrement entrouverts.
Un indien, à la peau enduite de peintures rouges et noires sur le visage, a tendu dans ma direction une calebasse à l'intérieur de laquelle se trouvait un breuvage nauséabond qui ressemblait à une mélasse. Je n'ai pas pu saisir le récipient. On l’a donc porté à mes lèvres et je me suis efforcé de boire le contenu. J’ai rapidement recraché le peu que j'avais en bouche tant c'était répugnant, infect. Toutefois, sous les injonctions de mes compagnons, j'ai réussi à boire tout l’épais liquide en m’y reprenant à plusieurs fois, accompagné par les vifs encouragements des hommes autour de moi. Une fois terminé, mon cœur s’est soulevé à cause de l’amertume de ce breuvage. Au bout d'une demi-heure, je me suis de nouveau évanoui.