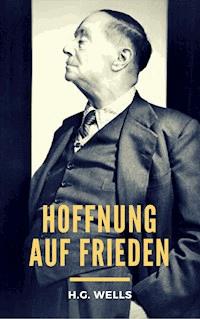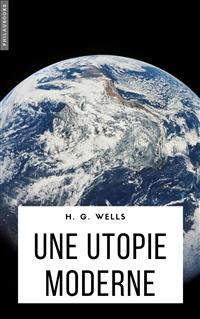
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans le présent ouvrage, j’ai tenté de solutionner divers problèmes négligés ou seulement posés dans les volumes précédents, de corriger quelques points de détail, et de tracer le tableau général d’une Utopie qui, au cours de ces spéculations, s’est dessinée dans mon esprit comme un état de choses à la fois possible et plus désirable que le monde dans lequel je vis.
Mais ce livre m’a ramené au style imaginatif. Dans les deux précédents, l’organisation sociale fut traitée d’une façon purement objective ; ici, mes ambitions ont été un peu plus vastes et un peu plus profondes, en ce que j’ai essayé de dépeindre non pas simplement un idéal, mais un idéal réagissant sur deux personnalités.
En outre, comme cette œuvre sera sans doute la dernière de ce genre que je publierai, j’y ai inclus, du mieux que j’ai pu, le scepticisme métaphysique et hérétique sur lequel repose toute ma pensée, et j’y ai adjoint certains commentaires critiques sur les méthodes habituelles de la science économique et sociologique.
H.G. Wells.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Une utopie moderne
Herbert George Wells
Traduction parHenry-D. Davray
Traduction parB. Kozakiewicz
Table des matières
Note pour le lecteur
Le possesseur de la voix
1. Considérations topographiques
2. Concernant les libertés
3. Lois économiques en utopie
4. La voix de la nature
5. Le déchet dans l'utopie moderne
6. Les femmes dans l'utopie moderne
7. Quelques impressions d’utopie
8. Mon semblable utopien
9. Le Samouraï
10. Les races en utopie
11. La bulle éclate
12. Appendice
Note pour le lecteur
Le présent volume, selon toute probabilité, termine la série d’écrits, dont, sans tenir compte de certains essais disparates, mes Anticipations furent le début.
Selon mon intention première, les Anticipations devaient être la seule excursion que je voulusse me permettre en dehors de mon art ou métier habituel, — appelez cela comme vous voudrez. J’ai rédigé ces dissertations afin de mettre, pour mon usage particulier, quelque clarté dans d’innombrables questions sociales et politiques, questions que je ne pouvais éviter d’aborder au cours de mes travaux, navré de les effleurer seulement d’une façon stupidement fortuite, d’autant plus que personne, si j’étais bien informé, ne les avait traitées de manière à satisfaire mes exigences. Cependant, mes Anticipations ne remplirent pas exactement le but que je m’étais proposé ; elles n’épuisèrent pas le sujet. Mes facultés cérébrales sont hésitantes et lentes, et, au sortir de mon entreprise, je m’aperçus que j’avais encore à exposer et à résoudre la plupart de ces questions.
Aussi, essayai-je, dans Mankind in the Making (l’Humanité en Formation), de passer en revue l’organisation sociale, de l’envisager cette fois comme un processus éducateur et non pas comme une chose comportant un avenir historique. Si, au point de vue littéraire, cet ouvrage est moins satisfaisant que le premier (et c’est mon avis), mes maladresses ont été, je pense, plus instructives, pour ce qui me concerne tout au moins. Je me risquai sur divers sujets avec une franchise plus grande que dans Anticipations, et si, à l’issue de ce second effort, j’avais perpétré un bon nombre de pages assez mal composées, mes opinions s’étaient considérablement développées et fixées. Sur bien des sujets, je m’étais enfin formé une certitude personnelle, sur laquelle je sais que je m’appuierai désormais.
Dans le présent ouvrage, j’ai tenté de solutionner divers problèmes négligés ou seulement posés dans les volumes précédents, de corriger quelques points de détail, et de tracer le tableau général d’une Utopie qui, au cours de ces spéculations, s’est dessinée dans mon esprit comme un état de choses à la fois possible et plus désirable que le monde dans lequel je vis. Mais ce livre m’a ramené au style imaginatif. Dans les deux précédents, l’organisation sociale fut traitée d’une façon purement objective ; ici, mes ambitions ont été un peu plus vastes et un peu plus profondes, en ce que j’ai essayé de dépeindre non pas simplement un idéal, mais un idéal réagissant sur deux personnalités. En outre, comme cette œuvre sera sans doute la dernière de ce genre que je publierai, j’y ai inclus, du mieux que j’ai pu, le scepticisme métaphysique et hérétique sur lequel repose toute ma pensée, et j’y ai adjoint certains commentaires critiques sur les méthodes habituelles de la science économique et sociologique.
Ces derniers mots, je le sais, n’attireront guère le lecteur volage. J’ai fait tous mes efforts pour rendre ce livre, dans son ensemble, aussi clair et aussi attrayant que le permet la matière dont il traite. Je veux qu’il agrée au plus grand nombre possible de lecteurs, mais je ne saurais promettre qu’irritation et dépit à celui qui se proposerait de jeter un coup d’œil, par-ci par-là, dans ces pages, pour s’assurer si nous sommes d’accord, qui commencerait ce volume par le milieu, ou qui n’apporterait pas à cette lecture une attention constamment en alerte. Si vous n’éprouvez déjà quelque curiosité éclairée pour les questions sociales et politiques, si vous n’êtes pas accoutumé déjà à peser et à examiner vos idées et vos opinions, vous ne prendrez, ici, ni intérêt ni plaisir. Si vous avez, sur de tels problèmes, des « convictions toutes faites », vous perdrez votre temps en lisant ces chapitres. Et si même vous êtes plein d’entrain et de bonne volonté, il vous faudra marquer quelque patience à l’égard de la méthode particulière que j’ai cette fois adoptée.
Cette méthode assume « un air de raccroc », mais elle n’est pas aussi capricieuse qu’elle le paraît. À présent même que le livre est terminé, elle me semble le meilleur moyen de parvenir à une sorte de lucidité vague, qui est le but que j’eus toujours en vue pour ce genre de sujet. J’ai tracé diverses ébauches d’un ouvrage utopique avant de m’arrêter à celle-ci. Tout d’abord, j’ai rejeté la forme de l’essai argumentatif, bien qu’elle séduise d’emblée ce qu’on dénomme le lecteur « sérieux », qui n’est souvent rien de plus que le parasite intolérablement solennel des grandes questions. Il aime que tout soit tracé en lignes épaisses et dures, noir sur blanc, que tout soit résolu par oui ou par non, parce qu’il n’imagine pas quelle quantité de choses il est impossible d’exposer de cette façon. Il refuse son attention à tout ce qui offre la moindre déviation, la moindre irrégularité, à tout ce qui révèle l’illimilable, à tout ce qui laisse soupçonner quelque trace d’humour ou de malice, à tout ce qui est exposé avec quelque complexité. Il semble mentalement édifié sur cette inébranlable assurance que l’Esprit Créateur ne sait pas compter plus loin que deux et qu’il procède seulement par alternatives. Je n’ai pas un instant songé à plaire ici à ce genre de lecteurs, car, même si je leur présentais mes cristaux tricliniques pour des systèmes de cubes... Non, vraiment, ce serait en pure perte !
Ayant donc renoncé à la forme de l’essai du genre sérieux, je passai plusieurs mois à chercher en tâtonnant le plan de mon livre. J’essayai la méthode connue d’envisager les questions à des points de vue divergents, méthode qui m’a toujours attiré, sans que j’aie jamais réussi à m’en servir, et qui donne le roman à controverse, avec l’ancienne forme du dialogue développée à la manière de Peacock, et à celle de Mr Mallock, aussi. Mais, il eût fallu m’encombrer de personnages superflus et compliquer inutilement l’intrigue. Ensuite, je songeai à une forme rappelant la double personnalité du Johnson de Boswell, une sorte de monologue avec son commentaire : c’était plus près de ce que je cherchais, mais sans y répondre encore précisément. Le lecteur expérimenté constatera que si certains éléments métaphysiques et spéculatifs avaient été omis, et si les incidents avaient été développés, ce livre aurait évidemment été réduit aux dimensions d’un simple récit. Mais je ne tenais pas, en cette occasion, à élaguer autant. Je ne vois pas pourquoi je me bornerais â alimenter complaisamment l’appétit vulgaire pour les histoires plus ou moins fantastiques ou romanesques. Bref, j’ai fini par produire ce livre tel qu’il est. Et je donne ces explications pour faire comprendre clairement au lecteur que, quelque bizarre qu’apparaisse mon œuvre au premier examen, elle est le résultat d’un effort laborieux et réfléchi, et qu’elle fut conçue pour être telle. D’un bout à l’autre, j’ai tissé une sorte d’étoffe bigarrée, de la soie gorge-de-pigeon, aux reflets changeants, en mélangeant la discussion philosophique à la narration imaginative.
H.-G. W.
Le possesseur de la voix
Il y a des ouvrages, et celui-ci en est un, qu’il vaut mieux commencer par un portrait de l’auteur, et pour obvier d’une méprise bien naturelle, c’est le seul parti à prendre. D’un bout à l’autre de ces payes tinte une note, une note distincte et personnelle, une note qui tend parfois à devenir stridente, et tout ce qui n’est pas, comme ce préambule, en italiques, est proféré pur une Voix. Or cette Voix, et c’est là la singularité du cas, ne doit pas être considérée comme la voix de l’auteur de ce livre. Débarrassez-vous de toute préconception à ce propos, et représentez-vous le Possesseur de la Voix comme un individu replet et pâlot, de taille et d’âge au-dessous de la moyenne, avec des yeux bleus comme en ont beaucoup d’Irlandais, des mouvements agiles, une légère calvitie en tonsure que couvrirait une pièce d’un penny. Son front est convexe. Ainsi que la plupart d’entre nous, il se courbe et bombe les épaules, mais, pour tout le reste, il se comporte aussi vaillamment qu’un moineau franc. À l’occasion, la main s’écarte dans un geste hésitant qui souligne une phrase. Sa voix, qui sera désormais notre truchement, a un timbre déplaisant de ténor et devient par instants agressive. Ceci convenu, imaginez-vous l’individu assis devant une table et lisant le manuscrit d’une dissertation sur les Utopies, un manuscrit qu’il tientdans ses deux mains un peu bouffies vers les poignets. C’est dans cette attitude qu’on le trouve au lever du rideau. El, si les procédés surannés de ce genre littéraire finissent par prévaloir, vous ferez avec lui de curieuses et intéressantes expériences. De temps à autre vous le verrez retourner à sa petite table, son manuscrit à la main, et reprendre consciencieusement ses ratiocinations concernant l’Utopie. La récréation qu’on vous offre ici n’est donc ni le drame savamment ourdi de l’œuvre d’imagination que vous avez accoutumé de lire, ni le sentencieux débit de la conférence que vous avez accoutumé d’éviter, elle est un composé hybride de ces deux formes. Si vous vous figurez le Possesseur de la Voix sur une estrade, assis un peu nerveusement, un peu modestement, devant une table, avec un verre d’eau et autres accessoires, et si vous consentez à voir simplement en moi le fâcheux président qui insiste avec une impitoyable cruauté sur l’importance des « quelques mots » d’introduction qu’il doit dire avant de disparaître dans les coulisses ; si, en outre, vous supposez, derrière notre ami, un rideau sur lequel apparaîtront par intermittence des scènes animées ; et si, finalement, vous admettez que son sujet soit la relation des aventures de son âme au milieu des recherches utopiques, vous serez prêt à surmonter quelques-unes, au moins, des difficultés de cet ouvrage sans grand mérite peut-être, mais assez original.
En face de l’écrivain ici présenté, se trouve un personnage terrestre qui ne parvient à affirmer sa personnalité qu’après une complication préalable que le lecteur voudra bien accepter. Ce personnage est mentionné sous la dénomination de « botaniste » et il est plus maigre, plus grand, plus grave que l’autre et beaucoup moins loquace. Il est blond clair, avec des yeux gris, un visage terne, d’une beautémalingre. Vous le soupçonneriez de dyspepsie, et le soupçon serait justifié. Les hommes appartenant à ce type, remarque le président dans un développement indiscret, sont chimériques avec une ombre de mesquinerie ; ils cherchent à dissimuler et à formuler à la fois leurs désirs sensuels sous des sentimentalités exagérées ; ils se créent des tracas et des déboires prodigieux avec les femmes, et le nôtre en eut sa part. On vous les racontera, car ils forment la caractéristique de son espèce. Jamais il ne prend en personne la parole dans ce livre ; la Voix que vous entendrez est toujours celle de l’autre, mais par les a-parte et les intonations vous saisirez beaucoup de la matière et quelque chose de la manière des interpolations du botaniste.
Cette esquisse est nécessaire pour présenter les explorateurs de l’Utopie Moderne arrière-plan devant lequel pirouetteront les deux enquêteurs. Un spectacle cinématographique, telle est la comparaison à retenir. Nos deux personnages se trémousseront dans le cercle projeté par une lanterne assez défectueuse : parfois l’appareil n’est plus au point et c’est alors une image brouillée et confuse, mais par instants il parvient à produire sur l’écran une silhouette, animée et passagère, de l’état de choses utopique. Quelquefois, l’image s’obscurcit entièrement, la Voix épilogue et discute, les lumières de la rampe reparaissent... Vous voici en train d’écouter les élucubrations du petit homme replet. Le rideau s’est levé.
Chapitre 1
Considérations topographiques
Les différences entre l’Utopie moderne et les Utopies anciennes. — Les Utopies statiques et l’Utopie cinétique. — Insuffisances des anciennes Utopies. — Nécessité d’un plan étendu. — L’Utopie, État Mondial. — La planète Utopie. — La descente des Alpes. — Une langue unique. — Collaboration avec l’Esprit créateur. — Critique des langues universelles. — Identité et divergences des deux planètes. — Les chagrins du botaniste.
§I
L’Utopie nouvelle qu’ébauche un rêveur moderne doit inévitablement différer, en un aspect essentiel, des Nulle-Part et des Utopies que les hommes ont échafaudées avant que Darwin eût accéléré la pensée du monde. Ces États imaginaires étaient parfaits et statiques, avec un équilibre de bonheur conquis à jamais sur les forces d’agitation et de désordre qui sont inhérentes aux choses humaines. On contemplait une simple et saine génération jouissant des fruits de la terre dans une atmosphère de vertu et de félicité et que devaient suivre d’autres générations vertueuses, heureuses, entièrement similaires, jusqu’à ce que les dieux se fussent lassés. Tout changement et tout développement étaient contenus à jamais derrière d’inébranlables digues.
L’Utopie moderne doit être non pas statique, mais cinétique ; elle ne peut pas prendre une forme immuable, mais elle doit nous apparaître comme une phase transitoire à laquelle succéderont une longue suite de phases qui la transformeront sans cesse. De nos jours nous ne résistons pas au grand courant des choses et nous ne l’enrayons pas, nous nous laissons plutôt porter par lui. Nous ne bâtissons plus de citadelles, mais des vaisseaux qui évoluent continuellement. Au lieu d’une organisation méthodique de citoyens jouissant d’une égalité de bonheur garantie et assurée à eux et à leurs enfants jusqu’à la Consommation des siècles, il nous faut établir « un compromis simple et élastique, dans lequel perpétuellement une succession d’individualités nouvelles tendent le plus efficacement vers un développement compréhensif et progressif ». Telle est la différence première et la plus générale qui doit exister entre une Utopie basée sur des conceptions modernes et toutes les Utopies qui furent écrites dans les temps révolus.
Notre tâche ici est d’être Utopien, d’animer, de rendre croyable, si nous le pouvons, une facette d’abord, puis une autre d’un monde imaginaire complet et heureux. Notre intention arrêtée est de montrer des choses non pas, en vérité, irréalisables, mais très certainement déconcertantes, en grimpant à toutes les échelles qui se dressent entre aujourd’hui et demain. Nous allons, pendant un moment, tourner le dos à l’obsédant examen de ce qui est et porter nos regards vers l’air plus libre, les espaces plus vastes de ce qui peut être, vers la conception d’un État ou d’une cité « qui en vaille la peine », vers la projection, sur l’écran de nos imaginations, du tableau d’une vie possible hypothétiquement et valant plus que la nôtre la peine d’être vécue. Telle est notre œuvre présente. Nous commencerons par émettre certaines propositions primordiales nécessaires, après quoi nous partirons explorer l’espèce de monde que ces propositions nous donnent...
C’est sans doute une entreprise optimiste. Mais il est bon d’être un instant délivré de la note critique qui devra se faire entendre quand nous discuterons nos imperfections actuelles ; il est bon de nous dégager des difficultés pratiques et de l’enchevêtrement des procédés et des moyens. Il est bon de s’arrêter au bord du sentier, de poser sac à terre, de s’éponger le front et de parler un peu des pentes supérieures de la montagne que nous voudrions escalader et que les arbres nous empêchent de voir.
Il n’y aura ici aucune recherche de système ni de méthode. C’est un divertissement de vacances que nous prendrons loin des politiques, des agitations et des programmes. Mais pourtant nous devons nous imposer certaines limitations. Si nous étions libres de divaguer sans entraves, nous suivrions, je crois, William Morris vers sa Nulle Part, nous changerions à la fois la nature de l’homme et la nature des choses ; nous ferions la race entière sage, tolérante, noble, parfaite ; nous acclamerions une anarchie splendide, chacun faisant ce qu’il lui plaît et nul ne se plaisant au mal, dans un monde essentiellement bon, aussi parfait et aussi ensoleillé que le Paradis avant la chute. Mais cet âge d’or, ce monde idéal est hors des conditions du temps et de l’espace. Dans le temps et dans l’espace, l’universelle Volonté de vivre soutient éternellement une perpétuité d’agressions.
Notre projet est basé sur un plan plus pratique au moins. Nous nous restreindrons d’abord aux limitations de la possibilité humaine telles que nous les connaissons aujourd’hui ; puis, nous aborderons toute l’inhumanité, toute l’insubordination de la nature. Nous ébaucherons notre État universel avec des saisons variables, des catastrophes soudaines, des maladies, des bêtes et des vermines hostiles, avec des hommes et des femmes aux passions, aux instabilités d’humeur et de désir semblables aux nôtres. En outre, nous accepterons ce monde de conflits, nous n’affecterons envers lui aucune altitude de renoncement, nous l’affronterons sans esprit ascétique, mais selon l’humeur des peuples occidentaux dont le but est de survivre et de triompher. Tout cela, nous l’adopterons à l’exemple de ceux qui ne s’occupent pas d’Utopies, mais de notre monde tel qu’il est à présent.
Cependant, selon les meilleurs précédents, nous prendrons certaines libertés avec les faits existants. Nous assumerons que le ton de la pensée pourra être entièrement différent de ce qu’il est dans le monde actuel. Nous nous permettrons un libre maniement du conflit mental de la vie, dans les limites des possibilités de l’esprit humain tel que nous le connaissons. Nous nous accorderons la même permission avec, tout l’organisme social que l’homme a, pour ainsi dire, fabriqué pour son usage : les maisons, les routes, les vêtements, les canaux, la machinerie, les lois, les frontières, les conventions et les traditions, les écoles, la littérature, les organisations religieuses, les croyances, les mœurs, tout ce que l’homme, en fait, a le pouvoir de transformer. Telle est, à vrai dire, l’hypothèse capitale de toutes les spéculations utopiques anciennes ou nouvelles ; la République et les Lois de Platon, l’Utopie de Sir Thomas More, l’Alturia implicite de Howells, la Boston future de Bellamy, la grande République Occidentale de Comte, la Contrée Libre de Hertzka, l’Icarie de Cabet et la Cité du Soleil de Campanella sont échafaudées, comme nous échafauderons notre Utopie, sur cette hypothèse de la complète émancipation d’une communauté d’hommes affranchis de la tradition, des habitudes, des liens légaux et de cette servitude plus subtile qu’implique toute possession. Une grande part de la valeur essentielle de ces spéculations réside en cette hypothèse d’émancipation, en ce respect de la liberté humaine, dans ce perpétuel besoin de notre nature, d’échapper à soi-même, dans cette faculté de résister à la causalité du passé, d’entreprendre, de persister et de vaincre.
§2
Il y a aussi certaines limitations artistiques très définies.
Inévitablement, les spéculations utopiques paraissent quelque peu arides et ténues. Leur défaut commun est d’être en général inertes. Ce qui est le sang, la chaleur, la réalité de la vie en est totalement absent : pas d’individualités, mais des individus généralisés. Dans presque toutes les Utopies, excepté peut-être les Nouvelles de Nulle-Part, de William Morris, on voit des édifices magnifiques, mais sans originalité, des cultures parfaites et symétriques, et une multitude de gens sains, heureux, superbement vêtus, mais sans aucun caractère distinctif personnel. Trop souvent l’image évoquée ressemble à la « clef » d’un de ces grands tableaux, représentant des couronnements, des mariages royaux, des parlements, des conférences, des assemblées, et qui furent si populaires sous le règne de Victoria ; dans cette « clef », chaque personnage est muni, au lieu d’un visage, d’un ovale où est inscrit lisiblement un numéro renvoyant à son nom sur une liste ad hoc. Ces rangées d’ovales nous imposent invinciblement une impression d’irréalité, et je ne vois pas du tout comment on pourrait y échapper. C’est un désavantage qu’il faut accepter. Toute institution qui a existé ou qui existe, si irrationnelle, si absurde qu’elle paraisse, possède, en vertu de son contact avec les individualités, une réalité et une rectitude qu’aucune chose non mise à l’épreuve ne peut avoir. Elle a mûri, elle a reçu le baptême du sang, elle a été patinée et assouplie par le maniement, elle a été arrondie et dentelée selon les contours adoucis que nous associons avec la vie ; elle a été ternie, peut-être, par une brume de larmes. Mais la chose qui est simplement proposée, qui est simplement suggérée, si rationnelle, si nécessaire soit-elle, semble étrange et inhumaine dans ses lignes claires, dures, inflexibles, avec ses surfaces et ses angles trop nets.
Il n’y a pas de remède. Le Maître en souffre comme le dernier et le moindre de ses successeurs. Malgré tout ce que confère d’humain le procédé dramatique du dialogue, je doute que quelqu’un ait jamais éprouvé le désir d’être un citoyen dans la République de Platon ; je me demande qui pourrait supporter pendant un mois l’implacable publicité de vertu imaginée par Sir Thomas More... Personne ne tient à vivre réellement dans une communauté de tous les instants, à moins que ce ne soit à cause des individualités qu’on y rencontrerait. Ce conflit fertilisant des individualités est l’objet même de la vie personnelle, et toutes nos utopies ne sont pas autre chose que des projets de perfectionnement de ces relations. Du moins, c’est ainsi que la vie apparaît de plus en plus aux intelligences modernes. Jusqu’à ce qu’interviennent les individualités, rien ne vient à la vie, et un Univers cesse quand se brise le miroir du moindre des esprits individuels.
§3
Le plan d’une Utopie moderne exige pour le moins une planète. Il fut un temps où une île, ou bien une vallée dans les montagnes, offraient un isolement suffisant pour qu’une organisation politique s’y maintînt sans être entamée par l’action des forces extérieures ; la République de Platon était en armes et prête a la défensive, la Nouvelle Atlantide et l’Utopie de More, en théorie, comme la Chine et le Japon pendant maints siècles de pratique effective, s’isolèrent de toute intrusion. Des exemples aussi récents que le satirique Erewhon, de Samuel Butler, et la contrée aux conditions sexuelles interverties, de Mr Stead, établirent, comme une règle simple et suffisante, la coutume tibétaine de mettre à mort le visiteur curieux. Mais la tendance de la pensée moderne s’oppose tout entière à la permanence de pareilles enceintes. On sait de nos jours d’une façon certaine que, si subtilement organisé que soit un État, l’épidémie, le barbare fécond ou les exigences économiques rassemblent leurs forces autour des frontières pour les renverser et les franchir. La marche rapide des inventions est toute en faveur de l’envahisseur. Actuellement peut-être, on pourrait garder une côte rocheuse ou défendre un étroit défilé. Mais qu’en adviendra-t-il dans ce proche demain, où la machine volante fendra les airs, libre de descendre au point qu’elle choisira ? Un État assez puissant pour rester isolé dans les conditions modernes, serait assez puissant pour gouverner le monde, ou, à vrai dire, s’il ne le gouvernait pas effectivement, il accorderait un consentement passif et indispensable à toutes les autres organisations humaines et serait ainsi responsable d’elles toutes. Il faut que ce soit un État mondial.
Nulle place, donc, pour une Utopie moderne, au centre de l’Afrique, dans l’Amérique du Sud, ou autour du pôle, ces derniers refuges de l’Idéalité. L’île flottante de la Cité Morellyste n’est plus d’aucun secours. Il nous faut une planète. Lord Erskine, auteur d’une Utopie (Armata) qui peut avoir été inspirée par Mr Hewins, fut, de tous les Utopistes, le premier à s’apercevoir de ce besoin : il joignit pôle à pôle, par une sorte de cordon ombilical, ses planètes jumelles. Mais l’imagination moderne, obsédée par la physique, doit se risquer plus loin.
Par delà Sirius, dans les profondeurs de l’espace, plus loin que la portée d’un projectile voyageant pendant un milliard d’années, plus loin que l’œil nu ne peut voir, scintille l’étoile qui est le soleil de notre Utopie. Pour ceux qui savent où regarder, aidant de bons yeux avec une puissante lorgnette, cet astre, avec trois autres apparemment groupés autour de lui (bien qu’ils soient distants de milliards de kilomètres), forme une vague tache de lumière. Autour de ce soleil tournent des planètes, semblables à nos planètes, mais accomplissant un destin différent, et, à sa place au milieu d’elles, se trouve Utopie avec sa sœur la Lune. C’est une planète identique à la nôtre, avec les mêmes continents, les mêmes îles, les mêmes mers et les mêmes océans ; un autre Fuji-Yama y dresse sa beauté au-dessus d’une autre Yokohama, un autre Matterhorn ysurplombe le glacier chaotique d’un autre Théodule. Cette planète est à tel point pareille à la nôtre qu’un botaniste y rencontrerait chacune des espèces terrestres, jusqu’à la moindre plante aquatique ou la plus rare fleur alpestre.
Pourtant, quand il aurait cueilli cette fleur et repris le chemin du retour, peut-être ne trouverait-il plus son auberge.
Supposons maintenant que deux d’entre nous fussent réellement exposés à cette surprise. Deux, dis-je, car, affronter une étrange planète, — fût-elle entièrement civilisée, — sans l’appui d’un compagnon familier serait trop exiger du courage même le plus assuré. Supposons que nous soyons en réalité transportés ainsi, tels que nous sommes. Figurez-vous que nous voilà grimpés dans une haute gorge des Alpes, et, bien que je ne sois pas botaniste moi-même, étant sujet au vertige dès que je me penche, je ne verrai certes rien à reprendre si mon compagnon porte en bandoulière une boite à spécimens, à condition toutefois qu’elle ne soit pas peinte de cet abominable vert-pomme si populaire en Suisse. Nous avons escalade, marché, botanisé ; nous nous sommes reposés et, assis parmi les rocs, nous avons dévoré notre déjeuner froid, vidé notre bouteille d’Yvorne, entamé une conversation sur le sujet des Utopies, et débité toutes ces propositions que je viens d’émettre. Je me vois moi-même sur ce petit col de la Passe Lucendro, sur l’épaulement du Piz où j’ai déjeuné jadis et bavardé agréablement. Nos regards s’étendent sur le Val Bedretto, tandis que Villa, Fontana et Airolo, essayent de se dissimuler à nos yeux dans les replis de la montagne, à douze cents mètres plus bas, verticalement. Avec cet absurde effet de proximité qu’on obtient dans les Alpes, nous apercevons le petit train, à vingt kilomètres de distance, descendant la Biaschina et roulant vers l’Italie. Le col du Lukmanier, au delà de Piora, à notre gauche, et celui de San Giacomo, à notre droite, apparaissent comme de simples sentiers sous nos pieds.
À ce moment, la lanterne projette sur l’écran ce panorama.
Et crac ! en un clin d’œil, nous voilà transportés dans cet autre monde.
C’est à peine si nous remarquons un changement. Pas un nuage n’a bougé au ciel. Peut-être la ville lointaine, au-dessous de nous, prend-elle un autre aspect que mon compagnon le botaniste distingue, habitué qu’il est à observer avec attention ; le train disparaît du tableau, et, dans les prairies d’Ambri-Piotta, le lit étroit et encaissé du Tessin est modifié, mais à cela se bornent les changements visibles. Pourtant, d’une façon obscure et vague, nous avons immédiatement conscience d’une différence dans les choses.
Cédant à une attraction subtile, les yeux du botaniste se portent sur Airolo.
C’est bizarre, — dit-il, d’un ton parfaitement indifférent, — mais je n’avais pas encore remarqué ce bâtiment là-bas à droite.
— Quel bâtiment ?
— Celui-là, adroite, avec cette drôle de chose.
— Ah ! oui, je vois ! En effet, c’est bien extraordinaire... énorme certes !... et superbe ! Je me demande...
Nous découvrons, ensuite, que les petites villes du bas sont transformées — mais de quelle façon ? Nous ne les avons pas, en les traversant, examinées assez minutieusement pour le savoir. L’impression est indéfinissable : un changement dans le caractère de leur groupement, de leurs petites formes lointaines.
Je balaie quelques mies de pain sur mou genou.
— C’est bizarre, — répété-je, pour la dixième ou onzième fois, en faisant mine de me relever.
Nous voilà debout, nous étirant, et, intrigués quelque peu, nous nous tournons vers le sentier qui dévale au milieu des rocs éboulés, contourne le lac tranquille et limpide, et descend jusqu’à l’Hospice du Saint-Gothard — en admettant que, par bonheur, nous retrouvions ce sentier.
Mais, longtemps avant de parvenir à l’Hospice, avant même de déboucher sur la grand-route, nous remarquons à de sûrs indices que le monde des hommes a subi de profondes transformations : la petite cabane de pierre, au creux du col, a disparu ou bien elle a singulièrement changé ; les chèvres sur les rochers, la hutte primitive près du pont de pierre, ne sont plus les mêmes.
Et bientôt, ahuris et ahurissants, nous rencontrons un homme, — pas un Suisse, — affublé de vêlements insolites et parlant un langage étrange.
§4
Avant la tombée de la nuit, nous sommes plongés dans la stupéfaction ; mais pourtant, nous le sommes bien davantage, quand mon compagnon, avec son éducation scientifique, fait la découverte la plus inattendue. Levant la tête, avec ce coup d’œil assuré de l’homme qui connaît les constellations jusqu’à la dernière des lettres de l’alphabet grec, il pousse une exclamation... que je vous laisse à deviner. Tout d’abord, il n’en croit pas ses yeux. Je lui demande la cause de son ébahissement, et il lui est difficile de l’expliquer. Il s’enquiert d’Orion, avec des manières un peu singulières. Je regarde à mon tour, et ne la trouve pas. Il s’informe de la Grande-Ourse, et elle a disparu.
— Où diable sont-elles passées ? — questionné-je, cherchant à les retrouver dans les multitudes étoilées, et lentement son ébahissement me gagne.
Alors, pour la première fois, nous comprenons, devant ce firmament devenu étranger, qu’un changement est survenu, — un changement que nous avons subi, nous, et non le monde, — et, que nous sommes échoués dans les plus extrêmes profondeurs de l’espace.
§5
Nous supposons qu’aucune difficulté linguistique n’intervient. Le monde entier parle une langue unique — c’est utopiquement élémentaire, — et puisque nous sommes délivrés des entraves de la vraisemblance du récit, nous supposons aussi que nous possédons assez cette langue pour la comprendre. Ce maudit obstacle du langage, cette expression hostile dans les yeux de l’étranger : « Sourd et muet pour vous, Monsieur, par conséquent votre ennemi, » est la toute première des défectuosités et des complications auxquelles nous échappons en fuyant la terre.
Mais quelle sorte de langage le monde parlerait-il, si le miracle de Babel était sur le point de se reproduire à l’envers ?
Si l’on me permet d’emprunter une image audacieuse, de prendre une liberté médiévale, je présumerai que, dans ce lieu solitaire, l’Esprit Créateur nous fait des confidences.
— Vous êtes des hommes sages, — déclare cet Esprit (et moi, être soupçonneux, susceptible, sérieux à l’excès malgré mes prédispositions à l’embonpoint, je flaire aussitôt l’ironie, tandis que mon compagnon se glorifie du compliment), — vous êtes des hommes sages, et c’est surtout pour la manifestation de votre sagesse que le monde a été créé. Vous avez la bonté de proposer l’accélération de cette multiple et ennuyeuse évolution à laquelle je travaille. J’en conviens, une langue universelle vous serait utile en l’occurrence. Or, tandis que je siège ici, au milieu de ces montagnes (voilà un ou deux éons que je les lime et les cisèle, simplement pour y faire surgir vos hôtels), voulez-vous avoir l’obligeance de m’aider...? Quelques indications ?... Quelques avis ? Quelques idées ?...
Alors l’Esprit Créateur sourit un moment, d’un sourire semblable à la brise qui dissipe les nuages. Toute la solitude de la montagne autour de nous est radieusement illuminée. Vous connaissez ces rapides instants où la chaleur et la clarté passent sur des endroits désolés et déserts ?
Après tout, pourquoi le sourire de l’Infini frapperait-il d’apathie deux hommes qui le contemplent ? Nous sommes là, avec nos caboches têtues, nos yeux, nos mains, nos pieds et nos cœurs robustes, et sinon nous ou les nôtres, du moins les infinies multitudes qui nous entourent ou que nous portons en germe dans nos reins verront enfin la réalisation de l’État mondial, d’une fraternité plus grande et dé la langue universelle. Dans la mesure de nos capacités, abordons celle question, sinon pour la résoudre, au moins pour essayer d’approcher du meilleur résultat possible. C’est là, en somme, notre but : imaginer le mieux et nous efforcer d’y atteindre, et ce serait une folie et une faute pires que la présomption que d’abandonner cet effort sous le prétexte que le meilleur de nos « mieux » parait mesquin au milieu des soleils.
Or, vous, en tant que botaniste, vous inclineriez, je pense, vers quelque chose de scientifique, comme on dit...
Vous sourcillez sous cette épithète offensante, et je vous accorde volontiers mon intelligente sympathie, bien que pseudo-scientifique et quasi-scientifique soient encore plus cuisants pour la peau. Vous vous mettez à parler de langues scientifiques, d’Espéranto, de Langue Bleue, de Nouveau Latin, de Volapük, de Lord Lytton, de la langue philosophique de l’archevêque Whateley, de l’ouvrage de Lady Welby sur les significations, que sais-je encore ? Vous me vantez la remarquable précision, les qualités encyclopédiques de la terminologie chimique, et, à ce mot de terminologie, j’insinue un commentaire sur un éminent biologiste américain, le professeur Mark Baldwin, qui a porté la langue biologique à de telles hauteurs de clarté expressive qu’elle, en est triomphalement et invinciblement illisible.
Vous affirmez votre idéal, vous demandez une langue scientifique, sans ambiguïté, aussi précise qu’une formule mathématique, où tous les termes ont entre eux des rapports logiques et exacts. Vous voulez une langue avec toutes les déclinaisons et conjugaisons strictement régulières, et toutes ses constructions rigoureusement fixes, avec chaque mot nettement distinct de l’autre, aussi bien en prononciation qu’en orthographe.
C’est là, en tous cas, l’espèce de langue qu’on entend réclamer partout, et il vaut la peine d’examiner ici ce postulat, quand ce ne serait que pour cette raison qu’il repose sur des implications qui dépassent de beaucoup le domaine du langage. Il implique, à vrai dire, presque tout ce que nous nous efforçons de répudier dans cet ouvrage particulier. Il implique que l’entière base intellectuelle de l’humanité est établie, que les règles de la logique, les systèmes de numération, de poids et de mesures, les catégories générales et les schémas de ressemblance et de différence sont fixés à jamais pour l’esprit humain — un morne Comtisme, en fait, de la plus morne espèce. Mais, en vérité, la science de la logique et la charpente entière de la pensée philosophique, telle que les hommes l’ont cultivée depuis Platon et Aristote, n’ont pas plus de permanence essentielle que le Grand Catéchisme Ecossais comme expression finale de l’esprit humain. Du milieu du gâchis de la pensée moderne, une philosophie depuis longtemps défunte ressuscite, comme un embryon aveugle et presque informe à qui bientôt viendront vue, forme, pouvoir, — une philosophie dans laquelle la précédente affirmation est niée1.
D’un bout à l’autre de cette excursion utopique, je dois vous en avertir, vous subirez la poussée et l’agitation de ce mouvement insurrectionnel. Cet « Unique », dont nous ferons un emploi fréquent, est l’embryon informe à qui viennent peu à peu des organes, des organes monstrueux peut-être, déjà il surgit de l’abîme et vous voyez les reflets de sa peau luisante, et l’affirmation persistante de l’individualité et de la différence individuelle comme signification de la vie, vous révèle la contexture de son corps. Rien ne dure, rien n’est précis ni certain, sinon l’esprit du pédant ; admettre la perfection c’est oublier cette inéluctable inexactitude marginale qui est la mystérieuse et intime qualité de l’Être. L’être, en vérité ? — Il n’y a pas d’être, mais un devenir universel d’individualités, et Platon a tourné le dos à la vérité, quand il s’est placé en face de son musée d’idéaux spécifiques. Heraclite, ce géant dédaigné et mal interprété, aura peut-être son tour...
Il n’y a rien d’immuable dans ce que nous connaissons. Nous passons d’une lueur plus faible à une lueur plus forte ; chaque clarté plus vive perce des fondations jusqu’ici opaques, et révèle, au-dessous, des opacités nouvelles et différentes. Nous ne pouvons jamais prédire laquelle de nos bases, assurées en apparence, sera affectée par le changement prochain. Quelle folie par conséquent de rêver de délimiter nos esprits en des mots, si généraux soient-ils, de fournir une terminologie et un idiome aux infinis mystères de l’avenir ! Nous suivons le filon, nous extrayons et accumulons notre trésor, mais qui peut dire quelle direction le filon va prendre ? Le langage est l’aliment de la pensée et il ne sert qu’autant qu’il subit l’action des forces métaboliques ; il devient pensée, il vit, et l’acte même de vivre entraîne sa mort. Vous autres, gens de science avec votre lubie de désirer une terrible exactitude de langage, des fondations indestructibles établies « jamais », vous êtes merveilleusement dénués d’imagination.
La langue d’Utopie sera, sans doute, une et indivisible ; dans la mesure des différences individuelles de qualité, toute l’humanité sera ramenée à la même phrase, à une résonance commune de pensée ; mais le moyen d’expression dont se serviront les humains sera toujours une langue vivante, un système animé d’imperfections, que chaque individu modifiera dans des proportions infinitésimales. Grâce à l’universelle liberté d’échange et de mouvement, la transformation continue de l’esprit général de cette langue sera une transformation mondiale : c’est là le caractère de son universalité. J’imagine que ce sera une langue unifiée, une synthèse de langues. L’anglais, par exemple, est un amalgame d’anglo-saxon, de franco-normand et de latin savant, formant un parler plus ample, plus puissant et plus beau que chacun de ses éléments constitutifs.
La langue utopique peut aussi bien présenter une unification plus vaste, et renfermer, dans le cadre d’un idiome sans flexions ou presque, — comme on en a l’exemple en anglais déjà, — un vocabulaire abondant, dans lequel auront été fondues une douzaine de langues autrefois séparées, superposées à présent et soudées les unes aux autres à travers des compromis bilingues et trilingues2. Naguère, des hommes ingénieux ont spéculé sur cette donnée : Quelle langue survivra ? — La question était mal posée. Je pense maintenant que cet amalgame de plusieurs langues et leur survivance en un rejeton commun est une hypothèse beaucoup plus probable.
§6
Cette causerie sur les langues n’en est pas moins une digression.
Nous suivions donc le vague sentier qui contourne le bord du lac de Lucendro, et nous étions sur le point de rencontrer notre premier Utopien. Il n’était pas Suisse, avons-nous dit. Cependant il l’aurait été sur terre ; ici, il a les mêmes traits, avec quelque modification peut-être dans l’expression ; le même physique, bien qu’un peu mieux développé, et le même teint. Il a des habitudes, des traditions, des connaissances, des idées différentes, des vêtements et accessoires différents, mais cependant c’est bien le même homme. Nous avons au début nettement stipulé que l’Utopie moderne devait être peuplée d’habitants identiques a ceux de ce monde.
Cette proposition renferme peut-être plus de choses qu’il n’apparaît au premier abord.
Elle fournit une opposition caractéristique entre l’Utopie moderne et celles qui l’ont précédée. Il s’agit d’une Utopie mondiale, pas moins, nous en avons convenu ; et il nous faut aussi affronter le fait que nous aurons des différences de race. Même dans la République de Platon, les classes inférieures n’étaient pas de races spécifiquement distinctes. Mais c’est ici une Utopie aussi vaste que la charité chrétienne, et les blancs et les noirs, les bruns, les rouges et les jaunes, toutes les teintes de peau, tous les types de corps et de caractère, s’y trouveront. Comment ajuster leurs différences, c’est la question maîtresse, et ce sujet ne sera même pas entamé ici.
Il nous faudra un chapitre entier pour jeter un simple coup d’œil sur la question. Mais soulignons cette stipulation : chacune des races vivant sur la planète Terre se retrouve sur notre planète utopique dans le plus strict parallélisme, avec les mêmes dénombrements, — seulement, comme je l’ai dit, avec un ensemble entièrement différent de traditions, d’idéaux, d’idées et de tendances, et se dirigeant sous des cieux différents vers une destinée tout à fait différente.
Il suit de là un curieux développement pour ceux qui sont convaincus de l’unité et de la signification une des individualités. Les races ne sont pas des amas nets et définis, ce ne sont pas des hordes de personnes identiquement similaires, mais des sous-races, des tribus, des familles rassemblées, chacune formant une unité, et chacune composée à son tour d’unités moindres et ainsi de suite jusqu’à l’individu seul. De sorte que notre première convention aboutit à ceci, que chaque montagne, plante, rivière, bête terrestre, si ; retrouve exactement dans cette planète parallèle par delà Sirius, de même que tout homme, femme et enfant vivant ici-bas, a un parallèle en Utopie. Naturellement et forcément, les destinées de ces deux planètes divergeront, désormais des hommes mourront ici que la sagesse utopienne préservera là-bas, et peut-être, inversement, en préserverons-nous ici d’autres. Des enfants naîtront à eux et non à nous, à nous et non à eux ; mais cet instant-ci, où vous lisez, est le moment du départ, et, pour la première et la dernière fois, les populations de nos planètes sont sur la même ligne.
Nous sommes obligés, à l’heure actuelle, d’avoir recours à une hypothèse de ce genre et à nulle autre. L’autre alternative est une Utopie de mannequins, de poupées ressemblant à des anges, avec des lois imaginaires s’adaptant à des gens invraisemblables, — en somme une entreprise sans intérêt.
Nous pouvons, par exemple, supposer qu’il existe, là-bas, un homme tel que j’aurais pu être, plus instruit, mieux cultivé, employant mieux ses facultés, plus svelte et plus actif (et je me demande ce qu’il fait !). Et vous, Monsieur ou Madame, vous avez là-bas votre double aussi, de même que tous les hommes et toutes les femmes que vous et moi connaissons. Je doute que nous les rencontrions jamais, ces doubles, et je ne sais si la rencontre serait agréable ; mais en descendant des montagnes désertes, vers les routes, les villages et les demeures du monde utopien, nous apercevrons certainement çà et là des visages qui nous rappelleront singulièrement des gens ayant vécu sous nos yeux.
Il y en a que vous désirez ne jamais rencontrer, dites-vous, et d’autres que vous reverriez avec plaisir.
— Il en est Une surtout... !
Chose étrange, ce type de botaniste ne veut pas tenir en place. Il a surgi entre nous, cher lecteur, comme un interlocuteur accidentel. Je ne sais ce qui me le mit en tête. À ce moment-là, j’étais d’humeur à vous affubler de la personnalité du bonhomme, afin de vous qualifier de cerveau scientifique—épithète offensante. Mais le voici indiscutablement avec moi en Utopie, et dégringolant de nos questions hautement spéculatives pour barboter dans des confidences entrecoupées, mais intimes.
Il déclare qu’il n’est pas venu en Utopie pour y retrouver ses chagrins.
Quels chagrins ?
Je proteste que je n’avais aucune intention de le faire intervenir, lui, avec ses chagrins.
C’est un homme de trente-neuf ans, je crois, dont la vie n’a été ni une tragédie, ni une aventure joyeuse. Dans ses contacts avec l’existence, sa figure a acquis une expression intéressante sans aucun caractère de force ni de noblesse. Il est quelque peu raffiné, avec, peut-être, une certaine expérience des menus déboires et des peines mesquines, et capable de tous les petits courages civils ; il a lu plus qu’il n’a souffert, et souffert plus qu’il n’a agi. Il me regarde avec ses yeux bleu-gris d’où s’est évanoui tout intérêt pour cette Utopie.
— C’est un tourment, — dit-il, — qui n’est entré dans ma vie que pour un mois ou deux, du moins d’une façon aiguë. Je croyais que tout était fini. Il y avait donc une jeune...
Cette banale affaire, cette histoire d’un cœur de banlieue vous cause quelque ébahissement quand on l’entend sur la crête d’une montagne en Utopie. Il l’avait connue avant d’avoir sa nomination de professeur, et ni ses parents ni ceux de la jeune fille n’approuvaient leur amour.
— Elle se laissait, je crois, assez facilement influencer, — dit-il. — Mais je suis peut-être injuste à son égard. Elle pensait trop aux autres. S’ils avaient l’air peiné, s’ils jugeaient meilleure telle façon d’agir...
Suis-je venu en Utopie pour entendre ces balivernes ?
§7
Il est nécessaire de diriger les pensées du botaniste dans une voie plus digne, et de repousser ses modestes regrets, sa mesquine et importune histoire d’amour. Se rend-il compte que nous sommes réellement en Utopie ?
— Tournez votre esprit vers cette Utopie que je vous découvre et laissez à leur planète originelle ces tourments terrestres. Comprenez-vous jusqu’où nous entraînent les propositions fondamentales d’une Utopie moderne ? Tous les personnages de la terre doivent immanquablement s’y trouver tous, mais avec une différence. On y rencontre, par exemple, M. Chamberlain, le Roi (sans doute incognito), tous les peintres de l’Académie Royale, Sandow, etc.
Mais ces noms fameux ne disent rien au botaniste.
Mon esprit va de l’une à l’autre de ces éminentes et typiques personnalités, et pendant un moment j’oublie mon compagnon. Je suis distrait par les curieux « à côté » que cette proposition générale entraîne. Il y aura un tel et un tel. Le nom et la personne de M.Roosevelt occupe l’objectif et oblitère un essai d’acclimatation de l’Empereur d’Allemagne. Que fera, par exemple, de M. Roosevelt notre Utopie ? À travers ma vision, se glisse l’image d’une lutte ardente entre lui et les policiers Utopiens. J’entends sa voix, cette voix qui, par ses protestations éloquentes, a soulevé des millions d’êtres terrestres. Un mandat d’arrêt, s’échappant dans le conflit, vient tomber à mes pieds ; je ramasse la feuille et je lis — mais est-ce possible ?
« ... S’est rendu coupable de discours séditieux, de provocations au suicide de la race, d’excitations à bouleverser l’équilibre de la population ? » Un excès de logique nous a, pour cette fois, entraînés à des fantaisies caricaturales. On pourrait continuer sur ce ton, et écrire une agréable petite Utopie qui, comme les Saintes Familles des Primitifs, ou le Jugement Dernier de Michel-Ange, reproduirait les portraits diversement flattés de nos amis. On pourrait aussi traiter dans la même manière tout l’Almanach de Gotha, et obtenir quelque chose dans le genre de la vision des grands damnés qu’eut Epistemon, alors que « Xerxès était crieur de moutarde, Romulus salinier et ravaudeur de socques ». Quel incomparable catalogue ! Inspirés par la Muse de la Parodie, nous pourrions continuer avec les pages du « Who's Who » anglais, et même le Tout-Paris, attaquer le « Who's Who » américain, et procéder aux plus drolatiques et aux plus vastes combinaisons. Allons, où mettons-nous cet excellent homme ? Que faisons-nous de celui-ci ? De celui-là ?
Mais il est peu probable que nous rencontrions les doublures d’aucun de ces personnages, au cours de notre excursion en Utopie, ou que nous les reconnaissions s’il nous arrivait de les rencontrer. Je doute que sur la planète utopienne les doublures des grands personnages terrestres occupent des situations correspondantes. Les grands hommes de cette Utopie encore inexplorée peuvent n’être dans notre monde que des sots de village, tandis que des chevriers terrestres ou d’obscurs illettrés trôneront là-bas dans les sièges des grands.
Voilà encore de tous côtés d’agréables perspectives.
Mais mon botaniste impose de nouveau sa personnalité. Ses pensées ont voyagé par d’autres chemins.
— Je sais, — dit-il, — qu’elle sera plus heureuse ici, et qu’elle sera mieux appréciée qu’elle ne le fut sur terre.
Cette interruption a pour effet de me détourner de ma rêverie momentanée sur les grands de la terre, ces mannequins populaires boursouflés par les journaux et la rumeur publique. Elle m’amène à penser à des applications plus personnelles et plus intimes, aux êtres humains que je connais avec une certaine approximation, à ce qui fait la base essentielle et commune de la vie. Elle évoque devant moi les rivalités et les tendresses, les querelles et les désappointements. Je me heurte péniblement contre les choses qui auraient pu être. Que faire si, au lieu d’ovales vides, nous rencontrons ici les amours renouées, les occasions perdues et les visages tels qu’ils auraient pu nous apparaître ?
Je me tourne vers mon botaniste avec presque un air de reproche.
— Mettez-vous bien en tête qu’ici elle ne sera pas du tout telle que vous l’avez connue à Frognal, — dis-je, et, pour me débarrasser d’un sujet qui a cessé d’être agréable, je me lève.
— D’ailleurs, — ajouté-je, debout, — il y a un million de chances contre une pour que nous ne la rencontrions pas... Mais nous batifolons ! Ceci n’est pas l’affaire que nous poursuivons, mais un simple incident dans un plus vaste plan. Le fait reste, que les gens que nous sommes venus voir ont des infirmités comme nous, les conditions seules sont changées. Poursuivons le cours de notre enquête.
Sur ces mots, je m’achemine par le bord du lac de Lucendro vers notre monde Utopien.
Nous descendons la montagne par le col, et à mesure que les vallées se découvrent, cette Utopie se déploie, où hommes et femmes sont heureux, où les lois sont sages, et où tout ce qui est enchevêtré et confus dans les affaires humaines a été débrouillé et redressé.
1Le lecteur sérieux peut à loisir se référer aux ouvrages suivants ; Use of Words in Reasoning, de Sidgwiek ; Essentials of Logic, de Bosanquet ; Principles of Logic, de Bradley ; Logik, de Sigwart. Le lecteur d'esprit moins technique peut lire l'article Logic, du Professeur Case, dans l'Encyclopédie Britannique, vol. XXX. J'ai ajouté en appendice, à ce volume, une esquisse philosophique qui fut d'abord lue devant l'Oxford Phil.Soc. en 1903.
2Voir un excellent article : la Langue française en l'an 2003, par Léon Bellak, dans la Revue, 15 juillet 1993.
Chapitre 2
Concernant les libertés
La liberté individuelle. — Sécurité, prohibitions et restrictions. — Solitude et sociabilité. — Déplacements et voyages. — Moyens de transport. — Population nomade. — Facteurs nouveaux. — Distribution de la population. — Le roman d’amour du botaniste. — Transports maritimes et aériens. — La morale personnelle. — Le contrôle de l’État. — L’usage des boissons.
§1
Quelle sorte de question se présenterait d’abord à l’esprit de deux hommes abordant sur la planète de l’Utopie Moderne ? Probablement de graves soucis à propos de leur liberté personnelle. Envers l’étranger, comme je l’ai déjà remarqué, les Utopies de jadis manifestaient une attitude des moins aimables. Notre nouveau genre d’État utopien, élargi jusqu’aux dimensions d’un monde, leur témoignerait-il autant d’aversion ?
Nous serions rassurés en pensant que la tolérance universelle est certainement une idée moderne ; or, c’est sur des idées modernes que cet État mondial est basé. Mais en supposant même que nous soyons tolérés, et même admis à l’inévitable dignité de citoyen, il reste encore une vaste série de possibilités... Il faut, je crois, essayer de résoudre le problème par la recherche des premiers principes ; il faut suivre l’impulsion de notre temps et de notre race en envisageant la question comme procédant de « l’individu contre l’État », et en discutant le compromis de la Liberté.
L’idée de la liberté individuelle croit en importance à chaque développement de la pensée moderne. Pour les Utopistes classiques, la liberté était relativement sans valeur. Ils considéraient la vertu et le bonheur comme entièrement séparables de la liberté et comme extrêmement plus importants. Mais le point de vue moderne, en insistant avec plus d’énergie sur l’individualité et la signification de son caractère unique, intensifie constamment la valeur de la liberté, jusqu’à ce qu’enfin nous commencions à voir que la liberté est la substance même de la vie, qu’elle est, en réalité, la vie, et que seules les choses inanimées, les choses qui n’ont pas à choisir, vivent dans une soumission absolue à la loi. Avoir libre jeu pour son individualité est, au point de vue moderne, le triomphe subjectif de l’existence, comme la survivance dans l’œuvre créée et dans la progéniture est son triomphe objectif. Mais pour tous les hommes, puisque l’homme est une créature sociale, le jeu de la volonté ne peut pas correspondre à la liberté absolue. Une parfaite liberté humaine n’est possible qu’à un despote qui est absolument et universellement obéi. Donc, vouloir devrait correspondre à ordonner et agir, et, dans les limites de la loi naturelle, nous pourrions à tout moment faire exactement ce qui nous plaît. Toute autre liberté est un compromis entre notre propre liberté de vouloir et les volontés de ceux avec qui nous venons en contact. Dans un État organisé, chacun de nous possède un code plus ou moins complexe de ce qu’il peut faire aux autres et à lui-même, et de ce que les autres peuvent lui faire. Il limite les autres par ses droits et il est limité par les droits des autres et par des considérations affectant le bien-être de la communauté dans son entier.
La liberté individuelle, dans une communauté, n’est pas toujours, comme diraient les mathématiciens, du même signe. L’ignorer est l’erreur essentielle du culte appelé individualisme. En vérité, une prohibition générale dans un État peut accroître la somme de liberté, et une autorisation générale peut la diminuer. Il ne s’ensuit pas, comme on voudrait nous le faire croire, qu’un homme est plus libre là où il y a moins de lois et plus asservi là où il y en a davantage. Un socialisme ou un communisme n’est pas nécessairement l’esclavage, et il n’y a aucune liberté sous l’Anarchie. Considérez quelle somme de liberté nous gagnerons par la perte de la commune liberté de tuer. Dès lors, on pourra aller et venir dans toutes les parties policées du monde, sans s’encombrer d’armes et d’armures, exempt de la crainte du poison, des barbiers capricieux et des chausses-trappes d’hôtel : en réalité, mille craintes et mille précautions disparaissent. Supposez seulement qu’existe la liberté limitée de tuer par vengeance, et pensez à ce qui arriverait dans nos banlieues, aux inconvénients de deux maisonnées, hostiles et pourvues d’armes de précision ; considérez non seulement leurs désagréments réciproques, mais le danger qu’elles présenteraient pour le piéton neutre, en supprimant pratiquement toute liberté autour d’elles. Le boucher, s’il s’y risquait, devrait venir prendre la commande dans une voilure blindée...
Il s’ensuit que, dans une Utopie moderne qui place l’espoir final du monde dans un commerce évoluant d’individualités uniques, l’État aura raboté efficacement ces libertés dissipatrices qui gâtent la Liberté, celles-là exactement, et pas une de plus, et sera parvenu au maximum de liberté générale.