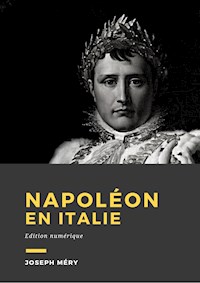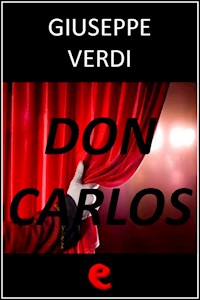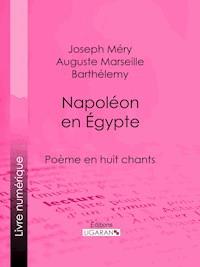Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Sylvain, le valet de chambre, entra dans l'herbier d'Urbain Andrivet, et dit : — La voiture de monsieur le comte est avancée. C'était un Frontin moderne, un jeune homme de trente ans, à la démarche grave, à l'œil vert, au regard louche ; il tenait à la main un journal qu'il se remit à lire, après avoir fait son annonce promptement et en donnant le titre de comte à son maître."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autrefois, les longs ouvrages faisaient peur, comme nous le dit La Fontaine. Nous revenons au goût d’autrefois : le volume isolé prend crédit ; l’élixir triomphe du délayage. Nous sourions à ce progrès, et nous nous résignons volontiers à sa loi. Quel bonheur de suivre la mode quand la raison est à la mode !
Je tiens dans la main quatre vérités un peu crues, et fort scabreuses ; je crois du moins que ce sont des vérités ; excusez-moi, si je me trompe. Il me faut un volume par vérité. J’ai donné au public la première dans Monsieur Auguste, livre qui a fait son chemin, sans bruit, comme toute vérité reléguée pour cause de scrupule au fond d’un puits artésien. Deux éditions épuisées, en six mois, semblent pourtant prouver que ce livre a été compris.
J’ouvre la main pour donner le vol à la seconde vérité, dans ce nouveau volume URSULE. Quand je serai à quatre, je rentrerai dans le paradoxe, mon élément naturel ; je ferai battre encore, dans de nouveaux romans, les Anglais avec les Chinois, les Anglais avec les Indiens insurgés, comme j’ai fait autrefois, de 1840 à 1845, ce qui m’a valu tant de cris, au Paradoxe ! Car, me disait-on, les Chinois et les Indiens doivent vivre éternellement en frères avec les Anglais. Paradoxe !
Le sujet de ce nouveau livre, Ursule, est pourtant vieux comme le monde ; l’Évangile lui consacre un chapitre admirable et tous les auteurs profanes l’ont traité avec plus ou moins de bonheur.
L’ADULTÈRE, puisqu’il faut l’appeler par son nom, a fourni prétexte à tous les moralistes du livre et du théâtre. Ce crime a été flétri par quelques-uns, enjolivé par les autres, et il a toujours fourni matière à force épigrammes, quolibets, chansons, comédies. Il paraît que ce crime a un côté fort plaisant. Molière ne lui a jamais donné son vrai nom. La Fontaine a fait une comédie, la Coupe enchantée, dans laquelle il démontre que le titre plaisant prodigué par Molière doit être donné, comme surnom comique, à tous les maris sans exception.
A-t-on fait rire au théâtre, aux dépens de ces pauvres maris ! La comédie a-t-elle assez abusé de son privilège de châtier les mœurs en riant ! les dramaturges ont essayé de mettre un peu de noir dans l’adultère en faisant poignarder la femme coupable par un mari vengeur. Leçon !
La leçon n’a corrigé personne ; le crime a fleuri, et le poignard a disparu de nos mœurs et de nos armuriers.
Telle est la définition de l’adultère, au point de vue du vaudeville, œuvre du Français né malin ; cette maxime a généralement prévalu. Ô maris ! sachez ignorer votre sort, Ce n’est rien !
Ah ! ce n’est rien ! Examinons la question sous un point de vue nouveau et sérieux, examinons ce rien, malgré le proverbe antique de Lucrèce de nihilo nihil.
Sylvain, le valet de chambre, entra dans l’herbier d’Urbain Andrivet, et dit :
– La voiture de monsieur le comte est avancée.
C’était un Frontin moderne, un jeune homme de trente ans, à la démarche grave, à l’œil vert, au regard louche ; il tenait à la main un journal qu’il se remit à lire, après avoir fait son annonce promptement et en donnant le titre de comte à son maître.
Urbain eut l’air de ne pas entendre, et continua d’examiner une tige d’hibiscus, vrai phénomène de floraison.
Comme il contemplait ce phénomène, une jeune femme entra, fit un léger haussement d’épaules et s’assit.
Après un moment de silence, elle dit :
– Je suis là.
Urbain se retourna vivement et répondit :
– Ah ! chère amie, je suis à toi dans l’instant… nous allons partir… Es-tu curieuse de voir ceci ?… une magnificence végétale que j’ai reçue du jardin zoologique de Ceylan…
– Si nous tardons encore, reprit la jeune femme, la chaleur sera plus forte, et…
– Nous partons, interrompit Urbain, en arrangeant ses fleurs empaillées, nous partons… C’est égal, les Chinois sont plus forts que nous en agriculture !… Pourquoi le gouvernement ne place-t-il pas deux Chinois fleuristes au Jardin des plantes ?… Nous partons, Ursule… Ah ! un instant… laisse-moi serrer la médaille que M. Dieffenbach m’a envoyée de Friedberg… Est-ce beau !… un module de cette dimension !… Auguste fermant le temple de Janus !… presque aussi rare qu’un Othon-grand-bronze !…
– Nous manquerons le convoi ! interrompit Ursule sur le ton de l’impatience.
Cette réflexion menaçante, inconnue de nos pères, produit toujours son effet sur les indolents et les retardataires de profession. Urbain suivit sa femme d’un pas leste ; on ne perdit plus une minute ; la voiture se dirigea au vol vers la gare du Nord.
Urbain et Ursule comptaient quatre ans de mariage.
– En voilà deux qui ont inventé le bonheur ! avait-on dit dans le monde à leur première apparition.
Ils avaient, en effet, tous les éléments de la vie heureuse. Urbain était un jeune mari complètement dépourvu de défauts. Sa figure fraîche, ronde, sereine, annonçait l’absence de toute mauvaise passion, comme la blanche pleine lune d’été promet un quartier d’azur et d’or. Ses yeux d’un bleu clair et tranquille ne donnaient jamais une étincelle d’animation ; le calme intérieur se reflétait toujours dans leur nuance immuable. Les goûts simples remplaçaient chez lui les passions actives ; il aimait l’étude de la philosophie, l’art numismatique, la chimie et la botanique, toutes choses qui se concilient si bien avec l’humeur sédentaire et l’affection pour le toit domestique. Une grande fortune lui permettait de consacrer à ses études et à ses collections des dépenses assez considérables, mais réglées avec discernement par un sage esprit d’économie. Sa belle-mère, femme d’expérience parisienne, disait de lui :
– Ah ! que je serai heureuse le jour où je découvrirai un défaut chez Urbain !
Ursule, sa femme, a vingt-quatre ans en 1855. Ce n’est pas une de ces belles personnes qu’on admire au théâtre et dans les bals publics, et qui servent de point de mire aux lorgnettes et aux doigts indicateurs ; elle n’a aucun éclat bruyant sur sa figure ni sur sa toilette : sa grâce et ses charmes ne se révèlent que dans le demi-jour du salon, lorsqu’elle a quitté son chapeau, sa mantille ou son châle ; et que rien ne dérobe ses beaux cheveux noirs, l’ovale pur de son front, la fraîcheur de son teint, le calme virginal de ses yeux, la souplesse ouatée de son col, les limites savoureuses de ses épaules, la perfection de son corsage, la finesse de sa taille et tout ce qu’on devine dans l’invisible, par une règle de proportion que font si aisément les mathématiciens de la forme et les connaisseurs en beauté.
Quant au caractère d’Ursule, il se dessinera plus tard en paroles et en actions.
La voiture conduisit les deux jeunes époux à la gare du Nord. Urbain prit deux billets de wagons pour la station d’Enghien.
Peu d’instants après, le coup de sifflet du départ se fit entendre, et la locomotive prit le galop.
Six compagnons de promenade, surnommés pompeusement VOYAGEURS de Paris par les préposés des stations de banlieue, complétèrent le personnel du wagon. Trois de ces voyageurs, ne pouvant supporter le poids de leur pensée jusqu’au lac d’Enghien, s’endormirent profondément. Un autre prit un journal et fit semblant de lire ; les deux autres causèrent de la rente et de la chaleur. Urbain, perverti ou magnétisé par le voisinage, s’endormit pour faire le quatuor.
Ursule regardait ces hommes avec des yeux pleins de tristesse, et personne ne la regardait.
Les deux causeurs changèrent de sujet à la station de Saint-Denis ; ils parlèrent des infiltrations souterraines qui s’étendent aux caves des maisons voisines du lac d’Enghien, et causent de grands ravages.
– Y a-t-il un remède à cet inconvénient ? demanda le plus jeune.
– Sans doute, répondit l’autre ; un remède fort simple, mais un peu cher : il faut faire recrépir les murs et le plancher avec de la pozzolane. Je m’en suis servi, et je m’en trouve fort bien.
– Vous dites… de la poso… ?
– Pozzolane, pozzolano… En français, pozzolane ; c’est un nom italien.
– Je vais récrire sur mon agenda… Où trouve-t-on ça ?
– Quai de Valmy… n°… n°… j’ai oublié le numéro… ; mais on ne peut pas se tromper, il y a sur le mur extérieur : Dépôt de pozzolane d’Italie.
– En faut-il beaucoup ?
– Oui, si l’infiltration est considérable. En tout état de choses, consultez mon maçon… Jean Isnard… un honnête homme… Je vous l’enverrai.
– Oui, envoyez-le-moi entre quatre et cinq.
Les deux causeurs cherchèrent un autre sujet de conversation pour tuer les trois minutes qui les séparaient encore de la station ; mais, n’ayant rien trouvé, ils alternèrent sur tous les tons ce refrain :
– Ah ! qu’il fait chaud !
Deux larmes mouillèrent les joues d’Ursule. Elle voyait la colline de Montmorency et sa forêt verte, un vaste paysage couronné par l’azur du ciel, une fête que Dieu donnait à la nature, et pour spectateurs trois hommes et son mari endormis dans les compartiments du wagon, et deux aimables causeurs s’entretenant des infiltrations du lac. C’était bien triste !
Au cri d’Enghien ! poussé avec un la-bémol par le ténor de la station, les dormeurs du wagon se réveillèrent en sursaut. On descendit avec tristesse, comme si le wagon eût transporté des condamnés dans une prison cellulaire. Ursule prit le bras de son mari, qui ne l’offrait pas, et nos deux jeunes époux arrivèrent en quelques minutes à leur chalet, séparé, du lac par de belles allées de tilleuls et un vaste jardin.
En entrant au chalet, Ursule donna son ombrelle, son chapeau et sa mantille à Brigitte, sa femme de chambre, et lui dit :
– Madame Vertbois est-elle arrivée ?
– Oui, madame, répondit Brigitte ; elle est assise dans le quinconce, et s’impatiente beaucoup.
– Je vais la rejoindre… Écoutez, Brigitte, si, par hasard, mon mari me demandait, vous lui diriez que je suis avec Mme Vertbois.
Brigitte inclina la tête, et tourna légèrement sur ses talons, en disant tout bas, et en soulignant ces deux mots :
– Par hasard !
Mme Vertbois se donnait trente ans ; elle en avait donc trente-quatre ; mais ce petit mensonge était le seul qu’elle eût commis dans sa vie. Sa fraîche et ronde figure respirait la franchise ; son esprit, un peu bourgeois, étincelait de bon sens. Elle était heureuse de vivre, d’avoir deux enfants, et d’être aimée de son mari, un honnête industriel, qui travaillait six jours de la semaine et ne se reposait pas le septième, car son usine était de celles qui doivent fonctionner toujours et sans interruption.
En voyant arriver Ursule, Mme Vertbois quitta sa broderie, se leva, pour courir au-devant de son amie ; elle l’embrassa bruyamment, et lui dit :
– Mon Dieu ! que tu arrives tard ! Il y a trois heures que je t’attends. Nous sommes arrivés avec la fraîcheur ; mais, mon mari m’a accompagnée à Enghien, puis il est retourné à Saint-Denis.
– Que veux-tu ! chère amie, dit Ursule, en s’asseyant sur une causeuse de jardin. – Mon mari n’en fait jamais d’autres ; il met trois heures à se décider lorsqu’il doit dire adieu à son atelier, à son herbier, à son médailler, à toutes ses antiquailles. Ce matin, il avait de plus toute une famille de fleurs chinoises à embrasser.
– Ah ! ma chère Ursule, reprit Mme Vertbois, tu dis tout cela sur le ton de la plainte et du reproche. J’aime assez, moi, un mari qui a des passions innocentes, et qui n’embrasse que des fleurs.
– Toi, Marie, tu serais heureuse comme une sainte au paradis, avec un mari comme le mien, dit Ursule.
– Eh bien ! qui t’empêche d’être heureuse, toi, comme je le serais, moi ?
– Ah ! qui m’empêche !… belle question !… C’est moi qui m’empêche… c’est mon caractère… ma nature… mon éducation…
– Bah !… on se refait, interrompit Marie ; on se refait quand on est mal faite. Tous les sept ans, on change de peau et de caractère.
– Mais on ne change pas de tête, ma bonne Marie ; et je garderai la mienne toute ma vie, avec tout ce qu’il y a dedans.
– Et qu’y a-t-il, Ursule ?
– Il y a mes goûts, mes instincts, mes penchants, mes passions, mes rêves, mes idées, et un beau matin, malgré toute ma volonté, je ne puis pas chasser tout cela, comme on donne congé à des locataires dont on est mécontent. Ce que j’ai là, au front, est mieux enraciné que ce tilleul.
– Tu me fais peur ! – dit Mme Vertbois, en joignant ses mains. – Ma bonne Ursule, je tremble pour toi… Écoute… nous sommes des amies d’enfance… nous sommes sœurs en amitié… parle-moi avec plus de franchise… Est-ce que parmi tes locataires on ne trouverait pas un certain monsieur… le comte de…
– Non.
– Ursule, je n’aime pas ce non ; il est trop sec. Ce non est un oui déguisé.
Ursule embrassa vivement son amie, et lui laissa une larme sur la joue.
– Ce n’est pas moi qui ai pleuré ! dit Marie avec épouvante… Ah ! Ursule ! Ursule ! j’ai le malheur d’avoir deviné !
– Ne parlons plus de cela, Marie…
– Parlons-en, au contraire ; parlons-en beaucoup, interrompit Marie. Un médecin interroge le malade sur son mal, et le malade répond : je souffre, n’en parlons plus ! Allons donc ! le médecin ne prend pas sa canne et son chapeau, il reste au chevet du malade…
– S’il y a chance de guérison…
– Comment ! interrompit Marie en pâlissant ; tu es déjà incurable !… Y aurait-il eu un commencement d’exécution ?…
– Oh ! ma chère ! dit Ursule, avec indignation, peux-tu me juger si mal !
– Enfin, tu aimes le jeune comte Edgar de… Bon ! tu l’aimes, c’est convenu… tu vois que je te juge bien… Amour innocent jusqu’à ce jour… à la bonne heure !… mais tous les amours criminels ont commencé par l’innocence… As-tu à te plaindre de ton mari ?
– Non, ma chère.
– Je le crois, Ursule… Eh bien ! ta faute serait sans excuse. Sans doute, Urbain n’est pas l’idéal du mari ; mais je le connais aussi bien que toi, et il ne mérite pas… un malheur.
– Mais je ne songe pas à le rendre malheureux, moi ; au contraire… quoique…
– Quoique… Achève, Ursule.
– Mon Dieu ! que veux-tu que je te dise !… Je m’ennuie horriblement avec cet homme-là !
– Mais, chère amie, on s’ennuie avec tous les hommes, aujourd’hui. Nous sommes nées trop tard. Crois-tu que je m’amuse, moi ? Mon mari a trois cents ouvriers, une usine grande comme un village, des machines anglaises, vingt-deux commis, quarante lettres à écrire par jour, et tous les soucis de l’univers dans sa tête. L’autre soir, je l’ai surpris dans un mouvement de tendresse, et je lui ai proposé une promenade sur l’eau ; il a d’abord accepté, puis s’est ravisé tout à coup, et s’est écrié en se frappant le front : « Ah ! il faut que j’écrive à Adélaïde ! – Allez écrire, monsieur, » lui ai-je dit… et je lui ai gardé rancune deux jours. Cela peut-être aurait pu commencer une vengeance ; mais heureusement j’ai appris qu’Adélaïde était une ville d’Australie ; on m’a montré ce nom sur la carte. Ce matin, je lui disais : « Mon ami, qu’attends-tu pour te retirer des affaires ? En liquidant, tu as deux cent mille francs de rente ; tu es aussi riche que l’empereur. Nous n’avons que deux filles ; leur dot est faite, et quelle dot ! Elles peuvent épouser deux princes. Nous quitterons Saint-Denis ; nous aurons un hôtel sur le boulevard, un équipage, des chevaux sérieux, une loge à l’Opéra. » Vertbois a poussé un cri déchirant, devant mon projet, comme si je lui eusse conseillé d’aller se pendre, et il m’a dit : « Tu parles comme une femme ! tu n’entends rien à l’industrie. Mes trois cents ouvriers sont mes enfants ; un père ne quitte pas sa famille ; un général ne quitte pas son armée. Se retirer des affaires, c’est déserter, passer à l’ennemi, c’est-à-dire à l’oisiveté. Que penseraient de moi mes correspondants de Manchester À Birmingham, mon ami, M. Schwab, a une fortune de cent millions, et il travaille comme un ouvrier. Nous sommes des enfants auprès des industriels d’Angleterre. Le proverbe a raison : L’homme est né pour travailler – Et la femme pour aimer, » ai-je dit en l’embrassant. Il m’a répondu par un grand éclat de rire, et a disparu comme une locomotive qui a pris le mors aux dents. Eh bien ! ces petites scènes domestiques me coûtent une ou deux larmes d’occasion, puis je me mets au piano ; je chaudronne une heure, je joue quatre polkas, et je pardonne à mon mari.
– Oui, oui, dit Ursule avec mélancolie ; mais tu as deux enfants, toi, deux adorables filles qui sont la joie de ta maison… et moi… moi ! je suis seule… la solitude conseille mal. Vois-tu, ma chère Marie, aujourd’hui, le malheur d’une femme est de naître riche. Une héritière n’est plus une jeune fille, c’est un portefeuille ; on l’expose sur un bureau de notaire, et un homme riche et calculateur se l’adjuge ; il ne l’épouse pas. L’amour ne joue aucun rôle dans ces enchères conjugales. Si j’avais eu le bonheur de naître pauvre, j’avais la chance de ne pas me marier, ce qui n’est jamais un malheur, ou d’épouser mon amant, un fiancé de l’amour. J’étais une héritière, on m’a cotée à la Bourse, et en m’a jetée dans le portefeuille du plus fort enchérisseur. Quatre ans se passent, et si je viens à rencontrer mon idéal, on me défend de l’aimer ; je ne dois aimer que mon acquéreur, celui qui ne m’aime pas, et que j’ai enrichi ; celui qui m’a épinglée comme une action de Bourse dans son portefeuille, et ne m’a jamais mise dans son cœur. Au moins, si j’eusse été consultée, au moment de ce trafic, et si mon acquiescement libre eût sanctionné le marché nuptial, j’aurais aujourd’hui mauvaise grâce à me plaindre, et je me soumettrais aux servitudes du contrat ; mais point du tout, on m’a traitée en chose inerte : on m’a mêlée dans les obligations de la ville de Paris, comme un chiffon à souche, on m’a mis un timbre sur le front, et on m’a crié : Sois fidèle au portefeuille, et n’en sors jamais !
– Calme-toi, ma chérie, calme-toi, dit Mme Vertbois, en prenant les mains d’Ursule ; ma pauvre amie, je suis ton ancienne dans le mariage, et tu ne m’apprends rien de nouveau. J’ai pensé mille fois ce que tu viens de dire, et j’ai eu mes occasions aussi, et je les aurai encore ; c’est surtout à mon âge que les femmes sont attaquées, parce qu’on suppose qu’il y a abandon mutuel dans le ménage pour cause d’ancienneté. Eh bien ! les galants peuvent venir, ils seront reçus comme je les recevais à vingt-quatre ans. Moi, compromettre ma tranquillité dans une intrigue avec un de ces coureurs d’aventures ! Oh ! jamais ! cela n’en vaut pas la peine. La sagesse a ses ennuis, je le sais, Ursule, mais j’aime mieux les ennuis de la sagesse que les tribulations du vice. Mon mari est un honnête homme qui m’aime à ses moments perdus, et n’a jamais rien fait pour me donner une heure mauvaise. Je l’aime avec la modération de l’habitude, et il ne me demande rien de plus. Prendre un amant, lorsqu’on a un mari, me paraît un luxe absurde au dernier point. Si j’avais pris un amant, je sens que je serais revenue à mon mari, un mois après ma chute. Eh bien ! j’ai toujours voulu m’épargner les frais du retour. Oh ! deux hommes sur les bras ! Ouf ! laisse-moi respirer !
– Tu en parles bien à ton aise, toi, dit Ursule avec tristesse ; tu as le bonheur de voir deux charmantes filles à tes côtés, deux anges qui te gardent ; tu es mère, et moi, je suis seule au monde ; j’habite une maison déserte. Que sont tes ennuis auprès des miens ! Mon mari est un honnête homme aussi ; qui n’est pas honnête homme ? voilà un beau mérite ! je voudrais qu’il eût une maîtresse, comme tant d’autres, parce que je le ramènerais à son devoir à force d’amour, et que je le verrais à mes pieds, implorant mon pardon, et me donnant enfin une douleur et une joie de la vie d’une femme…
– Bien ! interrompit en riant Mme Vertbois, tu vas même lui faire un crime de sa fidélité !
– Mais sa fidélité n’est pas une vertu, reprit Ursule, c’est une paresse d’organisation ; je ne lui en sais aucun gré. Il a des exigences et jamais de désirs : même au premier quartier de notre lune de miel, il lisait le journal du soir, depuis le titre jusqu’au nom d’imprimeur, avant de se coucher, et il montait méthodiquement sa montre devant la cheminée, comme un mari de cinquante ans. Il m’a embrassé une seule fois, en plein jour, et sais-tu pourquoi ? Il venait d’être nommé vice-président de la société de botanique ! il ne se possédait plus de joie. Le soir, il me conduisit au Théâtre-Français ; on jouait une comédie qui lui plaît beaucoup, Tartuffe ; c’est la troisième fois qu’il nous paye le plaisir de cette comédie, et je n’ai jamais pu le décider à me conduire à l’Opéra.
– Ainsi, vous continuez à passer vos soirées à la maison ? demanda Marie.
– Moi, je ne sors jamais, reprit Ursule ; quant à lui, il va très souvent à ses séances de botanique et me laisse seule. Quand il ne sort pas, il s’occupe dans son herbier ou met en ordre ses médailles. Pendant le jour, il fait de la photographie. Depuis quatre ans, cela n’a pas changé. Tous les jours se ressemblent dans ma semaine : je les appelle tous vendredi.
– Et avec sa fortune, reprit Marie, il pouvait ouvrir ses salons, recevoir, et…
– Lui ! interrompit Ursule, il a le monde en horreur ! il ne fréquente personne ; nos seuls amis sont nos voisins de campagne, les frères Tavignon, et nous sommes en visite avec eux, parce qu’ils ont un magnifique jardin de fleurs rares et une serre de plantes équinoxiales à Saint-Gratien, de l’autre côté du lac… Mais voici le plus curieux, et je te le gardais pour la fin du portrait… Mon mari est jaloux…
– Il est jaloux ! s’écria Mme Vertbois.
– Jaloux comme un tigre hypocrite ; il faut le deviner avec la pénétration d’une femme. Je lui ai découvert cette vertu fort tard.
– S’il est jaloux, il t’aime, dit Mme Vertbois ; alors, de quoi te plains-tu ?
– Il m’aime, oui ; mais il m’aime à sa manière, comme un bon bourgeois qui regarde le mariage au point de vue hygiénique et qui aime cent fois plus le mariage que la femme. J’ai entendu, à ce sujet, à travers une cloison, la plus étrange des conversations entre mon mari et son médecin… Ah ! ma chère Marie, si tu savais quelle est notre valeur réelle pour certains hommes !… Cette révélation me porta le dernier coup. Mon mari se montra sous un nouveau jour : c’était un jeune homme, sage avant l’âge mûr, ayant réglé sa vie avec une précision mathématique dans l’intérêt de sa santé ; se donnant chaque matin audience à lui-même pour régler l’hygiène à suivre jusqu’au lendemain ; adorant sa petite personne et la soignant avec un égoïsme de vieillard poltron ; enfin, que te dirai-je, regardant l’amour comme un article du Dictionnaire des sciences médicales, et le mariage comme un état de routine salutaire qui régularise la passion, donne l’embonpoint, purifie le sang et garantit une vieillesse exempte de douleurs. Et nous, pauvres jeunes filles, on nous donne des éducations de princesses ; on nous initie à tous les arts d’agrément ; on enrichit de tous les trésors de l’instruction notre esprit et notre cœur ; on nous façonne aux belles manières et au beau langage, pour servir de panacée vivante à ces calculateurs de la passion hygiénique, à ces égoïstes de la santé ! Oh ! vois-tu, ma chère Marie, j’en sais trop aujourd’hui, j’en ai trop appris de secrets en écoutant aux portes, et je prie Dieu de bien me garder !
– Et moi, je te garderai, après Dieu, et je ne te quitte plus, dit Marie avec une expansion d’amitié ardente ; je quitterai Saint-Denis, j’irai vivre avec toi, à Paris, dans ton hôtel, sous prétexte d’être plus près de mes deux filles et de surveiller leur éducation. Le péril est plus grand que je ne croyais. Tu es perdue, mon ange, perdue sans retour, si une main ne te retient pas au bord de l’abîme ! Quel malheur pour moi d’avoir vécu si longtemps loin de toi ! je t’aurais sauvée, et je crains d’arriver trop tard.
– Mais, reprit Ursule avec un calme d’emprunt, mais je ne t’ai fait aucun aveu alarmant, il me semble…
– Tu te justifies avant la faute, interrompit Marie, voilà ce qui me fait peur ; tu prends déjà tes précautions pour faire excuser l’aveu qui viendra plus tard ; tu détailles avec une effrayante complaisance tous les torts de ton mari pour t’absoudre d’avance à tes propres yeux, et pour rencontrer chez moi ou le silence qui approuve, ou l’indignation qui encourage. Eh bien ! mon ange, tu te trompes. Une femme ne peut et ne doit jamais transiger avec son devoir. Tous les torts du mari ne changent pas la nature du crime de la femme ; un crime est toujours un crime, et celui dont tu nourris le germe en toi est le plus grand de tous. Et si ce crime apportait avec lui quelques douceurs à la femme coupable ; mais Dieu te préserve des remords, des souffrances, des tortures qui suivent une chute ! Crois-tu trouver dans un amant l’amour dont tu as besoin ? Tu trouveras un second mari qui te fera regretter le premier. Tu trouveras un étourdi, un fat, un indiscret, un oisif, un menteur, qui traversera un instant ta vie, pour te laisser au cœur une amertume incurable. Tu te plains de ton mari, chère ange. Eh bien ! tu as tort, crois-moi ; ton mari t’a rendu le plus grand des services ; il t’a déjà fait connaître l’amant inconnu. Dieu n’a pas fait deux moules pour les hommes. Tu dis que le malheur d’une femme est de naître riche, tu aurais dû dire : est de naître femme. Les hommes ont fait la loi, les hommes sont les magistrats de la loi, les hommes sont les exécuteurs de la loi, il faut nous soumettre ; tout leur est permis, à eux ; tout nous est défendu, à nous. Ainsi, quand même une infidélité conjugale ne serait pas un crime devant Dieu, elle trouverait toujours une flétrissure et un châtiment au tribunal des hommes. Oses-tu courir la chance d’être traînée au palais de justice pour te voir déshonorée par un réquisitoire ? Ces horribles scènes de femmes publiquement flétries se renouvellent tous les jours. Veux-tu ajouter un nom à cette liste infinie qui commence à la femme adultère de l’Évangile ? C’est qu’à Paris, on est moins tolérant qu’à Jérusalem : les hommes n’y sont pas sans péchés, et ils jettent tous la première et la dernière pierre à une pauvre femme. Veux-tu te faire lapider ?
Un long soupir fut la réponse d’Ursule.
Marie sollicitait une réponse par son regard fixe et expressif, car ce long soupir semblait annoncer que le plus sage des raisonnements ne triomphe jamais d’une résolution immuable.
La réponse attendue n’arriva pas, et l’entretien prit une autre direction.
– Chère Marie, dit Ursule, j’accepte avec joie le secours que tu m’offres. Viens à Paris, viens m’arracher à un isolement dangereux ; j’ai besoin d’avoir à mon côté une amitié intelligente qui me comprenne. Mon mari et moi nous parlons une langue différente. Lui dédaigne ma sottise de femme, moi je méprise sa science d’homme. Notre entretien m’a un peu soulagée. Oui, je me trouve mieux… j’ai parlé… Nous passerons notre journée ensemble. C’est tout ce que je peux promettre… et crois-moi, c’est beaucoup.
– Ah ! je comprends, dit Marie… c’est sans doute là que tu rencontres le…
– Pas un mot de plus, interrompit Ursule : voici mon mari…
– Oh ! il est encore bien éloigné ! remarqua Marie, et il n’a pas l’air de se diriger vers nous… Il lit… Quelle espèce de livre peut-il lire ?… Il convient pourtant que j’aille le saluer… Viens avec moi ; allons au-devant de lui.
Urbain méditait sur son livre ; un double frôlement de robes lui fit lever les yeux ; il reconnut tout de suite Mme Vertbois, et l’ayant saluée avec une politesse froide, il échangea avec elle ces formules oiseuses qui ne signifient rien, et dont on se débarrasse au plus vite pour entrer en conversation suivie.
– Quel beau roman lisez-vous là, si je ne suis indiscrète ? demanda Mme Vertbois, sur un ton gracieusement léger.
– Un roman ! fit Urbain sur un ton grave ; moi, lire un roman !
– Que peut-on lire à la campagne ? reprit Mme Vertbois.
– À la campagne, dit Urbain, on doit s’instruire comme à la ville.
– Mon mari est vice-président de la Société de botanique, ajouta Ursule, avec une légère emphase.
Urbain, qui ne comprenait jamais la figure de rhétorique nommée ironie, s’inclina.
Mme Vertbois prit tout à coup un maintien respectueux, à l’annonce officielle d’une si haute fonction.
– Ursule, dit le mari, j’ai dépensé cinquante mille francs pour ma serre, et l’architecte et le terrassier m’ont volé. Je suis mangé par les taupes !
– Ah ! voilà un malheur ! dit Ursule.
– Je viens encore de découvrir, en arrivant, deux racines de roses carné de Java, et une belle tige de lavantera de Chine dévorées par ces horribles animaux ; et notez bien, mesdames, que les taupes ne s’attaquent qu’aux plantes exotiques, à l’aristocratie des fleurs.
– Les taupes ont le goût distingué, remarqua Ursule.
– J’ai essayé de l’arsenic pour les détruire ; c’est un excellent poison pour détruire la race des rongeurs ; mais, bah ! les taupes se moquent bien de l’arsenic ; on dirait qu’elles ont lu M. Raspail. Je cherche donc dans ce livre, que vous avez pris pour un roman, madame Vertbois, je cherche une combinaison de substances vénéneuses propre à la nature des taupes. Ce livre est un traité de toxicologie.
– Toxi… dit Mme Vertbois, de l’air d’une femme qui veut s’instruire.
– Toxicologie, reprit Urbain… de toxicum, poison.
– Comme ce livre doit être intéressant ! dit Mme Vertbois.
– Madame, poursuivit Urbain, le mithridaticum est plus intéressant encore ; il comble une lacune : il traite des contrepoisons.
– Comme ça doit être intéressant ! dit Mme Vertbois avec un sérieux admirable.
– Oh ! la toxicologie est un art merveilleux, reprit Urbain avec un enthousiasme concentré : les Chinois et les Indiens ont fait de vrais miracles en toxicologie. Je viens de trouver, là, dans ce livre, un poison chinois, contre les kandjils ; ce sont les taupes de l’Inde. Vous savez que les Chinois sont les premiers botanistes du monde ?…
Mme Vertbois fit un signe affirmatif.
– Et les premiers horticulteurs aussi, poursuivit Urbain. Eh bien ! voici la recette toute simple qu’ils me donnent pour exterminer les kandjils… Une décoction de nénufar, à l’eau froide ; une racine de tulipier jaune, et une poignée de feuilles de cette espèce de mancenillier que nous nommons mancenillier-lethalis, en botanique. Avec ces ingrédients, on compose une drogue qui détruit les taupes radicalement.
– C’est merveilleux ! remarqua Mme Vertbois.
– À la campagne, reprit Urbain, si on n’avait pas ces occupations sérieuses, on s’ennuierait à la mort. Le dimanche est assommant, surtout par cette chaleur ; il faut le tuer comme on peut, pour attendre le lundi, qui nous ramène à mon hôtel du faubourg Saint-Honoré.