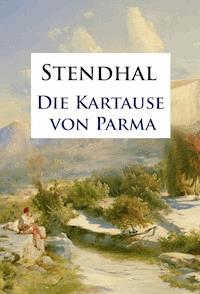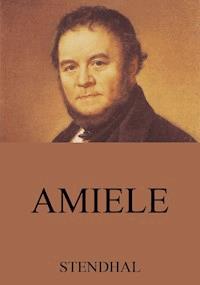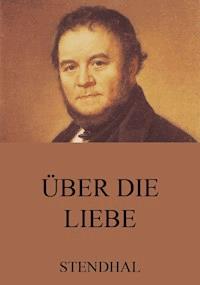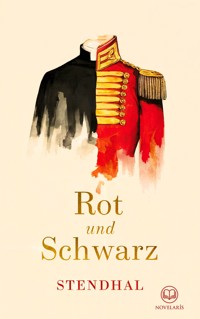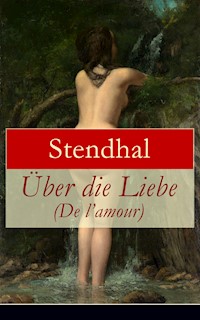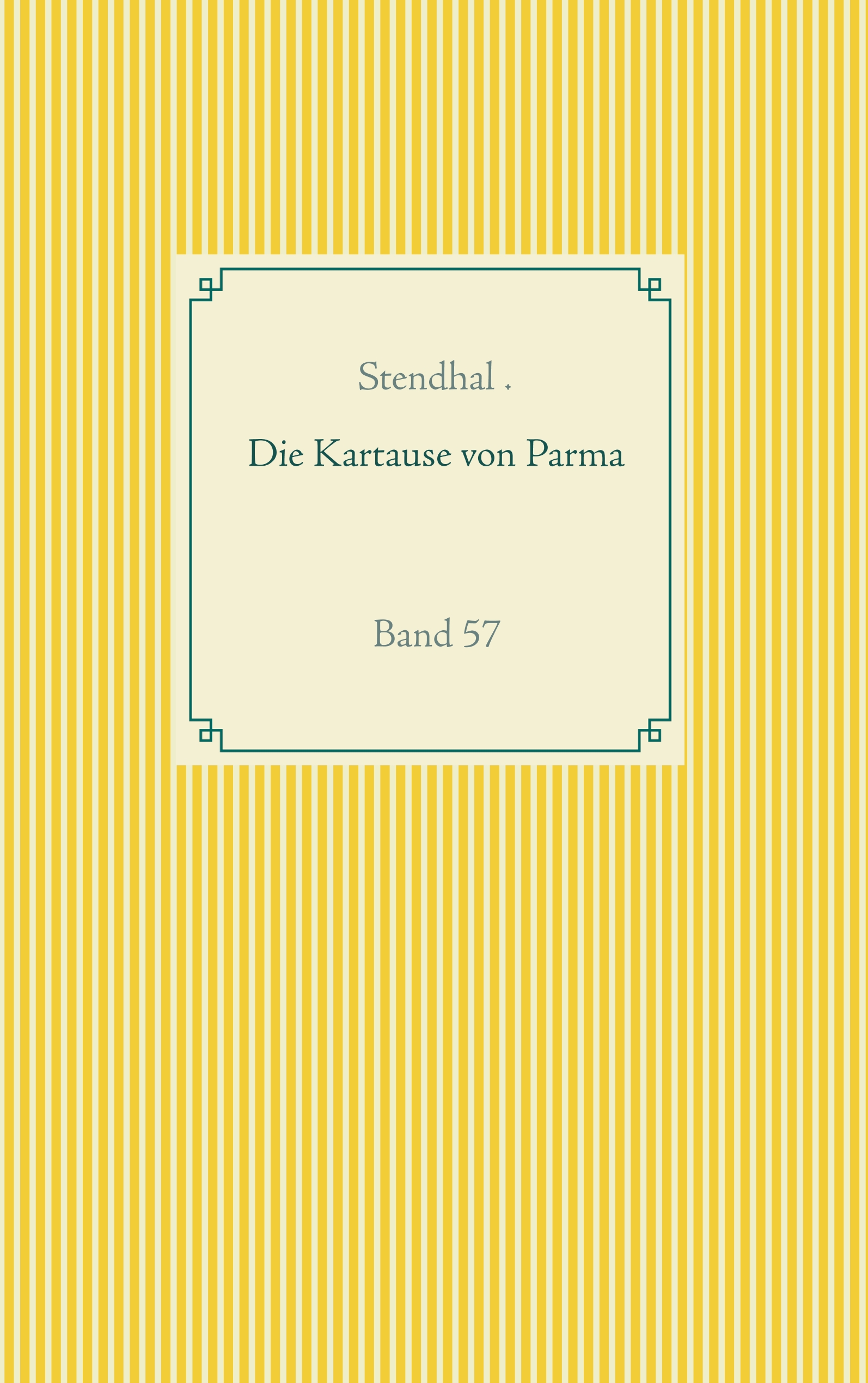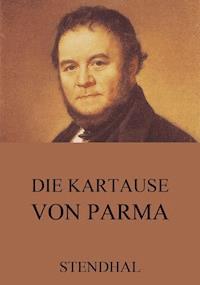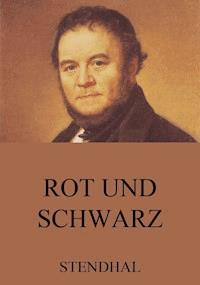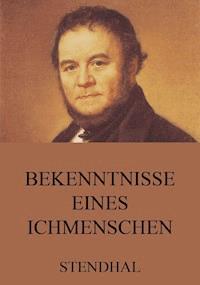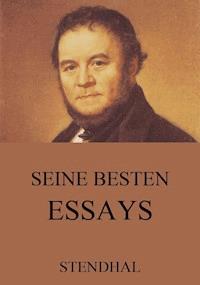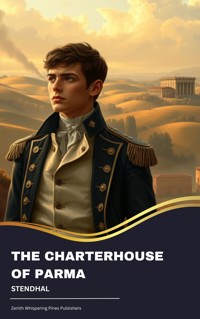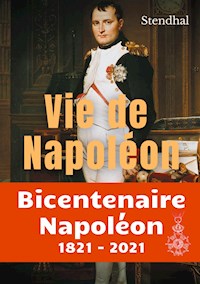
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Cette Vie de Napoléon, composée à Milan en 1817-1818, est l'un des deux essais que Stendhal a consacrés à l'Empereur, le second étant Mémoires sur Napoléon (1836-1837). Il fut écrit pour répondre à Madame de Staël qui, dans ses Considérations sur la Révolution française, avait attaqué Napoléon, auquel Stendhal, qui le plaçait plus haut que César même, vouait une véritable passion... n'excluant pas, comme il le montre ici, la critique. "Ma passion pour Napoléon, écrivait-il en 1836, est la seule qui me reste ; elle ne m'empêche pas de voir les erreurs et les petitesses qui peuvent lui être reprochées."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sommaire
AVANT-PROPOS.
PRÉFACE
I
.
État de l'opinion publique en France en 1794. — La Corse : ses mœurs, sa lutte contre Gênes et contre la France. — Parallèle de Paoli et de Napoléon. — La famille Bonaparte. — MM. de Marbeuf et de Narbonne. — Napoléon à Brienne
II
.
Napoléon à Valence. — Imperfection de son éducation. — Ses erreurs en politique. — Il tient garnison à Auxonne. — Son début comme auteur. — Imprime à Avignon la brochure intitulée : Le souper de Beaucaire. — Révolution française : Comment elle est envisagée à l'étranger. — Troubles politiques et insurrections à l'intérieur. — Énergie de la Convention. — Napoléon chef d'un bataillon de la garde nationale en Corse. — Il se rend à l'armée devant Toulon, pour y prendre le commandement en chef de l'artillerie
III
.
Napoléon général de brigade à l'armée d'Italie, reçoit une mission pour Gênes. — Il est mis en état d'arrestation ; sa belle justification. — Vient à Paris, y est destitué, son dénuement est extrême. — Note sur Napoléon par une femme. — Seconde note par une autre femme. — Rapports de Napoléon avec M. de Pontécoulant. — Considérations générales sur la situation de la France. — Journée du 1er prairial an III (20 mai 1795). — Expédition de Quiberon. — Constitution de l'an III. — Combat naval d'Ouessant. — Journée du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795)
IV
.
Napoléon prend le commandement de l'armée d'Italie, à son arrivée à Nice, le 27 mars 1796. — Dénuement absolu de cette armée. — Bonaparte demande au Sénat de Gênes réparation de l'attentat commis sur la frégate la Modeste. — Beaulieu remplace Devins dans le commandement de l'armée autrichienne en Italie. — La campagne s'ouvre le 10 avril 1796. — Montenotte. — Millesimo. — Dego. — Saint-Michel. — Mondovi. — Armistice de Cherasco
V
.
Considérations sur la situation et les opérations des armées françaises en Allemagne, en 1796. — Pichegru. — Moreau. — Jourdan
VI
.
Passage du pont de Lodi
VII
.
Misérable état de l'armée d'Italie. — Lettre de Napoléon au Directoire, du 14 mai 1796. — Milan, la Lombardie : ses mœurs, ses dispositions à l'égard des Français. Révolte à Pavie. — Bonaparte quitte Milan le-24 mai. Le 30, l'armée française passe le Mincio. — Beaulieu se retire au delà de l'Adige
VIII
.
Réflexions sur l'état moral de l'armée française en Italie. — Venise : ses habitudes sociales, sou gouvernement. — Masséna entre à Vérone le 3 juin 1795. — Le général Serrurier est chargé du blocus de Mantoue
IX
.
Bonaparte entre à Bologne le 19 juin 1796. — Armistice signé à Foligno le 24. — Occupation d'Ancône et de Livourne. — Bonaparte va visiter le grand duc de Toscane à Florence, le 1er juillet
X
.
Description du lac de Garde et de ses environs. — Gallé des soldats français. — Le génie militaire de Napoléon se développe et grandit au milieu des circonstances les plus périlleuses. — Wurmser remplace Beaulieu dans le commandement de l'armée autrichienne en Italie. Napoléon est obligé de lever le siège de Mantoue. Madame Bonaparte manque d'être prise par les Autrichiens. — Surprise de Lonato. — Bataille de Castiglione
XI
.
Bataille de Roveredo
XII
.
De l'art militaire
XIII
.
Occupation de Modène par les Français. — Bologne et Ferrare forment l'une des deux républiques cispadanes, Reggio forme la seconde. — Occupations de Bonaparte depuis le combat de Saint-George jusqu'à l'attaque de Caldiero. — Le général Gentili débarque en Corse, le 19 octobre 1796
XIV
.
Embarras de Bonaparte au sujet des fripons qui occupaient la plupart des emplois administratifs à l'armée d'Italie. — Le Directoire envoie le général Clarke au quartier général, pour y observer la conduite de Napoléon
XV
.
Bataille d'Arcole
XVI
.
Portraits des généraux : Berthier, Masséna, Augereau, Serrurier
XVII
.
Retour de Napoléon à Milan, le 19 septembre 1796. — Sa profonde haine pour les fournisseurs
XVIII
.
Intervalle d'Arcole à Rivoli (du 18 novembre 1796 au 14 janvier 1797). — Situation politique de la France ; attitude des différents partis ; faiblesse du Directoire. Effroi occasionné à Vienne par la défaite d'Arcole ; grands efforts de l'Autriche pour en atténuer les résultats. — On croit Napoléon empoisonné ; malgré de grandes souffrances, son activité redouble ; origine de sa maladie
XIX
.
Fermentation révolutionnaire dans les États de terre-ferme de la république de Venise. — Bataille de Rivoli. — Bataille de la Favorite
XX
.
M. Biogi, jeune peintre français ; beau caractère, noblesse et simplicité
XXI
.
Fin des temps héroïques de Napoléon
XXII
.
Les Jacobins et Fouché
XXIII
.
Chute de Napoléon. — Berthier. — Le comte Daru
AVANT-PROPOS.
Cet ouvrage, fruit de vingt ans de travaux, avait d'abord été conçu sur un plan plus vaste et tout autre que celui sous la forme duquel il arrive au public. L'auteur s'étant proposé d'écrire la vie de Napoléon, tout ce qui pouvait se rattacher à l'existence de ce grand homme avait été, pour lui, l'objet de recherches minutieuses et d'études approfondies. Une connaissance personnelle de faits intéressants, sur lesquels on n'avait que peu ou point de notions, donnait encore à Beyle des avantages particuliers. Cependant, tout en poursuivant son travail, il entrevit que la tâche qu'il s'était imposée serait bien lourde, et, modifiant le plan primitif, son objet ne fut plus que de composer des Mémoires sur Napoléon, pouvant faire la matière de six ou sept volumes.
Quant à la forme donnée, voici celle du manuscrit trouvé après sa mort. L'auteur, prenant un fait important ou une époque, dit ce qu'il en sait. Puis, il donne à la suite de sa version et textuellement, celle de Napoléon, copiée soit dans le Mémorial de Sainte-Hélène, soit dans les Mémoires dictés par Napoléon, pendant son exil, à MM. de Montholon et Gourgaud.
L'ouvrage devait embrasser toute la vie de Napoléon, mais l'ouvrier a manqué à l'œuvre et elle s'arrêtait au siège de Saint-Jean d'Acre, pendant l'expédition d'Égypte ; encore quelques parties n'étaient-elles qu'ébauchées. Il ne s'agit donc nullement ici du Consul ni de l'Empereur.
Réduit à offrir au public de simples fragments de cette composition, il eût été hors de propos de reproduire les longues citations empruntées au Mémorial de Sainte-Hélène et aux Mémoires de Napoléon.
R. COLOMB.
4 avril 1845.
A MONSIEUR LE LIBRAIRE.
Je vous en demande pardon, Monsieur, il n'y a nulle emphase dans les volumes que l'on vous présente à acheter. S'ils étaient écrits en style Salvandy, on vous demanderait quatre mille francs par volume.
Il n'y a jamais de grandes phrases ; jamais le style ne bride le papier, jamais de cadavres ; les mots horrible, sublime, horreur, exécrable, dissolution de la société, etc., ne sont pas employés.
L'auteur a la fatuité de n'imiter personne ; mais son ouvrage fait, s'il fallait, pour en donner une idée, en comparer le style à celui de quelqu'un des grands écrivains de France, l'auteur dirait :
J'ai cherché à raconter non pas comme MM. de Salvandy ou de Marchangy, mais comme Michel de Montaigne ou le président de Brosses.
POURQUOI AI-JE CONDUIT AINSI LES IDÉES DU LECTEUR ?
(13 février 1837)
PRÉFACE POUR MOI
L'histoire ordinaire (celle de M. Thibaudeau, par exemple), instruit le procès avec ostentation d'impartialité, comme Salluste, et laisse le prononcé du jugement au lecteur.
Par là, ce jugement ne peut être que commun : Jacques est un coquin ou un honnête homme. Moi, j'énonce ces jugements, et ils sont fondés sur une connaissance plus intime, et surtout plus délicate, du juste et de l'injuste : des jugements d'âme généreuse. Je voilerais la moitié du qualsisia merito1 — sans atteindre au mérite d'arrangement d'un Lemontey —, si je ne prononçais pas les jugements moi-même ; souvent d'une des circonstances de ce premier jugement, j'en tire un second. Donc, intituler ceci : Mémoires sur la vie de Napoléon.
Par l'originalité non cherchée — souvent je la voile exprès — de la pensée, je pourrai peut-être faire avaler six volumes. S'il fallait me gêner, je n'aurais pas la patience de continuer ; et pourquoi me gêner, pour devenir un dimidiato2 Lemontey ou Thiers ?
1 Mérite quelconque.
2 Un demi.
PRÉFACE.
De 1806 à 1814, j'ai vécu dans une société dont les actions de l'Empereur formaient la principale attention. Pendant une partie de ce temps, j'ai été attaché à la cour de ce grand homme, et je le voyais deux ou trois fois la semaine. (H. B.)
Fu vera gloria ?
Ai posteri l'ardua sentenza.
(MANZONI, Ode sur Napoléon.)
Un homme a eu l'occasion d'entrevoir Napoléon à Saint-Cloud, à Marengo, à Moscou ; maintenant il écrit sa vie, sans nulle prétention au beau style. Cet homme déteste l'emphase comme germaine de l'hypocrisie, le vice à la mode au XIXe siècle.
Les petits mérites seuls peuvent aimer le mensonge qui leur est favorable ; plus la vérité tout entière sera connue, plus Napoléon sera grand.
L'auteur emploiera presque toujours les propres paroles de Napoléon pour les récits militaires. Le même homme qui a fait a raconté. Quel bonheur pour la curiosité des siècles â venir ! Qui oserait, après Napoléon, raconter la bataille d'Arcole ?
Toutefois, tout occupé de son récit, il était plein de ce magnifique sujet, et supposant, comme les gens passionnés, que tout le monde devait le comprendre à demi-mot, quelquefois il est obscur. Alors on a placé, avant l'admirable récit de Napoléon, les éclaircissements nécessaires. L'auteur les a trouvés dans ses souvenirs.
En sa qualité de souverain, Napoléon écrivant mentait souvent. Quelquefois le cœur du grand homme soulevait la croûte impériale ; mais il s'est toujours repenti d'avoir écrit la vérité et, de temps en temps, de l'avoir dite. A Sainte-Hélène, il préparait le trône de son fils, ou un second retour, comme celui de l'ile d'Elbe. J'ai tâché de n'être pas dupe.
Pour les choses que l'auteur a vues ou qu'il croit vraies, il aime mieux employer les paroles d'un autre témoin, que de chercher lui-même à fabriquer une narration.
Je n'ai pas dit de certains personnages tout le mal que j'en sais ; il n'entrait point dans mes intentions de faire de ces mémoires un cours de connaissances du cœur humain.
J'écris cette histoire telle que j'aurais voulu la trouver écrite par un autre, au talent prés. Mon but est de faire connaitre cet homme extraordinaire, que j'aimais de son vivant, que j'estime maintenant de tout le mépris que m'inspire ce qui est venu après lui.
Comptant sur l'intelligence du lecteur, je ne garde point toutes les avenues contre la critique ; les hypocrites m'accuseront probablement de manquer de morale, ce qui n'augmentera nullement la dose de mépris que j'ai pour ces gens-là.
Il n'y a pas d'opinion publique à Paris sur les choses contemporaines ; il n'y a qu'une suite d'engouements, se détruisant l'un l'autre, comme une onde de la mer effaçant l'onde qui la précédait.
Le peuple, que Napoléon a civilisé en le faisant propriétaire et en lui donnant la même croix qu'à un maréchal, le juge avec son cœur, et je croirais assez que la postérité confirmera l'arrêt du peuple. Quant aux jugements des salons, je suppose qu'ils changeront tous les dix ans, comme j'ai vu arriver en Italie, pour le Dante, aussi méprisé en 1800 qu'il est adoré maintenant.
L'art de mentir a singulièrement grandi depuis quelques années. On n'exprime plus le mensonge en termes exprès, comme du temps de nos pères ; mais on le produit au moyen de formes de langage vagues et générales, qu'il serait difficile de reprocher au menteur et surtout de réfuter en peu de mots. Pour moi, je prends dans quatre ou cinq auteurs différents, quatre ou cinq petits faits ; au lieu de les résumer par une phrase générale, dans laquelle je pourrais glisser des nuances mensongères, je reproduis ces petits faits, en employant, autant que possible, les paroles mêmes des auteurs originaux.
Tout le monde avoue que l'homme qui raconte doit dire la vérité clairement. Mais pour cela il faut avoir le courage de descendre aux plus petits détails. C'est là, ce me semble, le moyen unique de répondre à la défiance du lecteur. Loin de redouter cette défiance, je la désire et la sollicite de tout mon cœur.
Par le mensonge qui court, la postérité ne pourra guère se fier qu'aux historiens contemporains. On sent chez un homme le ton de la vérité. D'ailleurs, dix ans après sa mort, la camaraderie qui le protégeait est dissoute, et celle qui lui succède met la vérité de cet écrivain au nombre de ces vérités indifférentes qu'il faut bien admettre, pour se donner du crédit, et pouvoir mentir avec quelque succès sur tout le reste.
Avant 1810, quand un écrivain mentait, c'était par l'effet d'une passion qui se trahissait d'elle-même et qu'il était facile d'apercevoir. Depuis 1812, et surtout depuis 1830, l'on ment de sang-froid pour arriver à une place ; ou, si l'on a de quoi vivre, pour atteindre, dans les salons, à une considération agréable.
Que de choses fausses dites sur Napoléon ! N'est-ce pas M. de Chateaubriand 3 qui a prétendu qu'il manquait de bravoure personnelle, et que, d'ailleurs, il s'appelait Nicolas ? Comment s'y prendra l'historien de 1860 pour se défendre de tous les faux mémoires qui, chaque mois, ornent les Revues de 1837 ? — L'écrivain qui a vu l'entrée de Napoléon à Berlin le 27 octobre 1806, qui l'a vu à Wagram, qui l'a vu marchant un bâton à la main, dans la retraite de Russie, qui l'a vu au conseil d'État, s'il a le courage de dire la vérité sur tout, même contre son héros, a donc quelque avantage.
Quand, pour mon malheur, il m'arrivera d'avoir une opinion qui n'entre pas dans le Credo littéraire ou politique du public de 1837, loin de l'envelopper savamment, je l'avouerai de la façon la plus claire et la plus crue. La crudité, je le sais, est un défaut de style ; mais l'hypocrisie est un défaut de mœurs tellement prédominant de nos jours, qu'il faut se précautionner de toutes les ressources, pour n'y pas être entraîné.
L'art de mentir fleurit surtout à l'aide du beau style académique et des périphrases commandées, dit-on, par l'élégance. Moi je prétends qu'elles sont commandées par la prudence de l'auteur qui, en général, veut de la littérature se faire un chausse-pied à quelque chose de mieux.
Je prie donc le lecteur de pardonner au style le plus simple et le moins élégant ; à un style qui ressemblerait, s'il en avait le talent, au style du XVIIe siècle, au style de M. de Sacy, traducteur des lettres de Pline, de M. l'abbé Mongault, traducteur d'Hérodien. Il me semble que j'aurai toujours le courage de choisir le mot inélégant, lorsqu'il donnera une nuance d'idées de plus.
En lisant l'histoire ancienne, dans la jeunesse, la plupart des cœurs qui sont susceptibles d'enthousiasme, s'attachent aux Romains et pleurent leurs défaites ; et tout cela malgré leurs injustices et leur tyrannie envers leurs alliés. Par un sentiment de même nature, on ne peut plus aimer un autre général après avoir vu agir Napoléon. On trouve toujours dans les propos des autres quelque chose d'hypocrite, de cotonneux d'exagéré, qui tue l'inclination naissante. L'amour pour Napoléon est la seule passion qui me soit restée ; ce qui ne m'empêche pas de voir les défauts de son esprit et les misérables faiblesses qu'on peut lui reprocher.
Maintenant que vous êtes prévenu, ô lecteur malévole, et que vous savez à quel rustre dépourvu de grâces, ou plutôt à quelle dupe, sans ambition, vous avez affaire, si vous n'avez point encore fermé le livre, je vais me permettre de discuter une question.
De bons juges m'ont assuré que ce n'est que dans vingt ou trente ans d'ici que l'on pourra publier une histoire raisonnable de Napoléon. Alors, les mémoires de M. de Talleyrand, de M. le duc de Bassano, et de bien d'autres, auront paru et auront été jugés. L'opinion définitive de la postérité sur ce grand homme aura commencé à se déclarer ; l'envie de la classe noble, si ce n'est que de l'envie, aura cessé. Maintenant beaucoup de gens recommandables se font encore une gloire d'appeler Napoléon, M. de Buonaparté.
L'écrivain de 1860 aura beaucoup d'avantages ; toutes les sottises que le temps détruit ne seront pas arrivées jusqu'à lui ; mais il lui manquera le mérite inappréciable d'avoir connu son héros, d'en avoir entendu parler trois ou quatre heures de chaque journée. J'étais employé à sa cour, j'y ai vécu ; j'ai suivi l'Empereur dans toutes ses guerres, j'ai participé à son administration des pays conquis, et je passais ma vie dans l'intimité d'un des ministres les plus influents. C'est à ces titres que j'ose élever la voix et présenter un petit abrégé provisoire, qui pourra être lu jusqu'à ce que paraisse la véritable histoire, vers 1860 ou 1880. Le métier du curieux est de lire des livres plats, qui parlent mal d'une chose qui nous intéresse.
J'ai cru devoir donner beaucoup de développements à la campagne d'Italie de 1796 et 1797. C'était le début de Napoléon. Suivant moi, elle fait mieux connaître qu'aucune autre et son génie militaire et son caractère. Si l'on veut considérer l'exiguïté des moyens, la magnifique défense de l'Autriche, et la défiance de soi-même qu'a toujours l'homme qui débute, quelque grand qu'on veuille le supposer, on trouvera que c'est peut-être la plus belle campagne de Napoléon. Enfin, en 1797 on pouvait l'aimer avec passion et sans restriction ; il n'avait point encore volé la liberté à son pays ; rien d'aussi grand n'avait paru depuis des siècles.
J'ai eu l'occasion d'étudier sur les lieux la campagne d'Italie ; le régiment dans lequel je servais en 1800, s'est arrêté à Cheracco, Lodi, Crema, Castiglione, Goïto, Padoue, Vicence, etc. J'ai visité avec tout l'enthousiasme d'un jeune homme, et seulement après la campagne de 1796, presque tous les champs de bataille de Napoléon ; je les parcourais avec des soldats qui avaient combattu sous ses ordres et des jeunes gens du pays émerveillés de sa gloire. Leurs réflexions montraient fort bien les idées qu'il avait su donner aux peuples. Les traces de ses combats étaient évidentes dans la campagne, dans les villes, et encore aujourd'hui les murs de Lodi, de Lonato, de Rivoli, d'Arcole, de Vérone, sont sillonnés par les balles françaises. Souvent il m'est arrivé d'entendre cette belle exclamation : Et alors nous pouvions nous révolter contre vous, qui nous rappeliez à la vie !
Je logeais par billet de logement, chez les plus chauds patriotes ; par exemple, chez un chanoine de Reggio, qui m'apprit toute l'histoire contemporaine du pays. Je supplie donc le lecteur de ne pas s'effrayer du nombre de pages occupé par la campagne d'Italie ; j'ai vu celles d'Allemagne et de Moscou, mais j'en parlerai moins longuement.
Le manuscrit que je présente au public fut commencé en 1816. Alors j'entendais dire tous les jours que M. de Buonaparté avait de la férocité, qu'il était lâche, qu'il ne s'appelait pas Napoléon, mais bien Nicolas, etc., etc. Je fis un petit livre qui ne racontait que les campagnes que j'avais entrevues ; mais tous les libraires auxquels je fis parler eurent peur. Je convenais des fautes de Napoléon ; ce fut à ce titre surtout que les gens qui cherchent la fortune en imprimant les pensées des autres, conçurent pour moi un mépris ineffable. Le danger, de la part du procureur du roi, disaient ces messieurs, est presque certain ; il faudrait du moins, par compensation, pouvoir compter sur le parti bonapartiste. Or, ce parti compte beaucoup de gens de cœur, mais peu accoutumés à lire. Dès qu'ils verront blâmer leur héros, ils en concluront que l'auteur attend quelque place de la Congrégation.
Il n'y avait rien à répondre, je n'y songeais plus. Me trouvant seul à la campagne avec ce manuscrit, je le relus en 1828, et, comme depuis douze ans je voyais contester les faits les plus notoires, comme on allait jusqu'à nier tout à fait des batailles (M. Botta nie Lonato), je pris le parti de raconter les faits clairement, c'est-à-dire longuement.
Une croyance presque instinctive chez moi, c'est que tout homme puissant ment quand il parle, et à plus forte raison, quand il écrit. Toutefois, par enthousiasme pour le beau idéal militaire, Napoléon a souvent dit la vérité dans le petit nombre de récits de batailles qu'il nous a laissés. J'ai admis ces récits pour la campagne d'Italie, en les faisant précéder d'un petit sommaire qui suffit pour établir la vérité, et surtout cette partie de la vérité négligée par l'auteur. Comment se priver volontairement de récits si passionnés ?
J'ai surtout admis ces récits, parce que mon but est de faire connaître l'homme extraordinaire. Quant à écrire l'histoire de France de 1800 à 1815, je n'y ai aucune prétention.
Je viens d'effacer beaucoup de phrases malsonnantes dans ce manuscrit de 1828. Mais, en évitant de heurter inutilement les personnes qui ne partagent pas mes opinions, je suis tombé comme Calpigi, dans un inconvénient bien pire : je veux et ne veux pas. La bonne compagnie réunit dans ce moment un sentiment et une fonction, qui se font entre eux une cruelle guerre : elle a peur du retour des horreurs de 1793, et, en même temps, elle est juge souveraine de la littérature.
On a vu dans les clubs, pendant la Révolution, que toute société qui a peur est, à son insu, dominée et conduite par ceux de ses membres qui ont le moins de lumières et le plus de folie. Dans tous les partis, plus un homme a d'esprit, moins il est de son parti, surtout si on l'interroge en tête-à-tête. Mais, en public, pour ne pas perdre sa caste, il doit dire comme les meneurs. Or, que diront les meneurs du présent essai historique ? Rien, ou beaucoup de mal. Ainsi, je voudrais être jugé par la bonne compagnie, et la bonne compagnie ne peut lire l'ouvrage suivant, sans choquer son allié le plus intime, celui qui lui a promis de rendre de toute impossibilité ce funeste retour de 93.
C'est en vain que je répéterais, mais, Messieurs, ce retour sort des bornes du possible ; il suffit, pour s'en convaincre, de comparer l'humanité et la générosité du peuple de Paris, pendant les trois journées de 1830, avec la fureur aveugle que montra la 'populace de 1789, lors de la prise de la Bastille. Rien de plus simple : on avait affaire, en 1789, à un peuple corrompu par la monarchie Pompadour, Dubarry et Richelieu, et nous marchons, en 1837, à côté d'un peuple d'ouvriers, qui sait qu'il peut obtenir la croix de la Légion d'honneur. Il n'est pas d'ouvrier qui n'ait un cousin propriétaire ou légionnaire. Napoléon a refait le moral du peuple français, c'est là sa gloire la plus vraie. Ses moyens ont été l'égale division, entre les enfants, des biens du père de famille (bienfait de la Révolution), et la Légion d'honneur, que l'on rencontre dans les ateliers, sur l'habit du plus simple ouvrier. Mais à quoi bon raisonner avec la peur ; qui pourrait la persuader ? C'est un sentiment vif. Or, en présence d'un intérêt passionné, de l'intérêt de l'existence, qu'est-ce qu'un vain intérêt de littérature et de beaux-arts ? Qu'il ne soit plus question de livres pendant cinquante ans, et n'ayons plus de Jacobins.
Comment écrire la vie de Napoléon sans toucher, malgré soi, à quelqu'une de ces quatre ou cinq grandes vérités : les droits de la naissance , le droit divin des rois, etc., etc., dont certaines gens ont arrêté qu'eux seuls pourraient parler.
Il n'y a pas de réponse raisonnable à cette objection. Ainsi, ô mon lecteur, comme je ne veux vous tromper en rien, je suis obligé de vous déclarer qu'il m'a fallu renoncer au suffrage de la bonne compagnie, malgré toute l'estime que je porte à ce suffrage.
Pour prouver, toutefois, que je ne suis pas un ennemi absolu des avantages que l'on peut devoir à la naissance, j'ajouterai que pour qu'un homme soit juge de nos bagatelles littéraires, il faut qu'il ait trouvé dans l'héritage paternel une édition des œuvres de Voltaire, quelques volumes elzévirs et l'Encyclopédie.
La préface d'un livre historique en est une partie nécessaire ; elle satisfait à cette question : Quel est cet homme qui vient me faire des récits ? C'est pour y répondre que je me permets les détails suivants :
Je vis pour la première fois le général Bonaparte deux jours après son passage du mont Saint-Bernard4 ; c'était au fort de Bard (le 22 mai 1800 ; il y a trente-sept ans, ô mon lecteur) ! Huit ou dix jours après la bataille de Marengo, je fus admis dans sa loge à la Scala (grand théâtre de Milan), pour rendre compte de mesures relatives à l'occupation de la citadelle d'Arona. J'étais à l'entrée de Napoléon à Berlin en 1800, à Moscou, en 1812, en Silésie en 1813. J'ai eu occasion de voir Napoléon à toutes ces époques. Ce grand homme m'a adressé la parole, pour la première fois, à une revue au Kremlin. J'ai été honoré d'une longue conversation en Silésie, pendant la campagne de 1813. Enfin, il m'a donné de vive voix des instructions détaillées, en décembre 1813, lors de ma mission à Grenoble, avec le sénateur comte de Saint-Vallier. Ainsi, je puis me moquer, en sûreté de conscience, de bien des mensonges.
Comme aucun détail vrai ne me semblera puéril, je dirai que je ne sais pas trop si la postérité appellera ce grand homme Bonaparte ou Napoléon ; dans le doute, j'emploie souvent ce dernier nom. La gloire qu'il a acquise sous celui de Bonaparte me semble bien plus pure ; mais je l'entends appeler M. Buonaparté, par des gens qui le haïssent, et dont lui seul au monde pouvait protéger les privilèges ; et ce nom si grand en 1797, me rappelle aujourd'hui, malgré moi, le souvenir ridicule des personnages qui affectent de s'en servir en l'altérant.
Je crains bien qu'aux yeux de la postérité, les écrivains du XIXe siècle ne jouent un rôle à peu près semblable à celui des contemporains de Sénèque ou de Claudien, dans la littérature latine.
Une des causes de cette décadence, c'est sans doute la préoccupation antilittéraire, qui porte le lecteur à chercher, avant tout, dans un livre, la religion politique de l'auteur. Quant à moi, je désire le maintien pur et simple de ce qui est. Mais ma religion politique ne m'empêchera pas de comprendre celle de Danton, de Sieyès, de Mirabeau et de Napoléon, véritables fondateurs de la France actuelle, grands hommes, sans l'un desquels la France de 1837 ne serait pas ce qu'elle est.
Avril 1837.
3 Mort à Paris le 4 juillet 1848, M. de Chateaubriand était né le 4 septembre 1768.
4 Le général Bonaparte passa en effet le mont Saint-Bernard le 30 floréal an VIII, correspondant au 20 mai 1800.
I.
État de l'opinion en France en 1794. — La Corse : ses mœurs, sa lutte contre Gênes et contre la France. — Parallèle de Paoli et de Napoléon. — La famille Bonaparte. MM. de Marbœuf et de Narbonne. — Napoléon à Brienne.
J'éprouve une sorte de sentiment religieux en écrivant la première phrase de l'histoire de Napoléon. Il s'agit, en effet, du plus grand homme qui ait paru dans le monde depuis César. Et même si le lecteur s'est donné la peine d'étudier la vie de César dans Suétone, Cicéron, Plutarque et les Commentaires, j'oserai dire que nous allons parcourir ensemble la vie de l'homme le plus étonnant qui ait paru depuis Alexandre, sur lequel nous n'avons point assez de détails pour apprécier justement la difficulté de ses entreprises.
J'espérais que quelqu'un de ceux qui ont vu Napoléon se chargerait de raconter sa vie. J'ai attendu pendant vingt ans. Mais, enfin, voyant que ce grand homme reste de plus en plus inconnu, je n'ai pas voulu mourir sans dire l'opinion qu'avaient de lui quelques-uns de ses compagnons d'armes ; car au milieu de toutes les platitudes que l'on connaît, il y avait des hommes qui pensaient librement dans ce palais des Tuileries, alors le centre du monde.
L'enthousiasme pour les vertus républicaines, éprouvé dans les années appartenant encore à l'enfance, le mépris excessif et allant jusqu'à la haine pour les façons d'agir des rois, contre lesquels on se battait, et même pour les usages militaires les plus simples, qu'on voyait pratiquer par leurs troupes, avaient donné à beaucoup de nos soldats de 1794 le sentiment que les Français seuls étaient des êtres raisonnables. A nos yeux, les habitants du reste de l'Europe qui se battaient pour conserver leurs chaînes, n'étaient que des imbéciles pitoyables, ou des fripons vendus aux despotes qui nous attaquaient. Pitt et Cobourg, dont le nom sonne encore quelquefois, répété par le vieil écho de la révolution, nous semblaient les chefs de ces fripons et la personnification de tout ce qu'il y a de traître et de stupide au monde. Alors tout était dominé par un sentiment profond dont je ne vois plus de vestiges. Que le lecteur, s'il a moins de cinquante ans, veuille bien se figurer, d'après les livres, qu'en 1794, nous n'avions aucune sorte de religion ; notre sentiment intérieur et sérieux était tout rassemblé dans cette idée : être utile à la patrie.
Tout le reste, l'habit, la nourriture, l'avancement, n'étaient à nos yeux qu'un misérable détail éphémère. Comme il n'y avait pas de société, les succès dans la société, chose si principale dans le caractère de notre nation, n'existaient pas.
Dans la rue nos yeux se remplissaient de larmes, en rencontrant sur le mur une inscription en l'honneur du jeune tambour Barra — qui se fit tuer à treize ans, plutôt que de cesser de battre sa caisse, afin de prévenir une surprise —. Pour nous, qui ne connaissions aucune autre grande réunion d'hommes, il y avait des fêtes, des cérémonies nombreuses et touchantes, qui venaient nourrir le sentiment dominant tout dans nos cœurs.
Il fut notre seule religion. Quand Napoléon parut et fit cesser les déroutes continuelles auxquelles nous exposait le plat gouvernement du Directoire, nous ne vîmes en lui que l'utilité militaire de la dictature. Il nous procurait des victoires, mais nous jugions toutes ses actions parles règles de la religion qui, dès notre première enfance faisait battre nos cœurs : nous ne voyions d'estimable en elle que l'utilité à la patrie.
Nous avons fait plus tard des infidélités à cette religion ; mais dans toutes les grandes circonstances, ainsi que la religion catholique le fait pour ses fidèles, elle a repris son empire sur nos cœurs.
Il en fut autrement des hommes nés vers 1790 et qui à quinze ans, en 1805, lorsqu'ils commencèrent à ouvrir les yeux, virent pour premier spectacle, les toques de velours ornées de plumes des ducs et comtes, récemment créés par Napoléon. Mais nous, anciens serviteurs de la patrie, nous n'avions que du mépris pour l'ambition puérile et l'enthousiasme ridicule de cette nouvelle génération.
Et parmi ces hommes habitant aux Tuileries, pour ainsi dire, qui maintenant avaient des voitures et sur le panneau de ces voitures de belles armoiries, il en fut beaucoup qui regardèrent ces choses comme un caprice de Napoléon et comme un caprice condamnable ; les moins ardents y voyaient une fantaisie dangereuse pour eux ; pas un sur cinquante, ne croyait à leur durée.
Ces hommes, bien différents de la génération arrivée à l'épaulette en 1805, ne retrouvaient l'alacrité, et le bonheur des premières campagnes d'Italie en 1796, que lorsque l'Empereur partait pour l'armée.
Je raconterai en son temps la répugnance avec laquelle l'armée réunie à Boulogne, en 1804, reçut la première distribution des croix de la Légion d'honneur ; plus tard, j'aurai à parler du républicanisme et de la disgrâce de Delmas, de Lecourbe, etc.
Ainsi, dans l'intérieur même des Tuileries, parmi les hommes qui aimaient sincèrement Napoléon, quand on croyait être bien entre soi, être bien à couvert des investigations de Savary, il y avait des hommes qui n'admettaient d'autre base pour juger des actions de l'Empereur que celle de l'utilité à la patrie. Tels furent Duroc, Lavalette, Lannes et quelques autres ; tels eussent été souverainement Desaix et Cafarelli-Dufalga ; et, chose étrange à dire, tel il était lui-même ; car il aimait la France avec toute la faiblesse d'un amoureux.
Telle fut constamment madame Lætitia, mère de Napoléon. Cette femme rare et l'on peut dire d'un caractère unique en France, eut par-dessus tous les autres habitants des Tuileries, la croyance ferme, sincère et jamais ébranlée, que la nation se réveillerait tôt ou tard, que tout l'échafaudage élevé par son fils s'écroulerait et pourrait le blesser en s'écroulant.
Ce grand caractère me ramène enfin à mon sujet, qui est maintenant l'histoire de l'enfance de Napoléon.
La Corse est une vaste agrégation de montagnes couronnées par des forêts primitives et sillonnées par des vallées profondes ; au fond de ces vallées, on rencontre un peu de terre végétale, et quelques peuplades sauvages et peu nombreuses, vivant de châtaignes. Ces gens n'offrent pas l'image de la société, mais plutôt celle d'une collection d'ermites rassemblés uniquement par le besoin. Ainsi, quoique si pauvres, ils ne sont point avares, et ne songent qu'à deux choses : se venger de leur ennemi, et aimer leur maîtresse. Ils sont remplis d'honneur, et cet honneur est plus raisonnable que celui de Paris au XVIIIe siècle ; mais, en revanche, leur vanité est presque aussi facile à se piquer que celle d'un bourgeois de petite ville. Si, lorsqu'ils passent dans un chemin, un de leurs ennemis sonne le cornet à bouquin du haut de la montagne voisine, il n'y a point à hésiter, il faut tuer cet homme.
Les vallées profondes, séparées entre elles par les crêtes des hautes chaînes de montagnes, forment la division naturelle de l'île de Corse ; on les appelle pieve5.
Chaque pieve nourrit quelques familles influentes, se détestant cordialement les unes les autres, quelquefois liguées ensemble, plus habituellement ennemies. A la menace d'un danger commun, les haines s'oublient pour quelques mois ; au total ce sont des cœurs brûlants qui, pour sentir la vie, ont besoin d'aimer ou de haïr avec passion.
La loi admirable du coup de fusil fait qu'il règne une grande politesse ; mais vous ne trouveriez nulle part la profonde obséquiosité envers le noble d'un village allemand. Le plus petit propriétaire d'une pieve ne fait nullement la cour au grand propriétaire, son voisin ; seulement, il vient le joindre avec son fusil sur l'épaule, quand sa vanité est blessée par la même cause que celle de ce voisin. Si Paoli fut puissant dans la guerre contre les Génois et ensuite contre les Français de Louis XV, c'est qu'il avait beaucoup de pieve pour lui.
Dès 1755, Pascal Paoli appelé au commandement en chef par les mécontents, chercha à s'emparer des parties montagneuses de l'île ; il réussit et parvint à reléguer les Génois dans les places maritimes.
Ces tyrans de la Corse, désespérant de la dompter, appelèrent les Français à leur aide, et ceux-ci finirent par faire la guerre aux mécontents pour leur propre compte ; de façon que les patriotes de Corse se mirent à détester les Français, héritiers de leurs tyrans et tyrans eux-mêmes6.
Le duc de Choiseul dirigeait alors la Guerre et les Affaires étrangères de Louis XV.
Parmi les chefs les plus passionnés de l'insurrection de Corse et les compagnons les plus fidèles de Paoli, on distinguait Charles Buonaparte, père de Napoléon. Il avait alors vingt-quatre ans, étant né à Ajaccio en 1744, d'une famille noble, établie dans l'île vers la fin du XVe siècle. Charles Buonaparte héritier d'une fortune médiocre, administrée par deux oncles prêtres et gens de mérite, avait étudié les lois à Pise, en Toscane. A son retour dans sa patrie, il épousa, sans le consentement de ses oncles, Lætitia Ramolini, qui passait pour la jeune fille la plus séduisante de l'île ; lui-même était fort bel homme et fort aimable.
En 1768, la querelle entre les Français et les Corses ayant atteint le dernier degré d'exaspération, et les Français ayant fait passer dans l'île des troupes extrêmement nombreuses, Charles Buonaparte se rendit à Corte auprès de Pascal Paoli et, ne voulant pas laisser d'otages aux Français, emmena avec lui ses oncles et sa femme.
Paoli avait beaucoup de confiance en lui. On attribue à Charles Buonaparte l'adresse à la jeunesse corse, publiée à Corte en juin 1768, et insérée, depuis, clans le Ive volume de l'histoire de Corse de Cambiagi.
Après la sanglante défaite de Ponte Novo, qui dissipa toutes les illusions d'indépendance conçues par Paoli et partagées par la majorité de la nation corse, Charles Buonaparte fut du nombre de ces patriotes fermes, qui ne désespérèrent point encore et voulurent accompagner Clemente Paoli, frère du général, à Niolo. Ils espéraient pouvoir soulever la population de cette province belliqueuse et la lancer contre l'armée française, qui s'avançait à grands pas ; mais cette tentative ne produisit aucun résultat.
Clemente Paoli, toujours accompagné de Charles Buonaparte, passa de Niolo à Vico ; il voulait engager une dernière lutte. Mais la marche rapide des événements rendit inutiles d'aussi nobles efforts, et Clemente Paoli, ainsi que son illustre frère, furent obligés de fuir une patrie qu'ils avaient voulu soustraire au joug de l'étranger.
Pendant les désastres de ces malheureuses expéditions de Niolo et de Vico, Charles Buonaparte fut constamment suivi par sa jeune et belle compagne. On la vit affronter les dangers de la guerre et partager toutes les fatigues des mécontents, dont les mouvements avaient lieu sur les montagnes les plus sauvages et au milieu de rochers escarpés. Madame Buonaparte ne songeant, comme son mari, qu'à sauver sa patrie de la domination étrangère, préférait supporter des souffrances au-dessus de son sexe et de sa position, à l'asile que le conquérant de l'île lui faisait offrir. C'était un oncle à elle, membre du conseil supérieur nouvellement institué par le général français, qui était l'intermédiaire de ces offres, dont le prétexte était l'état de grossesse avancée de madame Buonaparte.
Au mois de juin, quand, après le départ des deux Paoli, tout espoir fut définitivement perdu pour les patriotes, Charles Buonaparte qui, de Vico, s'était réfugié au petit village d'Appietto, rentra dans sa maison d'Ajaccio, avec sa jeune femme grosse de sept mois.