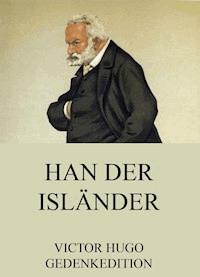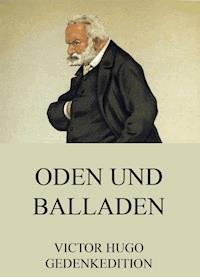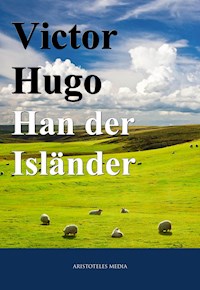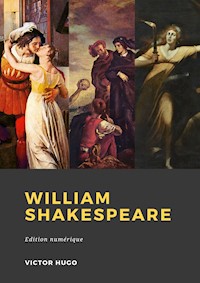
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
William Shakespeare est une œuvre de Victor Hugo parue en 1864. À l'origine, Victor Hugo devait écrire une biographie de William Shakespeare comme préface à la nouvelle traduction des œuvres du dramaturge anglais par son fils François-Victor Hugo. On peut supposer qu'emporté par son style, Hugo n'a pu se contenter de cet objectif premier : la biographie s'est transformée en un manifeste pour le romantisme de plusieurs centaines de pages. Le poète français y dresse notamment une liste exhaustive et enflammée de ceux qu'il nomme les « génies » de la littérature. Il y livre ses impressions, notamment des critiques, de ces hommes qui ont changé l'écriture du XIXe siècle.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Victor Hugo est un poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802 (7 ventôse an X) à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle.
Comme romancier, il a rencontré un grand succès populaire, d'abord avec Notre-Dame de Paris en 1831, et plus encore avec Les Misérables en 1862. Son œuvre multiple comprend aussi des écrits et discours politiques, des récits de voyages, des recueils de notes et de mémoires, des commentaires littéraires, une correspondance abondante, près de quatre mille dessins dont la plupart réalisés à l'encre, ainsi que la conception de décors intérieurs et une contribution à la photographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Hugo
WILLIAM SHAKESPEARE
– 1864 –
ÀL’ANGLETERRE
Je lui dédie ce livre, glorification de son poëte. Je dis à l’Angleterre la vérité ; mais, comme terre illustre et libre, je l’admire, et comme asile, je l’aime.
VICTOR HUGO.
Hauteville-House, 1864.
Le vrai titre de cet ouvrage serait : À propos de Shakespeare. Le désir d’introduire, comme on dit en Angleterre, devant le public, la nouvelle traduction de Shakespeare, a été le premier mobile de l’auteur. Le sentiment qui l’intéresse si profondément au traducteur ne saurait lui ôter le droit de recommander la traduction. Cependant sa conscience a été sollicitée d’autre part, et d’une façon plus étroite encore, par le sujet lui-même. À l’occasion de Shakespeare, toutes les questions qui touchent à l’art se sont présentées à son esprit. Traiter ces questions, c’est expliquer la mission de l’art ; traiter ces questions, c’est expliquer le devoir de la pensée humaine envers l’homme. Une telle occasion de dire des vérités s’impose, et il n’est pas permis, surtout à une époque comme la nôtre, de l’éluder. L’auteur l’a compris. Il n’a point hésité à aborder ces questions complexes de l’art et de la civilisation sous leurs faces diverses, multipliant les horizons toutes les fois que la perspective se déplaçait, et acceptant toutes les indications que le sujet, dans sa nécessité rigoureuse, lui offrait. De cet agrandissement du point de vue est né ce livre.
Hauteville-House, 1864.
PREMIÈRE PARTIE
LIVRE ISHAKESPEARE — SA VIE
I
Il y a une douzaine d’années, dans une île voisine des côtes de France, une maison, d’aspect mélancolique en toute saison, devenait particulièrement sombre à cause de l’hiver qui commençait. Le vent d’ouest, soufflant là en pleine liberté, faisait plus épaisses encore sur cette demeure toutes ces enveloppes de brouillard que novembre met entre la vie terrestre et le soleil. Le soir vient vite en automne ; la petitesse des fenêtres s’ajoutait à la brièveté des jours et aggravait la tristesse crépusculaire de la maison.
La maison, qui avait une terrasse pour toit, était rectiligne, correcte, carrée, badigeonnée de frais, toute blanche. C’était du méthodisme bâti. Rien n’est glacial comme cette blancheur anglaise. Elle semble vous offrir l’hospitalité de la neige. On songe, le cœur serré, aux vieilles baraques paysannes de France, en bois, joyeuses et noires, avec des vignes.
À la maison était attenant un jardin d’un quart d’arpent, en plan incliné, entouré de murailles, coupé de degrés de granit et de parapets, sans arbres, nu, où l’on voyait plus de pierres que de feuilles. Ce petit terrain, pas cultivé, abondait en touffes de soucis qui fleurissent l’automne et que les pauvres gens du pays mangent cuits avec le congre. La plage, toute voisine, était masquée à ce jardin par un renflement de terrain. Sur ce renflement il y avait une prairie en herbe courte où prospéraient quelques orties et une grosse ciguë.
De la maison on apercevait, à droite, à l’horizon, sur une colline et dans un petit bois, une tour qui passait pour hantée ; à gauche, on voyait le dick. Le dick était une file de grands troncs d’arbres adossés à un mur, plantés debout dans le sable, desséchés, décharnés, avec des nœuds, des ankyloses et des rotules, qui semblait une rangée de tibias. La rêverie, qui accepte volontiers les songes pour se proposer des énigmes, pouvait se demander à quels hommes avaient appartenu ces tibias de trois toises de haut.
La façade sud de la maison donnait sur le jardin, la façade nord sur une route déserte.
Un corridor pour entrée, au rez-de-chaussée, une cuisine, une serre et une basse-cour, plus un petit salon ayant vue sur le chemin sans passants et un assez grand cabinet à peine éclairé ; au premier et au second étage, des chambres, propres, froides, meublées sommairement, repeintes à neuf, avec des linceuls blancs aux fenêtres. Tel était ce logis. Le bruit de la mer toujours entendu.
Cette maison, lourd cube blanc à angles droits, choisie par ceux qui l’habitaient sur la désignation du hasard, parfois intentionnelle peut-être, avait la forme d’un tombeau.
Ceux qui habitaient cette demeure étaient un groupe, disons mieux, une famille. C’étaient des proscrits. Le plus vieux était un de ces hommes qui, à un moment donné, sont de trop dans leur pays. Il sortait d’une assemblée ; les autres, qui étaient jeunes, sortaient d’une prison. Avoir écrit, cela motive les verrous. Où mènerait la pensée, si ce n’est au cachot ?
La prison les avait élargis dans le bannissement.
Le vieux, le père, avait là tous les siens, moins sa fille aînée, qui n’avait pu le suivre. Son gendre était près d’elle. Souvent ils étaient accoudés autour d’une table ou assis sur un banc, silencieux, graves, songeant tous ensemble, et sans se le dire, à ces deux absents.
Pourquoi ce groupe s’était-il installé dans ce logis, si peu avenant ? Pour des raisons de hâte, et par le désir d’être le plut tôt possible ailleurs qu’à l’auberge. Sans doute aussi parce que c’était la première maison à louer qu’ils avaient rencontrée, et parce que les exilés n’ont pas la main heureuse.
Cette maison, — qu’il est temps de réhabiliter un peu et de consoler, car qui sait si, dans son isolement, elle n’est pas triste de ce que nous venons d’en dire ? un logis a une âme ; — cette maison s’appelait Marine-Terrace. L’arrivée y fut lugubre ; mais, après tout, déclarons-le, le séjour y fut bon, et Marine-Terrace n’a laissé à ceux qui l’habitèrent alors que d’affectueux et chers souvenirs. Et ce que nous disons de cette maison, Marine-Terrace, nous le disons aussi de cette île, Jersey. Les lieux de la souffrance et de l’épreuve finissent par avoir une sorte d’amère douceur qui, plus tard, les fait regretter. Ils ont une hospitalité sévère qui plaît à la conscience.
Il y avait eu, avant eux, d’autres exilés dans cette île. Ce n’est point ici l’instant d’en parler. Disons seulement que le plus ancien dont la tradition, la légende peut-être, ait gardé le souvenir, était un romain, Vipsanius Minator, qui employa son exil à augmenter, au profit de la domination de son pays, la muraille romaine dont on voit encore quelques pans, semblables à des morceaux de collines, près d’une baie nommée, je crois, la baie Sainte-Catherine. Ce Vipsanius Minator était un personnage consulaire, vieux romain si entêté de Rome qu’il gêna l’empire. Tibère l’exila dans cette île cimmérienne, Cœsarea ; selon d’autres, dans une des Orcades. Tibère fit plus ; non content de l’exil, il ordonna l’oubli. Défense fut faite aux orateurs du sénat et du forum de prononcer le nom de Vipsanius Minator. Les orateurs du forum et du sénat, et l’histoire, ont obéi ; ce dont Tibère, d’ailleurs, ne doutait pas. Cette arrogance dans le commandement, qui allait jusqu’à donner des ordres à la pensée des hommes, caractérisait certains gouvernements antiques parvenus à une de ces situations solides où la plus grande somme de crimes produit la plus grande somme de sécurité.
Revenons à Marine-Terrace.
Un matin de la fin de novembre, deux des habitants du lieu, le père et le plus jeune des fils, étaient assis dans la salle basse. Ils se taisaient, comme des naufragés qui pensent.
Dehors il pleuvait, le vent soufflait, la maison était comme assourdie par ce grondement extérieur. Tous deux songeaient, absorbés peut-être par cette coïncidence d’un commencement d’hiver et d’un commencement d’exil.
Tout à coup le fils éleva la voix et interrogea le père :
— Que penses-tu de cet exil ?
— Qu’il sera long.
— Comment comptes-tu le remplir ?
Le père répondit :
— Je regarderai l’Océan.
Il y eut un silence. Le père reprit :
— Et toi ?
— Moi, dit le fils, je traduirai Shakespeare.
II
Il y a des hommes océans en effet.
Ces ondes, ce flux et ce reflux, ce va-et-vient terrible, ce bruit de tous les souffles, ces noirceurs et ces transparences, ces végétations propres au gouffre, cette démagogie des nuées en plein ouragan, ces aigles dans l’écume, ces merveilleux levers, d’astres répercutés dans on ne sait quel mystérieux tumulte par des millions de cimes lumineuses, têtes confuses de l’innombrable, ces grandes foudres errantes qui semblent guetter, ces sanglots énormes, ces monstres entrevus, ces nuits de ténèbres coupées de rugissements, ces furies, ces frénésies, ces tourmentes, ces roches, ces naufrages, ces flottes qui se heurtent, ces tonnerres humains mêlés aux tonnerres divins, ce sang dans l’abîme ; puis ces grâces, ces douceurs, ces fêtes, ces gaies voiles blanches, ces bateaux de pêche, ces chants dans le fracas, ces ports splendides, ces fumées de la terre, ces villes à l’horizon, ce bleu profond de l’eau et du ciel, cette âcreté utile, cette amertume qui fait l’assainissement de l’univers, cet âpre sel sans lequel tout pourrirait ; ces colères et ces apaisements, ce tout dans un, cet inattendu dans l’immuable, ce vaste prodige de la monotonie inépuisablement variée, ce niveau après ce bouleversement, ces enfers et ces paradis de l’immensité éternellement émue, cet infini, cet insondable, tout cela peut être dans un esprit, et alors cet esprit s’appelle génie, et vous avez Eschyle, vous avez Isaïe, vous avez Juvénal, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange, vous avez Shakespeare, et c’est la même chose de regarder ces âmes ou de regarder l’Océan.
III
§ I
William Shakespeare naquit à Stratford-sur-Avon, dans une maison sous les tuiles de laquelle était cachée une profession de foi catholique commençant par ces mots : MoiJohnShakespeare. John était le père de William. La maison, située dans la ruelle Henley-Street, était humble, la chambre où Shakespeare vint au monde était misérable ; des murs blanchis à la chaux, des solives noires s’entrecoupant en croix, au fond une assez large fenêtre avec de petites vitres où l’on peut lire aujourd’hui, parmi d’autres noms, le nom de WalterScott. Ce logis pauvre abritait une famille déchue. Le père de William Shakespeare avait été alderman ; son aïeul avait été bailli. Shakespeare signifie secoue-lance ; la famille en avait le blason, unbrastenantunelance, armes parlantes confirmées, dit-on, par la reine Elisabeth en 1595, et visibles, à l’heure où nous écrivons, sur le tombeau de Shakespeare dans l’église de Stratford-sur-Avon. On est peu d’accord sur l’orthographe du mot Shakespeare, comme nom de famille ; on l’écrit diversement : Shakspere, Shakespere, Shakespeare, Shakspeare ; le dix-huitième siècle l’écrivait habituellement Shakespear ; le traducteur actuel a adopté l’orthographe Shakespeare, comme la seule exacte, et donne pour cela des raisons sans réplique. La seule objection qu’on puisse lui faire, c’est que Shakspeare se prononce plus aisément que Shakespeare, que l’élision de l’e muet est peut-être utile, et que dans leur intérêt même, et pour accroître leur facilité de circulation, la postérité a sur les noms propres un droit d’euphonie. Il est évident, par exemple, que dans le vers français l’orthographe Shakspeare est nécessaire. Cependant, en prose et vaincu par la démonstration du traducteur, nous écrirons Shakespeare.
§ II
Cette famille Shakespeare avait quelque vice originel, probablement son catholicisme, qui la fit tomber. Peu après la naissance de William, l’alderman Shakespeare n’était plus que le boucher John. William Shakespeare débuta dans un abattoir. A quinze ans, les manches retroussées dans la boucherie de son père, il tuait des moutons et des veaux « avec pompe », dit Aubrey. A dix-huit ans il se maria. Entre l’abattoir et le mariage, il fit un quatrain. Ce quatrain, dirigé contre les villages des environs, est son début dans la poésie. Il y déclare que Hillbrough est illustre par ses revenants et Bidford par ses ivrognes. Il fit ce quatrain étant ivre lui-même, à la belle étoile, sous un pommier resté célèbre dans le pays à cause de ce Songe d’une nuit d’été. Dans cette nuit et dans ce songe où il y avait des garçons et des filles, dans cette ivresse et sous ce pommier, il trouva jolie une paysanne, Anne Hatway. La noce suivit. Il épousa cette Anne Hatway, plus âgée que lui de huit ans, en eut une fille, puis deux jumeaux fille et garçon, et la quitta ; et cette femme, disparue de toute la vie de Shakespeare, ne revient plus que dans son testament où il lui lègue lemoinsbon de ses deux lits, « ayant probablement, dit un biographe, employé le meilleur avec d’autres. » Shakespeare, comme, La Fontaine, ne fit que traverser le mariage. Sa femme mise de côté, il fut maître d’école, puis clerc chez un procureur, puis braconnier. Ce braconnage a été utile plus tard pour faire dire que Shakespeare a été voleur. Un jour, braconnant, il fut pris dans le parc de sir Thomas Lucy. On le jeta en prison. On lui fit son procès. Aprement poursuivi, il se sauva à Londres. Il se mit, pour vivre, à garder les chevaux à la porte des théâtres. Plaute avait tourné une meule de moulin. Cette industrie de garder les chevaux aux portes existait encore à Londres au siècle dernier, et cela faisait une sorte de petite tribu ou de corps de métier qu’on nommait les Shakespeare’sboys.
§ III
On pourrait appeler Londres la Babylone noire. Lugubre le jour, splendide la nuit. Voir Londres est un saisissement. C’est une rumeur sous une fumée. Analogie mystérieuse ; la rumeur est la fumée du bruit. Paris est la capitale d’un versant de l’humanité, Londres est la capitale du versant opposé. Magnifique et sombre ville. L’activité y est tumulte et le peuple y est fourmilière. On y est libre et emboîté. Londres est le chaos en ordre. Le Londres du seizième siècle ne ressemblait point au Londres d’à présent, mais était déjà une ville démesurée. Cheapside était la grande rue. Saint-Paul, qui est un dôme, était une flèche. La peste était à Londres presque à demeure et chez elle, comme à, Constantinople. Il est vrai qu’il n’y avait pas loin de Henri VIII à un sultan. L’incendie, encore comme à Constantinople, était fréquent à Londres, à cause des quartiers populaires bâtis tout en bois. Il n’y avait dans les rues qu’un carrosse, le carrosse de sa majesté. Pas de carrefour où l’on ne bâtonnât quelque pick-pocket avec le drotschbloch, qui sert encore aujourd’hui en Groningue à battre le blé. Les mœurs étaient dures et presque farouches. Une grande dame était levée à six heures et couchée à neuf ; Lady Geraldine Kildare, chantée par lord Surrey, déjeunait d’une livre de lard et d’un pot de bière. Les reines, femmes de Henri VIII, se tricotaient des mitaines, volontiers de bonne grosse laine rouge. Dans ce Londres-là, la duchesse de Suffolk soignait elle-même son poulailler et, troussée à mi-jambes, jetait le grain aux canards dans sa basse-cour. Dîner à midi, c’était dîner tard. Les joies du grand monde étaient d’aller jouer à la main chaude chez lord Leicester. Anne Boleyn y avait joué. Elle s’était agenouillée, les yeux bandés, pour ce jeu, s’essayant, sans le savoir, à la posture de l’échafaud. Cette même Anne Boleyn, destinée au trône, d’où elle devait aller plus loin, était éblouie quand sa mère lui achetait trois chemises de toile, à six pence l’aune, et lui promettait, pour danser au bal du duc de Norfolk, une paire de souliers neufs valant cinq schellings.
§ IV
Sous Elisabeth, en dépit des puritains très en colère, il y avait à Londres huit troupes de comédiens, ceux de Hewington Butts, la compagnie du comte de Pembroke, les serviteurs de lord Strange, la troupe du lord-chambellan, la troupe du lord-amiral, les associés de Black-Friars, les Enfants de Saint-Paul, et, au premier rang, les Montreurs d’ours. Lord Southampton allait au spectacle tous les soirs. Presque tous les théâtres étaient situés sur le bord de la Tamise, ce qui fit augmenter le nombre des passeurs. Les salles étaient de deux espèces : les unes, simples cours d’hôtelleries, ouvertes, un tréteau adossé à un mur, pas de plafond, des rangées de bancs posés sur le sol, pour loges les croisées de l’auberge, on y jouait en plein jour et en plein air ; le principal de ces théâtres était le Globe ; les autres, des sortes de halles fermées, éclairées de lampes, on y jouait le soir ; la plus hantée était Black-Friars. Le meilleur acteur de lord Pembroke se nommait Henslowe ; le meilleur acteur de Black-Friars se nommait Burbage. Le Globe était situé sur le Bank-Side. Cela résulte d’une note du Stationers’Hall en date du 26 novembre 1607. HismajestyservantsplayingusuallyattheGlobeontheBank-Side. Les décors étaient simples. Deux épées croisées, quelquefois deux lattes, signifiaient une bataille ; la chemise par-dessus l’habit signifiait un chevalier ; la jupe de la ménagère des comédiens sur un manche à balai signifiait un palefroi caparaçonné. Un théâtre riche, qui fit faire son inventaire en 1598, possédait « des membres de maures, un dragon, un grand cheval avec ses jambes, une cage, un rocher, quatre têtes de turcs et celle du vieux Méhémet, une roue pour le siège de Londres et une bouche d’enfer. » Un autre avait « un soleil, une cible, les trois plumes du prince de Galles avec la devise : ICH DIEN, plus six diables, et le pape sur sa mule. » Un acteur barbouillé de plâtre et immobile signifiait une muraille ; s’il écartait les doigts, c’est que la muraille avait des lézardes. Un homme chargé d’un fagot, suivi d’un chien et portant une lanterne, signifiait la lune ; sa lanterne figurait son clair. On a beaucoup ri de cette mise en scène de clair de lune, devenue fameuse par leSonged’unenuitd’été, sans se douter que c’est là une sinistre indication de Dante. Voir l’Enfer, chant XX. Le vestiaire de ces théâtres, où les comédiens s’habillaient pêle-mêle, était un recoin séparé de la scène par une loque quelconque tendue sur une corde. Le vestiaire de Black-Friars était fermé d’une ancienne tapisserie de corps et métiers représentant l’atelier d’un ferron ; par des trous de cette cloison flottante en lambeaux, le public voyait les acteurs se rougir les joues avec de la brique pilée ou se faire des moustaches avec un bouchon brûlé à la chandelle. De temps en temps, par rentre-bâillement de la tapisserie, on voyait passer une face grimée en morisque, épiant si le moment d’entrer en scène était venu, ou le menton glabre d’un comédien jouant les rôles de femme. Glabrihistriones, dit Plaute. Dans ces théâtres abondaient les gentilshommes, les écoliers, les soldats et les matelots. On représentait là la tragédie de lord Buckhurst, GorboducouFerrexetPorrex, lamèreBombic, de Lily, où l’on entendait les moineaux crier phipphip, leLibertin, imitation du ConvivadodePiedra qui faisait son tour d’Europe, FelixandPhiliomena, comédie à la mode, jouée d’abord à Greenwich devant la « reine Bess », PromosetCassandra, comédie dédiée par l’auteur George Whetstone à William Fletwood, recorder de Londres, le Tamerlan et le JuifdeMalte de Christophe Marlowe, des interludes et des pièces de Robert Greene, de George Peele, de Thomas Lodge et de Thomas Kid, enfin des comédies gothiques, car, de même que la France a l’AvocatPathelin, l’Angleterre a l’AiguilledemacommèreGurton. Tandis que les acteurs gesticulaient et déclamaient, les gentilshommes et les officiers, avec leurs panaches et leurs rabats de dentelle d’or, debout ou accroupis sur le théâtre, tournant le dos, hautains et à leur aise au milieu des comédiens gênés, riaient, criaient, tenaient des brelans, se jetaient les cartes à la tête, ou jouaient au postandpair ; et en bas, dans l’ombre, sur le pavé, parmi les pots de bière et les pipes, on entrevoyait « les puants [1] » (le peuple). Ce fut par ce théâtre-là que Shakespeare entra dans le drame. De gardeur de chevaux il devint pasteur d’hommes.
§ V
Tel était le théâtre vers 1580, à Londres, sous « la grande reine » ; il n’était pas beaucoup moins misérable, un siècle plus tard, à Paris, sous « le grand roi » ; et Molière, à son début, dut, comme Shakespeare, faire ménage avec d’assez tristes salles. Il y a, dans les archives de la Comédie-Française, un manuscrit inédit de quatre cents pages, relié en parchemin et noué d’une bande de cuir blanc. C’est le journal de Lagrange, camarade de Molière. Lagrange décrit ainsi le théâtre où la troupe de Molière jouait par ordre du sieur de Rataban, surintendant des bâtiments du roi : « ... trois poutres, des charpentes pourries et étayées, et la moitié de la salle découverte et en ruine. » Ailleurs, en date du dimanche 15 mars 1671, il dit : « La troupe a résolu de faire un grand plafond qui règne par toute la salle, qui, jusqu’au dit jour 15, n’avait été couverte que d’une grande toile bleue suspendue avec des cordages. » Quant à l’éclairage et au chauffage de cette salle, particulièrement à l’occasion des frais extraordinaires qu’entraîna la Psyché, qui était de Molière et de Corneille, on lit ceci : « chandelles, trente livres ; concierge, à cause du feu, trois livres. » C’étaient là les salles que « le grand règne » mettait à la disposition de Molière. Ces encouragements aux lettres n’appauvrissaient pas Louis XIV au point de le priver du plaisir de donner, par exemple, en une seule fois, deux cent mille livres à Lavardin et deux cent mille livres à d’Épernon ; deux cent mille livres, plus le régiment de France, au comte de Médavid ; quatre cent mille livres à l’évêque de Noyon, parce que cet évêque était Clermont-Tonnerre, qui est une maison qui a deux brevets de comte et pair de France, un pour Clermont et un pour Tonnerre ; cinq cent mille livres au duc de Vivonne et sept cent mille livres au duc de Quintin-Lorges, plus huit cent mille livres à monseigneur Clément de Bavière, prince-evêque de Liège. Ajoutons qu’il donna mille livres de pension à Molière. On trouve sur le registre de Lagrange, au mois d’avril 1663, cette mention : « vers le même temps, M. de Molière reçut une pension du roi en qualité de bel esprit, et a été couché sur l’état pour la somme de mille livres. » Plus tard, quand Molière fut mort, et enterré à Saint-Joseph, « aide de la paroisse Saint-Eustache », le roi poussa la protection jusqu’à permettre que sa tombe fût « élevée d’un pied hors de terre. »
§ VI
Shakespeare, on vient de le voir, resta longtemps sur le seuil du théâtre, dehors, dans la rue. Enfin il entra. Il passa la porte et arriva à la coulisse. Il réussit à être call-boy, garçon appeleur, moins élégamment, aboyeur. Vers 1586, Shakespeare aboyait chez Greene, à Black-Friars. En 1587, il obtint de l’avancement ; dans la pièce intitulée : leGéantAgrapardo, roideNubie, pirequesonfrèrefeuAngulafer, Shakespeare fut chargé d’apporter son turban au géant. Puis de comparse il devint comédien, grâce à Burbage auquel, plus tard, dans un interligne de son testament, il légua trente-six schellings pour avoir un anneau d’or. Il fut l’ami de Condell et de Hemynge, ses camarades de son vivant, ses éditeurs après sa mort. II était beau ; il avait le front haut, la barbe brune, l’air doux, la bouche aimable, l’œil profond. Il lisait volontiers Montaigne, traduit par Florio. Il fréquentait la taverne d’Apollon. Il y voyait et traitait familièrement deux assidus de son théâtre, Decker, auteur du GuisHornbook, où un chapitre spécial est consacré à « la façon dont un homme du bel air doit se comporter au spectacle », et le docteur Symon Forman qui a laissé un journal manuscrit contenant des comptes rendus des premières représentations du MarchanddeVenise et du Conted’hiver. Il rencontrait sir Walter Raleigh au club de laSirène. A peu près vers la même époque, Mathurin Régnier rencontrait Philippe de Béthune à laPommedePin. Les grands seigneurs et les gentilshommes d’alors attachaient volontiers leurs noms à des fondations de cabarets. A Paris, le vicomte de Montauban, qui était Créqui, avait fondé leTripotdesonzemillediables ; à Madrid, le duc de Médina Sidonia, l’amiral malheureux de l’Invincible, avait fondé elPuno-en-rostro, et à Londres, sir Walter Raleigh avait fondé laSirène. On était là ivrogne et bel esprit.
§ VII
En 1589, pendant que Jacques VI d’Ecosse, dans l’espoir du trône d’Angleterre, rendait ses respects à Elisabeth, laquelle, deux ans auparavant, le 8 février 1587, avait coupé la tête à Marie Stuart, mère de ce Jacques, Shakespeare fit son premier drame, Périclès. En 1591, pendant que le roi catholique rêvait, sur le plan du marquis d’Astorga, une seconde Armada, plus heureuse que la première en ce qu’elle ne fut jamais mise à flot, il fit HenriVI. En 1593, pendant que les jésuites obtenaient du pape la permission expresse de faire peindre « les tourments et supplices de l’enfer » sur les murs de « la chambre de méditation » du collège de Clermont, où l’on enfermait souvent un pauvre adolescent qui devait, l’année d’après, rendre fameux le nom de Jean Châtel, il fit laSauvageapprivoisée. En 1594, pendant que, se regardant de travers et prêts à en venir aux mains, le roi d’Espagne, la reine d’Angleterre et même le roi de France disaient tous les trois : MabonnevilledeParis, il continua et compléta HenriVI. En 1595, pendant que Clément VIII, à Rome, frappait solennellement Henri IV de son bâton sur le dos des cardinaux du Perron et d’Ossat, il fit Timond’Athènes. En 1596, l’année où Elisabeth publia un édit contre les longues pointes des rondaches, et où Philippe II chassa de sa présence une femme qui avait ri en se mouchant, il fit Macbeth. En 1597, pendant que ce même Philippe II disait au duc d’Albe : Vousmériteriezlahache, non parce que le duc d’Albe avait mis à feu et à sang les Pays-Bas, mais parce qu’il était rentré chez le roi sans se faire annoncer, il fit Cymbeline et RichardIII. En 1598, pendant que le comte d’Essex ravageait l’Irlande ayant à son chapeau un gant de la vierge-reine Elisabeth, il fit lesDeuxgentilshommesdeVérone, leRoiJean, Peinesd’amourperdues, laComédied’erreurs, Toutestbienquifinitbien, leSonged’unenuitd’été et leMarchanddeVenise. En 1599, pendant que le conseil privé, à la demande de sa majesté, délibérait sur la proposition de mettre à la question le docteur Hayward pour avoir volé des pensées à Tacite, il fit RoméoetJuliette. En 1600, pendant que l’empereur Rodolphe faisait la guerre à son frère révolté et ouvrait les quatre veines à son fils, assassin d’une femme, il fit Commeilvousplaira, HenriIV, HenriVetBeaucoupdebruitpourrien. En 1601, pendant que Bacon publiait l’éloge du supplice du comte d’Essex, de même que Leibnitz devait, quatre-vingts ans plus tard, énumérer les bonnes raisons du meurtre de Monaldeschi, avec cette différence pourtant que Monaldeschi n’était rien à Leibnitz et que d’Essex était le bienfaiteur de Bacon, il fit laDouzièmenuitouCequevousvoudrez. En 1602, pendant que, pour obéir au pape, le roi de France, qualifié renarddeBéarn par le cardinal neveu Aldobrandini, récitait son chapelet tous les jours, les litanies le mercredi et le rosaire de la vierge Marie le samedi, pendant que quinze cardinaux, assistés des chefs d’ordre, ouvraient à Rome le débat sur le molinisme, et pendant que le saint-siége, à la demande de la couronne d’Espagne, « sauvait la chrétienté et le monde » par l’institution de la congrégation deAuxiliis, il fit Othello. En 1603, pendant que la mort d’Élisabeth faisait dire à Henri IV : Elleétaitviergecommejesuiscatholique, il fit Hamlet. En 1604, pendant que Philippe III achevait de perdre les Pays-Bas, il fit JulesCésar et Mesurepourmesure. En 1606, dans le temps où Jacques 1er d’Angleterre, l’ancien Jacques VI d’Écosse, écrivait contre Bellarmin le Torturatorti, et, infidèle à Carr, commençait à regarder doucement Villiers, qui devait l’honorer du titre de VotreCochonnerie, il fit Coriolan. En 1607, pendant que l’Université d’York recevait le petit prince de Galles docteur, comme le raconte le Père de Saint-Romuald, avectouteslescérémoniesetfourruresaccoutumées, il fit leRoiLear. En 1609, pendant que la magistrature de France, donnant un blanc seing pour l’échafaud, condamnait d’avance et de confiance le prince de Condé « à la peine qu’il plairait à sa majesté d’ordonner », il fit TroïlusetCressida. En 1610, pendant que Ravaillac assassinait Henri IV par le poignard, et pendant que le parlement de Paris assassinait Ravaillac par l’écartèlement, il fit AntoineetCléopâtre. En 1611, tandis que les maures, expulsés par Philippe III, se traînaient hors d’Espagne et agonisaient, il fit leConted’hiver, HenriVIII et laTempête.
§ VIII
Il écrivait sur des feuilles volantes, comme presque tous les poètes d’ailleurs. Malherbe et Boileau sont à peu près les seuls qui aient écrit sur des cahiers. Racan disait à mademoiselle de Gournay : « J’ai vu ce matin M. de Malherbe coudre lui-même avec du gros fil gris une liasse blanche où il y aura bientôt des sonnets. » Chaque drame de Shakespeare, composé pour les besoins de sa troupe, était, selon toute apparence, appris et répété à la hâte par les acteurs sur l’original même, qu’on ne prenait pas le temps de copier ; de là, pour lui comme pour Molière, le dépècement et la perte des manuscrits. Peu ou point de registres dans ces théâtres presque forains ; aucune coïncidence entre la représentation et l’impression des pièces ; quelquefois même pas d’imprimeur, le théâtre pour toute publication. Quand les pièces, par hasard, sont imprimées, elles portent des titres qui déroutent. La deuxième partie de HenriVI est intitulée : « La Première partie de la guerre entre York et Lancastre. » La troisième partie est intitulée : « La Vraie tragédie de Richard, duc d’York. » Tout ceci fait comprendre pourquoi il est resté tant d’obscurité sur les époques où Shakespeare composa ses drames, et pourquoi il est difficile d’en fixer les dates avec précision. Les dates que nous venons d’indiquer, et qui sont groupées ici pour la première fois, sont à peu près certaines ; cependant quelque doute persiste sur les années où furent non-seulement écrits, mais même joués, Timond’Athènes, Cymbeline, JulesCésar, AntoineetCléopâtre, Coriolan et Macbeth. Il y a çà et là des années stériles ; d’autres sont d’une fécondité qui semble excessive. C’est, par exemple, sur une simple note de Mères, auteur du Trésordel’esprit, qu’on est forcé d’attribuer à la seule année 1598 la création de six pièces, lesDeuxgentilshommesdeVérone, laComédied’erreurs, leRoiJean, leSonged’unenuitd’été, leMarchanddeVenise et Toutestbienquifinitbien, que Mères intitule Peinesd’amourgagnées. La date du HenriVI est fixée, pour la première partie du moins, par une allusion que fait à ce drame Nashe dans PiercePennilesse, L’année 1604 est indiquée pour Mesurepourmesure, en ce que cette pièce y fut représentée le jour de la Saint-Etienne, dont Hemynge tint note spéciale, et l’année 1611 pour HenriVIII, en ce que HenriVIII fut joué lors de l’incendie du Globe. Des incidents de toute sorte, une brouille avec les comédiens ses camarades, un caprice du lord-chambellan, forçaient quelquefois Shakespeare à changer de théâtre. LaSauvageapprivoisée fut jouée pour la première fois en 1593, au théâtre de Henslowe ; laDouzièmenuit en 1601, à Middle-Temple-Hall ; Othello en 1602, au château de Harefield. LeRoiLear fut joué à White-Hall, aux fêtes de Noël 1607, devant Jacques 1er. Burbage créa Lear. Lord Southampton, récemment élargi de la Tour de Londres, assistait à cette représentation. Ce lord Southampton était l’ancien habitué de Black-Friars, auquel Shakespeare, en 1589, avait dédié un poëme d’Adonis ; Adonis était alors à la mode ; vingt-cinq ans après Shakespeare, le cavalier Marini faisait un poëme d’Adonis qu’il dédiait à Louis XIII.
§ IX
En 1597, Shakespeare avait perdu son fils qui a laissé pour trace unique sur la terre une ligne du registre mortuaire de la paroisse de Stratford-sur-Avon : 1597. August. 17 : Hamnet. filiusWilliamShakespeare. Le 6 septembre 1601, John Shakespeare, son père, était mort. Il était devenu chef de sa troupe de comédiens. Jacques 1er lui avait donné en 1607 l’exploitation de Black-Friars, puis le privilège du Globe. En 1613, Madame Elisabeth, fille de Jacques, et l’électeur palatin, roi de Bohême, dont on voit la statue dans du lierre à l’angle d’une grosse tour de Heidelberg, vinrent au Globe voir jouer laTempête. Ces apparitions royales ne le sauvaient pas de la censure du lord-chambellan. Un certain interdit pesait sur ses pièces, dont la représentation était tolérée et l’impression parfois défendue. Sur le tome second du registre du Stationers’ Hall, on peut lire encore aujourd’hui en marge du titre des trois pièces, Commeilvousplaira, HenriV, Beaucoupdebruitpourrien, cette mention : « 4 août, à suspendre. » Les motifs de ces interdictions échappent. Shakespeare avait pu, par exemple, sans soulever de réclamation, mettre sur la scène son ancienne aventure de braconnier et faire de sir Thomas Lucy un grotesque, lejugeShallow, montrer au public Falstaff tuant le daim et rossant les gens de Shallow, et pousser le portrait jusqu’à donner à Shallow le blason de sir Thomas Lucy, audace aristophanesque d’un homme qui ne connaissait pas Aristophane. Falstaff, sur les manuscrits de Shakespeare, était écrit Falstaffe. Cependant quelque aisance lui était venue, comme plus tard à Molière. Vers la fin du siècle, il était assez riche pour que le 8 octobre 1598 un nommé Ryc-Quiney lui demandât un secours dans une lettre dont la suscription porte : àmonaimableamietcompatrioteWilliamShakespeare. Il refusa le secours, à ce qu’il paraît, et renvoya la lettre, trouvée depuis dans les papiers de Fletcher, et sur le revers de laquelle ce même Ryc-Quiney avait écrit : histrio ! mima ! Il aimait Stratford-sur-Avon où il était né, où son père était mort, où son fils était enterré. Il y acheta ou y fit bâtir une maison qu’il baptisa New-Place. Nous disons acheta ou fit bâtir une maison, car il l’acheta selon Whiterill, et la fit bâtir selon Forbes, et à ce sujet Forbes querelle Whiterill ; ces chicanes d’érudits sur des riens ne valent pas la peine d’être approfondies, surtout quand on voit le père Hardouin, par exemple, bouleverser tout un passage de Pline en remplaçant nospridem par nonpridem.
§ X
Shakespeare allait de temps en temps passer quelques jours à New-Place. Dans ces petits voyages il rencontrait à mi-chemin Oxford, et à Oxford l’hôtel de la Couronne, et dans l’hôtel l’hôtesse, belle et intelligente créature, femme du digne aubergiste Davenant. En 1606, madame Davenant accoucha d’un garçon qu’on nomma William, et en 1644 sir William Davenant, crée chevalier par Charles 1er, écrivait à lord Rochester : sachezceciquifaithonneuràmamère, jesuislefilsdeShakespeare ; se rattachant à Shakespeare de la même façon que de nos jours M. Lucas-Montigny s’est rattaché à Mirabeau. Shakespeare avait marié ses deux filles, Suzanne à un médecin, Judith à un marchand ; Suzanne avait de l’esprit, Judith ne savait ni lire ni écrire et signait d’une croix. En 1613, il arriva que Shakespeare, étant allé à Stratford-sur-Avon, n’eut plus envie de retourner à Londres. Peut-être était-il gêné. Il venait d’être contraint d’emprunter sur sa maison. Le contrat hypothécaire qui constate cet emprunt, en date du 11 mars 1613, et revêtu de la signature de Shakespeare, existait encore au siècle dernier chez un procureur qui le donna à Garrick, lequel l’a perdu. Garrick a perdu de même, c’est mademoiselle Violetti, sa femme, qui le raconte, le manuscrit de Forbes, avec ses lettres en latin. A partir de 1613, Shakespeare resta à sa maison de New-Place, occupé de son jardin, oubliant ses drames, tout à ses fleurs. Il planta dans ce jardin de New-Place le premier mûrier qu’on ait cultivé à Stratford, de même que la reine Elisabeth avait porté en 1561 les premiers bas de soie qu’on ait vus en Angleterre. Le 25 mars 1616, se sentant malade, il fit son testament. Son testament, dicté par lui, est écrit sur trois pages ; il signa sur les trois pages ; sa main tremblait ; sur la première page il signa seulement son prénom : WILLIAM, sur la seconde : WILLM SHASPR, sur la troisième : WILLIAM SHASP. Le 23 avril, il mourut. Il avait ce jour-là juste cinquante-deux ans, étant né le 23 avril 1564. Ce même jour 23 avril 1616, mourut Cervantes, génie de la même stature. Quand Shakespeare mourut, Milton avait huit ans, Corneille avait dix ans, Charles 1er et Cromwell étaient deux adolescents, l’un de seize, l’autre de dix-sept ans.
IV
La vie de Shakespeare fut très-mêlée d’amertume. Il vécut perpétuellement insulté. Il le constate lui-même. La postérité peut lire aujourd’hui ceci dans ses vers intimes : « Mon nom est diffamé, ma nature est abaissée ; ayez pitié de moi pendant que, soumis et patient, je bois le vinaigre. » Sonnet 111.— « Votre compassion efface la marque que font à mon nom les reproches du vulgaire. » Sonnet 112. — « Tu ne peux m’honorer d’une faveur publique, de peur de déshonorer ton nom. » Sonnet 36. — « Mes fragilités sont épiées par des censeurs plus fragiles encore que moi. » Sonnet 121. — Shakespeare avait près de lui un envieux en permanence, Ben Jonson, poëte comique médiocre dont il avait aidé les débuts. Shakespeare avait trente-neuf ans quand Elisabeth mourut. Cette reine n’avait pas fait attention à lui. Elle trouva moyen de régner quarante-quatre ans sans voir que Shakespeare était là. Elle n’en est pas moins qualifiée historiquement protectricedesartsetdeslettres, etc. Les historiens de la vieille école donnent de ces certificats à tous les princes, qu’ils sachent lire ou non.
Shakespeare, persécuté comme plus tard Molière, cherchait comme Molière à s’appuyer sur le maître, Shakespeare et Molière auraient aujourd’hui le cœur plus haut. Le maître, c’était Elisabeth, le roi Elisabeth, comme disent les anglais. Shakespeare glorifia Elisabeth ; il la qualifia Viergeétoile, astredel’Occident, et, nom de déesse qui plaisait à la reine, Diane ; mais vainement. La reine n’y prit pas garde ; moins attentive aux louanges où Shakespeare l’appelait Diane, qu’aux injures de Scipion Gentilis qui, prenant la prétention d’Elisabeth par le mauvais côté, l’appelait Hécate, et lui adressait la triple imprécation antique : Mormo!Bombo!Gorgo ! Quant à Jacques 1er, que Henri IV nommait maîtreJacques, il donna, on l’a vu, le privilège du Globe à Shakespeare, mais il interdisait volontiers la publication de ses pièces. Quelques contemporains, entre autres le docteur Symon Forman, se préoccupèrent de Shakespeare au point de noter l’emploi d’une soirée passée à une représentation du MarchanddeVenise. Ce fut là tout ce qu’il connut de la gloire. Shakespeare mort entra dans l’obscurité.
De 1640 à 1660, les puritains abolirent Part et fermèrent les spectacles ; il y eut un linceul sur tout le théâtre. Sous Charles II, le théâtre ressuscita, sans Shakespeare. Le faux goût de Louis XIV avait envahi l’Angleterre. Charles II était de Versailles plus que de Londres. Il avait pour maîtresse une fille française, la duchesse de Portsmouth, et pour amie intime la cassette du roi de France. Clifford, son favori, qui n’entrait jamais dans la salle du parlement sans cracher, disait : Ilvautmieuxpourmonmaîtreêtrevice-roisousungrandmonarquecommeLouisXIVqu ’esclavedecinqcentssujetsanglaisinsolents. Ce n’était plus le temps de la république ; le temps où Cromwell prenait le titre de Protecteurd’AngleterreetdeFrance, et forçait ce même Louis XIV à accepter la qualité de RoidesFrançais.
Sous cette restauration des Stuarts, Shakespeare acheva de s’effacer. Il était si bien mort que Davenant, son fils possible, refit ses pièces. Il n’y eut plus d’autre Macbeth que le Macbeth de Davenant. Dryden parla de Shakespeare une fois pour le déclarer « horsd’usage. » Lord Shaftesbury le qualifia « espritpassédemode. » Dryden et Shaftesbury étaient deux oracles. Dryden, catholique converti, avait deux fils huissiers de la chambre de Clément XI, il faisait des tragédies dignes d’être traduites en vers latins, comme le prouvent les hexamètres d’Atterbury, et il était le domestique de ce Jacques II qui, avant d’être roi pour son compte, avait demandé à Charles II son frère : Pourquoinefaites-vouspaspendreMilton ? Le comte de Shaftesbury, ami de Locke, était l’homme qui écrivait un Essaisurl’enjouementdanslesconversationsimportantes, et qui, à la manière dont le chancelier Hyde servait une aile de poulet à sa fille, devinait qu’elle était secrètement mariée au duc d’York.
Ces deux hommes ayant condamné Shakespeare, tout fut dit. L’Angleterre, pays d’obéissance plus qu’on ne croit, oublia Shakespeare. Un acheteur quelconque abattit sa maison, New-Place. Un docteur Cartrell, révérend, coupa et brûla son mûrier. Au commencement du dix-huitième siècle, l’éclipse était totale. En 1707, un nommé Nahum Tate publia un RoiLear, en avertissant les lecteurs « qu’il en avait puisé l’idée dans une pièce d’on ne sait quel auteur, qu’il avait lue par hasard. » Cet onnesaitqui était Shakespeare.
V
En 1728, Voltaire apporta d’Angleterre en France le nom de Will Shakespeare. Seulement, au lieu de Will, il prononça Gilles.
La moquerie commença en France et l’oubli continua en Angleterre. Ce que l’irlandais Nahum Tate avait fait pour leRoiLear, d’autres le firent pour d’autres pièces. Toutestbienquifinitbien eut successivement deux arrangeurs, Pilon pour Hay-Market, et Kemble pour Drury-Lane. Shakespeare n’existait plus et ne comptait plus. Beaucoupdebruitpourrien servit également de canevas deux fois : à Davenant, en 16/3 ; à James Miller, en 1737. Cymbeline fut refait quatre fois : sous Jacques II, au Théâtre-Royal, par Thomas Dursey ; en 1695, par Charles Marsh ; en 1759, par W. Hawkins ; en 1761, par Garrick. Coriolan fut refait quatre fois : en 1682, pour le Théâtre-Royal, par Tates ; en 1720, pour Drury-Lane, par John Dennis ; en 1755, pour Covent-Garden, par Thomas Sheridan ; en 1801, pour Drury-Lane, par Kemble. Timond’Athènes fut refait quatre fois : au théâtre du Duc, en 1678, par Shadwell ; en 1768, au théâtre de Richmond-Green, par James Love ; en 1771, à Drury-Lane, par Cumberland ; en 1786, à Covent-Garden, par Hull.
Au dix-huitième siècle, la raillerie obstinée de Voltaire finit par produire en Angleterre un certain réveil. Garrick, tout en corrigeant Shakespeare, le joua, et avoua que c’était Shakespeare qu’il jouait. On le réimprima à Glascow. Un imbécile, Malone, commenta ses drames, et, logique, badigeonna son tombeau. Il y a sur ce tombeau un petit buste, d’une ressemblance douteuse et d’un art médiocre, mais, ce qui le rend vénérable, contemporain de Shakespeare. C’est d’après ce buste qu’ont été faits tous les portraits de Shakespeare qu’on voit aujourd’hui. Le buste fut badigeonné. Malone, critique et blanchisseur de Shakespeare, mit une couche de plâtre sur son visage et de sottise sur son œuvre.
↑Stinkards
LIVRE IILES GÉNIES
I
Le grand Art, à employer ce mot dans son sens absolu, c’est la région des Égaux.
Avant d’aller plus loin, fixons la valeur de cette expression, l’Art, qui revient souvent sous notre plume.
Nous disons l’Art comme nous disons la Nature ; ce sont là deux termes d’une signification presque illimitée. Prononcer l’un ou l’autre de ces mots, Nature, Art, c’est faire une évocation, c’est extraire des profondeurs l’idéal, c’est tirer l’un des deux grands rideaux de la création divine. Dieu se manifeste à nous au premier degré à travers la vie de l’univers, et au deuxième degré à travers la pensée de l’homme.
La deuxième manifestation n’est pas moins sacrée que la première. La première s’appelle la Nature, la deuxième s’appelle l’Art. De là cette réalité : le poëte est prêtre.
Il y a ici-bas un pontife, c’est le génie.
Sacerdos magnus.
L’Art est la branche seconde de la Nature.
L’Art est aussi naturel que la Nature.
Par Dieu, — fixons encore le sens de ce mot, — nous entendons l’infini vivant.
Le moi latent de l’infini patent, voilà Dieu.
Dieu est l’invisible évident.
Le monde dense, c’est Dieu. Dieu dilaté, c’est le monde.
Nous qui parlons ici, nous ne croyons à rien hors de Dieu.
Cela dit, continuons.
Dieu crée l’art par l’homme. Il a un outil, le cerveau humain. Cet outil, c’est l’ouvrier lui-même qui se l’est fait ; il n’en a pas d’autre.
Forbes, dans le curieux fascicule feuilleté par Warburton et perdu par Garrick, affirme que Shakespeare se livrait à des pratiques de magie, que la magle était dans sa famille, et que le peu qu’il y a de bon dans ses pièces lui était dicté par « un Alleur », un Esprit.
Disons-le à ce propos, car il ne faut reculer devant aucune des questions qui s’offrent, ç’a été une bizarre erreur de tous les temps de vouloir donner au cerveau humain des auxiliaires extérieurs. Antrumadjuvatvatem. L’œuvre semblant surhumaine, on a voulu y faire intervenir l’extra-humain ; dans l’antiquité le trépied, de nos jours la table. La table n’est autre chose que le trépied revenant.
Prendre au pied de la lettre le démon que Socrate se suppose, et le buisson de Moïse, et la nymphe de Numa, et le dive de Plotin, et la colombe de Mahomet, c’est être dupe d’une métaphore.
D’autre part, la table, tournante ou parlante, a été fort raillée. Parlons net, cette raillerie est sans portée. Remplacer l’examen par la moquerie, c’est commode, mais peu scientifique. Quant à nous, nous estimons que le devoir étroit de la science est de sonder tous les phénomènes ; la science est ignorante et n’a pas le droit de rire ; un savant qui rit du possible est bien près d’être un idiot. L’inattendu doit toujours être attendu par la science. Elle a pour fonction de l’arrêter au passage et de le fouiller, rejetant le chimérique, constatant le réel. La science n’a sur les faits qu’un droit de visa. Elle doit vérifier et distinguer. Toute la connaissance humaine n’est que triage. Le faux compliquant le vrai n’excuse point le rejet en bloc. Depuis quand l’ivraie est-elle prétexte à refuser le froment ? Sarclez la mauvaise herbe, l’erreur, mais moissonnez le fait et liez-le aux autres. La science est la gerbe des faits.
Mission de la science : tout étudier et tout sonder. Tous, qui que nous soyons, nous sommes les créanciers de l’examen ; nous sommes ses débiteurs aussi. On nous le doit et nous le devons. Éluder un phénomène, lui refuser le payement d’attention auquel il a droit, reconduire, le mettre à la porte, lui tourner le dos en riant, c’est faire banqueroute à la vérité, c’est laisser protester la signature de la science. Le phénomène du trépied antique et de la table moderne a droit comme un autre à l’observation. La science psychique y gagnera, sans nul doute. Ajoutons ceci, qu’abandonner les phénomènes à la crédulité, c’est faire une trahison à la raison humaine.
Homère affirme que les trépieds de Delphes marchaient tout seuls, et il explique le fait, chant XVIII de l’Iliade, en disant que Vulcain leur forgeait des roues invisibles. L’explication ne simplifie pas beaucoup le phénomène. Platon raconte que les statues de Dédale gesticulaient dans les ténèbres, étaient volontaires, et résistaient à leur maître, et qu’il fallait les attacher pour qu’elles ne s’en allassent pas. Voilà d’étranges chiens à la chaîne. Fléchier mentionne à la page 52 de son HistoiredeThéodose, à propos de la grande conspiration des sorciers du quatrième siècle contre l’empereur, une table tournante dont nous parlerons peut-être ailleurs pour dire ce que Fléchier ne dit point et semble ignorer. Cette table était couverte d’une lame ronde faite de plusieurs métaux, exdiversismetallicismateriisfabrefacta, comme les plaques de cuivre et de zinc employées actuellement par la biologie. On le voit, le phénomène, toujours rejeté et toujours reparaissant, n’est pas d’hier.
Du reste, quoi que la crédulité en ait dit ou pensé, ce phénomène des trépieds et des tables est sans rapport aucun, c’est là que nous voulons en venir, avec l’inspiration des poètes, inspiration toute directe. La sibylle a un trépied, le poëte non. Le poëte est lui-même trépied. Il est le trépied de Dieu. Dieu n’a pas fait ce merveilleux alambic de l’idée, le cerveau de l’homme, pour ne point s’en servir. Le génie a tout ce qu’il lui faut dans son cerveau. Toute pensée passe par là. La pensée monte et se dégage du cerveau, comme le fruit de la racine. La pensée est la résultante de l’homme. La racine plonge dans la terre ; le cerveau plonge en Dieu.
C’est-à-dire dans l’infini.
Ceux qui s’imaginent — il y en a, témoin ce Forbes, — qu’un poëme comme leMédecindesonhonneurouleRoiLear peut être dicté par un trépied ou par une table, errent étrangement. Ces œuvres sont des œuvres de l’homme. Dieu n’a pas besoin de faire aider Shakespeare ou Calderon par un morceau de bois.
Donc écartons le trépied. La poésie est propre au poëte. Soyons respectueux devant le possible, dont nul ne sait la limite, soyons attentifs et sérieux devant l’extra-humain, d’où nous sortons et qui nous attend ; mais ne diminuons point les grands travailleurs terrestres par des hypothèses de collaborations mystérieuses qui ne sont point nécessaires, laissons au cerveau ce qui est au cerveau, et constatons que l’œuvre des génies est du surhumain sortant de l’homme.
II
L’art suprême est la région des Égaux.
Le chef-d’œuvre est adéquat au chef-d’œuvre.
Comme l’eau qui, chauffée à cent degrés, n’est plus capable d’augmentation calorique et ne peut s’élever plus haut, la pensée humaine atteint dans certains hommes sa complète intensité. Eschyle, Job, Phidias, Isaïe, saint Paul, Juvénal, Dante, Michel-Ange, Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, quelques autres encore, marquent les cent degrés du génie.
L’esprit humain a une cime.
Cette cime est l’idéal.
Dieu y descend, l’homme y monte.
Dans chaque siècle, trois ou quatre génies entreprennent cette ascension. D’en bas, on les suit des yeux. Ces hommes gravissent la montagne, entrent dans la nuée, disparaissent, reparaissent. On les épie, on les observe. Ils côtoient les précipices ; un faux pas ne déplairait point à certains spectateurs. Les aventuriers poursuivent leur chemin. Les voilà haut, les voilà loin ; ce ne sont plus que des points noirs. Comme ils sont petits ! dit la foule^ Ce sont des géants. Ils vont. La route est âpre. L’escarpement se défend. A chaque pas un mur, à chaque pas un piège. A mesure qu’on s’élève, le froid augmente. Il faut se faire son escalier, couper la glace et marcher dessus, se tailler des degrés dans la haine. Toutes les tempêtes font rage. Cependant ces insensés cheminent. L’air n’est plus respirable. Le gouffre se multiplie autour d’eux. Quelques-uns tombent. C’est bien fait. D’autres s’arrêtent et redescendent ; il y a de sombres lassitudes. Les intrépides continuent ; les prédestinés persistent. La pente redoutable croule sous eux et tâche de les entraîner ; la gloire est traître. Ils sont regardés par les aigles, ils sont tâtés par les éclairs ; l’ouragan est furieux. N’importe, ils s’obstinent. Ils montent. Celui qui arrive au sommet est ton égal, Homère.
Ces noms que nous venons de dire, et ceux que nous aurions pu ajouter, redites-les. Choisir entre ces hommes, impossible. Nul moyen de faire pencher la balance entre Rembrandt et Michel-Ange.
Et, pour nous enfermer seulement dans les écrivains et les poètes, examinez-les l’un après l’autre. Lequel est le plus grand ? Tous.
§ I
L’un, Homère, est l’énorme poëte enfant. Le monde naît, Homère chante. C’est l’oiseau de cette aurore. Homère a la candeur sacrée du matin. Il ignore presque l’ombre. Le chaos, le ciel, la terre, Géo et Céto, Jupiter dieu des dieux, Agamemnon roi des rois, les peuples, troupeaux dès le commencement, les temples, les villes, les assauts, les moissons, l’Océan ; Diomède combattant, Ulysse errant ; les méandres d’une voile cherchant la patrie ; les cyclopes, les pygmées ; une carte de géographie avec une couronne de dieux sur l’Olympe, et çà et là des trous de fournaise laissant voir l’Érèbe, les prêtres, les vierges, les mères, les petits enfants effrayés des panaches, le chien qui se souvient, les grandes paroles qui tombent des barbes blanches, les amitiés amours, les colères et les hydres, Vulcain pour le rire d’en haut, Thersite pour le rire d’en bas, les deux aspects du mariage résumés d’avance pour les siècles dans Hélène et dans Pénélope ; le Styx, le Destin, le talon d’Achille, sans lequel le Destin serait vaincu par le Styx ; les monstres, les héros, les hommes, les mille perspectives entrevues dans la nuée du monde antique, cette immensité, c’est Homère. Troie convoitée, Ithaque souhaitée. Homère, c’est la guerre et c’est le voyage, les deux modes primitifs de la rencontre des hommes ; la tente attaque la tour, le navire sonde l’inconnu, ce qui est aussi une attaque ; autour de la guerre, toutes les passions ; autour du voyage, toutes les aventures ; deux groupes gigantesques : le premier, sanglant, se nomme l’Iliade ; le deuxième, lumineux, se nomme l’Odyssée. Homère fait les hommes plus grands que nature ; ils se jettent à la tête des quartiers de rocs que douze jougs de bœufs ne feraient pas bouger ; les dieux se soucient médiocrement d’avoir affaire à eux. Minerve prend Achille aux cheveux ; il se retourne irrité : Que me veux-tu, déesse ? Nulle monotonie d’ailleurs dans ces puissantes statures. Ces géants sont nuancés. Après chaque héros, Homère brise le moule. Ajax fils d’Oïlée est de moins haute taille qu’Ajax fils de Télamon. Homère est un des génies qui résolvent ce beau problème de l’art, le plus beau de tous peut-être, la peinture vraie de l’humanité obtenue par le grandissement de l’homme, c’est-à-dire la génération du réel dans l’idéal. Fable et histoire, hypothèse et tradition, chimère et science, composent Homère. Il est sans fond, et il est riant. Toutes les profondeurs des vieux âges se meuvent, radieusement éclairées, dans le vaste azur de cet esprit. Lycurgue, ce sage hargneux, mi-parti de Solon et de Dracon, était vaincu par Homère. Il se détournait de sa route, en voyage, pour aller feuilleter, dans la maison de Cléophile, les poëmes d’Homère, déposés là en souvenir de l’hospitalité qu’Homère, disait-on, avait reçue jadis dans cette maison. Homère, pour les grecs, était dieu ; il avait des prêtres, les Homérides. Un rhéteur s’étant vanté de ne jamais lire Homère, Alcibiade donna à cet homme un soumet. La divinité d’Homère a survécu au paganisme. Michel-Ange disait : QuandjelisHomère, jemeregardepourvoirsijen ’aipasvingtpiedsdehaut. Une tradition veut que le premier vers de l’Iliade soit un vers d’Orphée, ce qui, doublant Homère d’Orphée, augmentait en Grèce la religion d’Homère. Le bouclier d’Achille, chant XVIII de l’Iliade, était commenté dans les temples par Danco, fille de Pythagore. Homère, comme le soleil, a des planètes. Virgile qui fait l’Enéide, Lucain qui fait la Pharsale, Tasse qui fait la Jérusalem, Arioste qui fait le Roland, Milton qui fait le ParadisPerdu, Camoëns qui fait les Lusiades, Klopstock qui fait la Messiade, Voltaire qui fait la Henriade, gravitent sur Homère, et, renvoyant à leurs propres lunes sa lumière diversement réfléchie, se meuvent à des distances inégales dans son orbite démesurée. Voilà Homère. Tel est le commencement de l’épopée.
§ II
L’autre, Job, commence le drame. Cet embryon est un colosse. Job commence le drame, et il y a quarante siècles de cela, par la mise en présence de Jéhovah et de Satan ; le mal défie le bien, et voilà l’action engagée. La terre est le lieu de la scène, et l’homme est le champ de bataille ; les fléaux sont les personnages. Une des plus sauvages grandeurs de ce poëme, c’est que le soleil y est sinistre. Le soleil est dans Job comme dans Homère, mais ce n’est plus l’aube, c’est le midi. Le lugubre accablement du rayon d’airain tombant à pic sur le désert emplit ce poëme chauffé à blanc. Job est en sueur sur son fumier. L’ombre de Job est petite et noire et cachée sous lui comme la vipère sous le rocher. Les mouches tropicales bourdonnent sur ses plaies. Job a au-dessus de sa tête cet affreux soleil arabe, éleveur de monstres, exagérateur de fléaux, qui change le chat en tigre, le lézard en crocodile, le pourceau en rhinocéros, l’anguille en boa, l’ortie en cactus, le vent en simoun, le miasme en peste. Job est antérieur à Moïse. Loin dans les siècles, à côté d’Abraham, le patriarche hébreu, il y a Job, le patriarche arabe. Avant d’être éprouvé, il avait été heureux : l’hommeleplushautdetoutl’Orient, dit son poëme. C’était le laboureur roi. Il exerçait l’immense prêtrise de la solitude. Il sacrifiait et sanctifiait. Le soir, il donnait à la terre la bénédiction, le « barac ». Il était lettré. Il connaissait le rhythme. Son poëme, dont le texte arabe est perdu, était écrit en vers ; cela du moins est certain à partir du verset 3 du chapitre ni jusqu’à la fin. Il était bon. Il ne rencontrait pas un enfant pauvre sans lui jeter la petite monnaie kesitha ; il était « le pied du boiteux et l’œil de l’aveugle. » C’est de cela qu’il a été précipité. Tombé, il devient gigantesque. Tout le poëme de Job est le développement de cette idée : la grandeur qu’on trouve au fond de l’abîme. Job est plus majestueux misérable que prospère. Sa lèpre est une pourpre. Son accablement terrifie ceux qui sont là. On ne lui parle qu’après un silence de sept jours et de sept nuits. Sa lamentation est empreinte d’on ne sait quel magisme tranquille et lugubre. Tout en écrasant les vermines sur ses ulcères, il interpelle les astres. Il s’adresse à Orion, aux Hyades qu’il nomme la Poussinière, et « aux signes qui sont au midi. » Il dit : « Dieu a mis un bout aux ténèbres. » Il nomme le diamant qui se cache : « la pierre de l’obscurité. » Il mêle à sa détresse l’infortune des autres, et il a des mots tragiques qui glacent : laveuveestvide. Il sourit aussi, plus effrayant alors. Il a autour de lui Éliphas, Bildad, Tsophar, trois implacables types de l’ami curieux, il leur dit : « Vous jouez de moi comme d’un tambourin. » Son langage, soumis du côté de Dieu, est amer du côté des rois, « les rois de la terre qui se bâtissent des solitudes », laissant notre esprit chercher s’il parle là de leur sépulcre ou de leur royaume. Tacite dit : solitudinemfaciunt. Quant à Jéhovah, il l’adore, et, sous la flagellation furieuse des fléaux, toute sa résistance est de demander à Dieu : « Ne me permettras-tu pas d’avaler ma salive ? » Ceci date de quatre mille ans. A l’heure même peut-être où