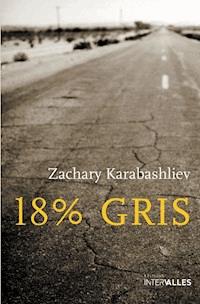
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Recel de drogues entre le Mexique et les États-Unis, loin du rêve américain
Après neuf jours et neuf nuits passés à se lamenter sur le départ de sa femme Stella, Zack franchit la frontière californienne pour noyer son chagrin dans l’alcool mexicain. Au sortir d’une rixe, il se retrouve malgré lui au volant d’une camionnette remplie de marijuana.
Plutôt que de reprendre son travail ingrat dans une société pharmaceutique aux visées purement mercantiles, Zack décide de tourner le dos au rêve américain et de traverser les États-Unis en voiture pour aller revendre la drogue à New York.
C’est le début d’un périple qui le fera également voyager dans ses souvenirs : l’histoire de son amour pour Stella et de leur relation entamée dans la Bulgarie de la fin des années 1980, puis de leur vie reconstruite aux États-Unis.
C’est aussi pour Zack l’occasion d’un voyage halluciné vers une stupéfiante vérité.
Un roman empreint d'éléments autobiographiques qui vous emmènera à l'aventure et vous fera voyager !
EXTRAIT
Cela fait neuf matins qu’elle n’est pas là.
Les stores dans la chambre sont baissés, mais le jour trouve tout de même le moyen de s’infiltrer, en rugissant qui plus est : c’est la benne à ordures. On est donc mercredi. Il est donc huit heures et quart. Y a-t-il bruit plus assourdissant que celui de la benne à ordures à huit heures et quart ?
Je me glisse hors du lit, change de pièce et m’affale sur le divan du salon. Le revêtement de cuir frais ne m’aide pas à m’assoupir de nouveau, et la benne est de plus en plus proche. Je me lève, soulève légèrement l’un des stores et un rayon de soleil éclatant me brûle le visage. Je rassemble toute mon énergie et essaie de détruire du regard le monstre vert qui rugit. Je ne réussis qu’à me réveiller complètement.
Je regarde les freesias dans le vase sur la petite table de verre. Des freesias morts dans une eau trouble, demeurés après son départ.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "Un très beau premier roman qui nous fait traverser les USA d’Ouest en Est"
(Librairie Atout Livre)
- "Un road-movie halluciné vers une vérité... stupéfiante."
(Jean-Luc Aubarbier, L’Essor salardais)
- "Entre parkings de motels blafards et rencontres de paumés, le mythe américain se détricote"
(F.M., Les Dernières Nouvelles d’Alsace)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Zachary Karabashliev est né en 1968 à Varna, en Bulgarie. Il est installé aux États-Unis depuis onze ans.
18 % gris est son premier roman et a reçu le Prix Vick du meilleur roman bulgare en 2009.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En effet, l’homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui se font prendre au filet du malheur, que les passereaux pris au piège. Ainsi, les fils d’Adam sont surpris par le malheur quand il tombe sur eux à l’improviste.
Ecclésiaste, 9 :12
Cela fait neuf matins qu’elle n’est pas là.
Les stores dans la chambre sont baissés, mais le jour trouve tout de même le moyen de s’infiltrer, en rugissant qui plus est : c’est la benne à ordures. On est donc mercredi. Il est donc huit heures et quart. Y a-t-il bruit plus assourdissant que celui de la benne à ordures à huit heures et quart ?
Je me glisse hors du lit, change de pièce et m’affale sur le divan du salon. Le revêtement de cuir frais ne m’aide pas à m’assoupir de nouveau, et la benne est de plus en plus proche. Je me lève, soulève légèrement l’un des stores et un rayon de soleil éclatant me brûle le visage. Je rassemble toute mon énergie et essaie de détruire du regard le monstre vert qui rugit. Je ne réussis qu’à me réveiller complètement.
Je regarde les freesias dans le vase sur la petite table de verre. Des freesias morts dans une eau trouble, demeurés après son départ.
J’ouvre le placard droit de la cuisine et tire une barre de Toblerone du tas de chocolats. Je prends la chemise jetée hier par terre, allume le fer à repasser, repasse d’une main, tandis que de l’autre je détache les triangles de Toblerone et me les fourre dans la bouche, j’enfile la chemise, noue une cravate, fais du Nescafé, en renverse une goutte sur ma manche au moment où je cherche les clefs, mets une veste grise et claque la porte derrière moi.
Dehors brille le énième jour de canicule en Californie du Sud. J’appuie sur le starter de la Toyota. Je tourne dans Jefferson et débouche sur l’autoroute.
Cinq files de voitures dans l’une des deux directions, cinq files dans la direction opposée. Bouchon. Grondement des tuyaux d’échappement, frémissement des moteurs, scintillement des pare-chocs – comme avant une bataille.
Au travail, je pense à elle, je ne peux m’empêcher de lui parler en mon for intérieur – il n’y a pas moyen que ça s’arrête, car l’un de nous d’eux n’est pas là. Puis-je m’arrêter ?
J’essaie.
Voilà : à partir de maintenant, je ne penserai plus à elle. Je ne penserai plus à elle. Je ne penserai plus à elle, je ne penserai plus à elle, je ne penserai plus à elle, non.
Je vais faire du yoga, ouvrir mes chakras, répéter OM jusqu’à ce que j’aie purifié mon cerveau, je vais manger du riz avec les doigts, je vais me laisser pousser la barbe, faire la chandelle…
OMmmm.
OMmmmerde, j’en ai marre de penser à elle.
OMmmmmmerde, j’en ai marre de penser à elle.
OMmmmmmmmmmerde, j’en ai marre de penser à elle.
À la réunion du matin, Scott, le chef, annonce les énièmes changements structurels qui vont intervenir dans le service, la table est couverte de paquets de beignets, de jus d’orange, de café fumant… L’étude clinique… Pourquoi la clim’ est-elle si forte ici ? … dans sa dernière phase… Ommmm… après qu’auront été précisés certains… Pourquoi le café est-il aussi léger et acide ?… chacun devra prêter attention au protocole… Ommmm… formulaire 1574… dans les hôpitaux… Ommmm… je veux que chacun examine encore une fois la documentation IRB avant de terminer… Qu’est-ce que je fous ici ? … pour que le personnel soignant respecte strictement… Qui sont tous ces gens ? Scott, le chef, distribue à chacun son programme personnel du prochain trimestre, dans ses yeux cette vivacité, cette vivacité, il nous serre énergiquement la main, comme savent le faire uniquement les personnes de petite taille, il garde la mienne un peu plus longtemps. Où suis-je ?
Ensuite, chacun se dirige vers son cubicle1 gris pâle tandis que Scott me fait signe de le suivre dans son bureau gris foncé et minimaliste : une table de travail, un moniteur, une petite machine à café et une fontaine à eau au-dessus de laquelle est affiché un poster avec une longue barque (canoë ? kayak ?) avec des rameurs. Sous la photo est écrit « travail en équipe ».
Scott dit quelque chose d’une voix soucieuse. Il me scrute avec ce regard-là. Je n’entends pas ce qu’il me raconte, je me contente d’opiner de la tête, j’ai envie de vomir. Ce regard-là. Je ne me rappelle pas comment se passe le reste de la journée. Exécrablement, je suppose.
Alors que je rentre du travail, à l’heure de pointe, le flot de voitures ralentit et s’arrête au feu de la 11e avenue et de Broadway. Quelque part, devant, des policiers redirigent la circulation, je vois leurs gilets orange, les signaux « Stop » dans leurs mains, leurs gestes. La masse blanche d’un camion affaissé en plein milieu de la chaussée. Il fait très chaud. Je tente de changer de file au dernier moment et de prendre ingénieusement le haut de Cedar street, mais je n’y parviens pas, le connard de droite m’en empêche. Je vais être obligé de rester coincé dans l’embouteillage, comme tous les autres. Je jette un coup d’œil à gauche : un homme de cinquante ans et des poussières, cheveux gris, hâle californien et rides ; il est en train de se curer le nez tout en essayant de suivre tout en haut dans le ciel un avion avec un drapeau rouge déployé portant une inscription. J’essaie moi aussi de lire ce qui est écrit dans le ciel derrière l’avion et je me surprends à me curer le nez. Je regarde l’avion dans le ciel, l’homme à gauche. Le coude gauche sur la fenêtre grande ouverte, l’index droit dans le nez, les cheveux gris. Voilà à quoi je ressemblerai dans une vingtaine d’années. Un léger coup de Klaxon, derrière, me fait sursauter et j’appuie avec colère sur l’embrayage pour passer en première. La pédale s’enfonce tout à coup. J’appuie plus fort, je tire et pousse le levier de vitesse, mais il ne bouge pas. Je vois l’homme aux cheveux gris et au doigt dans le nez s’éloigner. Le feu est toujours vert, mais je sais que ça ne va pas durer éternellement. J’empoigne le levier avec plus de force (et hop ! Orange), j’entends des coups de Klaxon de plus en plus impatients dans mon dos. Canicule insupportable (ça passe au vert), une journée plus longue que les autres (rouge éclatant). Je sens toute la fureur des comptables, avocats, conseillers municipaux, secrétaires, employés de banque, hôteliers, informaticiens, serveurs, ingénieurs, agents immobiliers qui ont travaillé depuis sept heures ce matin, la colère de toutes les forces travailleuses de cette rue se concentrer sur ma petite voiture. S’il y avait quelqu’un pour coordonner leurs pensées, d’un seul regard collectif ils me jetteraient dehors, sur le port, avec les SDF et les drogués.
Je me mets à chercher les feux de détresse, je ne sais pas où ils se trouvent. Derrière, anonymes dans leurs moyens de transport, les connards sont de plus en plus nombreux à klaxonner. Je vois dans le rétroviseur leurs visages qui se veulent impassibles, mais je sais qu’en bas ils appuient sur le Klaxon. Je transpire. Est-ce qu’ils ne voient pas que je suis dans le pétrin, est-ce qu’ils ne comprennent pas que je me sens minable ? Les plus intelligents mettent leur clignotant à gauche et dépassent mon véhicule immobilisé. Quant aux autres, ils ne veulent pas admettre que je suis en panne. Le négativisme des gens m’atteint toujours là où je suis le plus vulnérable. C’est-à-dire sous les aisselles. Il suffit d’un fort stress et d’une canicule comme celle d’aujourd’hui pour qu’elles se mettent à transpirer, dégageant une odeur de soupe à l’oignon. Qu’ils m’énervent encore un peu et je vais sortir de la voiture, étendre les bras comme la statue qui surplombe Rio et les faire détaler par cette odeur. Ils vont détaler ! Jaillir de leur véhicule, en proie à la panique, et fuir en se bouchant le nez le plus loin possible, comme dans le film Godzilla. Pour finir, il ne restera au croisement de la 11e et de Broadway que moi, bras étendus, et leurs voitures abandonnées aux portes grandes ouvertes qui piauleront. Elles feront piou-piou-piou-piou, comme de petits poussins, piou-piou-piou-piou, et moi je marcherai à grands pas triomphants et j’éclaterai d’un rire sinistre et sonore. Je trouve soudain le bouton des feux de détresse, j’appuie dans un dernier effort et bondis hors de la voiture, à moitié asphyxié par ma propre odeur. Dehors, l’air est chaud et sec. Je fais des gestes d’excuse en direction de ceux qui se trouvent derrière moi, ma chemise est trempée de sueur, je défais ma cravate, souris d’un air un peu confus, hausse les épaules (ça peut arriver à tout le monde) tout en violant mentalement tous les êtres chers au cœur de toutes ces lavettes qui évitent maintenant mon regard, qu’ils aillent se faire foutre.
D’un téléphone public j’appelle une entreprise pour qu’elle vienne et emporte ma voiture en panne.
Un type au faciès vietnamien arrive avec une dépanneuse qui transportera la Toyota jusqu’à un garage. Il me réclame quatre-vingts dollars.
Je lui demande à quel ordre libeller mon chèque. Il secoue la tête : pas de chèque. Moi non plus, y a tellement de choses que je n’ accepte pas !
– Cash, il veut, cash.
– Cash ? je dis, j’ai pas de cash, comment j’aurais du cash ? Je lui fais un chèque de quatre-vingts dollars et le lui tends.
– Non, répond le Vietnamien en secouant la tête. Cash, cash.
– Cash, cash, et mon cul, c’est du goulasch ?
– Hein ? Il fronce les sourcils, il n’a pas compris.
Moi non plus je ne comprends pas pourquoi Stella n’est pas là, pourtant… Le Vietnamien comprend qu’il n’y a rien à en tirer et décide de prendre le chèque, mais en augmentant la somme.
J’écris un nouveau chèque de quatre-vingt-dix dollars.
– À quel nom ?
– Howah.
– Howah ?
– Non.
– Howar ?
– Non.
– Howard ?
– Howah.
– D’accord, Howard.
Regarde-moi ça, ces Asiatiques qui se donnent eux-mêmes des noms aristocratiques ! J’en n’ai jamais vu qui s’appellent Bill ou Bob. Bon, va pour Howard. J’écris « Howard Stern2 » et lui tends le chèque.
– Non ! Non ! crie-t-il, pas « Howard Stern » !
Il déchire le chèque. Howah !
– Howard comment ?
Je suis furax. Il m’arrache le chéquier des mains et écrit lui-même son nom : Hau Ua.
– A-a-a-ah, là j’ai envie de rire, je lui donne une bourrade sur l’épaule. Je connais beaucoup de Vietnamiens, Hau, des braves gens.
Hau me regarde d’un air impassible.
– Des braves gens – je répète – … les Vietnamiens.
– Moi venir du Laos, rétorque Hau en me tournant le dos.
Je sais qu’au garage ça va me coûter la peau des fesses. Tant pis.
Je prends un taxi et rentre à la maison. Silencieuse et sombre. J’arrose les plantes du jardin, elles n’y sont pour rien. Le chat des voisins se montre à la porte, discret et orange. Il a envie de jouer avec quelqu’un. Moi aussi, j’aimerais bien jouer avec quelqu’un, mais je n’ai personne. Je lui demande : « Elle te manque, Stella ? » Il pousse un miaulement qui veut dire oui. Stella lui achetait des boîtes de conserve. Elle affirmait qu’il préférait la perche d’océan. Je trouve les boîtes sous l’évier et en ouvre une. Je la sors dans le jardin et la pose sous le chevalet où est posé son dernier tableau, abandonné, recouvert d’un drap maculé de bleu. J’observe un certain temps le chat en train de manger avec gourmandise. Je lui avais offert ce chevalet pour Noël, cinq ans auparavant. Je soulève un bout du drap et regarde le tableau. Je ne le comprends pas. C’est son unique tableau dans notre maison (tous les autres sont soit dans son atelier soit entreposés), et il est inachevé. Et si je le jetais à la poubelle ?
J’ai faim. Je me retourne et, sans le vouloir, heurte du pied un pot contenant de la peinture qui n’a pas encore séché et des pinceaux. Il se renverse et il en sort une tache de forme et de couleur peu ragoûtantes. Furieux, je lui donne un coup de pied et il se brise en mille morceaux. Je donne un coup de pied aux autres pots qui se cassent eux aussi en mille morceaux.
Dans le réfrigérateur, il ne reste que de vieux légumes d’avant son départ et une canette neuve de bière achetée après son départ. Depuis un certain temps, ma vie est divisée en deux parties, il y a avant et après son départ. La seconde partie, c’est neuf jours de solitude. Une solitude que je ressens le plus intensément dans ce fragment de temps entre le jour et la nuit, pas encore le soir, plus vraiment le jour. C’est la plus grande solitude. Le monde se délasse après le travail et moi je ressasse son absence. Aussi seul que l’homme des neiges, j’erre dans mes pensées sans trouver de refuge, sans trouver…
« … Tu as besoin de rester seul. De décider ce que tu vas faire de ta vie… » Je me taisais. Regardais CNN et me taisais (qu’est-ce qu’il y avait aux nouvelles à ce moment-là ?). Que pouvais-je dire ?
Dans la boîte à pain, je trouve une demi-baguette desséchée. Je la renifle, elle n’a pas encore moisi. Je sors une boîte de conserve sur laquelle est dessiné un sombrero bigarré avec l’inscription « El Cowboy », je verse son contenu dans une petite casserole, je la mets sur le feu. Je tourne de temps en temps. Ça commence à sentir le haricot sec assaisonné à la mexicaine. Elle n’aime pas les fayots. Elle n’aime pas non plus les épices mexicaines. Je vais mettre de la musique. Tout en farfouillant parmi les disques et CD, j’entends « pffffffffff ». Les fayots bouillent et débordent sur la cuisinière. J’entreprends de nettoyer avec une éponge avant que ça n’ait séché. Tout à coup, l’intérieur de ma main, là où la peau est la plus fine, colle au récipient brûlant. La douleur ne me fait même pas crier, pourquoi crier, putain de main ! Putain de conne de main ! Putain de main ? Tout à coup, l’idée de porno ne me semble pas aussi déplacée qu’il y a une semaine et demie. Après les fayots pimentés, je peux bien m’offrir la récompense d’une branlette pénarde.
J’étale une nappe. Mets des couverts et une serviette. Sors un bocal de piments Peperoncini et lui fais de la place sur la table. J’allume une bougie. Je place mon assiette au milieu de la table, deux bières dressées à côté. Je prends la télécommande et allume la chaîne Hi-Fi.
« Hérodiade », air de Salomé. Je pousse le son très fort, comme je ne l’ai jamais fait lorsqu’elle était là. J’émiette le pain sec dans mon assiette et avale bruyamment les grosses bouchées brûlantes en les roulant dans ma bouche jusqu’à ce qu’elles refroidissent. Les fayots, c’est une véritable aventure, il faut les manger brûlants et pimentés, sinon ça ne ressemble à rien.
Le premier acte dure cinq minutes et neuf secondes. Le temps qu’il retentisse, j’ai vidé mon assiette et écouté, les yeux fermés, pendant trois minutes. Le téléphone sonne sur le dernier accord. Je ne décroche pas. Je n’ai pas décroché une seule fois depuis que Stella n’est plus là.
Laissez votre message !
« Zack, tu es là ? » J’entends la voix d’un certain Tony qui, depuis un certain temps, appelle matin, midi et soir.
« Je te cherche matin, midi et soir. Il faut qu’on se parle. Rappelle-moi, s’il te plaît. Ciao. »
Trente-trois messages non écoutés clignotent en rouge sur le répondeur. Pas un seul d’elle.
Je regarde autour de moi.
Tout est à sa place dans cette maison, parce que c’est elle qui a tout laissé ainsi. Chaque objet, ici, porte ses empreintes. Et moi, j’essaie de m’habituer à l’illusion qu’elle n’est pas là.
La séance porno est plutôt morne. Des corps montrent furtivement à l’écran leur nudité rose et, en fin de compte, tout se termine dans une serviette en papier. Je la jette à la poubelle avec de vieux journaux, des enveloppes de factures et de la pub. Je m’apprête à me coucher. Je me lave les dents et le visage avec soin et éteins partout. Je m’allonge sur la moitié droite du lit. La sienne, la gauche, je la ressens comme une blessure.
La tristesse m’étouffe.
Je contemple longuement le plafond sombre, puis je roule là où elle dormait jusqu’à il y a neuf nuits. Je me recroqueville, embryon de presque deux mètres, et serre mon cœur avec mon corps. Il est comme le matou des voisins : il ne comprend pas les mots. Il ne comprend pas encore qu’elle n’est plus là. Le cœur est un animal.
+
1988, Varna, Bulgarie
Stella…
Je l’ai vue pour la première fois peu avant d’être libéré du service militaire. On m’avait accordé une permission et j’avais erré toute la journée dans la ville avec ce regard affamé de troufion qui pousse les filles à changer de trottoir. Par-dessus le marché, j’avais la boule à zéro. C’était par un chaud après-midi de la fin de mai et les tilleuls embaumaient, tandis qu’au centre-ville, c’était le bazar. En creusant les fondements de ce qui devait devenir un immense centre commercial, les pelleteuses avaient mis au jour des ruines antiques. On avait alors procédé à des fouilles et on avait trouvé les vestiges d’une arène romaine, si bien que, maintenant, la moitié du centre-ville s’était transformée en chantier archéologique. Je me suis dit qu’il valait la peine de pousser jusque-là et de voir ce qui se passait.
Il ne se passait rien : ce n’était qu’un grand trou dans la ville, rempli d’élèves blasés qui nettoyaient de vieilles pierres avec des brosses.
J’avais arpenté le centre-ville en long, en large et en travers, je voulais manger un morceau. Je suis entré dans un salon de thé et je l’ai vue. Ses lèvres d’abord ? Non, d’abord les yeux, puis les lèvres. Puis les seins, ses seins bien ronds qui bombaient le tablier de son uniforme. Puis la boucle de cheveux châtain clair retombant jusqu’à la fossette de la joue. Et l’impression de fatalité.
Et alors, la peur que, quoi que j’entreprenne à ce moment-là, ce serait inutile. Elle était la plus jolie fille de cette ville, il était impossible qu’elle ne soit pas la petite copine de quelqu’un. Il était impossible qu’il n’y ait pas un heureux en train de compter les minutes jusqu’à ce qu’elle ait fini sa journée. Les miracles, ça n’existe pas, me suis-je dit, et je suis sorti.
+
Tout à coup, quelque chose saute dans mon estomac et se crispe en une petite boule dure. Je m’assieds sur le lit et fixe du regard les veines argentées de l’obscurité. Je tends l’oreille. Y a-t-il quelqu’un dans la chambre ? Je retiens ma respiration et m’efforce de percevoir une présence dans le salon. Je suis prêt à parier qu’il y a quelqu’un. IL Y A quelqu’un. J’entends bouger les stores de la terrasse. Je me lève avec précaution. Tends le bras vers la lampe de chevet, débranche le fil, l’enroule et attrape le pied métallique : il fera l’affaire. C’est alors que je prends conscience d’être nu. Je ne peux pas bondir dans le salon et me lancer à la poursuite du malfaiteur dans la maison comme dans un film suédois, ça ne se fait pas. Dans l’obscurité j’aperçois les trois bandes blanches de mon pantalon de survêtement près du lit. Je l’enfile sans faire de bruit et sans lâcher la lampe de chevet et je m’approche de la porte. J’y colle l’oreille, m’efforçant d’entendre quelque chose.
J’entends le tic-tac de la pendule. J’entends le ronronnement du réfrigérateur. J’entends le sang dans ma tête. J’entends un autre bruit, à peine perceptible. Je prends une profonde inspiration, ouvre brusquement la porte et bondis bruyamment dans le salon.
Personne. Mais, sur la terrasse, quelque chose se met à cliqueter, je m’y précipite. Un raton laveur paniqué essaie d’escalader en griffant le parapet, mais sa patte arrière droite est coincée dans la boîte de conserve pour chats. Je lâche mon arme improvisée et éclate de rire.
Tiens, tiens, tu as eu envie de manger de la nourriture pour chats, hein, mon gros ! J’ai envie de pousser son gros derrière, de l’aider, mais je sais que je vais l’effrayer encore davantage. La boîte tombe enfin de sa patte et va rouler sous la chaise, tandis que l’animal rampe sur tout le parapet. Il s’arrête un instant sur le rebord et me jette un dernier coup d’œil.
Hé, je lui crie, tu ressembles à un brigand avec ce bandeau noir ridicule sur les yeux. Espèce de Zorro, va ! Tu m’as fait sacrément peur, allez, ouste !
Je doute pouvoir me rendormir rapidement après cet incident. Je reste un instant sur la terrasse. En bas, le canyon bruisse, le palmier, dans le jardin, se courbe. Le vent s’est levé. L’un de ces vents qui se précipitent en automne des froides montagnes, sifflent à travers le désert brûlant, desséchant tout sur leur passage en un rien de temps, avant d’atteindre les vagues de l’océan Pacifique. L’un de ces vents malades, secs, qui portent le nom d’une sainte, Santa Ana.
J’enfile un blouson, sors et prends à gauche au feu tricolore. Je tourne à droite, je ne sais pas où je vais, je ne me demande même pas où je vais déboucher. Je reprends mes esprits quelque part près de l’autoroute, dans l’un de ces nouveaux complexes d’habitation aux lacs artificiels, aux petites cascades coquettes, aux petites rivières mues à l’électricité et traversées d’un petit pont en bois décoré de lanternes made in China. Je marche sur le sentier qui serpente entre les immeubles, tâchant de jeter un coup d’œil, là où je le peux, à travers les fenêtres des gens. On distingue entre les stores les reflets bleutés de postes de télé, des photos encadrées et accrochées aux murs, des affiches de stars du cinéma dans les chambres d’enfant, des pianos refermés, des bougies éteintes, un calendrier avec une vieille photo de Manhattan, une reproduction de Thomas Kincaid…
La normalité de cette nuit m’est une insulte.
Insultante, la pensée que, tôt ou tard, ils vont tous éteindre leur écran, se laver les dents et s’endormir, ensuite ce sera de nouveau l’aube et le jour viendra, comme si de rien n’était. Insultante, l’idée que demain, le ciel au-dessus du quartier sera le même que quand Stella était là.
Insultant, le fait que les cratères de la lune seront les mêmes, le sel de l’océan, le même, le pourcentage d’octane d’essence, de sucre dans le Pepsi, les mêmes. Certaines choses demeurent tout simplement les mêmes.
Insultante aussi, l’idée que les gens continueront à travailler aux compagnies de gaz et d’électricité, qu’il y aura des professions telles que chauffeur, fleuriste, comptable, facteur ou réceptionniste.
Insultants, les mots comme évier, tuile, soukman3, gombo, gaufre, dessin…
Insultante, la pensée que quelqu’un, en ce moment, écrit un livre sur tout cela.
Insultant, de me dire que d’autres se sont sentis insultés par les mêmes choses.
+
– regarde dans ma direction
– j’ai soif
– regarde l’objectif
– j’ai froid
– s’il te plaît
– je voudrais du café…
– c’est fini
– je veux m’habiller, maintenant…
– une dernière pellicule et je te laisse tranquille
– dernière ?
– dernière
+
Je rentre à la maison, saisis les clefs de sa voiture de sport que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire, éclaire le garage. J’ouvre et entre. Avant de mettre le starter, je ferme les yeux et laisse aller ma tête en arrière. L’intérieur, qui n’a pas été aéré depuis qu’elle n’est plus là, est imprégné de son odeur. Je la hume bruyamment. J’allume le moteur. La porte du garage se lève et je m’élance dehors en faisant crisser les pneus dans le silence de minuit. J’ouvre toutes les fenêtres pour chasser sa présence. Un vent froid souffle du canyon. Je m’arrête au feu en arrivant sur l’Interstate 5. À une heure d’ici environ, au nord, c’est West Hollywood, Los Angeles. J’ai chez qui aller. À moins d’une heure, au sud, le Mexique. Je n’ai pas de raison de m’y rendre. Je dois décider quelle direction prendre avant que le feu ne passe au vert.
Feu vert, j’enfonce l’accélérateur.
+
Les miracles, ça n’arrive pas, me répétais-je intérieurement tout en traversant la rue. Elle était jolie avec ses yeux bleus, ses grands seins et son visage intelligent qui n’accorderait aucune attention à un troufion au crâne rasé en permission. Je n’avais pas approché de fille depuis deux ans. Avant la caserne, j’étais, disait-on, très drôle et j’avais beaucoup d’amis, mais je ne savais comment me comporter avec les filles et il faut croire que je n’apprendrai jamais. Je m’efforçais toujours de trouver quelque chose d’intéressant et d’amusant, et je rentrais toujours seul, alors que les plus ennuyeux de la bande embrassaient des filles sous les tilleuls. J’étais un boulet, un vieux, un sacré boulet. Je marchais dans les rues, en direction de la plage, me donnais des gifles en pensée, mais je savais, je savais avec une impitoyable clairvoyance que, cette fois-ci, j’avais vu et éprouvé quelque chose de différent. Évidemment, je bandais, comme chaque fois que mon imagination enflammée se représentait une jolie fille, mais, cette fois, il y avait quelque chose de plus. Ma pensée – aussi absurde que cela puisse paraître pour un troufion – ma pensée bandait elle aussi cette fois-ci, mon esprit était excité. Traversant les fraîches allées du parc maritime, je suis arrivé près d’une rangée de bancs occupés par des grands-mères et des grands-pères. J’en ai trouvé un de libre, on voyait la mer, l’horizon et le ciel. À gauche, c’était le nord, à droite le phare du Cap Galata, devant moi, la plage centrale et, derrière, l’amour de ma vie.
Prenant une profonde inspiration, je me suis levé et dirigé vers elle.
+
– tu me prendras toujours en photo ?
– toujours
– et si je deviens une grosse dondon ?
– quand même
– avec un cul énorme ?
– j’aurai encore plus à prendre en photo
– vrai ?
– vrai
– t’inquiète, je ne serai jamais une grosse dondon
– on verra
– je ne serai jamais une grosse dondon
+
Je gare la voiture devant le McDo, côté américain, je n’ai pas envie de conduire au Mexique. Je franchis à pied la frontière avec le Tiers Monde. À Tijuana, les chauffeurs de taxi bavardent devant leurs voitures, décortiquent des graines, regardent les passants, comme le font tous les chauffeurs de taxi au monde.
– Hola !
– Hola ! répondent ceux qui sont le plus en avant dans la rangée. Je monte.
Où vais-je ?
Avenida Revolución. On démarre. Un rap mexicain retentit dans la voiture, accompagné par un accordéon ; près du petit sapin accroché au rétroviseur se balance une croix en plastique avec un Christ doré. On s’arrête avant la fin du morceau. Je paie. Sors. Inspire profondément. En ce jeudi nocturne, la Plaza Revolución retentit des haut-parleurs de toutes les boîtes de nuit, elle est imprégnée de l’odeur des grils de rue, me regarde avidement avec les yeux de chaque vendeur et quémande mon argent de chaque main qui se tend. Partout il se passe quelque chose autour de vous.
Sur le trottoir, près de moi, un couple de mariachis s’évertue à chanter tout en jouant d’une grande guitare mal accordée : personne ne fait attention à eux. Sous le réverbère, un chien étire avec ses dents un chewing-gum collé au trottoir. Suspendu par une corde au toit de la discothèque la plus proche, qui porte l’inscription « Spiderman », l’homme-araignée passe au-dessus de la tête des passants, d’une extrémité de la rue à l’autre. Sur le trottoir d’en face, un âne, peint en noir et blanc pour ressembler à un zèbre, a les oreilles baissées. Le zèbre est attelé à une charrette décorée comme un œuf de Pâques. « $5. Foto. Viva Mexico ».
Des gens, des gens, des gens… C’est pour ça que je suis là… des gens-des gens-des gens-des gens-des gens-des gens-des gens… L’énergie de Tijuana bat dans chaque aorte au sud de la frontière, elle grouille dans chaque microbe. Cette énergie m’aspire hors de la maison vide près du canyon, de l’Amérique qui ira travailler demain.
J’entre dans le premier bar. Le barman, heureusement, parle anglais. Je lui demande s’il peut me faire une vodka-Martini.
Si, señor.
Il a des olives ?
Si, señor.
Il peut faire un Dirty Martini ?
Si, señor.
Donc, le señor veut un Dirty Martini avec trois olives, OK ?
Si, señor.
Trois Martinis plus tard, le señor jette un regard circulaire. Si je l’avais fait avant de m’asseoir, me dis-je, je ne serais sûrement pas resté. C’est quoi ce bar ? Tout est sale, sombre, ça empeste. Dans un coin, on a cloué un coffre pour le poste de télé qui projette l’immuable match de foot. Quelques clients aux chapeaux de cow-boys regardent le coffre avec le match tout en levant des bouteilles de bière vertes. Chaque fois que la pub commence, ils se retournent et me regardent. Je paie et je sors.
Dehors, Tijuana m’accueille à bras ouverts dans une étreinte moite. Des vendeurs à la voix criarde me tirent à gauche et à droite pour me faire entrer dans leurs échoppes suffocantes.
Je me rue dans un autre bar. Cette fois, je regarde attentivement les clients qui m’entourent. Dans le coin on a cloué un coffre pour le poste de télé qui projette un match de foot. Les hommes portent des chapeaux de cow-boys, ils regardent l’écran et le match. Arrive la pub et les chapeaux se tournent vers moi. Je reste. Même scénario que dans le bar précédent. En partant, les escaliers me semblent plus drôles.
Dehors, les mêmes pulsations de la chaude nuit mexicaine. Il me faut maintenant une panocha4 ImmÉdiAtemEnt ! Je veux une panocha !
Un cou épais et tatoué me tire vers le haut dans une cage d’escalier éclairée. Une maison close ? Non, non : on m’a traîné dans une discothèque. La musique retentit, electro-latino. À chaque pulsation, les lumières changent de couleur, de même que les filles qui sont dessous. C’est rempli de filles. La serveuse a de gros seins et les fourre sous mon regard éméché.
Qu’est-ce que je veux boire ?
Martini, je hurle.
Elle apporte Margarita.
Va pour la Margarita.
Le dancing est bondé. Les clients : des troufions américains, des maquereaux mexicains, des prostituées teintes en blond, des dealers et autres paumés comme moi. Pendant que les gens normaux, au nord de la frontière, se reposent avant d’affronter une nouvelle journée de travail, Tijuana ne dort pas. Une heure plus tard peut-être, je comprends que, si j’ai commis une erreur jusque-là durant cette nuit, elle porte le nom de Margarita. Lumières, corps, miroirs, nibards, sueur, verres, tables, chaises me font tourner la tête.
Dans les toilettes, un petit grand-père aux fines moustaches et portant un nœud papillon distribue des serviettes en papier et attend la monnaie. Je fouille dans mes poches, tire des dollars tout froissés, les lâche dans la soucoupe. Je titube, me retiens, trouve le lavabo, m’asperge d’eau. Dans le miroir souillé, un inconnu au visage gris me regarde. Il fait la grimace. Moi aussi.
Paraît que sa femme l’a quitté.
Hou-hou ! Waf-waf ! Moi aussi, à sa place – lui dis-je – je t’aurais largué.
Je sors des toilettes, la serveuse aux gros seins m’accueille avec une autre Margarita.
Mais, j’en n’ai pas commandé, non.
Si – les nibards frémissent.
Si, mais non.
Si, si, si, señor. Les nibards insistent.
Je n’ai rien commandé.
Les nibards se fâchent et rebroussent chemin. Tiens donc, les nibards appellent les gardiens !
Je sors de l’argent et la rattrape. Les Mexicains comprennent l’anglais quand ça leur chante. Je paie sans broncher. Je bois cul sec la Margarita douceâtre et fourre le verre dans la poche de ma veste : puisqu’on me fait un chantage, je vais le piquer. On se comporte avec moi comme avec le gringo le plus ordinaire. Je suis peut-être borracho5, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Et je ne suis pas un gringo. Brusquement, tout se met à tourner devant mes yeux, encore plus atrocement, oh-oh, je vais mourir. Je titube en descendant les escaliers, saisis la rampe à deux mains, m’arrête devant le cou tatoué. Merde, je vais mourir ici. J’essaie d’étreindre le garde du corps et bégaie panocha. Il faut que je me tape une panocha avant de mourir. Je veux une panocha.
Le cou sourit jusqu’aux oreilles – panocha, si, si. Il fait le geste de tous les imbéciles. Fucky, fucky, hein, señor ?
Fucky, fucky, oui.
Fucky, fucky ?
Vas-y, trouve une panocha avant que je ne meure.
Il montre du doigt un type de l’autre côté de la rue. Je n’arrive pas à concentrer mon regard. Je me dirige dans cette direction, mais le trottoir s’arrête sans crier gare. Me voilà sur le boulevard, je titube et retrouve avec peine mon équilibre. Un bossu vêtu d’une immense cape blanche fait irruption et me tire à l’écart.
Donkey show, donkey show, donkey show, donkey show…
Je ne comprends rien à ce qui se passe. À gauche, un marin serre une pute dans un coin et fourrage dans sa petite culotte, tandis qu’elle me sourit par-dessus son épaule.
À droite, appuyé contre un mur écaillé, un homme sans jambes tend un gobelet en plastique, il veut un dolla.
Une fillette de cinq ans tout ébouriffée lèche la morve qui lui coule du nez et tend un gobelet en plastique, elle veut un dolla.
Une Indienne, un bébé contre ses seins qui pendent, tend un gobelet en plastique, elle veut un dolla.
Une petite vieille borgne tend un gobelet en plastique, elle veut un dolla. Dolla-dolla-dolla-dolla. Tous veulent un dolla. Tout à coup, quelque chose vole bas au-dessus de ma tête dans un fracas et je parviens à m’accroupir au dernier moment pour éviter le choc : l’homme-araignée.
Donkey show, donkey show, donkey show, donkey show : le bossu à la cape blanche bouge son derrière – fucky, fucky.
Je n’y comprends rien.
Donkey fucky señorita.
Ah-ah, un spectacle avec un âne et une femme nue, ça me semble soudain tout à fait approprié. Je le suis.
Donkey show, donkey show, donkey show…
Nous traversons Revolución et descendons les escaliers d’un passage latéral. Le nain à la cape blanche s’arrête devant une porte écaillée au-dessus de laquelle pend une ampoule sale et appuie sur la sonnette. La porte s’ouvre, une tête rasée apparaît. Le bossu tend la main : dolla. Je lui donne un dollar et sa cape disparaît plus haut dans les escaliers. Je paie la tête rasée pour pouvoir entrer et descends quelques marches.
Un bar enfumé aux boxes lie de vin, aux lambris marron et aux colonnes peintes en noir entourées de guirlandes de Noël. Dans un coin est fixée une petite scène devant laquelle se trouvent quelques tables rondes remplies de canettes de bière froissées, de cendriers avec des mégots ; des uniformes de marin s’amusent, des blousons de cuir et des chemises hawaïennes. Aux murs sont accrochés des posters décolorés à l’effigie de bières mexicaines : Corona, Dos Equis, Tecate. J’entre au moment précis où la musique s’arrête et viens me planter près du bar, tout à l’arrière, derrière plusieurs rangées de dos masculins. Je me hausse sur la pointe des pieds. Les regards sont dirigés vers des rideaux de peluche rouge qui s’ouvrent, deux personnes traînent un âne gris avant de se cacher derrière le rideau.
Cris d’approbation. Des mains tendent des dollars vers le barman qui distribue des bières.
Les rideaux s’ouvrent à nouveau, laissant apparaître une femme brunâtre et nue, d’âge moyen, aux jambes très courtes, à la poitrine affaissée et au ventre distendu. Je l’imagine des pinces à la bouche, en train d’étendre le linge. Elle porte des sandales blanches vernies à hauts talons et ses jambes se rejoignent en haut par une touffe noire fournie. Ses cheveux sont teints au henné, elle est mal maquillée et ses sourcils ont d’abord été épilés, puis dessinés. Des exclamations fusent çà et là dans le public.
Hé, bande d’ingrats, qu’est-ce que vous voulez contre cinq dollars ? Shakira ?
Après un court prélude, la Mexicaine commence à se glisser sous l’animal. Il s’écarte. Elle saisit son organe et se met à le masturber avec énergie. L’âne secoue la tête et montre ses grandes dents. La femme poursuit ses mouvements un certain temps sans que l’âne réagisse. La femme agite plus vite sa main.
Tout à coup, l’âne renâcle et tord le cou pour la mordre, mais il n’atteint qu’à peine ses cheveux. La femme se glisse de là avec force jurons et, en colère, s’adresse en criant à quelqu’un qui se tient derrière les rideaux. Les deux Mexicains accourent ; l’un d’eux saisit la gueule de l’animal d’une main et, de l’autre, frappe un grand coup dans ses dents.
Oh-oh-oh-oh-oh ! s’écrie la foule compatissante.
L’animal renâcle et fait un bond en arrière, mais deux autres Mexicains moustachus en uniformes de mariachis font irruption et le mettent gentiment par terre sur le dos. L’un d’eux, sa guitare sur son dos, coince la tête de l’animal entre les jambes arquées de son pantalon et le saisit fermement sous les sabots de devant pointés vers le plafond. Son collègue, son accordéon dans le dos, l’attrape par les pattes de derrière.
La femme travaille désormais à deux mains en vue de l’érection de l’âne.
Le public, inquiet quelques minutes auparavant à l’idée d’avoir perdu son argent (comme c’est habituellement le cas à Tijuana), ne ménage pas ses cris d’approbation.
L’âne y répond à une échelle impressionnante. Quelqu’un applaudit.
Une touriste pétée part d’un grand rire hystérique. Au moment où la femme sur la scène suce le tuyau de l’âne, je tourne le dos au spectacle, écarte les gens qui se trouvaient derrière moi et monte les escaliers pour vomir la Margarita et tout ce que j’ai dans les tripes. Me voilà dehors à tituber, j’ai la tête qui tourne et envie de me coucher. Je tourne à l’angle d’une petite rue et m’appuie contre le mur. Je respire difficilement et me force à vider tout le poison de mon estomac.
C’est alors que je les vois. Je me dirige vers eux tout en prenant appui contre le mur.
Le corps est affalé sur le trottoir, deux hommes le rouent de coups de pied, en silence et avec indifférence. Je suis sous le choc. Je m’arrête un instant. Comme dans un rêve, je n’entends que le son sec des coups de pied. Je vois la tête du mec par terre rebondir sous les coups.
– Hé, je crie. Je ne supporte pas la violence. Mais ça, ça ne ressemble même pas à de la violence. Personne ne crie, personne n’est en colère. Deux personnes rouent de coups de pied une troisième sans y mettre aucune émotion, comme s’ils secouaient la boue de leurs chaussures. Je m’approche en prenant toujours appui au mur.
L’un d’eux se retourne et me regarde sans bouger. L’autre n’interrompt pas ce qu’il est en train de faire. Les deux hommes sont plus costauds que moi, avec des blousons noirs et des cheveux noirs coupés court. À un moment donné, le premier s’arrête lui aussi. Ils attendent que je m’approche. Le corps, sur le trottoir, bouge, Dieu soit loué.
Je souris et lève la main pour saluer.
– Hola, amigos ! C’est la dernière chose que je parviens à prononcer.
Coup de poing dans la mâchoire avant que j’aie vu d’où il venait. Le trottoir me reçoit sur le nez avec dureté. Un coup de pied dans les côtes me soulève de terre. Je parviens à me redresser à moitié et à recevoir un autre direct dans la tête. J’aperçois les marches qui descendent, un garde-fou. Je le saisis, dégringole, trébuche, manque une marche, roule, roule encore… Ils sont quelques mètres derrière moi. Je vole dans les escaliers. Je tente de saisir de nouveau le parapet, mais sans pouvoir me retenir. Je trébuche de nouveau et culbute. Je roule et roule longuement. Je m’arrête lorsque ma tête vient résonner contre une porte de fer blanc. Leurs silhouettes résonnent dans les escaliers. Je vois briller leurs chaussures tandis qu’elles volent vers moi. Ils me donnent plusieurs coups de pied. Me tirent par le col. L’un d’eux allume un briquet et m’examine. Ils me traînent sur les marches vers le haut. Me voilà sur le trottoir, une chaussure se prend dans mes jambes, c’est là, je crois bien, que gisait le corps il y a quelques minutes, maintenant il n’y a plus personne… On arrive à un fourgon, des voitures garées, du gravier qui crisse sous les chaussures, des barbelés, une lampe d’un jaune pisseux. Ils me tirent vers une camionnette immatriculée en Californie. L’un d’eux ouvre la porte qui émet des « piou-piou-piou ». L’autre essaie de me faire entrer dedans. Ça non, ils peuvent bien me molestertant qu’ils veulent, mais pas question que j’entre dans une camionnette inconnue ! J’écarte les bras pour les empêcher de me fourrer à l’intérieur comme du bétail. L’un d’eux parvient de nouveau à me flanquer un coup de pied dans le ventre.
Le verre de Margarita caché dans la poche de mon blouson se casse. Je me tiens à l’endroit du coup et reste plié en deux. Deux mains m’agrippent par les cheveux et me maintiennent la tête baissée. Je m’attends à un autre coup de pied dans le ventre. Un coup bien mesuré, fort, à me couper le souffle et à me rendre mou comme un sac de fayots. Je serre autant que je peux les muscles du ventre. Le coup se fait attendre. Les secondes s’étirent indéfiniment. Ce qui est encore plus terrible que le coup, c’est quand on l’attend. Advienne que pourra : je bande mes forces, et, dans une tentative désespérée, je libère brusquement ma tête de l’étreinte et plante le verre cassé dans le visage de celui qui me tient.
Il pousse un hurlement.
Pendant ce temps, l’autre était occupé à chercher le bout de l’épais Scotch avec lequel il voulait m’attacher.
Je l’atteins à la gorge, quelque chose de sombre éclabousse, tel un geyser, à au moins un mètre et demi à la ronde. Je me retourne vers le premier qui continue à hurler et à regarder avec horreur ses mains noires de sang.
Je le frappe d’un coup de poing à la tête, une douleur fulgurante me perce le poignet.
Une fenêtre claque tout près.
La porte ouverte de la camionnette continue ses « pioupiou ». Je saute dedans, ferme violemment la porte derrière moi, les clefs sont sur le tableau de bord. J’allume, appuie sur le champignon aussi fort que je peux. Dans le rétroviseur, l’un de mes agresseurs se vautre dans la poussière, tandis que la silhouette de l’autre se penche au-dessus de lui.
Un instant plus tard, je tourne dans une ruelle étroite et sombre. Un chien se met à aboyer.
Je me rends compte que je n’ai pas allumé les phares et je ralentis tout en cherchant la manette.
Quelques minutes plus tard et après avoir tourné cinq ou six fois, je me retrouve sur le Bulevar Constitución. Je le prends jusqu’à un feu tricolore, tourne à droite et débouche sur l’Avenida Revolución. Le boulevard est bien éclairé et encore animé : je me cale en arrière et prends une profonde inspiration.
Je commence à faire défiler dans ma tête les images de ce qui vient de se produire. Dans quel guêpier me suis-je fourré ? Je n’ai même pas conscience du moment où j’arrive au poste frontière, de retour aux États-Unis. Je fais la queue. À cette heure impossible, il n’y a qu’une dizaine de voitures devant moi, mais les contrôles sont longs. J’enlève mon blouson, mon tee-shirt maculé de sang, j’essuie autant que je le peux mon visage et fourre le tee-shirt sous le siège. Je remets mon blouson, tire la fermeture éclair jusqu’en haut, remets de l’ordre dans mes cheveux. J’ai toutes les peines du monde à garder la tête dressée, je suis ivre, j’ai à la fois envie de dormir et de vomir. Je m’assoupis derrière le volant.
+
Je retourne dans le salon de thé. J’ai le cœur qui va exploser ! Mais que sait-il, le cœur ? Je fais la queue derrière son stand et j’attends. Peu avant mon tour, je tourne les talons et sors. Pourquoi ce maudit cœur veut-il s’échapper ? Pourquoi me compromet-il ? Je prends mon courage à deux mains, j’entre de nouveau, il y a quelques personnes devant moi. Je commence des exercices respiratoires. Il faut que je me comporte normalement, bon sang ! Tu parles. Si j’avais su que, autant d’années plus tard, ce serait la même chose lorsque je penserais à elle !
Que prendrez-vous ? Sa voix. Ses lèvres. Et voilà qu’elle lève le regard sur moi. Le bleu de ses yeux ne reste pas en place, il scintille et se fond, comme dans une aquarelle.
Et, miracle, j’arrive à sortir quelques mots. C’est la première fois que je parle à une fille sans m’efforcer d’inventer la phrase la plus originale. Elle ne répond pas. Mais je ne reconnais pas dans son regard l’agacement ou l’ennui observés chez la plupart des filles avec lesquelles j’essaie d’avoir une conversation. Plutôt l’étonnement. Pendant qu’elle se demande, perplexe, comment se débarrasser de moi, je lui demande quand son service se termine. Elle me répond tranquillement et je m’empresse de ficher le camp avant qu’elle ait pu regretter d’avoir parlé avec moi.
+
– Dure nuit, dit une voix qui me réveille.
– Ouais…
– Monsieur, êtes-vous en état de conduire cette automobile ? Je fais un effort pour regarder d’où vient la voix – la douane, une cabine, les USA, un jeune employé aux yeux bienveillants.
– Ben, oui. Je m’efforce de parler avec énergie et précision tout en tendant mes papiers d’identité. « Je me suis tout simplement assoupi en attendant. » Il m’examine de nouveau pour comparer avec la photo.
– C’est votre anniversaire, aujourd’hui, Zack ! dit-il. Vous êtes seul ?
Je ne réponds pas, le regard fixé devant moi. « Quelque chose à déclarer ? » Le douanier jette un œil circulaire à l’intérieur de l’automobile.
– Non.
– Pourquoi n’avez-vous pas pris de taxi, Monsieur ?
– Je n’avais plus d’argent. Dans le rétroviseur, je remarque une tache sur ma joue droite.
– D’où venez-vous, monsieur Karab…
– D’un petit État, loin d’ici, Monsieur.
Une tache sombre sur la joue droite.
– Zack, je ne vous demande pas d’où vous êtes originaire.
– Ah, désolé, oui, heu… J’habite à Del Penasquitos.
C’est peut-être du sang.
– Et c’est où ?
– Un peu plus au nord de Rancho Bernardo…
Mais ça peut être aussi tout simplement de la saleté. Ça ne peut pas être du sang. C’est sur ma joue droite. Or, l’homme en uniforme est à quelques centimètres de la gauche.
– Je sais où est Del Penasquitos, m’interrompt-il. Mais où se trouve un petit État, loin d’ici ?
– Ah, ça… Un peu au nord de la Grèce.
– Je suppose qu’on ne prend pas le volant après avoir bu, un peu au nord de la Grèce ?
Sa voix me semble plus forte maintenant.
– Non, Monsieur.
– Nous non plus, nous ne prenons pas le volant après avoir bu, un peu au nord du Mexique, n’est-ce pas ?
– C’est exact, monsieur.
Je me tourne légèrement vers lui et essaie de hocher la tête et d’esquisser une grimace, un demi-sourire vers le bas censé exprimer la gratitude et l’obéissance.
Silence. Est-ce que ça vaut le coup de tenter de fuir ? Est-ce que ça vaut le coup d’essayer de cacher la tache sur ma joue droite ?
Brusquement, le poste de radio qu’il porte à l’épaule émet plusieurs commandes hachées, déformées par le speaker. Il approche l’oreille de l’engin sans me quitter du regard, appuie sur un bouton et dit :
– Affirmatif, Monsieur !
Je respire lentement mes dernières secondes de liberté. C’est fini.
– Je te laisse partir, mais fais attention, dit-il en me tendant mes papiers. Bon anniversaire ! Et direct chez toi, c’est compris ?
Puis il fait un geste de la main à la voiture suivante.
– Direct chez toi !
J’appuie sur le champignon et me voici de retour à la civilisation. La Californie ! Je roule jusqu’au parking où j’ai laissé ma voiture en arrivant. J’ai envie de m’arrêter et d’embrasser le bitume.
Je m’arrête, descends, embrasse le bitume. Je ferme la camionnette. J’entre dans ma voiture et mets le moteur en route. C’est alors qu’il me vient à l’esprit qu’une heure plus tôt, peut-être, j’ai tué un homme à Mexico, j’ai volé une camionnette et laissé des empreintes. Il faut y penser à temps. J’ouvre le coffre à la recherche d’un chiffon. Rien.
J’ouvre de nouveau la camionnette. Je ne vois rien, autour des sièges avant, qui puisse me servir à nettoyer. J’ouvre à l’arrière. Je pousse presque un cri en voyant le corps et je claque la portière. Mon cœur bat comme un fou dans ma poitrine. Quoi encore pour cette nuit ?
Était-ce un corps ? Qu’est-ce que j’ai vu ? J’ouvre de nouveau avec précaution. On dirait que ce n’est pas un corps. Je respire. Un énorme sac de forme allongée, légèrement plié au milieu. On dirait vraiment un cadavre, bon Dieu ! C’est mou au toucher, mais plein, comme rempli de paille. Je regarde autour de moi. Je dénoue la chose, fouille dedans en faisant attention, mes doigts touchent ce que mon nez a déjà reconnu.
Et alors, au lieu d’essuyer mes empreintes et de ficher le camp, je fais passer le sac de la camionnette dans le coffre de ma voiture.
Je mets le moteur en route, fais le signe de croix et fonce vers le nord, vers l’aube bleutée, avec un sac de marijuana.
+
Lorsque je l’ai rejointe, après son travail, elle avait enfilé un jean élimé et un tee-shirt bleu ciel tendu sur ses seins. Elle portait des sandales de cuir à hauts talons qu’on appelait des « sabots » dans les années 1970 – maintenant des « plateformes », quand je l’ai rencontrée je ne sais plus comment on disait – un sac en bandoulière. Il est facile de tomber amoureux d’une fille à qui tout va.
Je devais avoir les mains fourrées dans les poches.
Autour de nous, c’était la foule estivale habituelle. Nous nous sommes dirigés, je m’en souviens, vers le parc maritime. C’est quelque part autour du musée d’Art plastique que je perds le fil des souvenirs. Je ne me rappelle pas ce que nous avons fait entre six heures, moment où elle a terminé son travail, et la tombée de la nuit. Nous sommes-nous assis ? Marchions-nous tout simplement ? Nous avons fini par entrer dans un bar d’une rue croisant le boulevard Premier-Régiment-de-la-Marine et la rue où elle habitait, un petit bar sombre qui s’appelait Impouls. On a pris place à l’une des tables rondes recouvertes d’une nappe noire sous une surface de verre. On a bu du gin-tonic et mangé des cacahuètes. Et on s’est mis à parler. L’un après l’autre. On a parlé comme si on l’avait déjà fait depuis une éternité et que quelqu’un nous avait interrompus. On a parlé comme si on faisait semblant de ne pas se connaître. On terminait la phrase de l’autre, on se complétait mutuellement, on se rappelait où on en était. On a parlé comme si on devait se séparer le lendemain pour toujours.
+
… que vas-tu faire de ta vie…
Dans quelques kilomètres, c’est la sortie pour rentrer à la maison. Ce dont j’ai maintenant envie par-dessus tout, c’est de dormir, dormir, dormir, dormir autant que j’en ai besoin. J’ouvre la fenêtre pour faire entrer l’air frais et rester éveillé durant ces dernières minutes. La fraîcheur matinale me fouette le visage. Avec elle, l’intolérable pensée que je me dirige vers une maison vide.
Qui est-ce que je leurre ? Qu’est-ce que je vais faire à la maison sans elle ? Je vais dormir ? J’ai déjà essayé il y a quelques heures, et voilà le résultat. Non, pas question de dormir ! Il faut décider que faire de cette vie.
Dans le sac, à l’arrière, il y a bien trente kilos de marijuana. Je n’ai aucune idée du nombre de joints que ça fait et je subodore que, si je me mets à compter maintenant, la tête va me tourner et je vais vomir dans la voiture. La Margarita me chamboule complètement, je le sais. Un joint, ça fait environ cinq dollars. Dix joints, cinquante dollars. Cent joints, cinq cents dollars. Dans cinq cents grammes d’herbe, il y a… et voilà, j’ai un haut-le-cœur, putain de gueule de bois ! Ohohohoh… me voilà sur la bande d’arrêt d’urgence et, tout en ralentissant, je vomis par la fenêtre. Longuement, douloureusement, tout en conduisant. Je m’arrête, descends de voiture et m’appuie contre la bordure. Je vomis de nouveau à la pensée que je viens de vomir. De violents spasmes aigres et acides me contractent l’estomac.
Quelle nuit, Seigneur, quelle nuit !
Je remonte dans la voiture. Me voici tout près de la sortie pour rentrer chez moi. Le panneau bien connu, plus loin le feu tricolore bien connu. Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je fais, qu’est-ce que je fais, qu’est-ce que je fais…
Je passe le panneau bien connu, j’appuie encore plus fort sur l’accélérateur.
Adieu, panneau bien connu !
Adieu, feu bien connu !
Adieu, palmiers et arbres aux larges feuilles !
Adieu, quartier endormi !
Adieu à toi aussi, maison vide !
+
Durant mes quelques derniers mois de caserne, je n’arrête pas de penser à elle. Nous nous voyons encore plusieurs fois avant que je finisse mon service militaire. En descendant du train, le sac de toile vert en bandoulière, je prends un taxi et, au lieu d’aller chez moi, où m’attendent ma mère et ma petite sœur, j’indique au chauffeur son adresse à elle. Dans l’ascenseur pisseux, j’appuie sur le sept et me répète mentalement les premiers mots que je vais lui dire. Je sonne. Elle ouvre la porte, sourit. J’hésite : dois-je la prendre dans mes bras ou lui tendre la main ? J’oublie ce que j’avais l’intention de lui dire. Elle m’embrasse sur la joue et m’invite à entrer. Sa chambre est blanche, rangée et ascétique. La chaîne Hi-Fi est à même le sol, il y a des étagères pleines de livres, quelques tableaux sur les murs, un lit bas, une petite table en verre, un vase avec des freesias. Nous nous asseyons par terre et buvons des gin-tonic. Nous écoutons de la musique jusqu’au lendemain matin. C’est l’aube lorsque nous le faisons pour la première fois, sur la moquette de sa chambre. On ne fait rien en fait. Je suis tellement électrisé, fatigué et fou d’elle que je ne peux même pas me contenir plus de quelques secondes. Elle comprend. Elle comprend tout. Elle me tend le tee-shirt qu’elle vient d’enlever pour que je m’essuie et m’oblige à me coucher pour quelques heures. Puis je la vois ouvrir la fenêtre et escalader la fenêtre, avec l’agilité d’un chat. Terrifié, jeme redresse dans le lit. Elle se tourne vers moi, souriante, et s’assoit tranquillement sur la fenêtre, comme si, de l’autre côté, tout était beau et sans danger. Il fait frais. Septembre. La dernière chose que je vois avant de m’endormir, c’est sa silhouette sur le fond de l’aurore bleu pâle. Le bout de ses seins, l’étincelle d’un briquet, une cigarette. Cette jolie fille, pourquoi est-elle avec moi ? N’a-t-elle pas peur de la hauteur ?
+
Je m’arrête dans une petite ville pour surfeurs entre San Clemente et Los Angeles. Je trouve un hôtel près de la plage, je m’enregistre et me couche.
Je suis réveillé par le bruit de l’aspirateur dans la chambre voisine. Je regarde ma montre : j’ai dormi quatre heures entières. J’ai la tête qui va éclater. Je prends une douche. Je me lave de la saleté de Tijuana, mais la gueule de bois ne me quitte pas. Je me regarde dans le miroir : des hématomes bleuâtres commencent à se former sous mes yeux. La peau du crâne me fait mal, il me manque des mèches de cheveux, mais cela vaut mieux, mieux vaut être chauve et en vie.
Je décide de sortir à l’air frais et de réfléchir. Ça fait longtemps que je n’ai pas réfléchi comme il faut. Mais comment faut-il ? Je descends et demande à la fille de la réception où se trouve l’expresso le plus proche. Il y a un Starbucks à trois mètres d’ici, plus bas sur le boulevard.
Je le trouve, entre, fais la queue. C’est mon tour. À la caisse, une jeune fille aux cheveux rouges avec un piercing sur la langue me demande ce que je prendrai.
Quoi ? Je me retourne et regarde vers la porte. Pourquoi n’est-elle pas apparue tout simplement, ici, maintenant ? Pourquoi n’est-elle pas venue dans cette petite ville pour qu’on prenne un café, comme avant, et qu’on bavarde avant que…
– Vous attendez quelqu’un ? demande patiemment la jeune fille aux cheveux rouges et à la boucle sur la langue.
– Pardon ?
– Vous voulez quelque chose ?
Je ne réponds pas. Derrière moi commence à se former une bonne file d’hommes et de femmes qui attendent. Je regarde les boucles rouges de la fille, mais il n’y a pas de mots dans ma gorge.
– Monsieur ?
Stella, Stella, Stella, si tu te montres maintenant, je te promets :
je viderai la poubelle sans que tu aies besoin de m’y faire penser, j’apprendrai à ne pas faire claquer les portes, je te masserai le dos même quand tu n’auras pas attrapé froid, j’achèterai des fleurs, des prairies entières de fleurs, je ne ferai pas de bruit en me levant la nuit, je secouerai les couvertures le dimanche, j’arroserai le yucca, je passerai l’aspirateur, je soulèverai la lunette des toilettes avant de pisser (et je la remettrai en place), je me musclerai les abdos, je maigrirai côté cul, j’arrêterai de me comporter comme un con avec ta mère, je t’emmènerai faire du pédalo, je t’apprendrai les trois gammes de la guitare, je t’apprendrai ce que c’est que le « f-stop » du Nikon sans m’énerver, j’arrêterai de boire deux bières chaque soir, je serai quelqu’un d’important, on vendra enfin cette maison, je quitterai mon boulot qui me fait horreur et on aura quand même de l’argent, de l’argent, de l’argent, ce foutu argent, on ira en… Inde ?
Stella ! Je promets aussi :





























