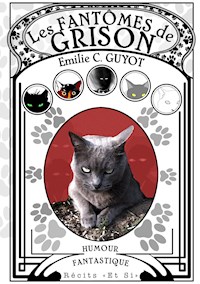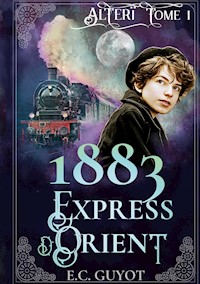
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Alterï
- Sprache: Französisch
Banquiers, artistes, médecins, sorciers, loups-garous, chasseurs de créatures... le train promet de fabuleuses rencontres. Octobre, 1883. Quatresous s'embarque à bord de l'Express d'Orient, le tout nouveau train de grand luxe, tout juste inauguré par la Compagnie des Wagons-lits. Sa mission est aussi claire qu'elle est saugrenue : faire faire demi-tour aussi vite que possible à son employeur Monsieur Desmilliers et récupérer l'argent des billets, car les finances de la famille en dépendent. Ses priorités vont devoir rapidement changer... Ce n'est pas de sa faute, vraiment, aucun guide de voyage n'avait parlé des Alterï, ni de quoi faire dans un train plein de ces créatures sorties tout droit des légendes les plus terrifiantes ! Pour Quatresous, un voyage vers l'inconnu va commencer dès le quai de la gare... "1883 Express d'Orient est un voyage captivant à travers le temps et la magie, un croisement excitant de policier, d'historique et de fantastique. D'une richesse incroyable, à l'image de l'intrigue, la plume d'E.C. Guyot foisonne d'idées formidables. Un vrai coup de coeur : l'une des meilleures découvertes de 2019!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chapitres
Chapitre 1 - 22 octobre 1883, Paris, Rue Berthollet, 15h27
Chapitre 2 - Du 23 au 27 octobre, Paris, Rue Berthollet
Chapitre 3 - 28 octobre, Paris, Gare de l'Est. Départ 19h30
Chapitre 4 - De Noisy-le-Sec à Epernay
Chapitre 5 - D'Epernay à Saverne
Chapitre 6 - De Saverne à Karlsruhe
Chapitre 7 - De Karlsruhe à Pforzheim
Chapitre 8 - De Pforzheim à Geislingen
Chapitre 9 - De Geislingen à Ulm
Chapitre 10 - De Ulm à Kissing
Chapitre 11 - De Kissing à Sankt Pölten
Chapitre 12 - Sankt Pölten
Chapitre 13 - De Sankt Pölten à Vienne
Chapitre 14 - De Vienne
Westbahnhof
à Vienne
Südbahnhof
Chapitre 15 - De Vienne Südbahnhof à Marchegg
Chapitre 16 - De Marchegg à Cegled
Chapitre 17 - De Cegled à Timisoara
Chapitre 18 - De Timisoara à Porta Orientalis
Chapitre 19 - Les Carpathes I
Chapitre 20 - Les Carpathes II
Chapitre 21 - Les Carpathes III
Chapitre 22 - Les Carpathes IV
Chapitre 23 - Les Carpathes V
Chapitre 24 - Herculesbad
Chapitre 25 - Novembre 1883, Paris
Épilogue - Saint-Leu, 2 février 1884, 17h37
Chapitre 1
22 octobre 1883, Paris, Rue Berthollet, 15h27
— Mais enfin Ernest, disait Madame, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ?!
Madame Isabelle Desmilliers, née Brissaud, était petite, pâle, délicate et dotée d'une voix douce et légèrement voilée, ce qui donnait l'impression qu'elle était une créature fragile.
— Ma chère, répondait Monsieur, il y va de notre réputation ! Tout le beau monde prend l'Express d'Orient ! Le train est complètement plein depuis juin ! Les gens s'arrachent les places, ils refusent du monde ! Vous n'imaginez pas ce que j'ai dû faire pour avoir ce compartiment…
Monsieur Ernest Desmilliers était trapu, charnu, moustachu, à l'allure dense et bourrue, ce qui donnait l'impression qu'il était un cube auquel on aurait attaché quatre membres épais. Sa tête était tout aussi cubique, avec un nez court, une bouche lippue, un regard porcin.
— Mais les prix, Ernest, les prix ! Vous avez dépensé 840 francs... !
— Ça y est, vous recommencez à être ridicule, ma chère. 840 francs, c'était juste un aller-retour ! J'ai pris deux billets ! Et j'ai réservé des chambres au Grand Hôtel de Pera !
— Deux fois 840 francs ! Plus l'hôtel !
— Ne vous laissez pas impressionner, ce ne sont que des chiffres ! Vous et moi allons à Constantinople dimanche prochain ! Vous allez emmener vos belles tenues et tout le tralala et je compte sur vous pour vous montrer à tout le monde là-bas !
— Je ne viendrai pas.
— Comment ?
— Je ne viendrai pas ! Cette dépense est complètement, outrageusement ridicule ! Vous allez rendre ces billets tout de suite !
Monsieur se figea sur place, ses yeux écarquillés dans sa grosse figure qui rougissait à vue d'œil. Madame changea immédiatement de stratégie, prenant un ton suppliant.
— Je suis désolée, Ernest, mais vous savez bien que je ne peux pas venir. Vous savez que j'ai horreur des trains et qu'ils me rendent malade.
Monsieur se dégonfla quelque peu et prit l'expression avec laquelle il discutait « affaires » avec ses collègues.
— Mais justement, ma chère. Ce train est la dernière expression du luxe. Finis les compartiments où les gens sont assis, serrés les uns sur les autres sur huit places où on n'est confortable qu'à condition d'être quatre. Ce sont des couchettes, des chambres personnelles ! Finies les courses dans les gares pour aller manger, il y a un wagon-restaurant ! Il y a des cabinets de toilette dans le train !
Monsieur avait peut-être commencé à discuter « affaires », mais il avait fini par marteler ses arguments comme des slogans de vendeur à la criée, grands gestes à l'appui.
— C'est exactement comme si vous emmeniez votre maison là-bas ! reprit-il. Vous n'aurez pas plus l'impression de voyager que lorsque vous recevez le jeudi après-midi ! Sauf que ce sera dans un train de luxe, avec un service de luxe, pour des gens de luxe !
Les yeux de Monsieur brillaient d'excitation chaque fois qu'il prononçait le mot « luxe ». Madame pâlit. Elle recula vers un fauteuil et se tordit les mains.
— Je n'irai pas ! J'ai bien trop peur ! Vous ne pouvez pas me forcer à y aller.
Elle se jeta, prostrée, sur le fauteuil. Monsieur hésita, visiblement troublé.
— Isabelle…
— Par pitié, Ernest, rendez ces billets, faites-vous rembourser ! C'est bien trop dangereux, je ne veux pas que vous preniez de risques. Et si vous ne reveniez pas ?
Monsieur semblait ruminer plusieurs pensées. Sa moustache tressaillait à intervalles réguliers.
— Ernest ?
— Eh bien, ma chère, vous avez sans doute raison. Vous n'êtes pas faite pour les voyages. Je vais y aller avec quelqu'un d'autre !
Madame se redressa d'un coup sur son siège, le ton plaintif oublié.
— Quelqu'un d'autre ? Mais, Ernest...
— Non, non, non, c'est parfait, s'exclama Monsieur en souriant de toutes ses dents. Je vais y aller avec un homme, c'est plus convenable pour voyager.
— Un homme ! Mais qui donc ?
— Un valet ! Je vais montrer que j'ai les moyens de faire dormir mon personnel dans le luxe !
— C'est vous qui êtes ridicule, mon cher. Dormir dans la même chambre que le personnel ? Cela ne se fait pas !
— Ah, vous avez raison. Dans ce cas, j'inviterai un ami. Quelqu'un digne de confiance, un de mes véritables amis, qui appréciera mon geste...
— De quels amis parlez-vous donc ? demanda Madame qui ne réussit pas à effacer totalement le cynisme dans sa voix. Ceux de la banque ?
— Non, non, pas un ami, un parent ! Encore mieux ! Moi, Ernest Desmilliers, je peux me permettre de voyager en première classe en offrant un billet à mon pauvre vieil oncle !
— Vous n'avez plus de famille, Ernest. Les parents qui vous restent ne veulent même pas entendre parler de vous !
— Et alors ? J'irai, même s'il faut que je m'achète un nouveau parent ! Ah !
Eugènie Chardon, la cuisinière de la maison, se tenait près de moi derrière la porte entrouverte. Si l'indignation avait été une arme, ses yeux d'un bleu limpide auraient foudroyé Monsieur sur place ; elle était farouchement fidèle à sa maîtresse car elle avait été élevée et formée par la famille de Madame depuis sa plus tendre enfance. Elle secouait la tête et le mouvement faisait glisser sa coiffe, libérant des boucles châtains qui se hérissaient sur sa tête comme les rayons d'un soleil.
— Il va s'acheter une famille ? grommela-t-elle. Il va falloir qu'il les paye un peu plus que son personnel. Il n'y a plus personne dans cette maison pour l'accompagner même en Enfer, s'il le fallait ! Deux mois qu'on n'a plus ni valet, ni maître d'hôtel, ni chauffeur. Il n'y a plus que toi, et toi…
— S'il y avait un train pour l'Enfer, coupai-je, il ne coûterait probablement pas 840 francs. Personne ne pourrait y aller, si c'était si cher.
— C'est parce que c'est un aller-retour, figure-toi ! L'aller est gratuit, et c'est 840 francs pour revenir de Là-bas.
— Dans ce cas c'est presque bon marché. À peine, quoi, trois ans de salaire ?
— Quand je te dis qu'il est temps que tu épargnes. Eh bien. Après ce cirque, Madame mérite bien son plat préféré. Ça devrait la remettre d'aplomb, va.
Je haussai les épaules. La dispute s'était terminée ; nous n'entendions plus rien, derrière la porte. Eugènie aplatit son halo capillaire et l'emprisonna à nouveau sous sa coiffe, puis elle se rendit dans la cuisine, son territoire attitré. Avec une chorégraphie bien rodée, elle saisit à deux mains les divers ingrédients qui allaient constituer le repas de ce soir et les projeta sur son plan de travail afin de les travailler. Je me laissai tomber sur une chaise et étalait un exemplaire du Gaulois sur la partie de la grande table qui n'allait pas être utilisée. Le Gaulois était un journal mondain plutôt destiné à la haute bourgeoisie ; je ne le lisais que parce qu'il se trouvait dans la maison.
— Elle va gagner, dis-je tout en parcourant méthodiquement les titres des dépêches. Il va rendre les billets.
C'était plus un souhait qu'une remarque. Eugènie s'était armée d'un couteau et découpait le cresson avec une précision acharnée. Je me demandai quand il nous faudrait abandonner les légumes premier choix pour se contenter de pommes de terre à tous les repas. Monsieur n'avait pas encore remarqué qu'on lui servait de plus en plus souvent du porc, la viande la moins chère sur le marché, plutôt que les perdreaux, les cailles et les faisans dont il était friand. L'étagère à épices était vide depuis longtemps, à l'exception du sel et de l'huile. Il n'y avait plus de beurre et Eugènie graissait ses poêles au lard.
— Tu l'as vu comme moi, me dit-elle. Il y a le mot « luxe » dans ce train. Il va y aller. Oh, je pourrais lui tordre le cou moi-même, faire ça à Madame !
— Il va louer un « pauvre vieil oncle », alors ?
— Il ferait mieux de t'emmener. Non seulement ça lui coûterait moins cher, et il faudrait bien ça pour garder un œil sur lui !
— Je serais son vieil oncle ?
— Eh bien, quel âge as-tu ?
— 24 ans, mentis-je en m'enlevant quelques années.
— 24 ans, mais toujours célibataire, sans famille, et sans épargne ! Tu corresponds au moins à « pauvre » !
— Pauvre, peut-être, mais pas assez pour faire un coup pareil à Madame. Ça m'étonne que tu encourages Monsieur dans cette idée.
— Je n'encourage personne ! Si je pouvais, je l'attacherais sur une chaise jusqu'à ce qu'un peu de jugeote lui rentre dans la tête, mais je connais Monsieur. Il faut se préparer au pire. Mon petit Louis, lui, il ferait ce qu'il faut.
— Es-tu devenue folle ?!
— Pas plus folle que Monsieur !
— « Ton petit Louis » trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça à la maison. C'est de la folie, on se ferait prendre.
— Bah ! Tu sais comment Monsieur est ! Il va passer tout son temps à bavasser auprès des riches et à essayer de trouver un moyen de ramener les rideaux du train de luxe dans sa valise ! Il ne verra rien !
— Passer une semaine dans le même compartiment que Monsieur sans qu'il ne s'aperçoive de rien relèverait quand même du miracle. De plus, Monsieur prend « ton petit Louis » pour un idiot. On ne montre pas les idiots au grand monde.
— Eh ! C'est peut-être bien ce qu'il lui faudrait, un parent idiot à qui faire la charité. Tu verras bien, dès qu'il s'apercevra qu'il ne trouvera personne d'autre de décent qui acceptera d'être son cousin ou je ne sais quoi pour moins d'un franc par jour.
— Tu veux faire un pari ?
— Je ne parie pas avec toi, j'aurais l'impression de te voler ! Allez, lis-moi plutôt le feuilleton. Ça nous fera oublier toutes ces bêtises pendant un temps.
Je portai mon attention sur le bas de la deuxième page où attendait l'épisode quotidien de « L'Ingénue de Poitiers ». Je commençai à lire, lentement, appréciant le seul moment de la journée où Eugènie était suspendue à chacun de mes mots.
Tout en lisant, je ne pouvais m'empêcher de penser au fait que Monsieur avait dépensé 840 francs pour un aller-retour. 840 francs. Avec 840 francs par an, j'aurais pu vivre au cœur de Paris dans une petite chambre à moi pour 2 francs par semaine, manger de la viande et du pain blanc à chaque repas (un « vrai » Parisien considérait impossible de s'en priver !), régler le blanchissage, l'éclairage, le chauffage, et m'offrir régulièrement des vêtements convenables pour « bien paraître » chez mon employeur. Mais pour toucher 840 francs par an, il fallait un bon emploi : décent, et rapportant au moins 3 francs par jour. Ce n'était pas si facile à trouver, ni pour un homme, ni encore moins pour une femme, toujours payée moins cher. Et comme il y avait beaucoup de demande et peu d'offre, une telle place était aussi très difficile à garder.
Chez les Desmilliers, je gagnais une misère (300 francs par an, avec le gîte et le couvert) et j'étais disponible pour eux à toute heure à l'exception d'une demi-journée par semaine. J'avais, en quelque sorte, sacrifié ma liberté. En revanche, l'appartement était confortable et chauffé, et j'avais à manger tous les jours. Après plusieurs hivers passés à grelotter et presque mourir de faim, ma liberté était devenue un sacrifice envisageable. Je tenais à ce confort et je ne comptais pas changer de vie. Mais si Monsieur continuait à jeter l'argent par les fenêtres…
Une sonnette retentit soudain ; Madame appelait dans le salon.
— Ah, dit Eugènie. C'est le destin qui t'appelle, ça ! Cours !
J'abandonnai « L'Ingénue de Poitiers » sur la table, ignorai le dernier commentaire d'Eugènie, et me rendis au salon au plus vite.
Se déplacer « au plus vite » chez les Desmilliers comportait toujours une grande part de danger de se cogner, ou pire, de s'assommer, si l'on ne faisait pas assez attention. Les « nouveautés » étaient la faiblesse de Monsieur, une vibrante passion profonde pour tout ce qu'il voyait en réclame dans les journaux. Le résultat ? Un bric-à-brac qui s'étalait et s'empilait sur toutes les surfaces : des machines à coudre (aux pièces inusables !) rouillaient lentement près de lampes à double courant d'air qui n'avaient jamais été allumées ; une machine américaine à laver le linge (s'adapte sur tous les fourneaux !) était embourbée dans une masse de bonbons « norwègiens » contre la toux (efficaces contre la coqueluche et la bronchite !) à moitié fondus ; des pots et des casseroles en bronze d'aluminium (recouverts de métal blanc !) qu'Eugènie n'avait jamais voulu toucher menaçaient d'estropier ceux qui passaient trop près du pauvre piano podophone dont les touches étaient arrachées par du grillage en fer galvanisé pour poulailler ; un tapis inaltérable se déchirait sous le poids d'un envahissant calorifère mobile (garanti exempt de tout danger de gaz délétère !) qui n'avait jamais vu l'intérieur d'une cheminée. La semaine précédente, Monsieur avait encore ramené deux lampes à pétrole « auto-motrices » et trois parapluies en soie (incassables à la pliure !) ; la semaine avant cela, tout un tas de boites de capsules d'huile de foie de morue (plus faciles à avaler !) et de cigarettes contre l'asthme.
Madame ne se trouvait pas dans le salon. En revanche, posée sur la table, je vis la gravure d'un cheval attelé à un fiacre, marchant fièrement sur les pavés d'une rue animée. Cette gravure aurait dû être accrochée au mur, je voyais parfaitement son emplacement. Je la remis à sa place rapidement ; je savais ce que j'avais à faire.
Je filai dans ma chambre sous les toits pour me changer, et me débarrassai avec soulagement de mes vêtements de ménage. Le costume de chauffeur était infiniment moins contraignant : il était beaucoup plus simple, la veste usée aux manches et aux coudes, le tissu grossier, mais le toucher me donnait toujours un frisson d'impatience, comme la première fois où j'avais pris la place du chauffeur, en catastrophe, après que celui-ci eut été remercié. Conduire ce fiacre était toujours une aventure, surtout à Paris où la circulation était un véritable défi. Mais c'était là que je trouvais ma liberté. La moitié de ma liberté, en tout cas.
Je redescendis les escaliers aussi silencieusement que possible. Le tapis atténuait mes pas, mais je savais que certaines planches en-dessous grinçaient quand même. La porte de la bibliothèque s'ouvrit soudain sur ma gauche.
— Quatresous ? dit Monsieur. C'est bien ça, Quatresous ? Je crois bien qu'on a employé quelqu'un d'autre avec ce nom, je ne sais plus… de la famille, peut-être ? Non ? Enfin, peu importe. Ça tombe bien que vous soyez là. Que pensez-vous des trains ?
— Trains ? croassai-je.
— Vous savez, les trains ? C'est comme un fiacre mais avec une locomotive à la place des chevaux. Vous savez, les locomotives ? Lo-co-mo-tives. Ce sont de grosses… euh… machines, qui font « tchoutchou »…
Je me contentai de le regarder jusqu'à ce qu'il renonce à me mimer la locomotive.
— Oubliez ça, reprit-il, ce n'est pas important. Que diriez-vous de m'accompagner dans un voyage, hein ? Je paye tout ! dit-il en écartant ses gros bras avec emphase.
— Je dois travailler, dis-je sur le ton le plus monocorde possible. Madame m'attend.
— Oh oui, oui, bien sûr… ce n'est pas grave, nous en reparlerons. Je vous en prie, allez-y. Ne la faites pas attendre ! Quel dévouement, hé hé. Vous êtes tout à fait la personne qu'il me faut !
Il rentra dans sa bibliothèque en chantonnant faux un air de La Flûte Enchantée. Cela faisait déjà deux mois que j'occupais deux emplois chez lui, l'un pour le ménage, et l'autre pour le fiacre, et Monsieur n'avait encore rien remarqué. Enfin, presque rien, apparemment.
Madame m'attendait déjà dans le fiacre, avec deux gros paquets emballés de papier de soie, et je pouvais voir par la portière qu'elle rassemblait son courage pour ce qui allait venir. Je trouvai sur mon siège un journal ouvert sur une publicité pour le magasin Le Printemps. J'avais notre destination ; pour tout ce qui était important, Madame préférait le silence et les coupures de journaux.
Alors que je suivais par cœur la route vers le grand magasin, de sombres pensées concernant la situation de mes employeurs m'assaillirent. Hélas pour Monsieur, le krach banquier de l'Union Générale de janvier 1882 avait entraîné une crise économique de plusieurs années. Des sociétés s'effondraient, le bâtiment et la métallurgie souffraient durement, et Monsieur, mal conseillé dans ses investissements, n'avait rien vu venir. Au bout d'un an et demi les revenus du couple Desmilliers étaient au plus bas, mais Monsieur était absolument déterminé à ne s'apercevoir de rien.
Madame, elle, était terrifiée à l'idée que le couple fût « déclassé », comme on disait, et qu'après avoir été de nouveaux riches, ils deviennent de nouveau pauvres. Avec mon aide et ma discrétion, elle se chargeait de maintenir le budget du foyer. Monsieur, quant à lui, trouvait qu'il était tout à fait normal que la maison soit gérée sans lui, que les domestiques soient payés, la nourriture achetée, le ménage et la cuisine accomplis, mais il restait persuadé que sa femme n'y connaissait rien du tout et qu'elle ne savait même pas le prix du pain.
Madame était entrée dans Le Printemps. J'attendais dans le boulevard Haussmann, observant les environs, fumant une cigarette pour me donner une contenance. Les autres chauffeurs me lançaient parfois de drôles de regards, comme s'ils savaient parfaitement que je jouais un rôle, que je ne méritais pas cette place. Je remontais alors un peu plus le col de ma veste, rentrais un peu plus la tête dans les épaules, et abaissais un peu plus ma casquette sur mes yeux. Heureusement, je n'avais pas un physique hors du commun : une grande silhouette osseuse de pantin désarticulé, les cheveux d'un blond vague, les yeux bruns aux cernes presque aussi foncées, un long nez fin, les mains abîmées, la peau d'un teint plus proche du grisâtre que du rose, les ongles souvent noirs.
Madame sortit du Printemps les mains vides et le pas plus assuré. Les Grands Magasins reprenaient les articles neufs, mais nous devions toujours attendre que Monsieur se passionne pour quelque chose de nouveau avant de passer à l'action ; quelque fois, c'était trop tard.
— Tout s'est bien passé ? demandai-je, attendant simplement le petit signe de tête habituel.
— Vous savez, Quatresous, dit-elle en s'adressant à la portière que je tenais ouverte, nous survivrons à cela. Comme cet horrible siège de Paris par les Prussiens, il y a treize ans.
— Oui, Madame, dis-je après un instant de surprise.
— Et les années si difficiles qui ont suivi.
— Oui, Madame.
— Travailler en usine doit être si dur.
— Assez, Madame. C'est surtout répétitif. Dur pour les jointures. Et le moral. Ça casse le moral. Ça casse les gens.
— Je ne le souhaiterais à aucun de mes proches. Et regardez ces vendeurs de rue, dans le froid.
— Marcher aide un peu à avoir chaud, Madame.
— Et c'est seulement octobre, dit-elle alors que son regard se perdait dans le vague pendant quelques minutes. Eh bien, dit-elle finalement. Nous survivrons. Tout du moins cet hiver encore.
Madame monta dans le fiacre, et ne dit plus un mot. Je fermai la portière et grimpai sur le siège du conducteur.
J'essayais d'ignorer le souvenir piquant que tout le monde n'avait pas survécu au Siège de 1870. Ni à l'usine, ou à vivre dans la rue. Ce n'était pas de la pitié que j'avais pour Madame, mais de la reconnaissance, une forme de solidarité, et une certaine forme de colère contre Monsieur pour son incapacité à voir les choses en face et prendre ses responsabilités. Je ne savais pas encore comment, mais je jurai à cet instant que j'allais protéger Madame, comme Eugènie. J'allais faire échouer le rêve de train de luxe de Monsieur et lui faire rendre les billets.
Chapitre 2
Du 23 au 27 octobre 1883, Paris, Rue Berthollet.
Je prenais ma demi-journée de congé le mardi après-midi. J'aimais me rendre au café, respirer le parfum chaleureusement amer de la boisson et des cigarettes, et me laisser bercer par les murmures des dernières rumeurs. Les Desmilliers n'étaient pas très bien vus dans le quartier : afin d'avoir la paix, il me fallait porter le costume discret de Louis le chauffeur, ou marcher au moins jusqu'à la rue Soufflot où personne ne pouvait me reconnaître. Ce jour-là, j'avais marché afin de m'éclaircir l'esprit, mais en vain. Le train me préoccupait trop pour que je puisse profiter du brouhaha enfumé : dans ma tête tournait l'obsession de trouver un stratagème, le plus vite possible, le temps comptait, mais lequel… lequel…
Une clameur attira mon attention vers le comptoir. Cinq ou six hommes, en complets, portaient un toast à l'un d'entre eux.
— À notre éminent confrère Fontaine, qui vient de décrocher son premier reportage officiel à l'étranger !
— Et un voyage tout frais payés sur l'Orient-Express, rien que ça !
— Bravo, Charles !
Encore ce maudit train ? Décidément, pensai-je, cela devenait de la persécution.
— Merci, merci, dit l'homme qui s'appelait Charles Fontaine. Mais puis-je me permettre de vous rappeler que je ne fais que mon travail !
Fontaine avait une trentaine d'années, peut-être, un long nez étroit et pointu, un menton en retrait, des yeux noirs, un teint hâlé. Il tapotait le comptoir du bout des doigts, selon un rythme aussi irrégulier qu'irritant.
— Ah oui, ton travail de journaliste, bien au chaud en première classe !
— Et payé par le patron !
— Je vais où mon devoir m'appelle, répondit Fontaine avec chaleur. Si je dois enquêter sur des tremblements de terre, je vais où les tremblements de terre sont !
— Tout en postant des dépêches sur ce que les gens veulent vraiment savoir : qui de connu fait quoi et va où !
— Je ne sais pas pourquoi je lis encore les journaux, alors que je sais très bien qu'ils n'impriment que ce qui fait vendre.
— Ou ce qu'ils veulent nous faire faire ! Achetez ceci ! Achetez cela ! Votez pour lui, ou pour l'autre ! Ayez peur de votre voisin comme ça nous pourrons l'arrêter !
— Surtout s'il est différent, si vous voyez ce que je veux dire.
— Allons, allons, chers confrères, se défendit Charles Fontaine. Mes dépêches seront purement géologiques. Et tenez, en gage de ma bonne foi : je vous jure solennellement de rechercher la vérité, toute la vérité, et de ne publier que la vérité !
— Alors change de métier !
— Ou parle nous de ce qui se passe avec Mademoiselle Cécile !
— On veut cette vérité là !
Le reste se perdit dans un nouveau toast et des grands éclats de rire. Si j'en avais eu les moyens, je leur aurais payé une tournée. Ils venaient de me donner le stratagème dont j'avais besoin.
Je rentrai aussi vite que possible et passai la soirée à éplucher les piles de journaux qui attendaient d'allumer les foyers de la maison. Il me fallait trouver les catastrophes ferroviaires les plus abominables possibles, des wagons réduits en cendres, des explosions de locomotives. Peu importaient les dates et les pays, il me fallait faire peur à Monsieur.
Le lendemain, en procédant au ménage, je plaçai les journaux bien en vue, partout dans la maison où Monsieur pourrait les remarquer : sur ses vitrines, dans son panier à courrier, sur son fauteuil près de la cheminée du salon, dans les tiroirs de son bureau, sur les coussins d'un canapé, sur le meuble-bar entre les verres à whisky.
Au fil des heures, je pouvais observer Monsieur aller d'une pièce à l'autre, l'air confus et de plus en plus inquiet. Au moment de servir le dîner, il trouva sur son assiette, à la place du Gaulois que j'avais laissé sur le bord de la table, un exemplaire de La Nature sur le déraillement de Hugstetten. Le journal contenait une excellente description des dix-huit wagons de voyageurs qui s'étaient empilés, défoncés et pulvérisés les uns sur les autres, et de la terrible histoire de rails qui avaient glissé à cause de pluies torrentielles et s'étaient déformés, déviant la locomotive que l'on retrouva à quarante mètres de la chaussée.
Madame entra dans la salle à manger avec le journal La Croix. Elle s'installa à sa place, le journal ouvert de façon à montrer l'article sur un homme tombé d'un wagon à cause d'une portière mal fermée. J'aurais juré que Monsieur avait pâli.
Il resta silencieux pendant de longues minutes, les sourcils froncés sous la force de son dilemme. Son gros poing s'ouvrait et se fermait, comme s'il voulait saisir quelque chose d'invisible devant lui. J'avais presque pitié de lui. Presque.
— Isabelle, ma chère, commença-t-il.
— Oui ? dit Madame en posant La Croix sur le bord de la table.
— Je me demandais s'il ne valait pas mieux…
Les doigts de Monsieur tapotaient nerveusement sur la table. Il regardait fixement l'exemplaire du Gaulois.
— Oui, Ernest ?
Le visage de Monsieur s'éclaira soudain, toute trace de conflit disparue.
— Mais bien sûr, Isabelle ! Je l'ai lu ce matin !
— Quoi donc, Ernest ?
— Le luxe est une garantie de qualité, n'est-ce pas? ! L'Orient Express est un train de grand luxe ! Les trains de luxe n'écrasent personne ! Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le train des gens connus !
— Que voulez-vous dire ? dit finalement Madame.
— Regardez ! reprit Monsieur en écrasant vigoureusement les pages du Gaulois de son doigt, Tristram Schaefer, le plus jeune violoniste virtuose, vous savez ? Il a une tête bien sinistre, mais je suis certain qu'il joue très bien, s'ils le disent dans le journal, c'est sûrement vrai. Ce Tristram Schaefer, donc, part pour l'Europe de L'Est dans l'Orient Express. Ils ne veulent pas le tuer, n'est-ce pas, donc c'est parfaitement sûr ! Il n'y a pas de meilleur endroit où aller que ce train. J'ai tellement hâte d'être à dimanche !
Et là-dessus, il jeta les journaux sur la pile destinée à allumer le feu. Si près. Notre but était passé si près.
Le jeudi était le jour où Madame recevait. Madame détestait devoir perdre plusieurs longs après-midis à prendre le thé avec des gens dont la conversation la fatiguait. Elle se présentait donc toujours chez ses connaissances lorsqu'elle savait qu'ils étaient absents, et leur laissait sa carte de visite écornée à gauche pour signaler qu'elle avait fait son devoir social. En revanche, elle ne pouvait pas échapper à son devoir d'hôtesse. Nous ne sacrifions ainsi qu'une journée par semaine, mais c'était une journée de perdue pour trouver une solution au problème du train.
Le vendredi matin, alors que je brossais le cheval (qui n'avait pas vu de véritable palefrenier depuis longtemps), Monsieur m'aborda comme un taureau fonçant sur un toréador.
— Quatresous ! Quatresous, il faut que je vous parle ! Allons dans mon bureau.
— Monsieur, résistai-je, non. Mes chaussures sont dégoûtantes.
— Ah tant pis, c'est bien pour ça qu'on paye les gens du ménage, eh ? Venez donc par ici !
Je voulus protester, étant donné que « les gens du ménage » en question, c'était moi et seulement moi, mais il m'entraîna par la manche vers l'intérieur de la maison.
Au milieu de tous ses achats inconsidérés, Monsieur avait acquis une formidable bibliothèque qu'il conservait sous clef, hors de portée de quiconque, y compris de lui-même. Il m'arrivait souvent de contempler les titres interdits, le cou tordu afin de déchiffrer les tranches. Parfois, Madame me laissait emprunter un volume ; voilà quelle était ma deuxième liberté au service des Desmilliers.
Monsieur brandissait la clef de la bibliothèque comme un flambeau. Il en déverrouilla les portes, et en sortit un livre à la tranche dorée.
— Voilà, dit-il. C'est pour vous. Un manuel de savoir-vivre ! Euh… dites-moi, vous savez lire, hein ?
J'hésitai, pendant un instant. Si je prétendais ne pas savoir lire, peut-être se découragerait-il ? Peut-être… Mais je ne le pouvais pas. Pas sans trahir la mémoire de mon père, et de notre petite collection de livres gardée derrière le rideau en velours, et les heures passées à étudier pour mon certificat d'études. De plus, si je refusais maintenant, je laisserais du temps à Monsieur pour trouver quelqu'un d'autre. Il fallait que je me désiste au dernier moment.
— Oui, dis-je. Je sais lire.
— Parfait ! Vous allez me lire ça et apprendre ce qu'il y a dedans.
— Pourquoi ?
— Parce que vous en aurez besoin dans le train, pardi ! Je ne veux pas avoir à expliquer pourquoi mon neveu ne sait pas se servir d'une fourchette… vous savez ce qu'est une fourchette, hein ?
— Oui, Monsieur, me forçai-je à articuler.
— Parfait, alors ! Aaah… attendez un peu. Montrez-moi l'état de vos mains ? Vous feriez mieux d'avoir les mains propres avant de toucher le livre, hein ? Autant commencer à apprendre les bonnes manières d'une bonne manière ! Ah ! Et puis venez par ici, je veux vous montrer quelque chose d'autre.
Une fois dans son bureau, il sortit d'un tiroir divers papiers qu'il exposa sur la table comme des œuvres d'art. Au centre, le billet que Monsieur m'avait destiné. Il y était inscrit le jour, le 28 octobre 1883 ; l'heure de départ du train, 7 heures 30 du soir ; le numéro de la voiture ainsi que celui de mon lit, le n°16, celui du haut. Un petit horaire avait été joint au billet, avec les heures d'arrivée aux principales gares : Strasbourg, Munich, Budapest, Bucarest, Giurgewo, Varna, et Constantinople, enfin. Je n'aurais pas été capable de placer ces noms sur une carte.
— Ce n'est pas magnifique, dites-moi ? Même le papier est de luxe.
— Oui, dis-je platement.
— C'est magnifique, juste magnifique. Mais il manque votre passeport ! Je voulais le faire faire, mais il faut une description de vous et je ne me souvenais plus de la couleur de vos yeux. Ils sont…?
— Marron.
— Vraiment ? dit-il en plissant les yeux. Vous savez quoi, faites moi une liste avec vos yeux, vos cheveux, votre taille, tout ça. Ce sera plus simple. Je connais le Préfet de Police, vous savez ? ajouta-t-il en replaçant les billets dans leur tiroir, qu'il ferma à clef.
— Oui, Monsieur…
— Et puis il va falloir vous emmener chez le tailleur, vous ne pouvez pas voyager dans ces vêtements-là ! On va vous faire faire tout ce qu'il faut, et… Dites-donc, vous m'avez l'air bien inquiet ! Tout ira bien, vous n'aurez qu'à suivre mes conseils et tout se passera bien ! Écoutez-moi donc : une fois passée la Hongrie, c'est facile, vous garderez toujours un œil sur nos bagages. Tous ces gens là-bas sont des voleurs, et des menteurs à ce qu'on dit, mais il est très facile de ne pas se faire avoir : il suffit de ne jamais leur faire confiance ! Je l'ai lu, ou on me l'a dit, donc ça doit être vrai. Les Anglais, ah, il suffit de leur parler du temps qu'il fait, et ils sont contents. Les Prussiens… je n'ai pas besoin de vous parler des Allemands, hein ? Après ce qu'ils ont fait à la France ! Si tu en vois, ne leur adresse pas la parole, c'est une question de principe. Les Turcs...
— À vous entendre, il y a beaucoup trop d'étrangers dans ces pays étrangers, dis-je avant de pouvoir m'en empêcher.
— On voit bien que vous n'avez pas l'habitude ! Mais il n'y a rien à craindre : le personnel de bord est français, bien sûr, et très qualifié.
— Je croyais que la Compagnie des Wagons-lits était belge, dis-je.
— Oh juste le fondateur ! Et puis la Belgique, c'est presque la France. Et ils ont passé tout un tas d'accords avec tous ces pays, pour éviter les brigands, et la guerre, et…
— La guerre ? dit Madame depuis l'encadrement de la porte d'où elle nous observait.
— Ma chère ! dit Monsieur en se redressant. Je disais tout ça uniquement pour rassurer Louis. Tout ira parfaitement bien.
— Ernest, mon cher, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Laissez-moi vous faire une Séance.
Monsieur avait été très emballé par les Séances lorsqu'elles avaient été une nouveauté. Après une soirée à faire bouger des verres et lever des tables, il avait décidé qu'il était trop intelligent pour ce genre de chose. Sans mentionner, bien sûr, qu'il avait dormi avec la lumière allumée pendant deux semaines après cela.
— Une Séance me rassurerait, dit Madame. Je ne peux pas vous laisser partir sans savoir l'approbation des esprits.
— Je ne voudrais pas effrayer encore plus votre esprit influençable de femme, dit Monsieur sur un ton un peu tremblant.
— Maintenant, dit Madame de sa voix la plus mystérieuse.
C'est vendredi, nous aurons l'influence de Vénus. C'est la meilleure influence, vous savez. Je l'ai lu, donc ce doit être vrai.
Madame fit entrer Monsieur dans son parloir. Elle avait installé une petite table avec des bougies, des pétales de fleurs, des perles et des cristaux qui servaient d'ordinaire de presse-papier, et une « planchette parlante », tout un tralala théâtral dont Monsieur raffolait. Monsieur avait fait venir la planchette d'Amérique. C'était un simple rectangle de bois où étaient peintes des lettres, quelques mots et quelques dessins ésotériques ; il fallait passer sur la planche une sorte de pointeur qui s'arrêtait soi-disant sur les messages envoyés par les esprits.
Madame fit asseoir Monsieur avant de prendre place à côté de lui. Ils posèrent ensemble leurs mains sur le pointeur. Monsieur était tellement mal à l'aise qu'il osait à peine y laisser un doigt. Madame n'avait qu'à pousser le curseur, et la mise en scène des journaux ne serait peut-être pas un désastre complet…
— O, esprits ! souffla-t-elle. Répondez-moi ! Y a-t-il quelqu'un qui m'entend ce soir ?
Madame, s'attendant probablement à résister à Monsieur, fit glisser le pointeur vers le « oui » avec tant de force que le bois grinça. Monsieur, toujours naïf et bon public, tremblait d'excitation et de peur mélangées.
— O, esprits ! Mon mari veut entreprendre un long voyage dangereux. Doit-il partir ?
Monsieur lorgnait le « oui ». Madame allait pousser le pointeur vers le « non » mais elle s'arrêta soudainement. Son regard se perdit dans le vague. Sur la planchette, le curseur glissa sans bruit vers le « oui », mais Madame ne lui prêtait plus aucune attention.
— Pourquoi ? demanda Madame d'une voix sourde et lointaine.
Cette fois, j'observai le curseur glisser le long des lettres.
— « l…a… r…é…u…n…i…o…n », épela Monsieur. La réunion ! C'est un bon signe, ça ! Je vais rencontrer des gens importants, tu vois !
— Que… qu'est-ce qui l'attend à la fin de ce voyage ? demanda Madame.
— « l…a…v…i…e », épela Monsieur. Lavie ? C'est le nom de quelqu'un ? On dirait un prénom étranger.
Madame se jeta d'un coup en arrière, comme délivrée de l'emprise du pointeur. Sur la planchette, le curseur était placé sur l'image d'un sablier.
— Ça veut dire qu'on peut y aller, hein ? dit Monsieur. Oh d'ailleurs, il faut que j'achète du tissu ! Je ne peux pas emmener Quatresous habillé comme un épouvantail !
Madame ne répondit rien, absorbée dans la contemplation du curseur sur la tablette.
— Je vais commander tout de suite les costumes chez mon tailleur !
Monsieur se leva et courut dans le couloir. Comme Madame ne bougeait toujours pas, je tentai de le suivre sans me faire trop remarquer.
— Quatresous ? Il y a quelqu'un ? Comment ça se fait qu'il n'y ait personne dans cette maison ? Ah, Madame Chardon, dit-il en entrant dans la cuisine. Est-ce que vous pourriez faire porter un message à mon tailleur, immédiatement. Il faut qu'il prenne les mesures de Quatresous et qu'il fasse un, non, deux ! Deux costumes de voyage, et un habit, et…
Il s'arrêta, conscient du regard perçant qu'Eugènie lui jetait.
— Y… y aurait-il un problème ?
— Monsieur, dit Eugènie, je suis désolée de vous le dire, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Vous forcez Quatresous à partir et à mentir, et vous lui faites tous ces vêtements. Ce n'est pas bien, pas bien du tout.
— Et pourquoi cela, s'il vous plaît ?! dit Monsieur, piqué.
— Vous ne pouvez pas partir. On va manquer de personnel et je ne peux pas tenir la maison toute seule !
— Mais vous n'êtes pas seule, il y aura des gens pour le ménage…
— Des journaliers !
— Tous, vous êtes sûre ? Il me semblait que nous avions quelqu'un à temps plein, que je vois tout le temps dans la…
— Des journaliers, Monsieur, des gens qui ne s'impliquent pas ! Et « la corruption de Paris », Monsieur ! Vous ne payez pas assez, alors on a les pires. Celles et ceux qui volent, celles et ceux qui ne font rien de leur journée que de courir les bals, celles et ceux qui font marcher « la remise des domestiques ».
— La quoi ? dit Monsieur, captivé à nouveau.
— Ce sont des magasins qui font payer moins cher aux employés, mais qui mettent le prix fort sur la note, Monsieur, et les domestiques gardant la différence pour eux. Désolée de vous le dire, Monsieur, mais si vous partez avec Quatresous plus personne ne nous protégera contre eux et nous courons tout droit à la ruine !
— Taisez-vous, malheureuse, ne parlez pas si fort, Madame va vous entendre.
— Toute votre collection va être pillée, saccagée, détruite ! Nous allons vivre en haillons, à mendier dans la rue et dormir sous les ponts !
Je devais reconnaître que Eugènie avait réussi où Madame et moi avions échoué. Monsieur avait l'air terrifié.
— Non non non, dit Monsieur. Non non non, ça n'arrivera pas !
— Restez, Monsieur, je vous en supplie, dit Eugènie en reprenant une voix calme et cajolante que je l'avais entendu utiliser avant de tordre le cou des poulets. Et rendez ces billets, c'est plus raisonnable.
— Non non non, répéta Monsieur, non non, je sais ce qu'il faut faire. Je vais prévenir la police, la police viendra surveiller la maison !
— Les policiers ne pourront pas faire le ménage, ou la cuisine !
— Je vais vous trouver les gens. Non, j'ai une meilleure idée ! Je vais vous donner tout l'argent de la semaine pour le ménage, comme ça vous trouverez les meilleurs qu'il soit ! Vous êtes la mieux placée pour ça !
— Monsieur, je ne peux pas…
— Bien sûr que si, vous êtes ma cuisinière, donc forcément vous êtes la meilleure. Tenez, prenez ça, dit-il en lui mettant dans la main deux billets bleus de 20 francs.
— Et pour les vêtements ? dit Eugènie qui semblait interloquée mais pas encore prête à lâcher l'affaire.
— Quels vêtements ? Oh ceux de Quatresous ? Si vous pouviez faire passer ce message…
— Monsieur ! Ne me demandez pas de faire ça !
— Mais il faut bien qu'il aille dans le train de luxe !
— Vous avez encore de très bons costumes de l'année dernière, dit Madame qui nous avait suivi. Nous devrions pouvoir les faire retoucher. Je m'en occupe, Ernest.
— Formidable idée, ma chère ! Je vous le confie !
Puis il remonta vers son bureau, et Madame disparut dans son boudoir, l'air très abattu. Nous avions peut-être gagné quelques batailles sur le front de la peur, mais nous perdions la guerre.
Si on m'avait demandé mon avis, « voler » aurait été pour moi un pêché capital. C'était une question d'honneur. En pourtant, ce soir-là, en désespoir de cause, je cherchai la clef du tiroir dans les poches du costume de Monsieur. Malheureusement ou heureusement, celle-ci resta introuvable.
La lendemain, Madame me demanda de l'accompagner chez un antiquaire. Nous allions ramener une horloge particulièrement chargée d'angelots en or et dont les heures étaient à peine lisibles sous les ornements. Elle avait trôné jusqu'ici sur une table, noyée au centre d'une pile de flacons de Pilules Suisses (« des milliers de guérisons en sont la preuve ! ») contre l'impureté du sang, d'huile de Corylopsis du Japon (« parfumerie Extra-fine ! ») et de Lotion H. Borel (« la seule ordonnée par les médecins ») contre la chute des cheveux. C'était une faible revanche par rapport à notre défaite imminente. L'horloge était si lourde que, même avec l'aide du garçon du magasin, je dus accompagner Madame à l'intérieur.
— Je m'occupe de vous après ces messieurs, nous annonça le propriétaire de la boutique qui était en train de discuter avec deux hommes.
Ceux-ci dégageaient une grandeur, une présence intimidante. L'un d'eux me jeta un regard assassin, et je détournai la tête. Je m'absorbai dans la contemplation de montres de gousset exposées dans une vitrine. J'avais toujours trouvé les montres fascinantes, leur « tic toc » courant après le temps qui passait à la fois sinistre et prometteur, mais cela ne suffit pas à me distraire. Je pouvais toujours apercevoir l'homme dans un miroir accroché au mur : des yeux bleus perçants, un large front, un nez trop court pour son visage et des sourcils sévères. Son compagnon, lui, avait un visage aimable, angulaire, souriant.
— Encore une autre toile ? disait l'homme sévère. Il en a déjà tellement.
— Il a aussi beaucoup de murs sur lesquels les exposer, dit l'homme souriant. Lorsque l'on possède un château, l'on n'a jamais assez de portraits.
— Pourquoi accepter ? dis-je tout bas en direction de la vitrine, sachant que Madame était juste derrière moi.
— Il faut savoir reconnaître ses défaites, dit-elle.
— Et survivre, alors ? Nous devions survivre ça.
— Il s'agit justement de survivre. On ne peut pas lutter contre ce qui est déjà décidé.
— Vous croyez à cette planchette, alors ? Que des esprits ont donné ces réponses ?
— Je crois, dit-elle, que c'est ma main qui a donné ces réponses. Il vous faudra une bonne coupe de cheveux, ajouta-telle en étudiant mon reflet dans la vitrine. Vous ne pouvez pas partir comme ça.
— Prenons lui quelque chose de neuf pour changer, dit l'homme sévère. Quelque chose qui lui donnera envie de venir nous voir, plutôt que l'inverse.
— Tu as raison, répondit son compagnon. Faisons cela. Merci monsieur, dit-il au propriétaire du magasin. Je suis désolé pour le dérangement.
— Ce n'est rien, monsieur Shepherd. La prochaine fois, peut-être.
Les deux hommes quittèrent le magasin, et je retournai à la voiture pendant que Madame se débarrassait de l'horloge.
Plus tard dans la soirée, ce fut Eugènie qui me coupa les cheveux, en grommelant que c'était une folie, mais qu'au moins nous n'aurions pas à payer un barbier en plus du reste.
Le matin du départ, je trouvai devant la porte de ma chambre une petite valise. À l'intérieur se trouvaient les vêtements de Monsieur retouchés à mes mesures. Je les essayai rapidement : les vestes avaient facilement pu être resserrées, mais les manches et les jambes de pantalon avaient de faux ourlets qui cachaient un rajout de tissu. J'avais de quoi m'habiller le jour, une veste pour sortir, une robe de chambre, une redingote pour visiter (qui allait-on bien pouvoir visiter, à Constantinople où nous ne connaissions personne ?), et une tenue de cérémonie pour le soir : un habit noir avec un pantalon assorti, cravate, gilet et gants blancs ainsi qu'un chapeau haut-de-forme. Dans tous les cas, mes chances d'être absolument ridicule était grandes. J'imaginai devoir supporter des regards comme celui de l'homme sévère du magasin d'antiquité, et réprimai un frisson.
Je me changeai afin de pouvoir remettre les vêtements dans la valise et y ajouter mes affaires. J'allais mettre le manuel de savoir-vivre dans la valise, lorsque j'eus un déclic. Le manuel, sur ces vêtements. J'avais toutes mes chances d'être ridicule. Si je me ridiculisais devant les autres passagers connus, dans ce train de luxe, Monsieur déciderait peut-être de faire demi-tour à la première étape pour échapper à leurs rires, et un billet pouvait peut-être se vendre sur un quai, ou nous pourrions nous faire rembourser le reste du voyage… et j'avais un atout majeur dans ma manche.
J'aperçus alors, bien sanglés dans la partie supérieure de la valise, plusieurs objets : une ancienne montre de gousset de Monsieur, encore en parfait état ; un carnet relié de cuir ; un porte-plume ; un petit flacon d'encre. Sur la première page du carnet était inscrit, dans une écriture toute en boucles et en volutes : « Le destin vous y envoie ; ramenez m'en un livre ». Eh bien, cela restait à voir.
La guerre n'était pas encore perdue.
Chapitre 3
28 octobre, Paris, Gare de l'Est. Départ 19h30.
À 7 heures 20 du soir, je me tenais sur le quai de la Gare de l'Est, mal à l'aise dans l'ancien habit noir de Monsieur, avec ses gants, usés et trop larges, et son chapeau haut-de-forme élimé qui glissait sans cesse sur mes cheveux trop courts.
Je venais à peine de quitter les rues familières de Paris sous leur ciel brumeux d'octobre. Devant moi, dans un brouhaha assourdissant, une foule de gens se pressait, allait et venait, s'embrassait, se congratulait, se donnait de dernières recommandations, se souhaitait bon voyage. C'était un ballet étourdissant de tenues d'hiver toutes neuves : cols montants, plis bouffants sur les hanches, profusion de rubans, petites mèches bouclées s'échappant des chapeaux. Je ne reconnus aucun visage. Je ne voyais que des frous-frous.
— Ne reste pas dans le passage, empoté ! me dit Monsieur en s'engageant dans la mer de monde comme si la gare toute entière lui appartenait, fendant la foule en jouant des épaules.
— Laissez passer, laissez passer !
L'activité autour de l'Express d'Orient était à son paroxysme. Malgré sa popularité, c'était un train assez court : un fourgon à bagages, un wagon-restaurant, deux wagons-lits, un autre fourgon, et enfin la locomotive et son tender. Les wagons étaient en bois, peint d'une couleur bronze aux reflets rougeâtres et vaguement menaçants sous les lampes à gaz de la gare.
Les employés de la Compagnie des Wagons-Lits étaient vêtus de la même couleur que le train. Certains chargeaient d'énormes coffres et valises par les larges portes latérales des fourgons, d'autres s'affairaient derrière les voyageurs avec des paquets et des sacs en direction des wagons-lits. Derrière les quinze grandes fenêtres du wagon-restaurant, des maîtres d'hôtel préparaient deux rangées de nappes immaculées, dressées de verres scintillants, de bouteilles accueillantes, d'assiettes décorées de serviettes savamment pliées.
— Quatresous ! Ne traîne pas, bon sang ! dit Monsieur avant de m'attraper par la manche et me tirer jusqu'à notre wagon-lit avec la détermination d'un bœuf lancé à pleine vitesse.
— Voilà, déclara-il fièrement à qui voulait l'entendre, c'est lui, le voyageur qui m'accompagne. C'est mon neveu ! Il est un peu idiot, vous savez, c'est la branche faible de la famille, regardez comme il est tout maigre ! Dans ma grande bonté, j'ai pensé qu'un beau voyage lui ferait du bien ! En première classe, en plus !
L'employé au visage rond et l'air placide à qui Monsieur s'adressait était notre conducteur, autrement dit l'employé chargé de la surveillance générale de notre wagon-lit. Il garda une expression de politesse neutre pendant la tirade de Monsieur, puis me tendit mon billet.
— Soyez les bienvenus à bord de l'Orient Express, messieurs, dit-il en nous ouvrant la portière de la plate-forme.
Ces plate-formes se trouvaient à l'avant et à l'arrière de chaque wagon. Elles avaient un toit, mais elles n'étaient fermées sur les côtés que par des panneaux de bois qui ne m'arrivaient qu'à la taille. En d'autres termes, ces plate-formes protégeaient les voyageurs de la pluie mais les laissaient exposés au vent, ainsi qu'aux regards des curieux sur le quai.
Monsieur gravit péniblement le marchepied, puis se hissa sur la plate-forme qu'il occupa comme une scène de théâtre. Je crus un instant qu'il allait saluer un public imaginaire, ou me faire faire un tour d'animal savant, mais il s'engouffra par la porte qui menait vers les compartiments de couchettes.
Je restai sur la plate-forme, regardant ce que je tenais en main. Mon billet. J'avais enfin mon billet. J'avais 840 francs au bout des doigts. Si je partais maintenant, je pourrais me faire rembourser, et ce serait toujours ça de gagné pour Madame. Je risquais de perdre ma place, du moins, l'une de mes deux places… mais cela valait le coup.
J'ouvris la portière et sautai sur le quai. L'action était grisante, libératrice. J'ignorai les injonctions du conducteur et me faufilai en direction de la sortie…
… lorsqu'un raz-de-marée de bras et de jambes se pressa autour de moi et me ramena contre le wagon-lit. Le conducteur me saisit par l'épaule, et je n'eus pas d'autre choix que de remonter sur la plate-forme pour échapper à la foule. Au milieu des cris et des mains tendues, un rempart d'employés des Wagons-Lits tentait de mener bravement trois personnes jusqu'au train.
— Bienvenue dans l'Orient Express, monsieur Schaefer ! cria le conducteur en couvrant le bruit de la foule.
Un jeune homme, aux cheveux noirs et à l'allure dégingandée, se hissa sur la plate-forme d'un pas mou. Le visage mélancolique du violoniste ne ressemblait pas vraiment à la gravure que j'avais vue dans le Gaulois, mais l'impression de lassitude était la même. La foule semblait aveugle à son indifférence, et des bras se tendaient encore dans l'espoir de le toucher. Derrière lui suivaient une femme et une jeune fille d'environ quinze ou seize ans.
Tristram Schaefer renfilait comme s'il était enrhumé. Il s'arrêta devant moi et me regarda pendant un instant, l'air confus.
— Je vous prie de nous excuser, me dit la femme blonde sur un ton qui ne s'excusait pas du tout.
Je les laissai passer. Tristram Schaefer disparut dans le wagon, mais la marée humaine bloquait toujours le quai, jusqu'au wagon-restaurant. Le restaurant… J'avais peut-être une chance de pouvoir passer par là, si je pouvais le traverser. L'accès au fourgon de queue devait sûrement être encore libre. Le conducteur était occupé à repousser les curieux. J'avais une chance.
Je passai d'un wagon à l'autre par une hasardeuse passerelle et essayai d'ouvrir la porte ; elle était verrouillée. Il y avait un train de l'autre côté de l'Express d'Orient, mais peut-être pourrais-je me glisser entre les deux… le conducteur était toujours distrait…
— Essayeriez-vous de vous enfuir ?
Je me retournai pour trouver la jeune fille en train de m'observer. Sous son chapeau de velours, elle avait un visage de poupée : pâle et lisse, avec une petite bouche, des yeux aux cils presque transparents, des sourcils très fins. J'avais du mal à déchiffrer son expression tant elle était neutre et retenue.
— Non, mentis-je.
— Dommage. J'aurais demandé à vous accompagner. Supplié, peut-être. Suggéré que je pouvais vous payer, en tout cas.
— Vraiment ? dis-je en essayant de déterminer à quelle point elle était sérieuse. Combien ?
— Monsieur Quatresous ? dit le conducteur. Que faites-vous par là ? C'est le wagon-restaurant, dit-il sur le ton très lent et articulé de quelqu'un qui parle à un enfant. Le wagon-lit est celui-ci.
— Oh, fut tout ce que je trouvai à répondre.
— Nous allons bientôt partir, dit le conducteur. Rejoignez votre oncle dans votre compartiment. Allez, allez. Je vous promets que le voyage va bien se passer.
Si j'avais fait un scandale ici, sans Monsieur pour voir la scène, aurais-je pu me faire rembourser mon billet ou bien aurais-je terminé la journée au poste de police ? Ou bien Monsieur les aurait-il convaincus que c'était la preuve que son neveu était idiot, et nous serions partis malgré tout…
— Je vais le guider, dit la jeune fille avant que mon choix ne fût fait.
— Vous êtes trop aimable, mademoiselle Schaefer, dit le conducteur. Merci infiniment.
— Courage, monsieur Quatresous, me dit la jeune fille lorsque je fus de nouveau sur la bonne plate-forme. N'ayez pas l'air si déçu. Il y aura sûrement d'autres occasions.
— C'est ce que j'espère, Mademoiselle… Schaefer ? Vous êtes la… euh… sœur de…?
— Je suis effectivement « La-Sœur-de » Schaefer, c'est le nom sous lequel je suis généralement connue, même de ma mère. Particulièrement de ma mère, si je dois être honnête. Mais mon véritable prénom est Melusine. Je dois avouer que je suis curieuse de savoir quelle prénom un monsieur « Quatresous » peut bien avoir.
— Lou… euh… Louis.
— Évidemment. Seriez-vous banquier, par le plus grand des hasards ?
— Non ?
— Vous avez encore le temps de le devenir, je suppose. Je suis ravie de faire votre connaissance, monsieur Louis Quatresous.
— Moi de même, mademoiselle Melusine Schaefer.
— À présent, entrons dans ce maudit wagon retrouver nos chères familles respectives.
Le petit vestibule et le couloir, brillamment éclairés et entièrement boisés, étaient étonnamment calmes après la clameur de la foule. Une douce sensation de chaleur m'enveloppa ; j'avais oublié que Monsieur avait vanté en long et en large le chauffage à la vapeur ainsi que l'éclairage au gaz.
— Ah ! s'exclama Monsieur qui apparut soudainement devant moi. Quatresous ! As-tu vu cette cabine ? Regarde moi ça ! Tout est boisé, tout est neuf ! Ils auraient tout de même pu mettre du vernis, parce que ça ne sent pas le neuf, c'est dommage. As-tu vu cette lampe ? C'est de la soie verte ! Il faut aimer le vert, moi je trouve que ça me donne l'air malade... Et cette banquette ! Ces rideaux !
Monsieur me saisit à nouveau par la manche pour me faire marcher plus vite. Le compartiment pour deux consistait en une sorte de petit couloir qui permettait tout juste de circuler, muni d'une banquette qui se transformait en deux lits superposés.
— Qu'en penses-tu, alors ?
C'était un cercueil. Un cercueil dont les parois se refermaient sur moi.
— C'est un placard, Monsieur.
— C'est vrai que c'est un peu petit. Je m'attendais à mieux. Un placard… oui, mais c'est un placard de luxe !
Monsieur connaissait toute une liste de détails techniques qui prouvaient indiscutablement que les placards de luxe étaient la meilleure chose à avoir dans la vie, mais je ne l'entendais plus qu'à demi. Un vertige faisait danser le compartiment, ma vision se troublait.
Je me laissai tomber sur la banquette le plus silencieusement possible. Monsieur ne me remarqua même pas, absorbé dans sa description d'une tablette qui, selon lui, devait permettre d'écrire sans aucune rature, grâce à quelque chose de formidable que faisaient les essieux sous les wagons.
Je remarquai une porte, discrètement placée dans la paroi en face de la banquette. Je fis un vague mouvement vers elle, et Monsieur bondit sur la poignée. Celle-ci résista fermement.
— Ah, dit-il, c'est fermé à clef, bien sûr. Ça doit donner sur la cabine à côté. On ne voudrait pas que des étrangers entrent dans la chambre la nuit, n'est-ce pas ! Parbleu, ils pensent vraiment à tout !
Un sifflet retentit soudain et la locomotive se mit en route avec un bruit assourdissant. Le train s'ébranla, prit lentement de la vitesse. Malgré moi, je me précipitai dans le couloir. Depuis la fenêtre la plus proche, je vis le train s'arracher au quai de la gare, laissant derrière lui la foule d'où s'élevaient des mouchoirs et des chapeaux. Le train s'élança dans un tunnel et je ne vis plus que mon reflet dans la vitre.
Près de moi se trouvait un couple d'une cinquantaine d'années. L'homme avait un air militaire, les cheveux gris, une expression de résignation solennelle. Sa femme avait l'air critique d'une institutrice, un visage sévère angulaire, avec des pommettes et une mâchoire fortes, une coiffure et une tenue relativement simples et dépourvues de fioritures. Ils échangèrent quelques mots que je ne compris pas, peut-être en anglais, ou en allemand.
— Quatresous ! me souffla brutalement Monsieur dans l'oreille. Viens donc ici ! Aides-moi à mettre ça, veux-tu ?
Il me tendit les boutons de manchette et l'épingle à cravate les plus larges et les plus brillants de sa collection.
— Moi ? Dis-je.
— Oui, toi, bien sûr ! Qui d'autre ? Il y a du beau monde, je veux qu'ils me voient ! Dépêche-toi un peu ! ajouta-t-il alors que je faisais de mon mieux pour attacher ses manches. Je veux voir les cabinets de toilette, maintenant qu'ils les ouvrent ! Il paraît qu'il y en un comme ça de chaque côté de la voiture ! Deux pour vingt voyageurs, tu te rends compte ! Alors que les autres trains express n'en ont même pas un ! Et ils ont de l'eau froide et de l'eau chaude ! N'empêche que, le matin, il doit y avoir la queue, ils auraient dû en mettre trois.
Mes mains tremblaient, Monsieur ne pouvait s'empêcher de gigoter, et j'avais du mal à glisser les boutons dans les boutonnières. La femme à l'air critique m'observait, ne pouvait pas détacher son regard de mes doigts maladroits. Plus elle m'observait, et plus les boutonnières semblaient se réduire.
— Laissez-moi vous aider, dit-elle finalement en me prenant les boutons de manchette des mains.
— Merci madame, marmonnai-je en prenant l'épingle à cravate.
— Faites toujours attention à ce que vous faites. La concentration, c'est la clef, en toutes circonstances.
Elle enfila les boutons avec une précision chirurgicale, si vite que Monsieur ne s'aperçut même pas de sa présence, et retourna auprès de son mari avant que je n'eus le temps de mourir de honte.
J'avais à peine placé l'épingle à cravate qu'un maître d'hôtel, mieux vêtu et ganté que je ne l'étais, apparut à la porte du wagon. Il annonça, d'une voix élégante :
— Mesdames et Messieurs les voyageurs, le dîner est servi !
Chapitre 4
De Noisy-le-Sec à Epernay
Les boutons de manchettes de Monsieur n'avaient aucune chance d'être remarqués à l'intérieur du wagon-restaurant. Chaque surface, qu'elle soit de bois ou de cristal, brillait de mille feux : l'emploi ingénieux de grandes glaces permettait à la lumière du plafonnier et des chandeliers de se refléter et d'illuminer tous les recoins de la pièce. C'était comme d'entrer dans une boîte à bijoux, au plafond décoré de motifs floraux, et aux parois recouvertes de tapisseries.
La voiture était divisée en quatre parties inégales : d'abord un petit fumoir de six sièges avec des tables tournantes, puis un salon pour dames avec une banquette en forme de « U ». Venait ensuite la salle du restaurant, et enfin la petite cuisine complètement isolée. La salle du restaurant elle-même pouvait accueillir vingt-quatre couverts, les seuls dressés ce soir : d'un côté les tables étaient prévues pour deux personnes, de l'autre pour quatre.
Nous fûmes conduits, Monsieur et moi, à une table pour deux tout au bout du restaurant, adossée à la cuisine. Le cuir clouté du dossier de la chaise était décoré d'une sorte de créature à longues pattes, avec un cou s'enroulant sur lui-même et terminé par une tête crachant du feu. Le motif me sembla si étrange que j'hésitais un instant avant de m'asseoir.
— Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? me souffla Monsieur. Tu vois bien qu'il y a du monde qui attend ! Excusez-le, dit-il au serveur qui plaçait les gens, c'est un provincial. Il n'est pas méchant, juste idiot. Laissez-le donc, il va finir par s'asseoir tout seul.
J'avais l'impression que la créature du dossier était là pour me prévenir d'un danger. Comme si quelque chose de terrible se tenait derrière…
Je me retournai pour découvrir un visage réprobateur autant que familier à la porte du restaurant : c'était l'homme sévère du magasin d'antiquités, en train de discuter avec son ami souriant ! En un éclair je fus sur ma chaise, la tête tournée vers la fenêtre afin de dissimuler mon visage. Je voyais encore son reflet dans la vitre ; les deux hommes étaient accompagnés d'une femme habillée d'un rouge écarlate. Le serveur les plaça à la table en face de la nôtre.