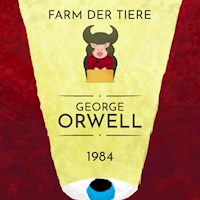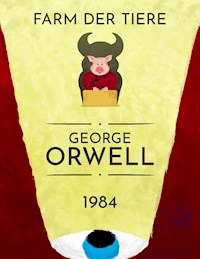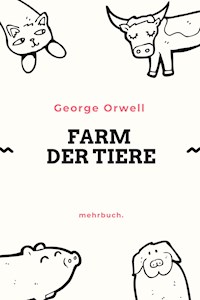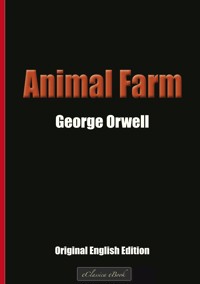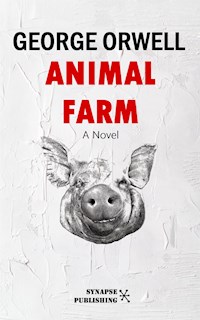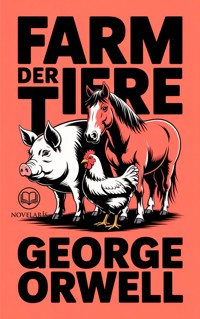0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Santidad
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Winston Smith est un quarantenaire londonien en pleine déprime. On suit son quotidien lors d'une année que l'on suppose être l'année 1984. Dans ce futur affreusement triste imaginé par George Orwell, la vie a profondément changé. Trois grands continents gouvernés par des régimes totalitaires (l'Océanie, l'Eurasie et l'Estasie) se partagent le monde. Winston vit en Océanie, il est employé au Ministère de la Vérité et doit se plier quotidiennement à la discipline de fer imposée par le Parti et plus particulièrement par son grand chef : Big Brother. Dans cette société futuriste, les citoyens sont espionnés vingt-quatre heures sur vingt-quatre par des caméras, jusque dans leur lit. Leur unique droit est d'aller travailler et de rentrer se coucher, ils n'ont aucune distraction, aucune liberté, aucun plaisir. Au cours de cette année 1984, Winston va se dresser contre les tyrans qui l'oppriment. En compagnie de Julia, une autre rebelle comme lui dont il tombe amoureux, ils vont tenter de se libérer de leurs chaînes. Vont-ils y parvenir ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titre Original: 1984
Traduit de l’anglais par Guillaume Hervier
© Editorial Santidad, 2021
©Matériel protégé par le droit d’auteur.
ISBN: 978-84-18631-11-5
PARTIE I
I
C’était une froide et radieuse journée d’avril, les horloges sonnèrent treize heures. Winston Smith, le menton enfoncé dans la poitrine pour essayer d’échapper à un horrible vent, se glissa rapidement entre les portes des Maisons de la Victoire mais pas suffisamment pour empêcher un tourbillon de poussière et de sable d’entrer derrière lui.
Le couloir de l’immeuble sentait le chou bouilli et les vieux tapis usés. Au bout de ce couloir, une affiche colorée, trop grande pour être accrochée à l’intérieur, avait été collée au mur. Elle représentait sobrement un visage énorme, de plus d’un mètre de large, qui appartenait à un homme d’environ quarante-cinq ans doté d’une épaisse moustache noire et de traits durs mais jolis. Winston se dirigea vers les escaliers car ce n’était pas la peine d’essayer de prendre l’ascenseur. Il était rare qu’il fonctionne, même dans le meilleur des cas et en ce moment, l’électricité était coupée pendant les heures de la journée. Cela faisait partie des mesures économiques prises pour préparer la Semaine de la haine. Son appartement était situé sept étages plus haut et Winston, qui n’avait que trente-neuf ans mais qui avait un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite les monta lentement tout en se reposant à plusieurs reprises lors de sa progression. Sur chaque palier, face à la porte de l’ascenseur, le poster de l’énorme visage fixait la scène depuis le mur. C’était l’une de ces images spécialement concoctées pour que les yeux vous suivent à chacun de vos mouvements. « BIG BROTHER vous regarde », cette phrase notée au bas de l’affiche courait dans l’atmosphère.
À l’intérieur de l’appartement, une voix fruitée était en train de lire une liste de numéros en lien avec la production de fonte. La voix provenait d’une plaque de métal rectangulaire qui ressemblait à un miroir terne et qui formait une partie de la surface du mur de droite. Winston tourna un interrupteur et la voix s’évanouit quelque peu, même si les mots étaient encore perceptibles. L’appareil (le télé-écran, comme on l’appelait) pouvait être atténué, mais il n’y avait aucun moyen de l’éteindre complètement. L’homme s’approcha de la fenêtre de sa petite silhouette frêle, la maigreur de son corps accentuée par la salopette bleue qui représentait l’uniforme du parti. Il avait des cheveux clairs, un visage naturellement coloré et une peau qui avait été rendue rêche par le savon râpeux, par les lames de rasoir mal taillées ainsi que par la froideur de l’hiver qui venait tout juste de se terminer.
Dehors, même à travers la fenêtre fermée, le monde avait l’air glacial. En bas, dans la rue, de petites bourrasques de vent faisaient tourbillonner de la poussière ainsi que des papiers déchirés en spirale et bien que le soleil brillât et que le ciel fût d’un bleu éblouissant, il n’y avait l’air d’avoir de la couleur dans rien, à part sur les affiches qui étaient placardées de partout. Le visage à la moustache noire regardait devant lui, depuis tous les coins stratégiques du quartier. Il y en avait un sur la maison juste en face. « BIG BROTHEr vous regarde », disait la légende, tandis que les deux yeux sombres étaient profondément fixés sur Winston lui-même. Plus bas, au niveau de la rue, une autre affiche, déchirée sur l’un des coins, claquait contre le vent par intermittence, couvrant et découvrant de façon alternative le mot INGSOC. Au loin, un hélicoptère rasa les toits, stationna un moment au-dessus d’eux comme une mouche bleue et repartit en flèche en décrivant une courbe. C’était une patrouille de police venue fouiner derrière les fenêtres des gens. Les patrouilles n’étaient pas vraiment gênantes, la seule chose qui importait, c’était la police de la pensée.
Derrière Winston, la voix du télé-écran continuait de bredouiller au sujet de la fonte et du dépassement du neuvième plan triennal. Le télé-écran était capable de recevoir et de transmettre simultanément. Le moindre bruit que Winston faisait, supérieur au volume d’un faible murmure, l’appareil le captait. De plus, tant qu’il restait dans le champ de vision contrôlé par la plaque de métal, l’homme pouvait aussi bien être vu qu’entendu. Il n’y avait évidemment aucun moyen de savoir si on était observé ou non à un moment donné. Connaître à quelle fréquence ou avec quel système la police de la pensée se branchait à la ligne d’un individu ne pouvait être qu’une supposition. Il était même envisageable qu’ils regardaient tout le monde en continu. Quoi qu’il en soit, ils pouvaient se connecter à votre ligne dès qu’ils le désiraient. Il fallait vivre et vous viviez, avec cette habitude qui se transformait en instinct : l’hypothèse que chaque son que vous faisiez était entendu et que, sauf dans l’obscurité, vos moindres mouvements étaient scrutés.
Winston resta le dos tourné au télé-écran. C’était plus sûr, même s’il savait bien qu’un do pouvait également s’avérer révélateur. À un kilomètre environ de son appartement, le Ministère de la Vérité, l’endroit où il travaillait, se dressait majestueux et immaculé au-dessus du paysage crasseux.
« Ça, pensa-t-il avec une sorte de vague dégoût, c’est Londres, chef-lieu de la Piste Une, la troisième ville la plus peuplée des régions d’Océanie. »
Il tenta d’extraire des souvenirs d’enfance de sa mémoire afin de se rappeler si Londres avait toujours été ainsi. Y avait-il toujours eu ce panorama de maisons du dix-neuvième siècle en décomposition avec leurs murs consolidés avec des planches de bois, leurs fenêtres raccommodées avec du carton, leurs toits faits de tôles ondulées, leurs jardins en friche et leurs charpentes qui s’affaissaient dans tous les sens ? Qu’en était-il de ces sites bombardés où de la poussière de plâtre tourbillonnait dans l’air et où les mauvaises herbes poussaient sur les tas de décombres; comment étaient ces larges parcelles où les bombes avaient fait émerger de sordides colonies de baraques en bois qui ressemblaient à des poulaillers ? C’était inutile, il n’arrivait pas à se souvenir : il ne restait rien de son enfance à part une série de tableaux lumineux sans fond et globalement inintelligibles.
Le Ministère de la Vérité (appelé Minivérité) dans le phrasénouveau, était étonnamment différent de tous les bâtiments aux alentours. C’était une énorme structure pyramidale construite en béton, d’un blanc étincelant, qui s’élevait de balcons en balcons à près de 300 mètres de hauteur. De là où Winston se tenait debout, il était uniquement possible de lire, ressortant de la façade immaculée dans une écriture élégante, les trois slogans du Parti :
« LA GUERRE EST UNE PAIX
LA LIBERTÉ EST UN ESCLAVAGE
L’IGNORANCE EST UNE FORCe »
Le Ministère de la Vérité comportait, selon les dires, trois mille pièces au-dessus du sol et le même nombre en dessous. Éparpillés autour de Londres, il n’y avait que trois autres bâtiments de la même taille et de la même allure. Vu qu’ils éclipsaient totalement le reste de l’architecture environnante, il était possible de les voir tous les quatre simultanément depuis le toit des Maisons de la Victoire. C’était les sièges des quatre ministères au sein desquels était réparti l’intégralité de l’appareil gouvernemental. Le Ministère de la Vérité, chargé des actualités, du divertissement, de l’éducation et des beaux-arts. Le Ministère de la Paix, chargé de la guerre. Le Ministère de l’Amour, qui maintenait la loi et l’ordre. Enfin, le Ministère de L’Abondance, qui était responsable des affaires économiques. Leurs noms dans le phrasénouveau : Minivérité, Minipaix, Miniamour et Miniabondance.
Le Ministère de l’Amour était vraiment le plus effrayant de tous car il ne possédait aucune fenêtre. Winston n’était jamais entré dans ce ministère et ne s’était jamais approché à moins de 500 mètres de lui. Il était impossible de pénétrer dans ce bâtiment sauf pour une affaire officielle et après avoir franchi un labyrinthe de barbelés enchevêtrés ainsi que des portes en acier et une batterie de mitrailleuses. Même les rues qui menaient aux clôtures extérieures étaient arpentées par des gardes aux allures de gorilles qui portaient des uniformes noirs et étaient armés de matraques.
Winston se retourna brusquement. Il avait maquillé son visage avec une expression calme et optimiste ce qui était conseillé pour faire face au télé-écran. Il traversa la pièce et se dirigea vers la minuscule cuisine. En quittant le Ministère à cette heure de la journée, il avait sacrifié son déjeuner à la cantine et il savait qu’il n’y avait rien à manger chez lui sauf un généreux morceau de pain rassis qui devait être conservé pour le petit déjeuner du lendemain. Il descendit de l’étagère une bouteille contenant un liquide transparent sur laquelle était apposé une étiquette blanche quelconque indiquant « VICTORY GIN ». Cela fit flotter une odeur d’huile avariée qui ressemblait à celle d’un mauvais alcool de riz chinois. Winston se versa environ l’équivalent d’une tasse à thé, se prépara à recevoir un choc et avala le contenu d’un trait, comme une dose de médicaments.
Instantanément, son visage devint écarlate et des larmes coulèrent de ses yeux. Il faut dire que cette boisson ressemblait à de l’acide nitrique, de plus, en l’ingérant en une fois, cela lui donna la sensation d’avoir été frappé derrière la tête à coups de matraque. Cependant, l’instant d’après, les brûlures dans son ventre diminuèrent et le monde commença à lui paraître plus joyeux. Il prit une cigarette dans un paquet froissé sur lequel était écrit « CIGARETTES VICTORY » mais la saisit imprudemment à la verticale ce qui fit tomber le tabac sur le sol. Il fut plus chanceux avec la suivante. Il retourna dans le salon et s’assit à une petite table qui se trouvait sur la gauche du télé-écran. Il ouvrit le tiroir d’où il sortit un pot à stylos, une bouteille d’encre et un épais livre vierge in-quarto dont l’arrière était rouge et la couverture marbrée.
Chez Winston, pour une raison inconnue, le télé-écran était situé dans une position inhabituelle. Au lieu d’être placé, comme à l’accoutumée, sur le mur du fond d’où il aurait pu contrôler toute la pièce, il était sur le mur le plus long, faisant face à la fenêtre et à une extrémité de ce mur, il y avait une petite alcôve dans laquelle Winston était assis en ce moment et qui, lorsque l’appartement avait été construit, avait probablement été prévue pour accueillir des étagères. De ce fait, en s’asseyant dans l’alcôve et en restant bien en arrière, Winston pouvait demeurer hors de portée du télé-écran, au-delà de son champ de vision. Il pouvait être entendu, bien sûr, mais tant qu’il restait dans sa position actuelle, il ne pouvait pas être vu. C’était d’ailleurs la géographie inhabituelle de cette pièce qui lui avait suggéré, en partie, de faire la chose qu’il était sur le point de faire.
Cette action lui avait également été inspirée par le livre qu’il venait tout juste de sortir du tiroir. C’était un livre particulièrement beau. Son doux papier crème, un peu jauni par le temps, faisait partie de ce genre de papiers qui n’avaient plus été fabriqués depuis quarante ans. Winston pouvait cependant estimer que le livre était encore bien plus vieux que ça. Il l’avait vu posé derrière la vitrine d’un petit brocanteur qui ne payait pas de mine dans un quartier sordide de la ville (un quartier dont il ne se souvenait plus en ce moment) et avait été immédiatement frappé par un irrésistible désir d’en faire l’acquisition. Les membres du Parti n’étaient pas supposés se rendre dans les magasins ordinaires (« vendant sur le marché libre », comme on disait), mais cette règle n’était pas suivie de manière stricte car il y avait diverses choses, comme les lacets ou les lames de rasoir, qu’il était impossible de se procurer de quelque autre manière que ce soit. Il avait lancé un bref regard de haut en bas dans la rue, s’était glissé à l’intérieur de la boutique et avait acheté le livre pour deux dollars cinquante. À ce moment-là, il n’avait pas souhaité s’en emparer dans un but précis. Il s’était contenté de le rapporter chez lui dans sa mallette avec culpabilité. Même si rien n’était écrit dedans, cela restait un achat compromettant.
La chose qu’il s’apprêtait à faire était de débuter un journal intime. Ce n’était pas illégal (rien n’était plus illégal vu qil ne tombait plus sous le coup de la loi), mais si son activité était détectée, il était presque certain que cela serait puni de mort ou au moins d’un séjour de vingt-cinq ans dans un camp de travaux forcés. Winston inséra une mine dans le pot à stylos et la suça afin d’en retirer la graisse. Le stylo était devenu un instrument archaïque, rarement utilisé même pour les signatures mais il s’en était procuré un furtivement et avec difficulté, simplement parce qu’il avait le sentiment que le joli papier crème méritait qu’on lui écrive dessus avec une vraie mine et non qu’on l’égratigne avec un stylo-plume. En vérité, Winston n’était pas habitué à écrire à la main. En dehors de quelques notes très courtes, il était commun de dicter son texte sur un enregistreur ce qui était bien entendu impossible dans le cadre de son objectif actuel. Ainsi, il se décida à plonger son crayon dans l’encre mais vacilla l’espace d’une seconde. Un frisson était passé dans ses entrailles. Marquer le papier était l’action décisive. En petites lettres maladroites, il écrivit :
« 4 avril 1984 »
Il se rassit dans sa chaise. Un sentiment d’impuissance totale l’envahit. Pour commencer, il n’avait pas la certitude de se trouver en 1984. Ça devait être à peu près ça vu qu’il était pratiquement sûr d’avoir trente-neuf ans et qu’il croyait être né vers 1944 ou 1945; mais il était impossible à cette époque de se fixer sur une date précise sans se tromper d’une année ou deux.
Pour qui, il se demanda soudainement dans quel but il écrivait ce journal. Pour l’avenir, pour les générations futures ? Son esprit erra pendant un moment autour de la date incertaine écrite sur la page et se fixa d’un coup sur un mot de phrasénouveau, « doublepensée ». Pour la première fois, l’ampleur de la difficulté de la tâche qu’il avait entrepris lui apparut clairement. Comment pouvait-il communiquer avec le futur ? C’était tout bonnement impossible. Soit le futur ressemblerait au présent et personne ne l’écouterait ou soit il serait différent auquel cas son malheur actuel n’aurait aucun sens.
Il resta assis ainsi un certain temps en fixant la feuille d’un air stupide. Pendant ce temps, le télé-écran s’était mis à diffuser une musique militaire stridente. C’était étrange car Winston ne semblait pas seulement avoir perdu le pouvoir de s’exprimer mais il avait également oublié ce qu’il avait initialement prévu d’écrire. Au cours des semaines précédentes, il s’était pourtant préparé à cet instant mais le fait qu’il n’aurait besoin de rien de particulier à part d’une bonne dose de courage ne lui avait jamais traversé l’esprit. Pourtant, ce qu’il était censé écrire présentement aurait dû être simple. Tout ce qu’il avait à faire était de transférer sur le papier l’interminable monologue en ébullition qui se jouait dans sa tête depuis des années. Cependant, à cet instant précis, même le monologue s’était tari. D’autre part, son ulcère variqueux commençait à le démanger de manière insupportable. Il n’osa pas se gratter car à chaque fois qu’il le faisait, la zone s’infectait. Les secondes s’égrainaient. Winston n’était plus conscient de rien à part de la page blanche qui se trouvait devant lui, de la peau au-dessus de sa cheville qui le démangeait, du vacarme de la musique et de sa légère ébriété causée par le gin.
Il se mit soudainement à écrire avec panique et enthousiasme, à peine conscient de ce qu’il était en train de noter. Sa petite écriture enfantine s’étala de haut en bas sur la page en perdant petit à petit ses majuscules puis finalement ses points :
« 4 avril 1984. Hier soir au cinoche. Que des films de guerre. D’abord un excellent à propos d’un bateau de réfugiés bombardé quelque part en Méditerranée. Les spectateurs ont été très amusés par les plans d’un monsieur vraiment très gros poursuivi par un hélicoptère qui essayait de s’échapper à la nage, au départ on l’a vu se vautrer dans l’eau comme un marsouin, puis on l’a aperçu à travers les viseurs de l’hélicoptère, ensuite il a eu des trous sur tout le corps et la mer autour de lui est devenue rose puis il a coulé comme si l’eau avait réussi à pénétrer à travers ses blessures, le public a éclaté de rire au moment de la noyade. Ensuite on a vu un canot de sauvetage rempli d’enfants et un hélicoptère tourner au-dessus d’eux. il y avait une femme d’un âge moyen, qui était peut-être juive, elle était assise à l’avant avec un petit garçon d’environ trois ans dans les bras. le petit garçon hurlait de peur et enfouissait sa tête dans la poitrine de sa mère comme s’il cherchait à se frayer un chemin pour se cacher en elle et la femme l’entourait avec ses bras pour le réconforter bien qu’elle était elle-même toute bleue de peur, elle continuait de le couvrir avec ses bras comme si elle croyait que cela allait le protéger des balles. ensuite l’hélicoptère a largué une bombe de 20 kilos sur eux un énorme flash et le bateau a fini en morceaux. après on a vu le magnifique plan d’un bras d’enfant qui montait montait montait en volant dans les airs un hélicoptère muni d’une caméra embarquée avait dû le suivre pendant son ascension et il y a eu beaucoup d’applaudissements provenant des sièges réservés au parti mais une femme en bas dans le coin prévu pour les prolos a commencé à faire des histoires et a crié ils nont pas osé montrer ça devant des enfants ils nont pas pas aux enfants ils nont pas jusqu’à ce que la police l’ait mise dehors je suppose que rien ne lui ait arrivé personne ne prête attention à ce que disent les prolétaires réaction typique de prolétaire ils ne sont jamais … »
Winston s’arrêta d’écrire, en partie parce qu’il commençait à avoir des crampes. Il ne savait pas vraiment ce qui l’avait poussé à déverser tout ce flot de détritus. Ce qui était curieux était que pendant qu’il était en train de rédiger, un tout autre souvenir était apparu clairement dans son esprit au point qu’il s’était dit qu’il aurait été tout aussi bien de raconter celui-ci à la place. C’était cet autre évènement, il le réalisait à présent, qui l’avait décidé à rentrer chez lui et à commencer ce journal dès aujourd’hui. Ça s’était passé ce matin même, au Ministère, enfin si on considérait qu’un fait aussi insignifiant pouvait entrer dans la catégorie des choses qui s’étaient passées dans une journée.
Il était environ onze heures et dans le département des archives, où Winston travaillait, les employés étaient en train de traîner des chaises à l’extérieur des boxes et de les regrouper au centre du hall, en face du grand télé-écran, en préparation des Deux minutes de la haine. Winston était occupé à prendre place dans l’une des rangées du milieu lorsque deux personnes, qu’il connaissait de vue mais à qui il n’avait jamais parlé, étaient entrées dans la pièce de manière totalement inattendue. L’une de ces personnes était une fille qu’il croisait souvent dans les couloirs. Il ne connaissait pas son nom mais il savait qu’elle travaillait probablement dans le département des fictions, vu qu’Il la voyait de temps en temps avec des mains huileuses et en possession d’une clé tout droit sortie d’une boîte à outils. Elle devait avoir un travail en lien avec la mécanique des machines à écrire les romans ou quelque chose comme ça. C’était une fille d’environ vingt-sept ans, à l’allure téméraire, elle avait des cheveux bruns et épais, un visage couvert de taches de rousseur ainsi que des gestes rapides et athlétiques. Une petite ceinture écarlate, emblème de la Ligue des jeunes anti-sexe était nouée à son bleu de travail, de façon suffisamment serrée pour faire ressortir l’harmonie de ses hanches. Winston l’avait détesté dès la première fois qu’il l’avait vu et il en connaissait la raison. C’était à cause de cette atmosphère de terrains de hockey, de bains glacés, de marches collectives ainsi que de cet état d’esprit globalement conventionnel qu’elle réussissait à emporter partout avec elle. Winston détestait presque toutes les femmes, surtout celles qui étaient jeunes et jolies. C’était tout le temps les femmes, et particulièrement les plus jeunes d’entre elles, qui faisaient partie des adhérents les plus bigots du Parti, de vraies avaleuses de slogans, des espionnes en herbe et des localisatrices de pensées dissidentes. Ces filles-là lui donnaient l’impression d’être plus dangereuses que tout le reste. Une fois, alors qu’il l’avait croisé dans un couloir, la jeune femme lui avait lancé un rapide regard de côté qui l’avait fait se sentir comme transpercé de part en part et qui l’avait plongé dans une immense terreur, l’espace d’un instant. Le fait qu’elle soit un agent de la police de la pensée lui avait même traversé l’esprit. À vrai dire, ceci était quand même très peu probable. Pourtant, il continuait à ressentir une sorte d’inquiétude, un mélange de peur et d’hostilité à chaque fois qu’elle se trouvait dans les parages.
L’autre personne était un homme qui se nommait O’Brien, membre du Parti Interne et titulaire d’un poste si important et éloigné de lui que Winston n’avait qu’une vague idée de ce qu’il faisait exactement. Un bref silence avait passé dans les rangs de l’assistance lorsque les gens groupés autour des chaises avaient aperçu l’uniforme noir de ce membre du Parti Interne qui s’approchait de la salle. O’Brien était un grand homme costaud doté d’un large cou et d’un visage grossier, comique mais sévère. Malgré son physique impressionnant, il possédait un certain charme dans la manière dont il se comportait. Il avait une technique bien à lui pour repositionner ses lunettes sur son nez qui était assez désarmante, quelque chose d’indéfinissable et d’étonnamment raffiné. C’était un geste qui, en se remettant dans le contexte, aurait pu faire penser à celui d’un homme du dix-huitième siècle désireux de partager le contenu de sa tabatière. Winston avait vu O’Brien quelque chose comme une douzaine de fois en presque autant d’années. Il se sentait profondément attiré par lui et pas seulement parce qu’il était intrigué par le contraste de ses manières sophistiquées et de son physique de boxeur. C’était davantage à cause d’une croyance secrète, ou peut-être même pas une croyance d’ailleurs, seulement un espoir, que l’orthodoxie politique d’O’Brien n’était pas parfaite. Quelque chose sur son visage le suggérait irrésistiblement, mais une fois de plus, peut-être que ce n’était même pas de l’anticonformisme qui était écrit sur ses traits mais simplement de l’intelligence. Quoi qu’il en soit, il avait l’air d’un homme à qui vous pouviez parler si vous cherchiez à tromper le télé-écran et à le rendre inefficace. Winston n’avait jamais fait le moindre effort pour vérifier cette supposition, à vrai dire, il n’y avait aucun moyen de faire cela. À cet instant, O’Brien avait jeté un coup d’œil à sa montre, vu qu’il était pratiquement onze heures et avait décidé de rester au département des archives jusqu’à ce que les Deux minutes de la haine soient terminées. Il s’était positionné dans la même rangée que Winston, à quelques places de lui. Une petite dame aux cheveux couleur sable, qui travaillait dans le box voisin de Winston, était assise entre eux. La fille aux cheveux bruns était installée juste derrière.
L’instant d’après, un discours odieux et grinçant, ressemblant à celui d’une machine monstrueuse en manque d’huile, avait émergé du grand télé-écran placé au fond de la salle. C’était un bruit qui faisait grincer des dents et qui vous hérissait les cheveux sur la tête. La haine avait commencé.
Comme d’habitude, le visage d’Emmanuel Goldstein, l’ennemi du peuple, s’était allumé sur l’écran. Il y avait eu quelques sifflets d’un bout à l’autre de l’assistance. La petite femme aux cheveux couleur sable avait poussé un cri mêlé de peur et de dégoût. Goldstein était le renégat rétrograde qui à son époque, il y avait bien longtemps (combien de temps exactement, personne ne s’en souvenait réellement), avait été l’une des figures de proue du Parti, presque au même niveau que Big Brother lui-même et s’était engagé dans des activités contre-révolutionnaires, avait été condamné à mort, s’était échappé et avait mystérieusement disparu. Le contenu du programme des Deux minutes de la haine variait chaque jour mais il n’y avait pas un seul épisode où Goldstein n’était pas le personnage principal. C’était le traitre originel, le premier profanateur de la pureté du Parti. Tous les crimes ultérieurs commis contre l’organisation, toutes les traitrises, les actes de sabotage, les hérésies, les déviances, toutes ces choses provenaient de ses enseignements. Ici ou ailleurs, Goldstein était encore en vie et il préparait l’éclosion de sa conspiration, peut-être quelque part au-delà des mers, sous la protection de complices étrangers, peut-être même, comme certaines rumeurs l’affirmaient de temps à autre, se trouvait-il non loin d’ici, en Océanie.
Winston avait la gorge nouée. Il n’arrivait jamais à regarder le visage de Goldstein sans ressentir une combinaison d’émotions douloureuses. C’était un visage fin, typiquement juif, couronné par un duvet de cheveux blancs et terminé par un petit bouc, une figure intelligente mais qui était, d’une certaine manière, fondamentalement méprisable à cause de la sorte d’idiotie sénile contenue dans son nez long et fin sur le bout duquel était perchée une paire de lunettes. Son visage ressemblait un peu à celui d’un mouton, tout comme sa voix d’ailleurs qui avait elle aussi toutes les caractéristiques de celle de cet animal. Goldstein avait asséné son attaque venimeuse habituelle contre les doctrines du Parti, une attaque si exagérée et perverse que même un enfant aurait été capable de la percer à jour mais juste assez plausible pour que le sentiment alarmiste qu’elle contenait convainque d’autres gens en partant du principe que ces personnes étaient moins intelligentes qu’elles ne l’étaient en réalité pour se laisser avoir par ce discours. Goldstein avait insulté Big Brother, dénoncé la dictature du Parti, demandé la conclusion immédiate d’une paix avec l’Eurasie, prôné la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de l’assemblée, la liberté de pensée, il sétait exclamé de manière hystérique que la révolution avait été trahie et tout ça dans un discours polysyllabique bien trop rapide qui était une sorte de parodie du style utilisé habituellement par les orateurs du Parti et qui contenait des mots de phrasénouveau : en fait bien plus de mots de phrasénouveau que ce que n’importe quel membre du Parti aurait employé dans la vie réelle. Pendant ce temps-là, de peur que quelqu’un ne doute de la réalité que le blabla de Goldstein cachait, derrière sa tête, sur le télé-écran, les colonnes interminables de l’armée eurasienne avaient défilé, des rangs et des rangs d’hommes solides avec des visages asiatiques inexpressifs qui marchaient jusqu’à la surface de l’écran puis qui disparaissaient et étaient remplacés par d’autres hommes parfaitement similaires. Le bruit sourd et rythmé des bottes des soldats servait de fond sonore aux bêlements plaintifs de Goldstein.
Avant même que la haine n’est atteint les trente secondes, d’incontrôlables exclamations de rage avaient éclaté de la part de la moitié des gens présents dans la pièce. La face de mouton satisfaite d’elle-même en premier plan sur l’écran ainsi que la puissance terrifiante de l’armée eurasienne en toile de fond étaient trop durs à supporter, de plus, le simple fait de voir ou même de penser à Goldstein inspirait automatiquement de la peur et de la colère. Il était un objet de haine bien plus constant que l’Eurasie ou l’Estasie vu que lorsque l’Océanie était en guerre contre l’une de ces deux puissances, elle était généralement en paix avec l’autre. Cependant, ce qui était étrange était que même si Goldstein était détesté et méprisé par tout le monde, tous les jours et mille fois par jour, sur les tribunes, sur les télé-écrans, dans les journaux et dans les livres, même si ses théories étaient réfutées, anéanties, ridiculisées, vues par l’opinion publique comme les déchets pitoyables qu’elles étaient, malgré tout cela, il semblait que son influence ne diminuait jamais. Il y avait toujours de nouvelles personnes crédules prêtes à se laisser séduire par lui. Il ne se passait pas un jour sans que les espions et les saboteurs qui agissaient sous ses ordres ne soient démasqués par la police de la pensée. Il était le commandant d’une vaste armée de l’ombre, d’un réseau souterrain de conspirateurs voués au renversement de l’État. La Confrérie, c’était ce nom qui était supposé être le leur. Il se murmurait également l’histoire d’un terrible livre, un recueil de toutes les hérésies que Goldstein avait produit et qui circulait clandestinement çà et là. C’était un livre sans titre. Les gens ne le nommaient pas ou se contentaient simplement de l’appeler : Le Livre. Toutefois, celui qui connaissait ce genre de choses ne les connaissait que grâce à de vagues rumeurs. Ni la Confrérie, ni Le Livre, n’étaient des sujets qu’un adhérent lambda du Parti abordait s’il était possible de les éviter.
Au cours de la seconde minute, la haine s’était transformée en une folie furieuse. Les gens faisaient des bons sur place et criaient aussi fort qu’ils le pouvaient en s’efforçant de noyer l’exaspérante voix bêlante qui sortait de l’écran. La petite femme aux cheveux couleur sable était devenue rose vif et sa bouche s’ouvrait et se fermait comme celle d’un poisson hors de l’eau. Même la figure sévère d’O’Brien était toute rouge. Il était assis tout droit sur sa chaise, son torse puissant se gonflait et vibrait comme s’il était debout et qu’il luttait contre les vagues. La fille aux cheveux bruns derrière Winston s’était mise à hurler : « Fumier ! Ordure ! Salaud ! », puis avait soudainement attrapé un énorme dictionnaire de phrasénouveau et l’avait lancé sur l’écran. L’ouvrage avait atteint le visage de Goldstein et avait rebondi sur lui; toutefois, sa voix avait continué inexorablement. Dans un moment de lucidité, Winston s’était rendu compte qu’il était en train de crier avec les autres et de frapper ses talons violemment contre les barreaux de sa chaise. La chose horrible à propos des Deux minutes de la haine était que personne n’était obligé de jouer un rôle mais qu’il était par contre impossible d’éviter de se joindre à la foule. Dès les premières trente secondes, tout faux-semblant devenait inutile. Une hideuse extase de peur et d’envie de vengeance, un désir de tuer, de torturer, de fracasser des têtes à coups de masse, semblait traverser l’assemblée comme un courant électrique qui transformait la volonté profonde de chacun en un hurlement dément et grimaçant. De plus, la rage que chaque personne ressentait était une émotion abstraite et sans but qui pouvait se porter aussi bien sur un objet que sur un autre comme la flamme d’un chalumeau. Ainsi, il y avait eu un moment où la haine de Winston n’était plus du tout tournée contre Goldstein mais plutôt contre Big Brother ainsi que le Parti et la police de la pensée. Dans ce genre de moments, son cœur penchait toujours pour l’homme solitaire, l’hérétique sur l’écran qui était raillé mais qui restait l’unique gardien de la raison et de la vérité dans ce monde de mensonges. Sauf que la seconde d’après, Winston redevenait d’accord avec ce que les gens pensaient et tout ce qui se disait sur Goldstein lui semblait être juste. À cet instant, son dégoût secret pour Big Brother se changeait en adoration, puis Big Brother avait l’air de tout dominer de nouveau, il était le protecteur invincible et sans peur qui se dressait comme un rock contre les hordes d’Eurasie, alors que Goldstein, malgré son isolement, son impuissance et le doute qui planait sur son existence actuelle, ressemblait à un enchantement sinistre qui était, par le simple pouvoir de sa voix, capable de détruire les structures de la civilisation.
Il était même possible, dans ce genre de moments, de diriger sa haine vers n’importe quoi et n’importe où puis de la matérialiser par un acte concret. Brusquement, par le même type d’effort violent que pour arracher sa tête de l’oreiller pendant un cauchemar, Winston avait ainsi réussi à transférer la haine qu’il avait pour le visage affiché sur l’écran vers la fille aux cheveux bruns qui se trouvait derrière lui. Des hallucinations vives et magnifiques étaient apparues dans son esprit. Il la fouetterait avec une matraque jusqu’à ce qu’elle meure, il l’attacherait nue sur un poteau et la criblerait de flèches comme Saint Sébastien. Il la violerait et lui trancherait la gorge au moment de l’orgasme. Enfin, il avait enfin compris pourquoi il la détestait tant. Il la détestait parce qu’elle était jeune, jolie et asexuée, parce qu’il voulait coucher avec elle mais que ça n’arriverait jamais, parce qu’autour de sa taille souple et délicate, qui avait l’air de vous inviter à l’entourer avec vos bras, on ne voyait que cette ceinture écarlate odieuse, symbole agressif de la chasteté.
La haine avait atteint son apogée. La voix de Goldstein était devenue le bêlement d’un vrai mouton et la gueule de l’animal avait remplacé le visage de l’opposant pendant quelques instants. Ensuite, la gueule du mouton avait été remplacée par la tête d’un soldat eurasien qui avait l’air d’être en marche, immense et terrible, sa mitraillette rugissante semblant surgir de la surface de l’écran ce qui avait fait sursauter les gens assis au premier rang. Heureusement, au même moment, les spectateurs avaient poussé un soupir de soulagement car le visage hostile s’était transformé et celui de Big Brother avait pris sa place, cheveux noirs, moustache noire, empli d’une réelle puissance et d’un calme mystérieux, il était si grand qu’il avait pratiquement recouvert l’ensemble de l’écran. Personne n’avait entendu ce que Big Brother avait dit. Cela avait probablement été quelques mots d’encouragement, le genre de mots que l’on prononce dans le vacarme d’une bataille, impossibles à distinguer individuellement mais qui restaurent la confiance par le simple fait d’avoir été dits. Puis le visage de Big Brother avait disparu à nouveau et avait été remplacé par les trois slogans du Parti qui s’étaient dressés en gras et en lettres capitales :
« LA GUERRE EST UNE PAIX
LA LIBERTÉ EST UN ESCLAVAGE
L’IGNORANCE EST UNE FORCE »
Cependant le visage de Big Brother avait semblé persister pendant quelques secondes sur l’écran, comme si l’impact qu’il avait eu sur les globes oculaires de l’assistance avait été trop brutal pour s’estomper directement. La petite femme aux cheveux couleur sable s’était élançée sur le dossier de la chaise qui se trouvait devant elle. En articulant un murmure tremblant qui ressemblait à quelque chose comme « mon sauveur ! », elle avait étendu les bras vers l’écran. Ensuite, elle avait enfoui sa tête entre ses mains. Il était clair qu’elle était en train de dire une prière.
Au même moment, l’ensemble des personnes présentes dans la salle s’étaient plongées dans un chant profond, lent et rythmique qui répétait « B-B ! … B-B ! … », encore et encore, très lentement, avec une longue pause entre le premier et le deuxième B, un son lourd, bas comme un murmure, qui était étrangement sauvage et derrière lequel on croyait entendre des bruits de pas faits par des pieds nus ainsi que des battements de tam-tam. Ils avaient exécuté ce chant pendant au moins trente secondes. C’était un refrain qu’on entendait souvent à l’occasion des moments où l’émotion était accablante. C’était en partie une sorte d’hymne à la gloire et à la majesté de Big Brother, mais c’était surtout un acte d’autohypnose, une manière délibérée de noyer sa conscience à travers des sonorités rythmiques. Winston avait senti ses entrailles se refroidir. Pendant les Deux minutes de la haine, il ne pouvait s’empêcher de partager le délire général, mais ce chant inhumain qui faisait « B-B ! ... B-B ! », lui faisait toujours horreur. Bien entendu, il chantait avec les autres, ce n’était pas possible de faire autrement. Dissimuler ses sentiments, contrôler ses expressions, faire tout ce que les autres faisaient était une réaction instinctive. Mais il y avait un petit laps de temps de quelques secondes où ses yeux pouvaient peut-être le trahir. Et c’est exactement pendant cet instant-là que la chose importante s’était passée, enfin, en admettant qu’elle se soit vraiment passée.
Winston avait momentanément croisé le regard d’O’Brien. O’Brien s’était levé, il avait retiré ses lunettes et était occupé à les réajuster sur son nez de sa manière caractéristique. Cependant, il y avait eu une fraction de seconde où les yeux des deux hommes s’étaient rencontrés et pendant le temps où cela s’était déroulé Winston avait su, oui, il avait su, qu’O’Brien était en train de penser la même chose que lui. Un message sans ambiguïté était passé entre eux. C’était comme si leurs deux esprits s’étaient ouverts en même temps et que les pensées avaient glissé de l’un à l’autre grâce à leurs yeux.
« Je suis avec toi, avait semblé lui dire O’Brien. Je sais exactement ce que tu ressens. Je connais tous tes désaccords, toute ta haine, tout ton dégoût. Surtout ne t’inquiète pas, je suis de ton côté. »
Ensuite, l’éclat d’intelligence était passé et le visage d’O’Brien était redevenu aussi impénétrable que celui des autres.
C’était tout, et il n’était même pas sûr que cela se soit véritablement passé. Ce genre d’incidents n’avaient jamais de suite. Tout ce qu’ils réussissaient à produire était de maintenir en lui la croyance, ou l’espoir, que d’autres personnes en dehors de lui étaient également des ennemis du Parti. Après tout, peut-être que les rumeurs de la vaste conspiration souterraine étaient vraies, peut-être que la Confrérie existait vraiment ! Il était impossible, vu toutes les arrestations, tous les aveux, toutes les exécutions, de penser que la Confrérie était seulement un mythe. Certains jours il y croyait, d’autres non. Il n’y avait aucune certitude, seulement de brèves étincelles qui pouvaient tout et rien dire à la fois, des bribes de conversations entendues par hasard, de légers gribouillis sur les murs des toilettes, parfois même, lorsque deux étrangers se rencontraient, un petit mouvement de la main pouvait avoir l’air d’être un signe de reconnaissance. Cela restait cependant de simples conjectures : il avait très probablement tout imaginé. Il était retourné dans son box sans un autre regard pour O’Brien. L’idée de donner suite à leur contact momentané lui avait à peine traversé l’esprit. Cela aurait été incroyablement dangereux même s’il avait su comment s’y prendre. Pendant une ou deux secondes, ils avaient échangé un regard ambigu, et c’était la fin de l’histoire. Cependant, cela avait malgré tout été un moment mémorable, dans cette prison de solitude dans laquelle chacun devait vivre.
Winston sortit de sa torpeur et se redressa. Il laissa s’échapper un rot. Le gin commençait à remonter de son estomac. Ses yeux se fixèrent de nouveau sur la page. Il découvrit que pendant qu’il était assis là, plongé dans ses rêveries, il avait continué à écrire de manière automatique. Cette fois, ce n’était plus la même écriture maladroite et étrange qu’au début. Son stylo avait glissé voluptueusement sur le papier lisse et inscrit en lettres majuscules soigneusement dessinées :
« À BAS BIG BROTHER À BAS BIG BROTHER À BAS BIG BROTHER À BAS BIG BROTHER À BAS BIG BROTHER »
Encore et encore, sur la moitié d’une page.
Il ne put s’empêcher de ressentir un tressaillement de panique. C’était absurde, vu qu’écrire ces mots en particulier n’était pas plus dangereux que l’acte initial d’avoir ouvert le journal, mais pendant un moment, il fut tenté de déchirer les pages souillées et d’abandonner totalement l’entreprise.
Cependant il ne le fit pas, parce qu’il savait très bien que c’était inutile. Qu’il ait écrit « à BAS Big Brother » ou qu’il se soit retenu de le faire, cela ne faisait aucune différence. Qu’il continue le journal ou qu’il ne le continue pas, cela ne faisait aucune différence non plus. La police de la pensée l’aurait quand même. Il avait commis, et il l’aurait également commis même s’il n’avait jamais posé son stylo sur la feuille, le crime absolu qui contenait en lui-même tous les autres crimes. Ils l’appelaient la penséecriminelle. La penséecriminelle n’était pas une chose qui pouvait rester cachée éternellement. Vous aviez beau esquiver pendant quelque temps, même pendant des années, un jour ou l’autre, ils étaient programmés pour vous avoir.
Ça se passait toujours la nuit, les arrestations se produisaient tout le temps la nuit. L’arrachement brutal au sommeil, les mains violentes qui vous secouaient les épaules, la lumière éblouissante dans les yeux, le contour des visages durs autour de votre lit. Dans la grande majorité des cas, il n’y avait pas de jugement ni de procès-verbal de l’arrestation. Les gens disparaissaient, tout simplement, à chaque fois pendant la nuit. Votre nom était supprimé des registres, toute trace de ce que vous aviez fait dans votre vie était effacée, votre simple existence était niée, puis oubliée. Vous étiez aboli, annihilé : vaporisé était le mot plus couramment employé.
D’un coup, Winston fut saisi par une sorte d’hystérie. Il se mit à griffonner avec empressement un gribouillage illisible et désordonné :
« Ils vont me tirer dessus je men fou ils vont me tirer dessus dans le dos je men fou à bas big brother ils tirent toujours dans le dos je men fou à bas big brother »
Il se rassit contre le dossier de sa chaise, légèrement honteux de ce qu’il venait de faire et posa son crayon. La seconde d’après, il sursauta violemment. Quelqu’un venait de frapper à la porte.
Déjà ! Il resta assis, aussi discret qu’une petite souris, dans l’espoir futile que quel que soit l’individu qui avait frappé, il avait décidé de repartir après sa première tentative. Malheureusement non, on frappa à nouveau. Le pire de tout aurait été d’attendre davantage. Son cœur battait la chamade, mais son visage, grâce à l’habitude, était probablement demeuré impassible. Il se leva et marcha d’un pas lourd en direction de la porte.
II
En posant la main sur le bouton d’ouverture de la porte, Winston se rendit compte qu’il avait laissé le journal ouvert sur la table. « À BAS BIG BROTHER », était écrit un peu partout sur la page, en un lettrage presque assez gros pour être visible d’un bout à l’autre de la pièce. C’était quelque chose d’incroyablement stupide. Cependant il réalisa que même dans sa panique, il n’avait pas voulu tacher le papier crème en fermant le livre alors que l’encre n’était pas encore sèche.
Il retint son souffle et ouvrit la porte. Une vague brûlante de soulagement le submergea instantanément. Une femme assez terne, qui avait l’air anéantie, avec des cheveux clairsemés et un visage ridé, se tenait debout à l’extérieur.
« Oh, camarade, commença-t-elle d’une voix morne et gémissante, je savais que je vous avais entendu rentrer. Pensez-vous que vous pourriez sortir et venir jeter un œil à l’évier de notre cuisine ? Il s’est bouché et … »
C’était Mme Parsons, la femme d’un voisin de palier. Madame était un mot déconseillé par le Parti, vous étiez supposé appeler tout le monde « camarade », mais ce mot sortait instinctivement dans la compagnie de certaines femmes. Mme Parsons était une dame d’environ trente ans, mais elle avait l’air beaucoup plus âgée. On avait l’impression qu’elle avait de la poussière dans les rides du visage. Winston la suivit dans le couloir. Ces petites réparations du quotidien étaient un désagrément permanent. Les Maisons de la Victoire étaient de vieux appartements, construits dans les années 1930 ou environ, et qui étaient en train de tomber en lambeaux. Le plâtre s’effritait sur les murs et les plafonds, les tuyaux éclataient à chaque grande période de gel, le toit fuyait dès qu’il y avait de la neige et le chauffage ne marchait qu’à la moitié de sa puissance quand il n’était pas complètement coupé pour des motifs économiques. Les réparations, sauf celles que vous pouviez faire vous-même, devaient être validées par des comités à distance qui étaient susceptibles de retarder le remplacement d’une simple vitre pendant plus de deux ans.
« Bien sûr, c’est seulement parce que Tom n’est pas à la maison, dit vaguement Mme Parsons. »
Son appartement était plus grand que celui de Winston et tout aussi miteux, mais de façon différente.
L’ensemble du logement avait l’air d’avoir été martyrisé, piétiné, comme si un troupeau d’animaux imposants et violents venaient de visiter les lieux. Un amoncellement de jouets : des crosses de hockey, des gants de boxe, un ballon de foot crevé et un short à l’envers imbibé de sueur étaient étalés sur le sol, et sur la table, il y avait un tas de plats sales et des cahiers munis de paires d’oreilles de chien. Des banderoles écarlates de la Ligue des jeunes et des Espions ainsi que l’affiche grand format de Big Brother étaient accrochées au mur. Il y avait l’odeur habituelle de chou bouilli, commune à tout l’immeuble, mais elle était traversée par un relent de sueur aigu, qui, vous le saviez à la seconde même où vous la sentiez, même si c’était difficile à dire, n’appartenait pas à une personne qui se trouvait dans l’appartement en ce moment. Dans une autre pièce, un garçon qui tenait un peigne et un morceau de papier toilette dans ses mains essayait de rester concentré sur la musique militaire que continuait de jouer le télé-écran.
« Ce sont les enfants, dit Mme Parsons, en lançant un regard à demi-inquiet en direction de la porte. Ils ne sont pas sortis aujourd’hui, et bien sûr … »
Elle avait l’habitude de couper ses phrases en plein milieu. L’évier de la cuisine était rempli, presque jusqu’au bord, d’une eau verdâtre immonde qui sentait le chou comme jamais. Winston s’agenouilla et examina le joint placé à l’angle du tuyau d’évacuation. Il détestait utiliser ses mains et il détestait se pencher, deux choses qui étaient généralement susceptibles de le faire tousser. Mme Parsons le regardait, impuissante.
« Bien sûr, si Tom avait été à la maison, il aurait réparé ça en un clin d’œil, dit-elle. Il aime toutes les choses comme ça, il est vraiment très doué de ses mains. Tom est … »
Parsons était le collègue de Winston au Ministère de la Vérité. C’était un homme balourd mais actif, d’une stupidité désarmante. Une masse d’enthousiasme imbécile, l’une de ses bêtes de somme inconditionnellement dévouées de qui, bien plus que de la police de la pensée, dépendait la stabilité du Parti. À trente-cinq ans, il avait été expulsé contre son gré de la Ligue des jeunes, et avant d’avoir été diplômé de cette organisation, il était parvenu à rester chez les Espions plus d’un an au-delà de l’âge légal. Au Ministère, il avait un poste secondaire pour lequel aucune intelligence n’était requise mais à côté de ça, il était une figure dominante du Comité des Sports et de tous les autres comités engagés dans l’organisation de marches communautaires, de manifestations spontanées, de collectes de fonds et de toute activité bénévole en général. Il vous rappelait avec calme et fierté, entre les bouffées de sa pipe, qu’il avait été présent au centre communautaire chaque soir durant ces quatre dernières années. Une odeur de sueur surpuissante, une sorte de témoignage inconscient de sa vie terriblement éprouvante, le suivait partout où il allait et restait dans l’air même après son départ.
« Avez-vous une clé ? demanda Winston, en triturant l’écrou à l’embouchure du tuyau d’évacuation.
— Une clé, dit Mme Parsons, soudain prise d’un élan de lâcheté. Je ne sais pas, je suis sûr que. Peut-être les enfants … »
Il y eut un piétinement de bottes et un peigne fut projeté dans l’air alors que les enfants se ruèrent vers le salon. Mme Parsons apporta la clé. Winston vida l’eau et retira avec dégoût un amas de cheveux de femme qui bloquait le tuyau. Il se nettoya les doigts du mieux qu’il put sous l’eau froide du robinet et retourna dans l’autre pièce.
« Haut les mains ! hurla une voix féroce. »
Un garçon de neuf ans, mignon mais coriace, surgit de derrière la table et le menaça avec un faux pistolet automatique, alors que sa petite sœur, d’environ deux ans de moins que lui, fit le même geste avec un morceau de bois. Ils portaient tous les deux un short bleu, un t-shirt gris et un foulard rouge, l’uniforme des Espions. Winston leva les mains d’un air embarrassé, vu le comportement vicieux du garçon, ça n’avait pas tout à fait l’air d’être un jeu.
« Tu es un traitre ! hurla l’enfant. Tu es un criminel de la pensée ! Tu es un espion de l’Eurasie ! Je vais te tirer dessus, je vais te vaporiser, je vais t’envoyer dans les mines de sel ! »
Ils se retrouvèrent soudainement à bondir autour de lui, à crier « traitre ! » et « criminel de la pensée ! », la petite fille imitant tous les gestes de son frère. C’était assez effrayant, on aurait dit une cavalcade de bébés tigres s’apprêtant à se muer en mangeurs d’homme. Il y avait une sorte de férocité calculatrice dans l’œil du garçon, un évident désir de frapper ou de donner un cou-de-pied à Winston et la conscience d’être presque assez grand pour avoir le droit de le faire. Winston en vint même à penser que c’était une vraie mission ainsi qu’un vrai pistolet que ce petit diable avait entre les mains.
Les yeux de Mme Parsons passèrent nerveusement de Winston aux enfants, et inversement. Dans la lumière du salon, meilleure que dans le reste de l’immeuble, Winston constata qu’il y avait effectivement de la poussière entre les rides de son visage.
« Ils deviennent très bruyants, dit-elle. Ils sont déçus parce qu’ils ne pourront pas aller voir la pendaison. C’est comme ça. Je suis trop occupée pour les emmener et Tom ne rentrera pas du travail à temps.
— Pourquoi on ne peut pas aller voir la pendaison ? rugit le garçon de sa grosse voix.
— Je veux voir la pendaison, je veux voir la pendaison, scanda la petite fille en continuant de gambader autour de la pièce. »
Winston se souvint que certains prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devaient être pendus dans le parc ce soir-là. Cela se passait environ une fois par mois et c’était un spectacle très populaire. Les enfants réclamaient tout le temps qu’on les emmène voir ça. Il prit congé de Mme Parsons et se dirigea vers la porte. Cependant, il n’avait pas fait six pas dans le couloir que quelque chose lui heurta l’arrière du cou et lui causa un choc extrêmement douloureux. C’était comme si on lui avait donné un petit coup sec avec un fil de fer rouge et brûlant. Il se retourna juste à temps pour voir Mme Parsons traîner son fils à travers l’embrasure de la porte alors que celui-ci glissait une catapulte à l’intérieur de sa poche.
« Goldstein ! beugla le garçon alors que la porte se refermait sur lui. »
Ce qui choqua par-dessus tout Winston fut le regard d’effroi impuissant présent sur le visage grisâtre de sa mère.
De retour dans l’appartement, il passa rapidement devant le télé-écran et se rassit à la table en continuant de se frotter le cou. La musique s’était arrêtée. À la place, une voix militaire saccadée lisait, dans une sorte de délectation cruelle, la description de l’armement de la nouvelle forteresse flottante qui venait tout juste d’être installée entre l’Islande et les Îles Féroé.
« Avec des enfants pareils, pensa Winston, cette pauvre femme doit mener une vie terrorisante. Encore un an, ou deux, et ils la surveilleront nuit et jour pour de simples symptômes de dissidence. »
À cette époque, presque tous les enfants étaient horribles. Le pire de tout était que grâce aux moyens d’une organisation comme les Espions, ils étaient systématiquement transformés en petits sauvages ingouvernables sans pour autant que cela n’insuffle en eux de tendance à se rebeller contre la discipline du Parti. Au contraire, ils adoraient le Parti ainsi que tout ce qui lui était associé. Les chansons, les processions, les banderoles, la marche, le forage avec des fusils factices, la déclamation de slogans, l’adoration de Big Brother, tout cela était un magnifique jeu pour eux. Leur férocité était exclusivement tournée vers l’extérieur, contre les ennemis de l’État, contre les étrangers, les traitres, les saboteurs, les criminels de la pensée. Il était presque normal pour les gens ayant dépassé trente ans d’avoir peur de leurs propres enfants, et pour cause. Il était rare qu’une semaine se passe sans que le Times ne publie un paragraphe au sujet d’un petit espion furtif, « un enfant héros » comme ils l’appelaient habituellement, qui avait entendu une parole compromettante et qui avait dénoncé ses parents à la police de la pensée.
La piqûre causée par la munition de la catapulte s’était dissipée. Winston attrapa son stylo sans conviction, en se demandant s’il réussirait ou non à trouver quelque chose de plus à écrire dans le journal. Soudainement, il se mit de nouveau à penser à O’Brien.
Des années auparavant, combien exactement, peut-être sept ans, il avait rêvé être en train de marcher dans une pièce totalement sombre. Quelqu’un assis sur le côté de cette pièce lui avait dit, alors que Winston passait devant lui : « Nous nous rencontrerons dans un endroit où il n’y a pas d’obscurité ». Ceci avait été dit très doucement, avec une quasi-désinvolture. C’était une affirmation, pas un ordre. Il avait continué à marcher sans s’arrêter. Ce qui était étrange était qu’au moment du rêve, ces mots ne l’avaient pas interpelé plus que ça. C’était seulement plus tard et petit à petit qu’ils avaient commencé à acquérir une signification dans son esprit. Il n’arrivait pas à se rappeler si c’était avant ou après le rêve qu’il avait vu O’Brien pour la première fois ni à quel moment il avait identifié la voix de l’inconnu qui l’avait abordé comme étant la sienne. Quoi qu’il en soit, cette association existait. C’était O’Brien qui lui avait parlé dans la pénombre.
Winston n’avait jamais pu être sûr, même après le contact visuel intervenu dans la matinée, il était toujours impossible de savoir si O’Brien était un ami ou un ennemi. Ce n’était d’ailleurs peut-être pas très important. Il existait un lien de compréhension mutuelle entre eux qui était bien plus significatif que de l’affection ou de la camaraderie. « Nous nous rencontrerons dans un endroit où il n’y a pas d’obscurité », avait-il dit. Winston ne savait pas bien ce que cela voulait dire mais il savait que cette prédiction se réaliserait, d’une manière ou d’une autre.
la voix dans le télé-écran s’interrompit. Un signal à la trompette, clair et joli, flotta dans l’air, puis le discours grinçant reprit :
« Attention, votre attention s’il vous plaît. Une information vient de nous arriver du front du Malabar. Nos forces présentes au sud de l’Inde ont remporté une glorieuse victoire. Je suis autorisé à vous dire que l’évènement que nous vous rapportons en ce moment pourrait entrainer une fin prochaine de la guerre. C’était le flash info.
— Voilà une mauvaise nouvelle, pensa Winston. »
C’était obligatoire, après la description sanglante de l’anéantissement d’une armée eurasienne, accompagnée d’un nombre prodigieux de morts et de prisonniers, l’annonce à laquelle Winston s’attendait arriva :
« À partir de la semaine prochaine, la ration de chocolat sera réduite de trente à vingt grammes. »
Winston rota de nouveau. L’effet du gin était en train de se dissiper en laissant s’installer derrière lui une sensation de découragement. Le télé-écran, peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour noyer le souvenir du chocolat perdu, fit raisonner la chanson ‘Océanie, C’est pour toi ». Tout le monde était supposé se lever et l’écouter avec attention. Toutefois, dans sa position actuelle, Winston était invisible.
« Océanie, c’est pour toi », laissa place à de la musique plus légère. Winston marcha jusqu’à la fenêtre en tournant le dos au télé-écran. Le jour était toujours froid et clair. Quelque part dans le lointain, une roquette explosa avec un grondement sourd et diffus. Environ vingt à trente explosions de ce genre se produisaient chaque semaine dans Londres en ce moment.
En bas dans la rue, le vent faisait bouger l’affiche d’avant en arrière en faisant alternativement apparaître et disparaître le mot INGSOC. Ingsoc. Le principe sacré de l’Ingsoc. Le phrasénouveau, la doublepensée, la mutabilité du passé. Il avait l’impression d’errer dans des forêts sous-marines, d’être perdu dans un monde monstrueux où lui-même était le monstre. Il était seul. Le passé était mort, le futur était inimaginable. Quelle certitude avait-il qu’il existait quelque part une créature humaine vivante qui était de son côté ? Comment savoir si la domination du Parti allait durer pour l’éternité ? En guise de réponse, les trois slogans affichés sur la façade blanche du Ministère de la Vérité lui revinrent en tête :
« LA GUERRE EST UNE PAIX
LA LIBERTÉ EST UN ESCLAVAGE
L’IGNORANCE EST UNE FORCE »
Il sortit une pièce de vingt-cinq centimes de sa poche. Là aussi, écrits en lettres fines et claires, les mêmes slogans étaient inscrits, et sur l’autre face, il y avait le visage de Big Brother. Même sur les pièces de monnaie, ses yeux vous poursuivaient. Sur les pièces, sur les timbres, sur la couverture des livres, sur les banderoles, sur les affiches et sur l’emballage d’un paquet de cigarettes, partout. Ses yeux vous regardaient toujours et sa voix vous enveloppait. Éveillé ou endormi, en mangeant ou en travaillant, dehors ou à l’intérieur, dans le lit ou dans le bain, pas d’échappatoire. Rien n’était à vous à part les quelques centimètres cubes à l’intérieur de votre crâne.
Le soleil avait tourné et la myriade de fenêtres du Ministère de la Vérité, à cause de la lumière qui ne brillait plus sur elles, avaient l’air sombres comme les meurtrières d’une forteresse. Le cœur de Winston tressaillit face à cette énorme forme pyramidale. Elle était bien trop solide et ne pourrait jamais être prise d’assaut. Même un millier de bombes ne pourraient pas la faire tomber. Il se demanda à nouveau pour qui il écrivait ce journal. Pour le futur, pour le passé, pour une époque qui était sans doute imaginaire. D’autre part, ce n’était pas la mort qui s’étendait devant lui, mais l’anéantissement. Le journal allait finir en cendres et lui en vapeur. Seule la police de la pensée allait lire ce qu’il avait écrit, juste avant d’éradiquer son existence, puis son souvenir. Comment pouviez-vous lancer un appel au futur quand ni la trace de votre passage sur terre, ni un mot quelconque gribouillé sur une feuille de papier pouvait physiquement survivre ?
le télé-écran indiqua quatorze heures par un petit signal sonore. Il devait partir dans dix minutes. Il fallait qu’il soit de retour au travail à quatorze heures trente.
Curieusement, la sonnerie qui retentit sembla lui redonner un coup de fouet. Il était un fantôme solitaire qui énonçait une vérité que personne n’entendrait jamais. Cependant, tant qu’il la disait, même si le chemin était obscur, le fil n’était pas rompu. L’idée n’était pas d’être entendu mais plutôt de rester sain d’esprit afin de continuer à porter l’héritage humain. Il retourna à la table, trempa son stylo dans l’encre et écrivit :
« Au futur ou au passé, à des temps où la pensée est libre, où les hommes sont différents les uns des autres et ne vivent pas seuls, à des temps où la vérité existe et où les choses qui sont faites ne peuvent pas être défaites.
Depuis l’âge de l’uniformité, depuis l’âge de la solitude, depuis l’âge de Big Brother, depuis l’âge de la doublepensée, salutations ! »
Il pensa que ça y est, il était mort. Il lui semblait que c’était seulement maintenant, alors qu’il commençait tout juste à pouvoir formuler ses pensées, qu’il venait de faire le pas décisif. Les conséquences de tous les autres actes étaient contenues dans cet acte précis. Il écrivit :
« La penséecriminelle ne cause pas la mort, la penséecriminelle est la mort. »
Maintenant qu’il se voyait comme un homme mort il devenait important de rester en vie aussi longtemps que possible. Deux doigts de sa main droite étaient tâchés d’encre. C’était exactement le genre de détail qui pouvait le trahir. Certains fouineurs fanatiques au Ministère (probablement une femme : quelqu’un comme la petite dame aux cheveux couleur sable ou la fille aux cheveux bruns du département des fictions), pourrait se demander pourquoi il avait écrit pendant la pause de midi, pourquoi il avait utilisé un stylo de l’ancienne époque, ce qu’il avait écrit exactement, puis laisser un indice à ce sujet à l’endroit approprié. Il alla dans la salle de bain et frotta l’encre avec soin grâce à un savon abrasif de couleur marron qui vous râpait la peau comme du papier de verre et qui était donc parfaitement adapté pour cette tâche.
Il rangea le journal dans le tiroir. Il était plutôt inutile de penser à le cacher mais il pouvait au moins s’assurer d’être en mesure de détecter si son existence avait été découverte ou non. Un cheveu posé en bas de page était trop évident. Avec le bout de son doigt, il collecta un grain de poussière blanchâtre et le déposa sur le coin de la couverture, à un endroit qui était supposé bouger si le livre était déplacé.
III
Winston était en train de rêver de sa mère.