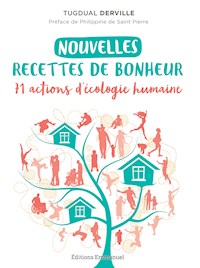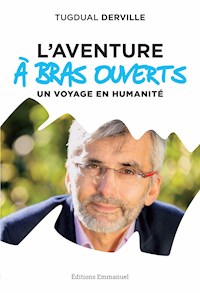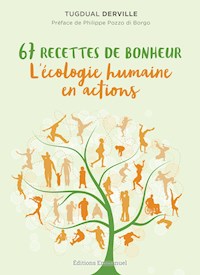
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
Accueillir la rencontre imprévue, suivre (un peu) la mode, opter pour le débat bienveillant, apprendre à s’ennuyer, récuser l’étiquette, écouter, réparer, s’émerveiller... voici quelques-unes des aventures dans lesquelles nous entraîne Tugdual Derville.
À chaque fois, avec humour et finesse, l’auteur part d’un constat et invite chacun à une petite introspection. Puis il suggère de poser un geste dans notre quotidien, une démarche concrète et souvent originale, pour faire avancer en nous et autour de nous la révolution de l’écologie humaine. Une vraie leçon de simplicité et d’espérance pour nous rendre plus humains et nous faire goûter au bonheur de vivre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tugdual Derville
67 recettes de bonheur
L’écologie humaine en actions
Conception couverture : © Christophe Roger
Crédits photographiques : © Christophe Damaggio
Composition : Soft Office (38)
© Éditions Emmanuel, 2018
89, bd Auguste Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-701-8
Dépôt légal : 4e trimestre 2018
Préface
67 recettes de bonheur…
67 recettes de Tugdual Derville pour nous redonner le goût du bonheur.
Dans notre société désenchantée, nous avons bien souvent perdu l’espoir d’un avenir serein. Tugdual nous convainc de croire encore en la beauté de l’humanité. Il ne nous propose aucune exaltation artificielle, mais, étape par étape, ingrédient après ingrédient, nous invite à mijoter un plat savoureux, unique, personnel. Chacun est ainsi amené à faire ses gammes pour élargir son piano de cuisson, à se laisser aider, consoler, sauver. La démarche réclame seulement un peu d’humilité.
Avec ces 67 recettes, Tugdual Derville nous incite à nous détourner de nos chemins convenus. Cela suppose de consentir par avance à ce qui va nous bousculer, nous demander de réviser nos plans, nous « ravir » (« au sens de nous déposséder de nous-mêmes »). À chaque fois, Tugdual clôt cette dépossession par un appel à l’action : à la première occasion, laisser détourner le cours de nos vies par un visage, pour emprunter le chemin de traverse d’une relation inattendue ; choisir de considérer l’autre quel qu’il soit, et rendre ainsi hommage à sa dignité ; ajuster notre regard sur l’humanité fragile, en renonçant aux grandes peurs ou aux grandes illusions. C’est ainsi que nous verrons comment bâtir, en conscience, un avenir réjouissant.
Plutôt que de démonter un système dont les excès semblent conduire l’humanité à une mort certaine, Tugdual part de notre aspiration commune à reconstruire. En ces temps d’incertitude sur le sens du travail, il nous propose de mieux réaliser notre contribution à la transformation du monde. À l’heure de l’impatience généralisée, du « tout, tout de suite » et des plaisirs éphémères, il nous invite à nous mettre à l’école du temps, ce temps de la nature qu’on apprivoise sans la forcer. Retour à la terre ! Par exemple, pourquoi ne pas planter, histoire de restaurer l’alliance entre l’homme et cet humus, d’où nous avons émergé et où nous retournerons ? Planter nous permet d’approcher le secret de la vie, d’en tirer des richesses que nous concocterons dans des vies délicieuses. De goûter vraiment à cette vie.
Avec cette qualité d’accessibilité que procure le mijotement de ses idées, Tugdual invite donc chacun à envisager sa propre contribution pour sortir des impasses de l’existence, tout en se reliant à d’autres, au sein de la communauté. Son ambition est de nous faire prendre conscience de nos absurdités, puis adhérer à des solutions simples et souvent originales. À chacun de les mettre en œuvre en exerçant sa responsabilité.
Dans cette époque figée, voire tétanisée, Tugdual nous bouscule, sans jamais donner de leçons de morale. Il nous remet en mouvement, non pas dans l’agitation et la frénésie, mais sur un chemin partagé, balisé par le sens commun et la confiance restaurée. Sur ce chemin, les étapes sont multiples : retrouver certaines valeurs naturelles à l’homme que la pression sociale a pu dévoyer ; revisiter la personne, le groupe, la communauté ; imaginer des itinéraires pour sortir de la crise existentielle ; donner de l’importance à ces petits riens qui fondent une vie.
Un exemple ? Apprendre à démonter et remonter un objet, pour en saisir la richesse et la beauté ; faire fonctionner ainsi l’intelligence de ses mains ; apprendre la patience, la rigueur, le soin. Voilà une recette facile à réaliser ! C’est avec cette philosophie, sans négliger les petites choses, que nous pouvons entrer dans un chemin de réparation pour la terre, notre maison commune si défigurée. Autre exemple, pour apprendre à nous unifier : établir d’abord un petit schéma personnel décrivant la façon dont nous cultivons et cuisinons chacune de nos quatre dimensions (physique, psychique, intellectuelle ou spirituelle) ; choisir ensuite une action pour rééquilibrer l’une ou l’autre par trop délaissée, histoire de bien nous tenir debout. J’y souscris. Parole de tétraplégique !
Le fastfood insipide a une racine commune : l’absence de l’autre dans nos vies pressées. Avec sa cuisine savoureuse, Tugdual propose de nous réconcilier avec notre nature intime en opérant un basculement du moi vers l’autre. Tous, en effet, nous aspirons à une dépendance assumée.
À l’image des anciens, Tugdual fait preuve de sagesse et de bon sens. Ses recettes sont puisées dans une condition humaine intemporelle, à partager ensemble. Il sait percevoir la simplicité des choses avec lucidité et humilité, sans complications inutiles, sans artifice trop épicé, sans l’intellectualisme qui dénature certaine cuisine « nouvelle », sans dramatiser non plus devant les difficultés. Il nous aide à réconcilier notre intériorité avec le monde extérieur, à vivre intensément l’instant présent, le seul propice à la rencontre véritable et au ressourcement. Son espoir est de nous convertir à une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d’être, sans nous torturer. Simple exercice de respiration…
Le goût du bonheur que Tugdual nous incite à redonner à notre vie revient à humaniser le monde avec bienveillance, à participer, humblement et joyeusement, au banquet des hommes du temps présent. À travers toutes ces recettes, il s’agit en réalité de consentir à l’imprévisible, de se mobiliser sans remettre à plus tard, de rester ouvert à la rencontre de l’inconnu, toujours différent. Ce sont en effet les différences qui font le mieux ressortir ce que l’humanité a de commun, ce qui nous relie. L’autre, différent, est bien mon « semblable » : ce qui nous unit en profondeur est toujours plus fort que ce qui nous divise.
Avant de nous engager dans la cuisson, Tugdual nous invite au voyage intérieur. Ce qu’il y a de délétère, d’encombrant, de douloureux, aura tendance à s’évaporer pour laisser place à une harmonie, à un état intérieur plus conscient, plus paisible, plus ouvert. Prenons le temps de ce voyage intérieur pour simplement nous offrir le présent, avec cette lenteur si nécessaire à la cuisine de la vie. Vivre, en effet, c’est oublier sans cesse, puis goûter la nouveauté régénératrice.
La lecture des 67 recettes de bonheur de Tugdual Derville nous apaise, nous unifie et, à l’instar d’un repos qui suit un bon repas, nous mène à la contemplation. Ce goût du bonheur auquel il nous convie est une leçon de vie, une recherche du « goût d’être », être en vérité. Ce goût incomparable, je souhaite que ce livre vous aide, vous aussi, à le cueillir pour mieux le savourer.
Philippe POZZO DI BORGO Essaouira, octobre 2018
Ami lecteur !
Les 67 idées présentées dans ce livre dessinent une petite philosophie de la vie. Elle tient en un mot : bienveillance.
Sorties toutes crues de mon laboratoire intérieur, ces recettes sont nées d’observations et de rencontres. Toutes veulent rejoindre notre soif commune de beau, de bien et de vrai. Chaque chapitre propose une action à réaliser.
Vous pouvez découvrir ces recettes au fil des pages ou dans le désordre, selon l’attrait suscité par les titres et les résumés.
Quel bonheur si je parvenais à suivre tous mes conseils ! Il restera toujours du chemin… Quant à vous, pour vous donner toutes les chances de vous les approprier, je vous suggère de lire « crayon en main ». Soulignez, complétez, annotez librement ce livre. Ou contestez-le. Ajoutez surtout votre propre sel. Pimentez-le, à votre façon, pour enjoliver nos vies.
Et, surtout, fermez-le illico dès que vous vient une intention précise, en écho à ce qui est proposé : mieux vaut passer à l’action sans délai.
Priorité à l’humanisation !
Tugdual Derville
01
Prendre sa place dans l’Histoire
Plutôt que de regarder passivement passer le train de l’histoire, quitte à la commenter ou la déplorer, si nous nous y embarquions joyeusement ?
Quand une année commence, c’est une nouvelle étape de l’histoire des hommes à laquelle nous participons, vous et moi. Quelle résolution prendre ? J’en propose une : ne pas laisser passer les trains de l’histoire comme une vache ruminant au bord de la voie ferrée.
Nous avons tous la capacité d’influer sur le cours de l’histoire des hommes, à notre hauteur, sans nous laisser démoraliser par ce qui ne va pas, ou hypnotiser par ce qui nous fascine… Je propose une prise de conscience : la véritable histoire des hommes ne se joue pas sur ce qui se voit (ce qui est médiatisé), mais dans ce qui se vit.
Pensons aux périodes sombres de l’histoire de nos pays où quelques-uns ont ramé à contre-courant du mensonge, du totalitarisme, de la barbarie… On pourrait dire aujourd’hui de la pensée unique. Résistants de tout poil ! Parfois au prix de leur vie, mais souvent aussi par de minuscules gestes dont personne n’a rien su. Un sourire peut, d’une certaine façon, sauver le monde. Certainement sauver une vie.
Si le sens que je veux donner à ma vie, c’est d’« humaniser le monde », alors je choisirai l’amour et l’altruisme comme moteurs de l’histoire.
Alors, action !
Nous pouvons d’abord réfléchir – papier en main – à ce qui, dans le cours de l’histoire actuelle (grande ou petite) dans laquelle nous sommes plongés ici et maintenant nous réjouit, nous trouble ou nous peine.
Qu’est-ce qui me réjouit ? Qu’est-ce qui me trouble ? Qu’est-ce qui me peine ? Cela peut-être quelque chose de très lointain ou de très proche. Cela peut concerner ce qui est médiatisé ou ce que j’observe par moi-même. Évolution des mœurs, de la technique, souffrances des hommes… Il faut peut-être privilégier ce que nous voyons autour de nous, à portée de nos bras.
Imaginons que nous ayons fait ce petit travail. Suis-je maintenant capable de passer, sur au moins un sujet, de la constatation, du commentaire, voire de la déploration à une action « humanisante » ? Une action, même ponctuelle, qui serait dans mes cordes ? Qui contribuerait à plus de joie, de justice, de consolation ? Vous connaissez la formule : « Mieux vaut allumer une lampe que maudire l’obscurité. »
Peu importe le moyen. Prise de parole ? Rencontre ? Échange ? Formation ? Prière ? Il y a mille façons d’accrocher notre petit wagon sur le train de la grande histoire. Action individuelle ou collective ; intérieure ou extérieure ; secrète ou visible. Mieux vaut prendre une petite initiative qui nous relie à au moins une autre personne. Je parie que, si nous choisissons d’être disponibles, les circonstances vont nous donner, dans les jours à venir, l’occasion de passer à l’action.
Et n’hésitez pas à raconter autour de vous comment, désormais, vous vous sentez participer, humblement et joyeusement, à l’histoire des hommes du temps présent.
02
Transmettre ce qui est reçu
Nous pouvons prendre conscience de ce nous avons « hérité » de précieux de la part d’autrui, pour décider de transmettre quelque chose à quelqu’un.
Quel que soit notre âge, nous oublions parfois à quel point nous sommes héritiers des générations qui nous ont précédés. Aucun être humain ne s’est fait tout seul. Même si tout un courant de pensée croit qu’il faut récuser ses enracinements pour conquérir sa liberté, je suis persuadé de l’inverse : avec la philosophe Simone Weil, nous pouvons constater que nous recevons la presque totalité de ce que nous sommes de multiples racines, toujours vivantes, qui nous donnent notre identité1. Nous nous recevons de nos parents biologiques et de leurs ancêtres, de lieux géographiques où nous nous sommes développés, d’une culture, d’une religion… Et ces racines sont bien vivantes car nous continuons d’y puiser des forces et du ressourcement. La famille est un premier lieu d’enracinement. Mais le « pays » (comme on disait autrefois d’un territoire natal) compte aussi.
En ces temps de doute sur l’identité de la France, nous sentons combien l’appel des racines est devenu, soudain, un sujet sérieux qui préoccupe nos concitoyens. L’histoire, la langue, la terre sont des « communs » d’un pays. Ils constituent une sorte d’esprit de famille à partir duquel je peux me construire, et m’ouvrir. Au contraire, les mots orphelin et apatride sont des « maux » parce qu’ils attestent un déracinement.
Bon, assez glosé. Place à l’humanisation.
Alors, action !
Voilà ce que je vous propose si le cœur vous en dit.
Il s’agit d’abord de recueillir – par tous les moyens à notre disposition – des données sur nos ascendants. Nous pouvons le faire jusqu’à la génération de nos arrière-grands-parents, c’est-à-dire (en comptant parents et grands-parents) quatorze personnes. Prénom, nom, date et lieu de naissance et d’éventuel décès, et profession. Avec, si possible, une photographie – plus ou moins jaunie – pour chacun. Avec un peu de chance, cette recherche va nous relier, autour de la quête de leurs souvenirs, à des personnes encore vivantes capables de nous renseigner. Nous allons explorer le temps vers notre origine, remonter notre fleuve en direction de sa source. Nous voici donc en possession de notre généalogie minimale illustrée. En regardant ces visages et ces noms, peut-être prendrons-nous davantage conscience de l’héritage immatériel que nous devons à certains d’entre eux. Nous pouvons bien sûr ajouter quelques autres personnes : celles qui ont tellement compté pour nous qu’elles sont à inclure dans nos racines vivantes. Car l’homme, contrairement à l’arbre, s’enracine en marchant. Il ne cesse de se ressourcer à des racines anciennes et nouvelles.
Que faire de tout cela ? Tout simplement transmettre un petit bout de cet enracinement, en l’offrant à quelqu’un. Saisir une prochaine occasion pour nous donner la joie de la transmission. Ce peut-être une pensée, l’amour d’une œuvre d’art, une chanson, une poésie, un savoir-faire, une attitude, un état d’esprit, une valeur… Vous voulez un exemple ? Près de chez mes grands-parents maternels, dans le Var, vivait un vieil immigré italien qui m’a appris à monter des hameçons pour la pêche. J’ai de temps en temps la joie de transmettre à mon tour ce savoir-faire à certains enfants. Un de mes ascendants bien-aimé m’a souvent dit qu’on n’utilisait pas assez le point-virgule ; du coup, quand j’en tape un, je pense à lui. C’est transmis. Point final.
03
Choisir des racines qui ressourcent
Comme un arbre, nous puisons nos forces, notre ressourcement, par des racines vivantes que nous pouvons faire grandir en conscience.
Cette fois, je reviens sur nos racines… Mais sous un autre angle. Reprenons l’allégorie de l’arbre. N’oublions pas que ses racines sont bien vivantes, sinon il serait mort. Plus il déploie sa ramure, plus il s’enracine secrètement, pour puiser à la mystérieuse source qu’il s’est choisie…
Contrairement à ce qu’on pense parfois des racines, il ne faut pas les confondre avec quelque chose de figé, de sclérosé ou de sclérosant. Non seulement les racines grandissent, se renforcent, se multiplient, plongent plus loin à mesure que se développe la vie, mais ce sont elles qui assurent le ressourcement continu. Les racines qui meurent ne servent plus à rien, ne transmettent rien, ne tiennent plus rien. Elles pourrissent. Et puisque les hommes s’enracinent au travers de leurs expériences, la question qui nous est posée aujourd’hui est celle de notre action consciente d’enracinement. Partir à l’aventure, c’est aussi s’enraciner. D’ailleurs, les personnes qui découvrent une nouvelle civilisation font cette expérience : en s’y immergeant, ils renforcent souvent leur attachement à leurs propres racines et traditions. Qu’ils restent à l’étranger, ils les cultivent volontiers, comme l’atteste la vitalité de certaines traditions nationales au sein de communautés d’immigration ; qu’ils reviennent à la maison, ils goûtent avec délices leurs racines retrouvées, enrichies d’une sève exotique…
Mais comment s’enraciner consciemment ?
Prenons un exemple : si j’arrive dans un village, une entreprise, une belle-famille, bref une nouvelle communauté, n’ai-je pas besoin d’exercer, aidé de ses membres, une action consciente d’enracinement ? Je découvrirai une histoire, des événements passés qu’on me raconte, un langage, de nouveaux rites, un état d’esprit qui contribueront à m’inclure, m’intégrer, me ressourcer. Tout cela va me donner un sentiment d’appartenance et des forces pour agir, rendre service, être utile… À noter que ce travail d’enracinement mobilise d’autres acteurs, et me relie par essence aux autres membres de la communauté. Vous me suivez ?
Alors, action !
Je pense que vous avez deviné la proposition qui vient. Avec encore les deux phases : introspection, action. Il s’agit tout d’abord de prendre conscience de nos lieux d’enracinement volontaire. Quelles sont les racines dont j’ai aujourd’hui besoin pour mieux m’inclure, me relier, humaniser le monde ? Occasion peut-être de réaliser douloureusement que je n’ai pas réussi à m’enraciner, parce qu’on ne m’a pas accueilli, qu’on m’a mal informé, qu’on m’a même rejeté. Ou simplement qu’un bon livre d’histoire va me faire du bien.
La suite est évidente : à chacun d’agir pour faire grandir davantage ses racines, avec d’autres. Face à la société individualiste où les personnes sont trop souvent perçues comme des individus autonomes, égoïstes, sans attaches, le travail d’enracinement et d’engagement relie les hommes et les rend interdépendants, solidaires. Comme la fragile dune de sable est tenue par les racines de la végétation qui y pousse, la société est tenue par les relations tissées entre les personnes. Je parie donc que chacun aura l’occasion de faire quelques rencontres ou activités « enracinantes » pour soi-même ou pour des personnes isolées, mal intégrées, exclues.
Bref, enracinons-nous les uns par les autres.
04
Nommer le vivant
Chaque jour, nous croisons diverses espèces animales et végétales. Et si nous nous y intéressions de plus près ?
Sous nos latitudes, si nous survivons au climat frisquet de l’hiver, c’est grâce à notre culture humaine. Car nous ne disposons ni des moyens ni des abris naturels pour maintenir notre température corporelle au-dessus du seuil de viabilité. Il nous faut du feu, de l’énergie, des outils et des vêtements pour résister, là où bien des animaux sont condamnés à l’émigration saisonnière.
C’est l’occasion de jeter un coup d’œil en dessous de nous. Je veux parler du règne animal. Quelle que soit la saison, nous cohabitons avec des bêtes. Elles pullulent souvent aux beaux jours. Et nous en croisons moins en hiver : les insectes hibernent, nombre d’entre eux s’enterrent, ainsi que des batraciens et quelques mammifères. Mais c’est l’occasion de mieux observer ceux qui sortent encore. Il reste beaucoup d’animaux, notamment d’oiseaux qui hivernent dans nos contrées.
Regardons-les. Comment l’Homo sapiens mérite-t-il de considérer la biosphère ? Sans mépris surtout. Car il en fait partie autant qu’il en dépend. Mais admettons que nous en sommes la plus belle créature : la fine fleur de la biodiversité, c’est l’homme ! Né nu certes, mais si performant ! Il semble même que l’absence de pelage nous donne une endurance exceptionnelle : le système de thermorégulation propre aux hominidés nous permet (depuis deux millions d’années paraît-il) de pratiquer la « chasse à l’épuisement », grâce à notre capacité de nous refroidir par transpiration. Dans la savane africaine, quelques tribus de chasseurs d’antilopes savent encore qu’ils ont le temps pour eux : il leur suffit de trottiner à distance de leurs proies en attentant que la plus faible s’effondre sous un coup de chaleur. Comme le chien qui tire la langue, l’antilope n’a que la bouche pour se refroidir. Elle peut donc se chasser à l’usure. Pourquoi ces précisions ? Pour admirer l’extraordinaire corps humain, plus polyvalent que celui de n’importe quelle bête. Mais j’en viens à un autre signe de notre supériorité : c’est nous qui nommons. Les bêtes et les plantes. Déjà 40 000 espèces de charançons (ces coléoptères munis d’une petite trompe) ont été recensées par les entomologistes. Et il pourrait y en avoir tout autant à découvrir… Stupéfiante biodiversité, qu’on sait menacée.
Alors, action !
Dans les jours qui viennent, vous allez certainement tomber nez à nez avec une bête sauvage. Autochtone ou invasive. Mammifère, oiseau, bestiole… Les citadins autant que les ruraux sont concernés. Cela donne un but à nos promenades. Je pourrais dresser une étonnante liste des animaux d’Île-de-France qui passent inaperçus dans nos rues, tant qu’on ne s’y intéresse pas. Les écosystèmes n’en finissent pas de chercher leur équilibre… Quand j’étais jeune, les grillons abondaient dans le métro parisien. Ils s’y sont éteints avec leur chant depuis l’interdiction de fumer, car ils se nourrissaient des vieux mégots jetés sur les voies. Mais d’autres bestioles réapparaissent…
Bref, que vous soyez urbain ou campagnard, je vous propose cette fois de tout faire pour identifier votre prochaine rencontre animale. L’observer. L’écouter, si elle dit quelque chose. Nommer la bête, histoire de faire plus ample connaissance, et creuser son mode de vie, avant de partager avec quelqu’un vos découvertes. Internet, pour une fois, pourra servir à l’identification d’après photo. Tous chasseurs d’images, pour nous réjouir ensemble du vivant qui nous entoure !
05
Accueillir la rencontre imprévue
La société de la performance peut bien nous faire injonction de réussir nos projets, de la vie à la mort : vivre, c’est d’abord accueillir l’imprévu.
Notre existence s’établit selon un équilibre entre d’un côté ce qui est prévu (ou prévisible) et de l’autre ce qui nous arrive par surprise. Nous avons tous besoin d’habitudes, d’horaires, de rites. Ils nous reposent, nous sécurisent. Ils structurent et rythment notre existence. Mais nous avons aussi besoin d’inattendu. Un besoin vital. Nos souvenirs sont illuminés par les grands imprévus de nos vies, qu’ils semblent allonger comme par magie. Même quand ils nous ont dérangé… Rien de tel qu’une bonne panne d’électricité ou de train pour créer des liens de voisinage, n’est-ce pas ?
Nos ancêtres ruraux, qui cultivaient la terre, savaient à quel point le travail, au-delà de l’ordonnancement millimétré du temps, du lever au coucher du soleil, de la lune et des quatre saisons, était tributaire de la surprise… climatique. Parfois dramatique. Mais qui permettait aussi d’espérer une récolte exceptionnelle. L’imprévisible de la terre était compensé par un surcroît de solidarité. Pluie, gel, grêle, sécheresse, inondations… Comme encore aujourd’hui les paysans, ils avaient appris à articuler les rites et la surprise.
Mais l’homme postmoderne s’escrime de plus en plus à prévoir. Depuis la révolution industrielle, nous avons pris l’habitude de parler au « futur de certitude », de faire des projets, de les planifier, d’être condamnés à les réussir. De s’assurer contre tous les risques. On ne reçoit plus ses amis à l’improviste comme en Afrique. Nos maladies sont désormais annoncées par la médecine prédictive. Même nos propres enfants sont conçus comme des projets à planifier et réussir, eux qui ont pourtant besoin, avant tout, comme chacun de nous, d’être accueillis tels qu’ils sont. Idem pour la mort, la faucheuse sauvage : de plus en plus de personnes imaginent désormais la domestiquer. Comme si mourir pouvait devenir un projet.
En réalité, tout l’enjeu de la sagesse d’une vie est, de son début à sa fin, de consentir à l’imprévisible. Imaginons un instant ce que deviendrait une vie décidée par avance ; une seule journée dont nous connaîtrions tout dès le lever. Faudrait-il laisser aux compétitions sportives, à la pêche à la ligne, à l’actualité dramatique du monde, aux accidents de vie, la seule part d’inattendu ?
Alors, action !
Objectif : adopter pendant une journée de notre choix un regard d’enfant, un regard neuf. Car c’est d’abord une question de regard. Entre l’œil blasé que toute nouveauté dérange et l’œil vif qui se rend disponible à la découverte, c’est une question de choix. Un choix de vie.
Commençons par le tester pendant un bon morceau de temps, un trajet, une promenade, un jour de détente ou même de travail. Nous oublierons ce jour-là les écrans aliénants de nos téléphones portables. Nous nous laisserons surtout surprendre par les vrais visages rencontrés. De là à entamer la conversation… ? Il n’y a qu’un pas que certains feront. Car il n’y a pas de plus bel inattendu que celui d’une rencontre humaine.