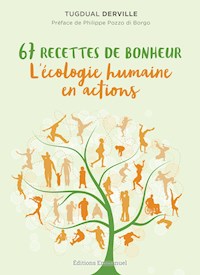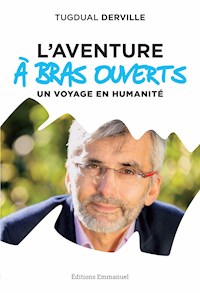
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le grand défenseur de la vie Tugdual Derville nous raconte comment la rencontre d'un enfant handicapé a changé sa vie et l'a amené à fonder l'association "À bras ouverts."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tugdual Derville
L’aventure À Bras Ouverts
Un voyage en humanité
Certains prénoms des enfants et jeunes évoqués dans cet ouvrage ont été modifiés.
Conception couverture :© Christophe Roger
Composition : Soft Office (38)
Crédits photographiques :
Couverture : © Christophe Damaggio
Intérieur : © À Bras Ouverts
© Éditions de l’Emmanuel, 2017
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-587-8
Dépôt légal : 2e trimestre 2017
À tous les enfants et jeunes d’À Bras Ouverts.
À Cédric, Michel, Mehdi, Charlotte, Mario, Perrine, Pierre, Valérie et tous les autres qui sont déjà partis au Ciel.
Aux accompagnateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
À tous ceux qui ont construit l’association depuis plus de 30 ans en acceptant une responsabilité, et à ceux qui les suivront.
À tous ceux qui ont encouragé et soutenu l’aventure d’À Bras Ouverts.
Préface
Le témoignage de Tugdual Derville est profondément intéressant ! Il raconte, du point de vue de son fondateur, l’histoire d’À Bras Ouverts. À l’âge de 20 ans, Tugdual a découvert, en devenant ami de Cédric, qu’il y a comme deux mondes : un monde où la culture ambiante sépare ceux qu’on dit « bien portants » de ceux qui sont incapables de connaître et de faire beaucoup de choses ; et le monde caché de l’amitié avec les exclus.
Le mouvement qu’il a fondé en 1986 pour favoriser cette amitié réunit des enfants et des jeunes porteurs de divers handicaps physiques et intellectuels et de jeunes accompagnateurs, le temps d’un week-end ou d’un séjour de vacances. Ces moments sont sources d’immense joie pour ces jeunes résidant dans des hôpitaux, trop souvent enfermés sur eux-mêmes, parfois dans des formes de dépression : « Je ne suis pas capable donc je ne vaux rien. » Avec À Bras Ouverts, ils découvrent des amis qui s’engagent à leurs côtés. Leurs parents profitent de moments de repos, tout en sachant leurs enfants en sécurité et heureux avec de nouveaux amis. Cette joie est largement partagée par les accompagnateurs qui donnent de leur temps hors de leurs études et de leurs métiers. Les professionnels des institutions où demeurent ces enfants sont également heureux de les voir s’épanouir. La joie est au cœur d’À Bras Ouverts, même s’il y a aussi, bien sûr, des moments de souffrances et même de grands drames…
Ma première rencontre avec À Bras Ouverts m’a beaucoup réjoui ! J’étais surtout heureux d’écouter ces jeunes accompagnateurs témoigner de ce qu’ils vivaient auprès des enfants et des jeunes porteurs de handicap. Beaucoup des volontaires rejoignent l’association dans l’idée de leur faire du bien, en les sortant des hôpitaux et des institutions ou de leur famille pour soulager les parents. Ils assument des responsabilités importantes, non seulement dans le domaine festif mais aussi dans celui du bien-être de chacune des personnes qu’ils accompagnent, avec ses multiples besoins. Mais en vivant avec ces jeunes porteurs de handicap, en devenant responsables d’eux, ils se trouvent aussi comme transformés. Eux qui sont habitués aux valeurs de réussite et de compétitivité de nos sociétés découvrent la tendresse et la beauté de leurs propres cœurs, et leur capacité à donner de la vie à des personnes fragiles. Ils trouvent ainsi le sens profond de leur propre vie.
Favoriser les rencontres et les amitiés entre les personnes exclues à cause de leur fragilité et les personnes qui « réussissent » leur vie grâce à leurs capacités, les plus « compétents » avec les plus « incompétents » – au niveau du savoir humain –, est source de vie, de guérison et de transformation pour tous. Cette intuition de Tugdual est vraiment révolutionnaire.
Son livre nous révèle de très belles « communautés » qui, je l’espère, continueront à s’approfondir, à grandir et à apporter beaucoup de joie et d’amour à nos sociétés. Elles révèlent combien ces personnes avec un handicap peuvent apporter à notre monde une nouvelle vision de la personne humaine et nous aider tous à grandir dans l’amour.
Jean VANIER
« L’âme a besoin d’aimer […] comme le corps a besoin de manger. Il y a des âmes qui meurent de faim. »
Albert SAMAIN, Carnets intimes
Avant-propos
« You must tell your story ! » (« Tu dois raconter ton histoire ! »), m’a dit Jean Vanier, dans son anglais natal, un jour que je lui rendais visite à Trosly avec Raphaële, comme nous le faisons de temps en temps pour parler d’À Bras Ouverts et de mes autres engagements… Il m’a fallu du temps pour commencer à retracer l’aventure d’À Bras Ouverts en adoptant un point de vue personnel.
Plusieurs dizaines d’années après la rencontre fondatrice de Cédric, puis-je faire confiance à ma mémoire ? Heureusement, en commençant ce travail d’écriture, les événements me reviennent, intacts. Au fil des lignes, surgissent à la fois l’émerveillement des débuts et une immense gratitude, du même ordre que celle qui m’a étreint en 1999, treize ans après la fondation, quand j’ai remis les clés d’À Bras Ouverts à mon premier successeur, Éric.
Pourquoi ai-je été appelé à fonder une telle œuvre ? Je serais bien en peine de trouver la moindre explication. Si À Bras Ouverts est un cadeau – et je veux bien le croire à en juger par sa fécondité –, j’en suis assurément le premier bénéficiaire. Malgré mon indignité et une foule d’imperfections, l’histoire d’À Bras Ouverts est belle, au-delà de l’entendement.
Je serai bien sûr forcé d’assumer, dans ces pages, une part de subjectivité. Il en va de la fondation d’À Bras Ouverts comme de toutes les histoires d’amour : chaque protagoniste se la remémore à sa façon. D’autres témoignages pourront utilement compléter et ajuster le regard que je porte aujourd’hui sur ce qui s’est passé depuis août 1982, à Lourdes…
Quand il est question du handicap des enfants et des jeunes, jusqu’où aller dans la description des situations difficiles ? Il s’agit d’éviter tout angélisme, irrespectueux de la réalité. Mais je ne voudrais pas non plus projeter dans l’esprit du lecteur des images sombres, voire « trash », qui donneraient une idée rebutante de mes amis. Noircir le tableau serait un comble, car la joie est – j’espère le montrer – la spécificité lumineuse d’À Bras Ouverts. Mais il est difficile d’en témoigner par des moments précis, tant la joie est diffuse, comme la lumière. Les moments durs, parfois dramatiques, sont mémorables. Par ailleurs – c’est la raison de leur fréquence dans ces lignes –, ils sont souvent riches d’enseignements.
Puisque c’est dans mon expérience personnelle qu’il me faut scruter les racines de cette aventure collective, j’évoquerai pour commencer trois souvenirs qui ont survécu aux brumes de l’enfance, chacun lié à une personne ayant un handicap. Le premier est ponctuel, impersonnel et brutal. Il s’est imprimé comme un cauchemar. Les deux autres ont entrouvert mon cœur.
Premier flash. Il est issu de ma toute petite enfance. C’est la plus ancienne image que je garde d’une personne handicapée. Sur la plage de sable bondée gît un jeune homme grabataire. Son corps est déformé ; il est couché en arc de cercle, entouré de quelques proches. J’ai l’œil perçant : je l’ai vu de loin. J’entends aussitôt une phrase : « C’est une honte de montrer des gens comme ça, devant des enfants ! » D’où vient cette parole brutale encore ancrée dans ma mémoire ? A-t-elle pu surgir d’une pensée enfantine ? A-t-elle été lancée par un adulte ? Le petit garçon que j’étais l’aurait alors entendue et reprise à son compte. Toujours est-il que j’éprouvai, ce jour-là, un vif sentiment d’horreur, de répulsion et de rejet du handicap.
Le second souvenir est paisible. C’est celui de Nadia, une grande jeune fille que recevaient de temps en temps mon oncle et ma tante qui vivaient sans enfants dans leur grande maison lyonnaise. Après une poliomyélite, elle était restée paralysée du bas du corps. Ses jambes inertes paraissaient très maigres à l’enfant que j’étais. Nadia était assise dans un fauteuil roulant. J’ai appris, plus tard, qu’elle s’était mariée et avait eu un enfant.
Enfin, près de Toulon, où nous passions nos vacances, une tante de nos cousins venait de temps en temps nous rendre visite avec sa fille trisomique, nettement plus âgée que moi. Catherine était à la fois souriante et autoritaire, timide et farceuse. Elle s’exprimait avec difficulté. La peau de son visage était étrangement ridée. Lorsqu’elle semblait gênée, elle avait l’habitude de se courber en avant avec brusquerie, les mains jointes entre ses genoux. Catherine me faisait peut-être peur, mais je l’aimais bien. C’était réciproque. Amusée par mes facéties, elle toquait du doigt sur son front et je m’amusais à faire ce même geste en désignant un autre enfant pour la faire rire, ce qui ne manquait pas. Je pense qu’elle m’inspirait de la gentillesse. Près d’un demi-siècle plus tard, il paraît que Catherine, qui a passé la soixantaine, vit désormais dans une communauté de l’Arche…
De ces trois souvenirs contrastés, je peux tirer un enseignement. Confrontés au choc de la différence, pour dépasser nos peurs et rendre possible la véritable rencontre, nous avons tous besoin, avant tout, de médiateurs (facilitateurs, ambassadeurs), ainsi que d’un minimum de temps. Encore faut-il que nous ayons la chance de faire de ces rencontres qui peuvent illuminer nos vies, c’est-à-dire – j’ose l’écrire – nous humaniser… Plus les « fragiles », selon l’expression de Philippe Pozzo di Borgo, demeureront cachés et cantonnés dans des ghettos, plus leur présence sera vécue comme un choc, une agression, et considérée par certains comme insupportable. Et la société tout entière s’en trouvera endurcie.
À l’approche de l’âge adulte, je fus confronté à une autre expérience marquante. Anne, une amie de lycée, paraissait souvent préoccupée. Elle me confia un jour que sa famille avait un énorme souci : son frère aîné, Jean-Claude, était handicapé depuis la naissance. Il souffrait d’un spina-bifida. Il s’agit d’une malformation congénitale de la colonne vertébrale qui entraîne une multitude de dysfonctionnements et surtout, dans son cas, une paralysie complète du bassin et des membres inférieurs. Jean-Claude traversait des moments difficiles. Il subissait de fréquentes opérations et sa vie demeurait précaire. Il manquait aussi d’amis. Je proposai à Anne de rendre visite à son frère. Elle accepta avec joie. Je me rendis donc dans l’appartement où vivaient Jean-Claude, ses sœurs et leurs parents, au rez-de-chaussée d’un immeuble à trois pâtés de maison de mon domicile. Je découvris un garçon nettement plus âgé que moi, ouvert et intelligent, quoique plutôt morose. Nous passâmes un bon moment ensemble, évoquant des sujets d’intérêt commun comme le jazz. Mais je ne le vis qu’une seule fois. Ma vie était bien remplie.
Pour le reste, rien ne me prédisposait à aller plus loin, jusqu’à ma vie d’étudiant et ma première participation au pèlerinage national de Lourdes, où une rencontre fit basculer ma vie.
1
L’émerveillement.Lourdes, été 1982
Tout commence donc dans la cité mariale, au cours d’une semaine d’août 1982. J’ai 20 ans. Il m’a fallu plusieurs sollicitations avant d’accepter de couper mes vacances familiales rituelles au soleil de la Méditerranée, au moment où l’eau est si bonne, quand les poissons pullulent pour la pêche…
Je suis d’abord entraîné par l’exemple de mon frère aîné. Il est revenu enthousiaste du pèlerinage national auquel il a participé quelques années plus tôt avec un cousin du même âge. Mon frère a même gardé des liens avec une dame âgée à laquelle il continue de rendre visite. Puis c’est une tante qui me secoue affectueusement : « Tu devrais aller à Lourdes et te rendre utile au lieu de passer tout l’été à t’amuser. » Enfin, quelques amis avec lesquels j’ai marché dans les Alpes, début juillet, se préparent à participer ensemble aux cinq jours du pèlerinage national 1. C’est ce projet qui me décide. Ignorant qu’un train spécial part de Toulon, je profite d’une place dans une voiture pour rejoindre ma destination, où j’arrive avec un jour d’avance.
En cet été 1982, mon esprit est libre : après une fin de scolarité très chaotique effectuée dans plusieurs lycées, je viens de terminer avec succès la première année de Sciences Po Paris. Ouf ! Côté études, le ciel s’est enfin éclairci après des années d’errance morose dont je mettrai du temps à comprendre la cause : une dyslexie non diagnostiquée et une forme de bouillonnement intérieur incompatible avec une scolarité classique. Je rêvais d’un ailleurs. Et j’en ai payé le prix : deux piteux redoublements, d’abord de la première, puis de la terminale. Deux niveaux en quatre ans, et trois passages des épreuves de français pour aboutir, à 19 ans et demi, à un bac C obtenu de justesse… Dans ces interminables années de scolarité, la neuvième (CE2), suivie par correspondance, fait cependant figure d’exception. Deux heures de travail le matin me suffisaient et je passais l’essentiel de mon temps à gambader dans le jardin de mes grands-parents, un inoffensif arc à la main… Une oasis de liberté ! À l’époque, rêvant d’être entomologiste, je n’aimais rien de plus que de courir après les papillons.
Retour à Lourdes, en 1982. C’est la première fois que je me rends dans la cité mariale. Je ne la connais que par la collection de cartes postales d’un de mes frères. La plupart portent la mention « À la grotte bénie, j’ai prié pour vous ! » qui sonne à mes oreilles comme une fade litanie. Le sanctuaire évoque pour moi une mare étrange où des grenouilles de bénitier en villégiature envoient leurs messages codés à d’autres batraciens tout aussi confits en dévotion. Je suis croyant, élevé dès la petite enfance dans la foi catholique, mais ma pratique s’est affadie à l’adolescence. J’ai l’impression de la vivre comme un zombie, sans chaleur, a minima. La prière n’est donc pas tellement dans mes prévisions de voyage. Je me crois au-dessus des bigoteries, des trempettes dans les eaux guérisseuses et de la soif de miracles. Et pourtant, je crois.
Je compte surtout vivre pleinement le service aux personnes malades ou handicapées.
La plupart des amis que je m’apprête à rejoindre seront brancardiers. C’est la fonction qui semble la plus adaptée aux nouveaux venus. En décidant avec l’un d’eux d’être hospitalier, j’imagine choisir « le meilleur », viser haut. Mon frère et mon cousin m’ont expliqué qu’on est vraiment au chevet des personnes et tout proche d’elles. Je tenterai même de m’inscrire dans une certaine salle d’enfants dont ils m’ont parlé avec des trémolos dans la voix…
Arrivé seul, trop tôt, sans mes amis, j’erre dans les rues de Lourdes en solitaire. Des files ininterrompues de pèlerins n’en finissent pas de se croiser. Certains vont seuls, d’autres déambulent en groupe. Les cars de tourisme se frayent un passage dans la foule. On dirait une immense fourmilière. Ses galeries sont courbes, pentues et, parfois, se superposent. Je peine à m’y retrouver, ne comprenant pas que tout tourne autour d’un monticule où trône un imposant château fort. La rivière tumultueuse qui serpente ajoute à la confusion. Circonspect, je ne franchis même pas les grilles du mystérieux sanctuaire, cause de toute cette agitation. J’attends le jour prévu pour les inscriptions.
Un peu partout, mon regard se pose sur des personnes en fauteuil roulant, présentes dans une proportion stupéfiante. Parfois, surgit la longue ligne d’un attelage de brancardiers transportant des personnes âgées, malades ou handicapées. Leurs protégés sont assis dans de grands tricycles bâchés de bleu qu’on tire par une tringle frontale. Les plus impotents sont couchés sur des brancards à quatre roues. Les passants s’écartent avec empressement pour leur laisser la priorité. Freinant dans les descentes et poussant dans les montées, des brancardiers de tous âges, munis d’étranges et inutiles bretelles, pilotent les « tringlots » avec autorité.
Aux terrasses des cafés, des jeunes gens s’interpellent joyeusement. Certaines femmes déambulent en grappes bruyantes, bizarrement vêtues : elles frisent le ridicule à mes yeux. Infirmières ? Religieuses ? Le bleu et le blanc des robes et des coiffes me font hésiter. Beaucoup bavardent avec entrain. À l’oreille, ce sont des Italiennes. Des hommes en civil arborent sur la poitrine des insignes multicolores, avec de grosses croix. Il n’est pas possible qu’ils soient tous prêtres, ni même médecins. La plupart se pressent. Chaque pèlerin a visiblement une bonne raison d’aller et venir, que ma raison ignore. Cette foule de personnes de toutes couleurs, nationalités et conditions, dont une bonne proportion souffre d’une infirmité, me semble avoir un seul point commun : elles se sentent ici comme chez elles.
Ce qui me surprend le plus, ce sont les magasins de bondieuseries qui s’alignent des deux côtés des rues, au rez-de-chaussée des hôtels. Ils ne désemplissent pas. Sans m’intéresser au sanctuaire, je manifeste ma distance hautaine par le choix de la carte postale que j’adresse à mes parents : une photo de chamois des Pyrénées. J’ai dédaigné les saintes vierges…
Voici enfin le jour J. Je m’inscris sans difficulté avec Hubert à l’Accueil Notre-Dame, qui prend en charge les personnes handicapées. Nous sommes les premiers. Le responsable de l’Hospitalité nous saute dessus : justement, un monsieur vient d’arriver avec ses affaires. Il a été malade et a besoin d’aide. Envoyés en mission, nous montons à l’étage, vêtus de blanc, après avoir épinglé notre petite croix rouge et les badges qui font de nous des hospitaliers du premier grade. Hubert arbore une vraie blouse, à manches longues. Je n’ai pu trouver – chez mes grands-parents – qu’une sorte de tablier de boucher… Nous découvrons une série de trois salles silencieuses où les lits vides se font face, dix par dix pour les deux pièces extrêmes, et quatre par quatre pour la petite salle centrale. Un seul est occupé, tout au bout de l’enfilade, par un homme immobile et silencieux. Sa tête est étrangement déformée, sans doute par un choc (un accident de la circulation ?) qui lui a enfoncé une partie du crâne. Grand sourire aux lèvres, il baigne dans son vomi. L’odeur est âcre. Son badge indique un prénom : Francis. Gorge nouée, nous le saluons d’un « Bonjour ! » qui mobilise toute la chaleur dont nous nous sentons capables. Il nous répond par le même mot, sur le même ton, mais d’une voix nasillarde qu’explique la trachéotomie bien visible qui perce son cou. « Nous allons nous occuper de vous… » tenté-je en indiquant sa valise. Nous demandons à Francis si celle-ci est fermée à clé. « Ouiii ! » répond-il immédiatement dans un sourire. Est-ce lui qui a la clé ? Un nouveau « oui » traînant semble nous rapprocher du but. Est-ce dans son manteau ? Même acquiescement. Mais les poches du blouson posé au bout du lit sont vides… Désarçonnés, nous finissons par ouvrir le bagage : il n’est pas verrouillé. Notre homme n’a visiblement pas tous ses esprits. Nous apprendrons qu’il a été victime d’un accident de voiture et souffre des séquelles d’un traumatisme crânien. Il ne peut bouger seul. Nous le nettoyons tant bien que mal, le cœur battant. Il porte un « penilex », dispositif lui permettant d’uriner sans se mouiller. L’apprentissage est abrupt, mais nous nous jetons à l’eau. Nous nous limitons à faire sur autrui les gestes inspirés de ceux que nous effectuons sur nous-mêmes chaque jour. Prendre soin, finalement, c’est assez simple. Le cœur y est.
Hubert restera avec Francis dans cette salle où arrivent des hommes adultes. J’irai dans celle des enfants, de l’autre côté. Nous serons tellement occupés pendant ces quelques jours, que nous nous croiserons à peine. Quelques regards échangés sans parole au milieu du brouhaha suffiront à nous assurer réciproquement de l’expérience extraordinaire et personnelle que chacun est en train de vivre. La mienne est d’une telle intensité que j’ai l’impression d’une vie nouvelle.
Après le baptême du feu avec le grand Francis, un tout petit garçon attire mon attention. Il est avachi, bras ballants vers les roulettes de sa grande poussette multicolore ; sa tête blonde tombe sur ses genoux. Immobile et prostré, il semble échoué dans ce dortoir. Lorsque je m’accroupis à ses pieds pour distinguer son visage, je découvre sa mâchoire, cadenassée dans une moue de tristesse. L’expression contraste avec deux yeux bleus, vifs, grands ouverts sur le vide, et fixés sur le carrelage. Un badge indique son prénom : Cédric. Il ressemble à un ange.
J’apprendrai qu’on dit qu’il est « IMC », pour infirme moteur cérébral. Pour certains, c’est un libellé trompeur : il s’agit d’un handicap physique, parfois associé à un retard intellectuel ou du développement affectif… Tout cela, je l’ignore pour le moment. J’apprendrai d’ailleurs, plus tard, à me méfier de certains mots savants qui enferment. Ces étiquettes qualificatives que l’on colle aux autres pour se rassurer font souvent barrière entre les êtres et risquent de dénaturer leurs relations.
Ma découverte immédiate, c’est donc la vitalité d’un regard qui jaillit du corps immobile. Comme une lumière de l’âme, ces yeux reflètent une vie intérieure, évidente, intacte, insondable. Il me semble même que le handicap, par contraste, donne en quelque sorte plus d’éclat à son humanité. Je vais effectivement découvrir, en quelques jours, que pour ce garçonnet emmuré dans un handicap si lourd qu’il lui interdit presque de « faire » quoi que ce soit, tous les sentiments, toutes les émotions et toutes les pensées demeurent possibles. Je suis émerveillé par l’intégrité de son « être » !
Dès le début de l’amitié qui naît ce jour-là, une joie nouvelle m’illumine. Elle grandira pendant toute ma semaine à Lourdes, et – je peux le dire avec trente-cinq ans de recul – bouleversera le cours de ma vie.
Pendant cinq jours, mon regard reste fixé sur la personne de Cédric comme sur un trésor qu’on ne cesse de découvrir. Toute ma nostalgie de l’enfance et toutes mes aspirations fiévreuses de l’avenir semblent dissoutes. À quoi bon rêver d’un ailleurs ? À quoi bon partir à l’autre bout du monde, quand on peut, ici et maintenant, vivre dans l’instant présent l’aventure la plus belle, la plus prometteuse, toujours imprévisible, et que je pressens jamais achevée ? J’ai découvert le voyage en humanité.
Certes, je vais mesurer progressivement les incapacités multiples de Cédric et son besoin de présence, d’aide et de consolation. Il ne peut maîtriser aucun de ses gestes. Ses bras et ses mains sont crispés, inutilisables. Quand on le tient verticalement, ses jambes se croisent sans qu’il puisse les dénouer. Il ne peut ni marcher, ni parler, ni même se gratter. Il ne peut réaliser aucune tâche élémentaire de sa vie quotidienne sans aide et a besoin d’un médicament pour son transit. La moindre surprise le fait brusquement sursauter, et ses bras raides se dressent alors en croix. Je recevrai ainsi quelques claques monumentales en pleine figure parce que quelqu’un est apparu un peu vite dans son champ de vision. Sa crispation l’empêche de mastiquer. Elle lui fait grincer des dents, au risque de tordre une cuillère mal placée. Cédric doit alors longtemps se concentrer pour desserrer l’étau. Bien qu’on lui donne de la nourriture mixée, chaque repas est un long effort. Comme Cédric a beaucoup de difficulté à maîtriser la déglutition, il faut aussi beaucoup de patience, un certain coup de main, et surtout sa confiance, pour qu’il parvienne à ingurgiter le liquide qu’on tente de lui offrir… en évitant la fausse-route. Bien souvent, en effet, une toux salutaire, violente comme un éternuement, projette alentour une giclée d’eau. Ceux qui se pressent autour de lui sont arrosés. Devant nos airs ébahis ou tétanisés, Cédric éclate de rire, d’un son cristallin et musical qui rassure et réjouit soudain toute la salle.
Entre Cédric et moi, le courant passe immédiatement. Je découvre cette forme d’amitié extraordinaire qui peut relier un jeune adulte « valide » et un enfant handicapé. La vie m’y avait-elle prédisposé ? Certes, j’appréciais la compagnie des enfants, notamment ceux de mes cousins germains, que je faisais volontiers jouer. J’étais également assez à l’aise quand il s’agissait de prendre soin des personnes malades. Ma grand-mère maternelle m’avait souvent emmené rendre visite à quelques personnes âgées démunies et isolées de La Seyne-sur-Mer, qui vivaient dans des taudis en sous-sol. Mais avec Cédric, je découvre en moi une capacité de présence et de consolation plus personnelle et plus concrète.
Du fait de sa dépendance, Cédric ne peut pas prendre ses repas au « réfectoire des malades ». À cette époque, dans le jargon du pèlerinage, tout pèlerin âgé ou handicapé accueilli par des hospitaliers est dénommé « malade », même si une petite minorité souffre effectivement d’une maladie évolutive. Je suis donc naturellement désigné pour aider mon ami dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Je comprends progressivement qu’il faut lui plier fermement les bras sans les tordre – c’est-à-dire dans le bon sens – pour enfiler ses vêtements. Je m’aperçois qu’il tente d’aider en se cambrant quand on achève de lui enfiler son pantalon. Ses parents ont préparé un trousseau complet avec des vêtements multicolores qui paraissent tout neufs. Je l’accompagne dans les cérémonies pour le faire boire, lui éviter l’insolation et jouer l’interprète… Cédric fait lui-même comprendre du regard qu’il souhaite que je l’assiste, et m’accueille systématiquement avec un cri de joie et un regard qui s’illumine. C’est gratifiant ! Un jour, j’arrive dans la salle au retour de mon déjeuner et découvre un Cédric en larmes, entouré d’hospitalières désemparées, aussi perdues que lui. Il ne me faut pas longtemps pour lui redonner le sourire. Mais gare à la posture du sauveur… J’y reviendrai plus tard dans ce récit.
Pendant ces cinq jours, je passe des heures à « discuter » et à plaisanter avec Cédric. Comme il ne parle pas, je m’efforce de lui proposer des options, auxquelles il répond par acquiescement ou par dénégation. C’est ainsi, étape par étape, que j’essaie de m’orienter dans le labyrinthe de sa pensée. Au lieu de nous décourager, nous prenons tous deux le parti de rire des contresens. L’humour est une clé majeure pour dédramatiser. Notre complicité se renforce par la richesse de cette communication « non verbale ». Un échange de regards, à distance, suffit parfois pour partager une impression. Nous y associons volontiers tous ceux qui passent et trouvent à leur tour, auprès du petit bonhomme, de quoi se réjouir d’être là. Je suis comme son ambassadeur.
C’est la première fois que Cédric vient à Lourdes, et les consignes transmises à son sujet sont étrangement limitées. C’est pour cela que je l’ai trouvé si perdu. Je découvrirai plus tard que c’est la première fois qu’il quitte sa famille. En discutant avec ses parents, je comprendrai aussi qu’il a souffert qu’on lui ait laissé des couches durant le séjour, alors que ce n’était qu’une précaution exceptionnelle pour le voyage. Une petite fiche nous apprend qu’il s’exprime avec les yeux : « oui », par un cillement vertical ; « non » par un mouvement horizontal. Habitué à l’intuition de sa mère, il effectue ces battements de façon fugitive. Il faut s’accrocher pour établir une distinction. Au geste à peine ébauché succède un regard perçant qui s’enquiert de notre compréhension. Puis l’ébahissement jubilatoire de nous découvrir si empotés. Je lui propose un autre système : le sourire ou la moue avec laquelle je l’ai découvert. Cette tentative de transposition le fait visiblement bien rigoler, entraînant de multiples contresens, mais nous nous en sortirons comme cela. Je découvre un caractère déterminé, enjoué, observateur et moqueur.
La relation est si intense que j’ai l’impression a posteriori que ma semaine lourdaise s’est résumée à ce face-à-face. Bien sûr, je côtoie d’autres hospitaliers, mais c’est davantage pour partager silencieusement la contemplation joyeuse ou grave de nos amis : nous regardons ensemble ceux qui sont la raison de notre présence. Parmi eux, Piluca fera partie plus tard du groupe des cinq fondateurs d’À Bras Ouverts…
Je rencontre aussi une vingtaine d’autres enfants. Cédric a voyagé par le train spécial de Toulon – d’où je viens ! – avec un garçon de son âge, Éric, lui aussi en fauteuil roulant, mais plus mobile. Nous sympathisons. Plusieurs enfants trisomiques – c’est inscrit sur leurs visages – sont hébergés dans ma salle. Chacun a sa personnalité. L’un d’entre eux, raisonnable et presque maniaque, plie soigneusement ses vêtements et enfile chaque soir sa grande panoplie : pyjama, pantoufles, robe de chambre… Ne manque qu’un bonnet de nuit. Un autre n’en finit pas de faire le pitre et de provoquer les filles. Certains enfants ont des handicaps indéfinissables. Gilles, au physique un peu ingrat à mes yeux, est recroquevillé (sur son lit comme sur son fauteuil) et toujours prêt à grimacer. Dès qu’il m’aperçoit, il tire ostensiblement la langue. C’est sa façon de communiquer. Nous nous saluons ainsi une dizaine de fois par jour.
Quinze ans plus tard, lors d’une conférence aux hospitaliers de Lourdes rassemblés dans le nouvel édifice qui fait face à la grotte, le visage d’un jeune homme assis au premier rang sur son fauteuil roulant, entouré d’amis plus jeunes que lui, attirera mon attention… Ce regard bleu sur ce visage tout ridé, cette bouche, ces bras recroquevillés… Mais c’est Gilles ! Lui ne me reconnaît sans doute pas, mais lorsque je viens le saluer, je retrouve exactement le même sourire narquois, bien qu’il ne me tire plus la langue. C’est l’occasion de me réjouir de la fidélité de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut à ceux qu’elle accueille…
En cette semaine de 1982, l’essentiel de mes journées se passe dans la salle. Je prends mes repas le plus vite possible à la « popote », le restaurant réservé aux services du pèlerinage national, rentre tard au camp des jeunes et en repars tôt pour le réveil étrangement matinal imposé à tous par l’antique organisation (le pèlerinage national de Lourdes a été fondé en 1873, et l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, qui organise l’accueil des personnes malades ou handicapées, a fêté son centenaire en 1981).
Des nuits de veille nous sont également proposées. J’en ferai deux. Moments privilégiés et silencieux où l’on doit effectuer des rondes. Nous y scrutons les visages de nos protégés endormis, prêts à répondre à leurs appels avant de nous retrouver à la salle de garde. C’est le lieu de rencontres magnifiques : nous échangeons entre hospitaliers nos impressions ; nous refaisons le monde… La confrontation au mystère de la souffrance nous y incite. Lors des visites à l’infirmerie ou à la tisanerie, on croise les veilleurs des autres étages, aussitôt familiers. Je découvre que chaque salle a son état d’esprit, son histoire, ses traditions… Confrontés à la découverte des personnes porteuses de handicaps, nous avons besoin de décompresser, de nous exprimer : questions, souvenirs, confidences, pitreries parfois…
C’est de nuit que je me rends à la grotte pour la première fois… À l’heure où les grilles du sanctuaire sont fermées, quelques veilleurs s’y faufilent en privilégiés, grâce à la porte dérobée d’une salle endormie du rez-de-chaussée. Première méditation – je n’ose dire prière – où je goûte l’incomparable atmosphère. Quelques silhouettes seulement sont agenouillées ou assises dans la pénombre, tandis que brûlent encore les plus gros cierges, témoins de la ferveur du jour. À l’endroit désigné par Bernadette, une statue blanchâtre semble nous regarder…
Certains « enfants » grabataires sont au cœur des conversations. L’un d’entre eux, Daniel, qui a plusieurs dizaines d’années, en paraît moins de dix. Il est nourri par une sonde dont le tuyau sort de son nez. Des infirmières y renouvellent régulièrement l’administration d’un liquide blanchâtre à l’odeur inoubliable. Ses yeux et sa bouche sont entrouverts en permanence. Ses cheveux partent en bataille autour de sa tête. Ses membres pliés sont écartés à plat de part et d’autre de son corps. Il ne réagit que par quelques sourires énigmatiques dont on se fait part avec émotion d’un bout à l’autre de la salle… La nuit, nous lui parlons tout doucement, comme le fait son père qui demeure tout le jour auprès de lui. La vie de Daniel nous inspire un sentiment de gravité mystérieuse et précieuse. Lorsqu’il se déplace dans le sanctuaire pour les cérémonies, entouré de mille précautions, la foule s’écarte, comme saisie de stupeur.
Avec ses yeux qui roulent, un autre grand adolescent attire mon attention. Didier reste toujours étendu, cambré, avec ses membres rétractés, son cou musculeux, sa tête rejetée en arrière. Sa posture ressemble à celle du jeune homme très handicapé de la plage de mon enfance. Didier regarde partout sans qu’on puisse dire ce qu’il exprime ou comprend. Des hospitaliers s’affairent régulièrement autour de lui pour changer ses couches ou le nourrir… Je m’attache à lui adresser la parole. Il me sourit. J’apprendrai, l’année suivante, que, dans l’institution où il vit, une fausse-route l’a emporté.
C’est pendant la première nuit de veille que je fais davantage connaissance avec un jeune pèlerin qui m’a beaucoup marqué. Laurent est un adolescent atteint de myopathie de Duchenne. Contrairement à son frère plus jeune, Michael, qui court encore dans tous les sens en boitillant et fait les quatre cents coups, Laurent est entré dans une phase avancée de sa maladie. Le jour, il est assis sur un fauteuil roulant qu’il déplace avec précaution. Il est maigre et fragile. Très lucide sur son état, il fait preuve d’une étonnante maturité. En pleine nuit, ses jambes sont parfois saisies de crampes qui le réveillent, le font gémir et grimacer. Nous nous précipitons pour masser doucement le muscle crispé. Dès qu’il est soulagé, Laurent sourit, nous remercie avec une infinie douceur et s’endort sur-le-champ. Je contemple alors ce sourire qui continue d’illuminer dans son sommeil ce visage émacié redevenu paisible. Il arrive aussi que nous devions changer Laurent complètement, car il ne maîtrise plus ses sphincters. Nous déployons alors un paravent tout autour du lit pour le nettoyer de fond en comble, comme un nourrisson. C’est là que j’apprends que la pudeur est une question de regard. Elle se témoigne et se vérifie par un respect inconditionnel du corps. Un respect qui jaillit du cœur. Le mien est saisi de compassion et d’admiration. Le jour, Laurent s’exprime parfois tranquillement, par quelques mots empreints d’une joyeuse profondeur. Il fait partie de ces enfants philosophes que l’épreuve a fait mûrir très tôt. Les hospitaliers réunis autour de son fauteuil boivent ses paroles, toujours douces, avec respect, comme s’il leur donnait de belles raisons de vivre pleinement.
Souvent, quand j’entendrai parler des « vies qui ne valent pas la peine d’être vécues », je penserai à celle de Laurent, scandaleusement souffrante et courte, mais marquée par l’essentiel. Un modèle de sagesse et d’humanité. Je songerai aussi aux larmes d’une hospitalière apprenant que l’autre petit frère de Laurent, celui que nous avions vu gambader, souffrait de la même maladie évolutive, qui l’emporterait lui aussi…
Je voudrais également évoquer ma rencontre avec Jacques. C’est un grand adolescent aux cheveux bouclés. Il ne cesse de gigoter dans son fauteuil, saisi par des mouvements irrépressibles de tous les membres. D’une main, Jacques agite en permanence une chaînette, de celles qu’on utilise pour attacher le bouchon d’une baignoire. Jacques louche et bave ; des sons gutturaux s’échappent de sa bouche. À n’en pas douter, la plupart des personnes qui le croisent croient avoir affaire à un simple d’esprit. Devant lui est cependant disposé un « pictogramme ». C’est son code visuel. Jacques s’exprime en désignant tant bien que mal des lettres, une par une, d’un doigt tendu. Le geste a beau être vague, il aboutit précisément à ce qu’il a décidé. Et c’est ainsi que le jeune homme auquel je viens d’être présenté me pose d’emblée une question surprenante que je déchiffre, lettre à lettre, avec étonnement : « Connais-tu la musique dodécaphonique ? » Et de m’épeler le nom d’un musicien qu’il apprécie et que je ne connais pas. Ne jamais se fier aux apparences ! Me voilà pris de court face à un être d’une sensibilité insondable et d’une grande avidité intellectuelle. Jacques est venu à Lourdes avec un père attentif, grand monsieur qu’on repère à ses cheveux, bouclés comme ceux de son fils. Ce dernier se pose à ce moment-là des milliers de questions sur la vie et sur Dieu qu’il partage autour de lui. Il traverse une période de doute. Quelques années plus tard, j’apprendrai par des soignantes que Jacques s’est hissé sur le rebord d’une fenêtre et s’est jeté dans le vide…
Hormis la brève halte nocturne au pied de la grotte, je passe largement à côté de l’aspect spirituel du pèlerinage. Seule une messe intime, réservée aux hospitaliers de l’étage, me touche. C’est l’aumônier de notre salle qui la célèbre dans une petite chapelle souterraine. J’ai dédaigné les piscines (où l’on plonge les pèlerins dans l’eau de la source), sauf pour y conduire Cédric, et je ne vais aux principales cérémonies – processions, grand-messes… – que pour l’y accompagner. Au milieu de ces enfants prioritaires, j’ai le privilège d’être placé au tout premier rang. Leur présence me nourrit plus que toute autre chose. Lors de la liturgie internationale à laquelle participent dix mille pèlerins venus de tous les continents pour la solennité du 15 août, je ressens un sentiment de communion inédit. Les prières qui se succèdent dans de multiples langues me font goûter à l’universalité du lieu. Le reste, spirituel et plus personnel, viendra bien plus tard.
Ma foi d’alors est peut-être semblable à celle de beaucoup de jeunes, hésitante et sans grande cohérence. Depuis plusieurs années, je la traîne secrètement comme un boulet, au bout d’une chaîne que pourtant je n’envisage pas de couper. Une foi pesante, évidente mais endormie. De quelques expériences spirituelles, heureusement lumineuses, de mon enfance, il ne me reste qu’un pâle souvenir ; juste de quoi m’accrocher à une pratique superficielle, réduite à la messe dominicale, que je ne suis pas près d’abandonner. Cause de ce malaise ? Une profonde déception spirituelle subie six ans plus tôt. Dans un groupe de jeunes chrétiens, j’ai vécu deux expériences contradictoires : d’une part, celle de me sentir appelé à me donner entièrement, et, d’autre part, celle de me sentir manipulé inconsciemment par quelques animateurs maladroits. J’en reste comme écartelé : d’un côté, perclus de tristesse, avec l’impression d’être passé pour toujours à côté de ma vocation ; de l’autre, libéré d’une emprise. Cette expérience douloureuse me sera profitable dans l’aventure d’À Bras Ouverts : je suis devenu ultra-sensible aux risques des dérives sectaires et de la « gouroutisation », conscient que de tels risques n’épargnent aucun groupe, aucune communauté, aucune famille, aussi belle soit-elle…
Il reste qu’en 1982, je suis comme spirituellement endeuillé, pour ainsi dire condamné à rester au seuil de l’essentiel. Mon esprit est alors partagé entre la nostalgie du passé révolu – celui de l’innocence enfantine – et l’attente d’un futur lointain et indéfini, celui du Grand Amour, dont je ne connais pas le visage. Ce que je découvre à Lourdes, c’est une réponse réaliste : le cadeau du temps présent, qui me paraissait jusqu’alors fade et superficiel, révèle toute sa saveur.
Ce n’est certes pas une expérience mystique qui m’enflamme, mais la brûlure du cœur n’en est pas moins vive. Je la crois alors profane. Avec Cédric, Gilles, Laurent, Éric, Daniel et tous les autres, je fais pourtant une expérience intérieure. Quelque chose qui sommeillait se révèle dans la relation : une capacité insoupçonnée de présence, une disponibilité profonde, et surtout une joie absolument nouvelle.
Des années plus tard, je peux affirmer que l’émerveillement devant un être humain particulièrement fragile est une expérience universelle. Chacun mérite de la faire un jour. Et elle est accessible à tous, croyants et incroyants. La découverte de la dignité cachée des plus petits, c’est l’expérience humaine par excellence ; elle ouvre une fenêtre sur le mystère de la transcendance ; elle étanche la soif spirituelle qui caractérise l’humanité.
Un soir, au crépuscule, je fais une autre expérience marquante : en tête de la sinueuse procession aux flambeaux, nous avançons vers le cœur de l’esplanade avec Cédric, Éric et les autres petits pensionnaires de notre salle, en reprenant les interminables Ave Maria. Je vois, défilant à la lueur des cierges, les visages fervents des pèlerins valides qui nous regardent au bord du chemin. Stupéfaction : les physionomies se figent brusquement à la vue des adorables petits bouts de chou handicapés dans leurs poussettes. Deux femmes âgées les dévisagent bouche bée, les yeux atterrés, et je vois même couler des larmes de tristesse… La joie qui est entrée paradoxalement dans mon cœur en découvrant des enfants éprouvés n’est donc pas spontanément partagée par tous ! Comment la simple vue de mes amis peut-elle provoquer une désespérance aussi soudaine ? J’ai envie de crier : « Ne pleurez pas ! Si seulement vous les connaissiez ! » Je redoute l’effet que peut faire sur les enfants cette réaction de pitié larmoyante. Mais ils semblent n’y prêter aucune attention.
Au lendemain du sommet du pèlerinage que constitue cette fête mariale de l’Assomption – qui place Lourdes et ses pèlerins au cœur de la prière de l’Église catholique –, c’est le rangement et le départ. L’heure est aux adieux, aux promesses de correspondance, un peu illusoires, et de retrouvailles, ainsi qu’à la nostalgie. La voilà qui m’envahit soudainement, grise et cruelle, pendant que l’Hospitalité Notre-Dame de Salut plie bagage. Les salles se sont vidées. Dans le vaste hall de transit, l’attente est interminable. Les pèlerins « malades » sont préoccupés par leurs valises bouclées dès le matin, qui s’entassent. Ils serrent contre eux les petites affaires indispensables à leur quotidien et leurs souvenirs. C’est un lent ballet de cars qui s’approchent de la plate-forme en marche arrière et emportent vers la gare les pèlerins triés par région. Leur remplissage est fastidieux. Il faut vérifier dans la cohue la présence de chaque personne et de chaque bagage. À la faveur de mon statut d’hospitalier, je décide de m’incruster dans le train retour à destination de Toulon. Je voyagerai dans les wagons-ambulances avec Cédric et Éric, effectuant ainsi une troisième nuit de veille. Comment vais-je gérer l’atterrissage dans ma vie d’avant ? J’ai vécu les plus beaux jours de mon existence. Rien ne pourra les égaler. Qui peut m’assurer que mon ami reviendra l’an prochain et que j’éprouverai la même illumination ? Comment vais-je trouver du goût aux jours de farniente qui arrivent ? Ils me paraissent alors d’une mortelle superficialité. Je m’y ferai pourtant sans difficulté, grâce au soleil, à la mer et à mes lignes de pêche…
Pour le moment, je profite d’une ultime conversation avec Cédric. Celui-ci semble partagé entre la joie de retrouver sa famille et la tristesse de notre séparation. Comme souvent, la plupart des questions ont trait à son bien-être. Souffre-t-il des courants d’air ? A-t-il chaud, soif, faim… ? Mais son regard s’allume parfois, plus intense, m’obligeant à puiser dans mon imagination pour déceler ce qu’il veut exprimer comme sensation, expérience, sentiment ou émotion. Cela peut être sa réaction à une scène cocasse qu’il aperçoit. Le questionnaire devient alors un jeu de piste.
Un monsieur non voyant, un peu âgé, attend lui aussi son car, juste à côté de nous. On dirait un santon aux lunettes noires. Droit comme un i, sa canne blanche entre les mains, il écoute visiblement de toutes ses oreilles notre conversation, c’est-à-dire mes questions qui tâtonnent et progressent et les silences qui accueillent les réponses de Cédric, ponctués peut-être de quelques gloussements. Soudain, le santon s’écrie d’une voix forte : « Ah ! la jeunesse de Lourdes ! Qu’elle est belle ! Si la jeunesse de France était comme ça, la vie serait belle ! » Cette phrase produit en moi un choc instantané. Elle résonne dans mes profondeurs et m’interroge. De quelle jeunesse suis-je ? Jeunesse de Lourdes, je le suis à cet instant, pour quelques heures encore… Dans ce lieu privilégié, j’ai eu la chance de rencontrer Cédric. Lourdes a été le sanctuaire, l’écrin de notre rencontre. Mais dans le reste de la France, qu’aurais-je fait en croisant par hasard Cédric dans son fauteuil roulant ? Comment faut-il se comporter dans la rue face à celui qui nous paraît étrange ? Détourner le regard ? Le fixer ? Deux attitudes indélicates. Je serais certainement passé à côté de mon nouvel ami. Quelle impuissance ! Quel gâchis !
À cet instant, une décision s’impose du plus profond de mon être, réponse instinctive au cri de l’aveugle : je serai jeunesse de Lourdes en France.
Une quinzaine d’années plus tard, j’entendrai Jean Vanier redire aux accompagnateurs d’À Bras Ouverts : « Jésus entend le cri du pauvre » et je réaliserai que c’est le cri jailli du cœur d’un monsieur non voyant qui, ce jour-là, a semé À Bras Ouverts. C’est lui l’innocent fondateur, instrument de la Providence. Il n’en a rien su. Puisse-t-il se reconnaître (et se faire connaître) s’il accède à ces lignes !
Pour le moment, je pars avec le désir de revoir Cédric chez lui pendant que je serai en vacances à Toulon. J’ai aussi l’intention d’essayer de rencontrer des enfants handicapés du côté de Paris, où j’habite. Avec un espoir : que l’alchimie de Lourdes soit transposable là-bas.
Alors que la navette remonte une dernière fois les rues de Lourdes, où le sens de circulation s’est inversé pendant la nuit (question d’équité pour les commerçants qui doivent tous bénéficier des flux de pèlerins…), des personnes âgées récitent le chapelet, le visage collé à la vitre. Apercevant une dernière fois la grotte consolatrice, certaines essuient une larme.
À la gare de Lourdes, le train pour le Sud-Est se remplit de pèlerins à l’accent chantant. Je remarque que Daniel, ce jeune homme à la posture de bébé qui vit dans un état végétatif, est du voyage, toujours accompagné de son père. Sous les fenêtres des wagons-ambulances, les hospitaliers des autres régions sont venus dire adieu à ceux qu’ils ont accompagnés pendant cinq jours. Eux aussi, j’en suis certain, ont vécu des moments qui compteront dans leur vie. Les filles ont toujours le sourire aux lèvres mais bien souvent aussi les larmes aux yeux. Pour se consoler, on échange des adresses sur de petits bouts de papier. Chacun promet d’écrire et de se retrouver… dans douze mois.
Avec leurs tee-shirts colorés, les groupes du « pélé-jeunes » parcourent le quai, entonnant, guitare à la main, des chants d’adieu. La musique assourdie parvient aux oreilles attentives des personnes âgées ou handicapées qui sont déjà étendues sur leurs couchettes. Elles souffrent de la chaleur et du manque d’aération.
Lorsque le convoi s’ébranle, les mains s’agitent par les fenêtres et sur le quai. C’est un adieu au sens premier du terme. On ne sait plus très bien qui part et qui reste : à Lourdes, le sanctuaire est presque déserté, même si de nouveaux pèlerinages sont déjà sur place. Dans les wagons de l’Hospitalité, on continue de chanter et de prier. L’aumônier du train profite du système de sonorisation pour poursuivre son animation spirituelle, religieusement suivie par la plupart des pèlerins.