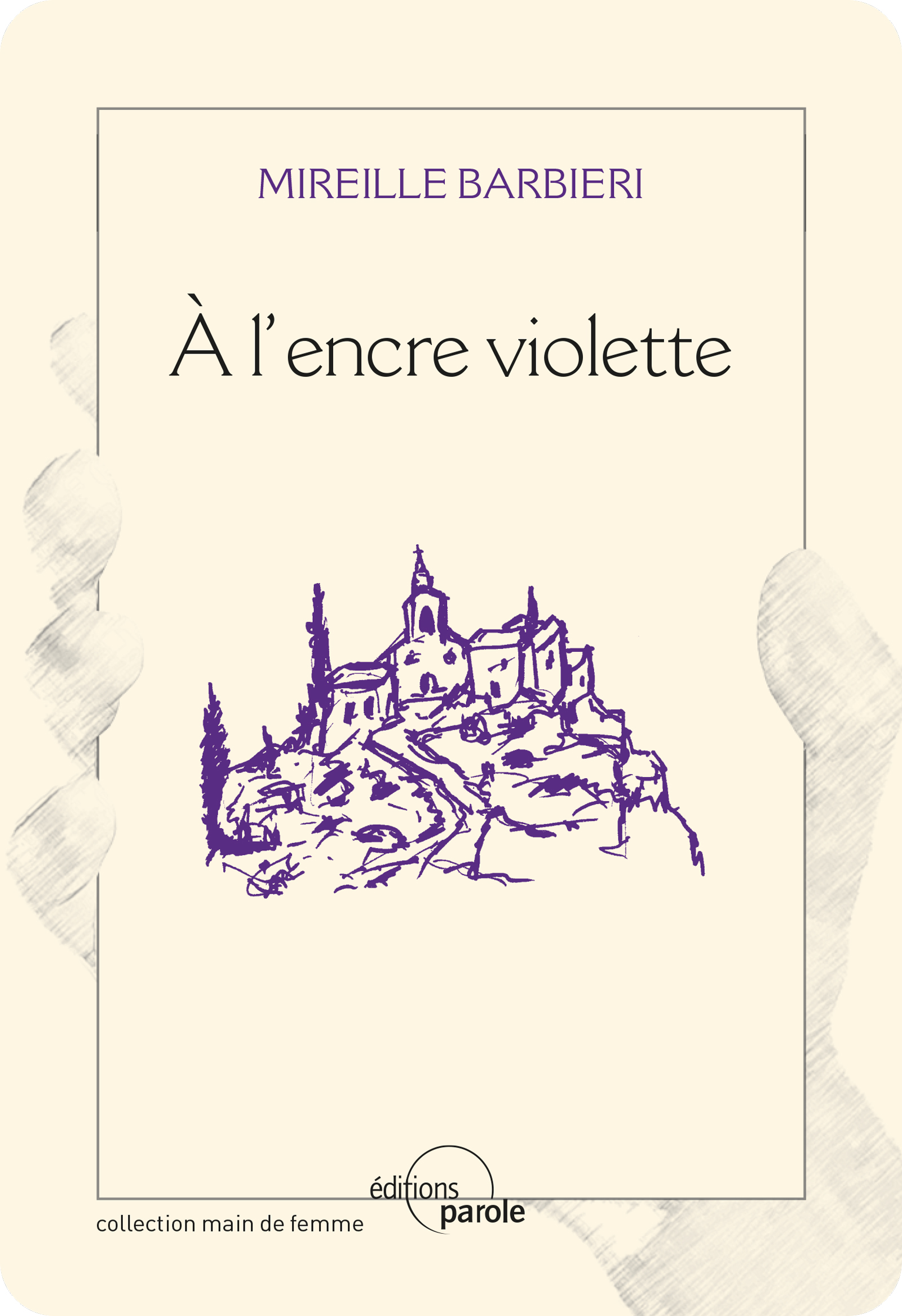
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Parole
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il y a le voyage qui vous amène et celui qui vous emporte. Celui de l’exil est toujours l’un et l’autre. Il vous pose ici et vous a fait quitter là-bas. Généralement sans retour, il ferme une porte pour en ouvrir une autre devant laquelle va se construire un nouveau monde, une nouvelle vie. Dans ce roman, la narratrice écrit à l’encre violette le parcours d’exil de deux femmes. Ce faisant, elle se reconstruit et finit par livrer sa propre histoire. Le plus troublant est qu’elle réveille en chacun de nous un exil que nous ignorions, ou presque.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Fille des terres du Vaucluse et marseillaise d’adoption,
Mireille Barbieri n’en est pas à son premier ouvrage publié. Si le livre a été au centre de son parcours professionnel, l’écriture est pour elle le moyen d’aller à la rencontre des autres tout en mettant en lumière la vie de ceux dont personne ne se souvient. Après
C’était en février, À l’encre violette est le second roman publié par les éditions Parole.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
◦◦◦
ISBN : 978-2-37586-076-2
© 2020, Éditions Parole
Groupe AlterMondo 83500 La Seyne-sur-Mer
Courriel : [email protected]
www.editions-parole.net
Tous droits réservés pour tous pays
◦◦◦
Mireille Barbieri
À l’encre violette
« Nous promenons entre des ombres,ombre nous-mêmes pour les autres et pour nous. »
Denis Diderot
« Les mots qui vont surgir savent de nousdes choses que nous ignorons d’eux. »
René Char
Voilà trois mois que j’observe cet objet sur le coin de mon grand bureau. Je n’arrive pas à le soustraire à mon regard, je n’arrive pas non plus à en prendre totalement possession. Parfois, je m’assois et je le regarde, simplement. Il me défie.
Quand me déciderai-je à l’ouvrir ? Plus tard, peut-être.
Je n’ai rien changé à ma vie. Je me rends chaque jour à ma boutique, je travaille consciencieusement, sans plaisir, par habitude. Mes amis du temps d’avant me rendent visite et nous causons du passé, nous rions même parfois à l’évocation d’un souvenir. Je reste fidèle à l’image qui m’a toujours collé à la peau et je ne cherche plus celle qu’un jour j’avais décidé de redessiner.
Tout s’est figé en moi voilà déjà un an ou une éternité.
L’écheveau de ma vie se déroule, immuable, un fil toujours identique, de même couleur, sans surprise. Je ne tisse rien de tout ce qui m’arrive. C’est ainsi.
Lorsque Jean est parti, je n’ai pas été surprise, c’était dans l’ordre des choses. Je lui avais fermé les portes de ma vie avant même qu’elles ne s’ouvrent vraiment.
Un matin, il est venu. J’aurais alors voulu expliquer, lui dire avec clarté pourquoi je ne me sentais pas maître de mon destin. Trop difficile. Toujours ce vide en moi, cette incapacité à construire.
Avant que je n’émette un son, il s’était mis à parler :
– Je ne viens rien réclamer. Je pars. Je ne voulais pas que tu l’apprennes par hasard. Je vais en Italie. J’ai besoin de savoir ce qu’il y a de moi là-bas. Je ne sais pas très bien ce que je vais y chercher, ma mère sûrement, mon père peut-être. Je ne sais pas non plus combien de temps je vais y rester, ni si je reviendrai.
Toujours muette, je ne pouvais esquisser le moindre mouvement. Il serrait dans ses bras une mallette, il me la tendit et je ne parvins pas à m’en saisir. Il la déposa sur mon bureau.
– Prends Marthe, ce n’est ni un souvenir de moi, ni un gage, ni un cadeau. Il n’y a qu’à toi que je puisse la remettre. Tu en feras ce que tu voudras, elle t’appartient. Le jour où je l’ai retrouvée dans les affaires de ma mère, je me suis dit qu’elle était là pour toi qui prêtes vie aux choses du passé. C’était un vieil ami du pays qui la lui avait offerte. À l’intérieur, il y a un encrier vide, un porte-plume, une boîte de plumes Sergent-Major et quatre petits cahiers jaunis aux fines lignes. Ma mère y a longtemps conservé ses journaux intimes. Elle ne me les a jamais fait lire. Un jour, elle les a brûlés et n’a gardé que ces quatre cahiers vierges. Ce jour-là, elle m’avait demandé de venir et m’avait expliqué son geste.
« Tu sais tout ce qu’il y a à savoir sur mon passé et sur celui de ton père. Mes journaux, c’est une autre histoire, ils n’étaient pas destinés à être lus, je n’ai jamais été écrivain, j’ai seulement eu besoin, un jour, de me coucher sur le papier pour tenter une réconciliation avec moi-même. Cela ne concernait que moi. »
– Marthe, cette mallette est trop chargée d’émotion, elle cristallise à elle seule toute l’absence de ma mère, je ne peux pas la conserver. Je sais que tu as des milliers de mots qui se bousculent en toi, des vies qui s’agitent derrière ton regard tranquille, si un jour tu décides de les libérer, je voudrais que ce soit sur ces cahiers. C’est à toi de décider.
Il s’était à nouveau rapproché de moi et après une caresse légère comme un souffle sur ma joue, il avait tourné les talons puis il était parti.
J’étais restée sans réaction, le regard au-delà de la vitrine, fixant sa silhouette longtemps encore après qu’elle eût disparu. Désormais le vide n’était plus seulement intérieur, il devenait tangible, une sensation physique du vide autour de moi.
Elle n’a rien d’exceptionnel mais elle ne ressemble pas non plus aux porte-documents ordinaires. Elle semble faite pour les longs voyages. Il fallait envisager de partir dans des contrées lointaines pour remplir une mallette d’encre et papier, sinon une simple écritoire eut fait l’affaire ! Oui, celui ou celle qui l’avait acquise avait sans doute choisi l’aventure.
Pensive, j’en caresse le couvercle, il est doux au toucher. Si je ferme les yeux, je peux déceler la moindre égratignure, des stries, marques de vie.
Soudain, je me lève, je me précipite dans l’atelier. Je mets tout sens dessus dessous pour trouver une brosse aux poils souples et de la cire.
Je ne sais combien de temps je suis restée à nourrir, lustrer le cuir jusqu’à retrouver l’aspect flambant qu’il devait avoir aux premiers jours.
Les objets du passé ont quelque chose de rassurant. Ils ont traversé les âges, c’est peut-être pour cela qu’on s’y attache, on s’accroche à un brin d’éternité. Pourtant, ils disparaîtront certainement un jour, mais en attendant ils vivent. À eux seuls ils sont plusieurs vies, plusieurs pages du temps.
Je vais souvent flâner dans les brocantes. Je ne crois pas que ce soit par goût du passé ou par nostalgie. Par contre, il me plaît d’imaginer d’où viennent ces bibelots, outils, meubles. J’aime rêver ce qui s’est déroulé autour d’eux, amours, morts, naissances. Comment sont-ils passés de famille en famille avant d’arriver là pour attendre une énième vie ?
Ce n’est pas l’utile que je vais chercher dans ces vide-greniers, mais peut-être l’envie de croiser mon passé. Il n’y a rien en moi du collectionneur compulsif, je repars très souvent les mains vides. Les objets que j’emporte s’imposent toujours, ils me parlent de moi ou d’autres. Je sens des présences autour d’eux. Lorsque l’un d’entre eux accroche mon regard, je l’observe, je m’éloigne, je reviens, je tourne autour. En ai-je besoin ? Où le mettrais-je ? A-t-il sa place chez moi ? Pourquoi lui ? Pourquoi est-il là, était-il de trop là où il était ? Ses propriétaires ont-ils disparu ?
Mille questions me traversent l’esprit. Je sais très bien que toutes sont superflues et que de toute façon je partirai avec l’objet sous le bras ! Je vais même parfois dans les décharges, là où en principe tout est fini, et j’exhume des choses dont plus personne ne veut, des objets qui n’espèrent plus rien et je leur donne une dernière chance. Ce sont là mes plus beaux trésors, ceux dont je suis le plus fière car je les ai retapés, rapiécés, nettoyés, rafraîchis. Une vraie résurrection !
Je n’aime pas les musées, les choses que l’on vient y admirer en ont fini avec la vie, elles sont les témoins morts d’un passé révolu. Moi, j’aime les objets qui ont encore leur place dans le présent. Sur mon bureau, un petit tourniquet en bois avec des tampons fait partie de mon quotidien. Je me sers du tampon PAYÉ, celui muni d’une petite brosse nettoie les touches de mon ordinateur, sur la tête des tampons sont inscrits un nom de commerce, une rue, et autour d’eux, s’agitent des personnages en blouses grises, crayon sur l’oreille !
La mallette, je ne l’ai pas choisie. J’ai tourné un peu plus longtemps autour d’elle avant de me dire qu’elle était faite pour moi. Maintenant, je peux pousser son fermoir, elle est mienne. Le tissu sous le couvercle est très abîmé, je décide de le garnir avec un coupon déniché aux Puces. En mettant à jour le fond du couvercle, en cuir lui aussi, apparaît dans l’angle à gauche une inscription à l’encre :
Desolina, New York 1912.
Je suis secouée d’une joie enfantine à la vue de ce prénom que Jean a évoqué lorsqu’il me parlait de la vie de sa mère, là-bas, en Italie, mais je ne sais que peu de chose de cette personne.
Les caractères sont appliqués, avec de belles majuscules comme on apprenait à les faire à l’école primaire. Cette écritoire a appartenu à une fillette au prénom peu courant. Je ne recouvrirai finalement pas le fond du couvercle, trop heureuse d’avoir découvert cette marque exceptionnelle. Ce signe ouvre pour moi une nouvelle porte. Il faut que je fasse connaissance avec Desolina avant de lui prêter vie.
Mon cher Jean
Cette lettre que j’entame aujourd’hui, je ne sais encore si je te l’enverrai. Elle sera longue, très longue. Je dois tout te dire, mot par mot, ne rien omettre, c’est vital pour moi. Tu sauras ce que je vis désormais, ce que j’ai vécu jusqu’à ce jour.
Sache d’abord que la magie de ta mallette a opéré et une envie un peu folle d’écrire s’est fait jour. Sous la toile du couvercle, un prénom était inscrit et depuis une semaine, Desolina, ou Dina – c’est le diminutif que je lui donne – fait partie de mes nuits, de mes rêves et je crois même qu’elle accompagne mes journées à la boutique. Mes clients me surprennent parfois tant je suis rêveuse. Je ne pense qu’au moment où je vais coucher sur la feuille ce que cette silhouette impalpable, mais de plus en plus précise, ne cesse de me glisser à l’oreille. Les autres m’importunent. Leur agitation m’ennuie et m’éloigne de ce qui se dessine dans cet espace indéfini où tout prend forme avant d’être révélé à la page. Mon seul désir est de m’extraire du monde. Rien d’autre n’a d’importance que de chercher les mots, en trouver le juste poids pour donner vie à des êtres qui ne sont qu’ébauches. J’ai choisi d’écrire à l’encre violette dans les cahiers de la mallette, une teinte pâle pour ne pas brutaliser la couleur passée du papier. Tout est prêt. Mes soirées ne laissent rien espérer, mes nuits s’étirent laissant peu de place au sommeil, le champ est donc libre pour ce qui se trame dans ma tête. Je vais franchir enfin le pas et peut-être libérer cette parole qui se terre en moi. C’est comme si depuis des années, j’avais engrangé des fragments de vies, des histoires à la croisée de la mienne, de mes aïeux, de toi et des tiens, et qu’enfin tout cela allait prendre corps.
Mais je ne t’ai encore rien dit de moi, certainement parce que je ne sais pas par quoi commencer. Il y a eu un avant et pour l’après, c’est le grand vide. Je suis un vague reflet qui n’essaie même pas de se raccrocher au passé. J’ai encore des réflexes, des habitudes qui résistent. J’affectionne toujours autant la marche solitaire au petit matin sur la digue, à l’heure où elle est enveloppée de brume. J’aime ce moment paisible que seul déchire le cri des mouettes. Plusieurs fois par semaine, encore maintenant, je vais ainsi le long de la côte jusqu’au port. J’aspire l’air frais à pleins poumons jusqu’à en avoir mal, pour le sentir en moi, pour me sentir vivante. Les jours sombres, une barre vient creuser mon front me donnant un air sévère. Sévère, pourtant, je ne le suis que pour moi-même. Je m’interpelle, parle à voix haute, me fustige. Ceux qui m’aperçoivent alors, marchant au bord de l’eau, déversant ma colère, ma douleur, apostrophant l’invisible, n’ont rien d’autre à faire que passer leur chemin, je ne suis pas folle. Je me parle. J’essaie de me convaincre que je fais fausse route ou bien que j’ai raison. Je cherche ma voie.
Seuls mes jours de grand silence sont inquiétants, quand le doute m’assaille, quand l’angoisse me broie et que je n’ai plus la force de convaincre les autres et surtout moi-même. Ces jours enténébrés, je cherche en moi quelque ressource pour traverser le quotidien sans que transpirent mon désarroi et ma solitude. Je puise dans le silence le peu d’énergie qui me reste pour franchir le vide, tel le funambule sur son fil. Un souffle et tout peut basculer. Qui peut savoir ce qui se passe derrière un front creusé, un visage fermé ?
Lorsque j’étais enfant, ce qui me fascinait, c’était le mystère de ce qui se passe dans la tête des autres. Comment être sûre que ce que faisaient ou disaient les gens autour de moi correspondait réellement à leurs pensées ? Comment pénétrer les coulisses de l’apparence et savoir ce qui fait la vérité de chacun ? Comment avoir confiance ? Longtemps cette crainte m’a rendue sauvage, fermée. Pour me livrer, il me fallait du temps. Il ne s’agissait pas de méfiance ou de suspicion, j’aspirais seulement à échanger du vrai, du sincère. Je tentais souvent vainement de décrypter l’autre.
Pourtant, lorsque j’ai rencontré Guy mon syndicaliste de mari, il y a plus d’un quart de siècle, je m’étais tout de suite enflammée pour ce jeune homme plein de fougue, de volonté, de convictions, qui défendait « la veuve et l’orphelin » ! Il séduisait tout le monde et je m’étais laissée séduire. Il avait une chevelure épaisse et blonde, et une carrure de Viking. Son regard d’un bleu intense semblait lire au plus profond de moi. Comme beaucoup d’hommes de cette ville de La Ciotat, il travaillait au chantier naval et très vite, il s’était engagé dans la vie syndicale. Sa vie, notre vie, fut une succession de luttes, grèves et manifestations.
J’en ai fait des comités de soutien aux grévistes, aux chômeurs, et autres encore ! Il me semblait tout naturel d’être à ses côtés. Il s’enflammait pour les autres, voulait faire renaître l’espoir. Auprès de ses camarades, il était vivant.
Nous étions à Paris en 1989 lorsque les ouvriers du chantier avaient accroché un beau bateau place de la Bastille. Nous étions aussi parmi les leaders lors de la prise d’otage d’un bateau du chantier. Je les avais accompagnés lorsqu’ils faisaient du porte-à-porte dans la ville et j’avais bu le champagne avec eux lorsqu’ils avaient obtenu que cent cinq ouvriers soient réembauchés cette même année. Puis il y avait eu les comités chômeurs, une suite sans fin de causes plus justes les unes que les autres. Il était toujours présent pour soutenir, face à la répression, face au désespoir. Il était en tête de la marche sur Paris, haranguant les foules dans les meetings, réconfortant les grévistes de la faim, puis cessant lui aussi de s’alimenter pour aller au bout de son combat. Je l’admirais.
Pendant toutes ces années, « la petite Marthe » l’a soutenu dans sa lutte contre toutes les injustices sociales. J’étais là pour l’encourager les jours de fatigue et de galère. Je défilais pour réclamer plus de justice et d’égalité des droits. J’y croyais moi aussi.
J’y crois toujours. Mon seul regret c’est de m’être oubliée dans cette course folle, d’avoir tu mes envies, mes rêves, de m’être noyée dans l’action, de ne pas avoir cherché quelle était ma place dans tout ça.
Je ne suis pas certaine de pouvoir dire plus pour l’instant, refaire le parcours n’est pas chose simple pour moi. J’ai besoin d’ailleurs, besoin de m’extraire et d’aller sur les pas d’autres vies avant d’aller plus avant sur mon propre chemin. Ce soir, j’ai mis tout en œuvre pour ne pas rater mon rendez-vous avec Desolina, il me fallait tous les atouts de mon côté. J’ai fait du feu dans la cheminée, je le laisse danser et craquer avant de poser mon écriture ronde au creux des interlignes, avant que les mots ne trouvent leur place, avant que ne commence une longue conversation avec ceux qui auraient pu tenir ma mallette entre leurs mains.
C’est une vie que je vais bâtir pour celle dont le nom me fait rêver, un destin pour Dina.
Le grand voyage
Dina avait presque dix ans quand elle apprit qu’elle serait du grand voyage. Elle était l’aînée des trois enfants, c’est pour cela qu’elle fut la première à apprendre la nouvelle. Maria était jalouse de ce privilège mais comme elle écoutait aux portes, l’avantage de la grande fut de courte durée ! Maria déboula dans la cuisine, sauta au cou de sa mère en poussant de petits cris.
– Est-ce que Luigi n’est pas trop petit pour ce voyage ? On pourrait le confier à la nonna1 pour quelque temps, dit Maria qui aurait bien aimé se débarrasser de ce petit frère qui l’avait supplantée dans le cœur de sa mère.
– Non, il est hors de question de le laisser ici, nous ne savons pas pour combien de temps nous allons partir, il a besoin de moi et son père le réclame, avait répondu la mamma.
Ce père se résumait pour Dina à de très longues absences et à quelques lettres dont une qu’il avait adressée à son nom et qu’elle cachait précieusement dans sa table de chevet. Elle ne l’avait pas revu depuis deux ans. Chaque fois qu’il rentrait au pays, se mêlaient en elle des sentiments contradictoires, la joie et la crainte. Cet homme auréolé de la prestance du voyageur, toujours bien vêtu, à la moustache sévère, l’impressionnait et l’attirait tout à la fois. Il était maître d’hôtel, là-bas, en Amérique. Elle ne savait pas très bien ce que cela voulait dire, mais si c’était un maître ce devait être quelqu’un d’important. Et puis, il avait des costumes, chemises, cravates, pour aller à son travail, alors elle était fière de lui. Dans ses lettres, il décrivait en termes surprenants ce pays si lointain où il espérait s’enrichir avant de revenir couler des jours heureux dans leur petit village de San Vitalo. La dernière fois qu’il était venu ici, il lui avait offert une petite valise extraordinaire. On la lui avait donnée à l’hôtel, une cliente l’avait oubliée là quelques mois auparavant et ne l’avait jamais récupérée. Sa mère avait protesté, c’était un objet rare, trop précieux pour une enfant, disait-elle. Il avait balayé les protestations d’un geste.
– Elle ne m’a rien coûté, et Dina mérite ce cadeau, je crois.
Maria était jalouse bien sûr, malgré la jolie robe à volants qu’il lui avait rapportée et Luigi était trop petit pour avoir un avis sur la question.
La mallette était petite, en cuir, Dina s’empressa de cacher ce trésor. Parfois, lorsqu’elle était seule, elle l’ouvrait, sortait les plumes, le papier à lettres, l’encrier, mais elle n’avait jamais rien écrit, elle gardait le tout pour plus tard, quand elle serait grande.
Lors du dernier séjour de son mari au pays, Angela, la mère, avait refusé de l’accompagner en Amérique avec les enfants. Luigi avait à peine plus d’un an et elle s’était mal remise de ses couches qui avaient été suivies de plusieurs bronchites. Le père était donc reparti tout seul vers ce pays lointain et extraordinaire.
Le Bon Dieu avait enfin entendu les prières de Dina. Tous les soirs, elle s’agenouillait au pied du lit, ses petits poings serrés et récitait un Pater Noster, et certains soirs dix Ave Maria, la Sainte Vierge ne pouvait rester éternellement insensible à ses demandes. Elle avait dû finir par intercéder pour elle auprès de Dieu le Père, car voilà que son rêve allait se réaliser : partir, sortir de ce village où rien ne pouvait la surprendre, voir le monde. Son cœur galopait dès qu’elle pensait au jour du départ. Ils allaient prendre le train à la ville, quitter l’Italie pour traverser toute la France et embarquer au Havre afin de gagner le continent américain. Elle n’avait de cesse de chercher à l’école, sur les cartes de géographie, le parcours qui allait être le leur. Elle avait entendu sa mère expliquer à ses amies qu’une compagnie maritime proposait la place de train à un prix modique pour attirer les immigrants de toute l’Europe. Ils allaient prendre, ainsi, un train spécial qui les conduirait directement à l’embarquement. D’après le père – et il savait de quoi il parlait – cela ne revenait pas plus cher que de partir d’Italie et puis, la compagnie transatlantique avait bien meilleure réputation que celles de Gênes ou Naples.
Dina n’osait pas poser trop de questions au maître d’école qui pestait contre ces Italiens qui ne savaient pas se contenter de ce qu’ils avaient ici et croyaient trouver fortune ailleurs. Monsieur le curé aussi était perplexe.
– Ces terres sont-elles bénies de Dieu ? Je n’en suis pas certain, mais je prierai pour tous ceux qui partent afin qu’ils ne tombent pas dans le péché et qu’ils portent la parole du Seigneur là où leurs pas les conduiront.
Dina savait que sa mère était une sainte et elle ne comprenait pas les doutes du curé, mais elle était bien trop respectueuse pour oser émettre un avis, alors, elle gardait en elle l’enthousiasme qui la dévorait.





























