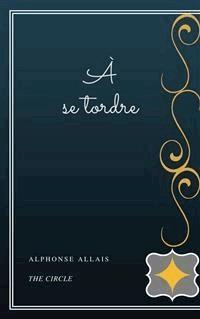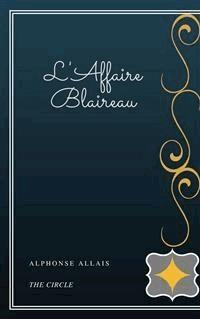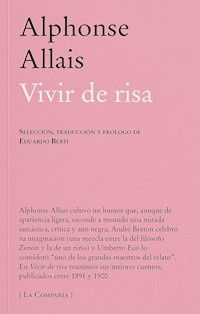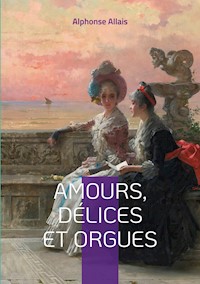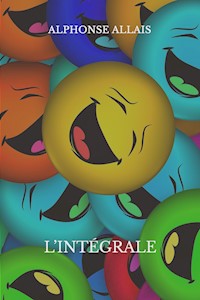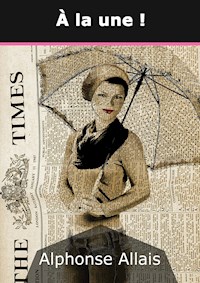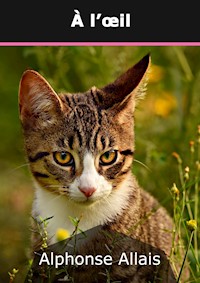
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
" La logique mène à tout, à condition d'en sortir ", dit un sage... La trentaine de contes rassemblés dans ce recueil ne lui donneront pas tort ! Pourquoi un département terrien comme l'Eure s'est-il doté d'un phare maritime de première classe ? Vaut-il mieux épouser une jeune fille laide plutôt que sa ravissante maman ? Comment faire fortune en semant des fleurs dans un champ ? Pourquoi Alphonse Allais n'est-il jamais entré au gouvernement ? Et Pète-Sec, Puyraleux, Desmachins ou le baron Lagourde ? De sérieux déboires les attendent ! Autant de prétextes à rire de la folie d'un monde décidément trop sérieux ! " Le Pasteur, écrivait Allais, qui découvrira, pour le tuer, le bacille du corollaire ou le microbe de la réciproque, rendra un sacré service à l'humanité. " En attendant, voici déjà un vrai vaccin contre la morosité !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
À l'oeil
Pages de titrePage de copyrightAlphonse Allais
À l’œil
Préface de Maurice Donnay
de l’Académie française
À l’œil
Édition de référence :
Paris, Ernest Flammarion, Éditeur, 1921.
Préface
Alphonse Allais ! je le revois encore, tel que je l’ai connu dans les dernières années de sa vie, avec sa longue figure colorée et douce, ses yeux bleus étonnés, ses belles mains dont il avait grand soin, et cet air de dignité répandu sur toute sa personne ; tel que l’a dépeint une de ses compatriotes, le poète Mme Lucie Delarue-Mardrus :
Vous qui l’avez connu, qu’il vous souvienne.
Il semblait un viking blond, sérieux et fier.
Eh ! oui, sérieux comme un humoriste, et c’est précisément ce sérieux qui faisait d’Alphonse Allais le prince des pince-sans-rire. L’humour, ce sont les jeux de la philosophie et de la plaisanterie, de la logique et de la fantaisie, de l’observation et de l’imagination, du cœur et de l’esprit. Il entre dans l’humour beaucoup de gravité.
On raconte que pendant qu’il accomplissait dans je ne sais quelle ville une période d’exercices de vingt-huit jours, Alphonse Allais, simple soldat, entra un matin à la salle des rapports. Il y avait là des officiers d’un grade élevé : le capitaine adjudant-major, un commandant, le colonel peut-être ! Alphonse Allais porta la main à son képi et dit du ton le plus naturel : « Bonjour, messieurs et dames ! »
Cela n’a l’air de rien ; mais, quand on y réfléchit, quand on songe à la hiérarchie, à la discipline, à la terreur militaire, à la grosse boîte, à Biribi, que sais-je ? cela paraît formidable ; devant cet inoffensif : – Bonjour, messieurs et dames ! – on demeure confondu, on est pris de vertige. Depuis que l’humanité est à l’âge des casernes, un seul troupier, un seul, est entré dans une salle des rapports en disant : – Bonjour, messieurs et dames ! – et ce troupier est Alphonse Allais... et c’est tout Alphonse Allais.
Certes, la plaisanterie était téméraire :
Humour, humour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire : Adieu, prudence !
Mais ce qui préserva notre humoriste, dans une circonstance aussi périlleuse, ce fut son imperturbable sérieux. S’il avait paru s’amuser lui-même de ce salut prodigieux, s’il avait ri, le premier (et quel mauvais goût !) de sa plaisanterie, il était perdu. Le capitaine adjudant-major, le commandant, le colonel ne s’y seraient pas trompés : ils auraient bien vu qu’ils avaient affaire à un farceur ; que serait-il arrivé ? On frémit rien que d’y penser. Mais, encore une fois, le soldat ne riait pas, ni même souriait. Alors, les chefs prirent le parti de rire, croyant à quelque bizarrerie, à quelque passager dérangement cérébral.
Si j’ai un peu appuyé sur ce trait excellent, c’est qu’il m’apparaît bien caractéristique de la manière de ce grand humoriste : c’est une clé de son œuvre.
On a dit qu’Alphonse Allais était supérieur à son œuvre. J’entends bien : ex-élève en pharmacie, (ai-je mentionné qu’il était le fils d’un pharmacien d’Honfleur ?), chimiste distingué, curieux des sciences naturelles, des inventions mécaniques et des systèmes philosophiques, d’une culture étendue, très fin lettré, il aurait pu écrire des livres moins..., des livres plus..., enfin des livres ! C’est que trop de gens en France n’admettent pas qu’un à-peu-près puisse valoir parfois une grande pensée, surtout ne comprennent pas l’ironie, la seule arme pourtant que nous ayons contre les mauvaises puissances et les faux dieux.
Alphonse Allais a écrit la Vie drôle, et c’est considérable.
Sa sœur, Mme Leroy-Allais, dans une biographie toute pleine d’admiration et de piété fraternelles, nous le montre à vingt ans, après des débuts très modestes au Tintamarre, hésitant entre la pharmacie et la littérature. Un père le pressait de manipuler, un démon le pressait d’écrire. Celui-ci l’emporta. Ses premiers contes parurent dans le journal Le Chat Noir, dont le directeur était le gentilhomme-peintre-cabaretier Rodolphe Salis. Les lecteurs de cette feuille hebdomadaire et indépendante apprécièrent aussitôt la qualité de ces petits écrits. Cependant, la renommée de leur auteur descendit assez lentement, malgré la pente, de Montmartre sur les boulevards et ce n’est que quelques années plus tard, quand parut le journal Le Journal dont il fut un des premiers collaborateurs, que le grand public connut Alphonse Allais ; mais, dès qu’il le connut, il l’aima. Son nom devint bientôt populaire.
C’est qu’il n’y a pas seulement dans ces articles d’Alphonse Allais gaieté, blague et fumisterie, et une aptitude singulière à saisir des rapports inattendus entre les choses, et des applications inespérées des dernières découvertes de la science, il y a aussi de l’indulgence de la simplicité, de la générosité, de la pitié, de la bonté, et par là ils allaient au peuple. Joignez à cela qu’ils sont écrits dans un style pittoresque, souple, nuancé, ingénieux ; style d’un écrivain qui connaît admirablement sa langue, qui la connaît dans les grandes lignes et dans les coins. Dans plus d’un de ces articles, le fils du pharmacien d’Honfleur semblait doser et manipuler, si l’on peut dire, toutes les figures de l’intelligence.
Pendant quinze années et, plusieurs fois par semaine, Alphonse Allais a distribué de la joie à des milliers de lecteurs. Alors, dans les wagons qui des banlieues amènent à Paris ouvriers et ouvrières, petits et petites employés, dans le métro, dans les omnibus (il n’y avait pas encore d’autobus), dans la rue, on entendait cette phrase : – « Avez-vous lu celui de ce matin ? » – Il s’agissait de l’article d’Alphonse Allais et, pendant quelques instants, ces humbles gens avaient pu croire, effectivement, que la vie était drôle. Résultat émouvant !
L’explication de cette réussite, comme l’a très bien remarqué Alfred Capus, c’est qu’Alponse Allais avait du goût. La muflerie, la bassesse, l’hypocrisie, l’avarice, la méchanceté, lui faisaient horreur. Il avait aussi un grand bon sens, jusque-là qu’il a pu signer Francisque Sarcey de petites parodies d’une drôlerie impayable, et dont l’Oncle était le premier à rire aux larmes.
Ce qui contribuait encore à faire d’Alphonse Allais un homme d’une originalité extraordinaire, c’est qu’il n’était pas seulement humoriste en écrivant et sur le papier ; dans sa conversation, dans ses actes, à chaque instant, il réalisait son humour, il le vivait.
Ai-je besoin d’ajouter que la fin de l’auteur de la Vie drôle fut pathétique ? Je l’ai vu sur son lit de mort, dans une triste chambre d’un hôtel de la rue d’Amsterdam. Son visage avait une gravité, une sérénité, une noblesse admirables.
Si, à l’entrée de l’au-delà, il y a une salle des rapports, celui qui a écrit cette phrase célèbre : « Tous les jours que le bon Dieu fait – et il en fait le bougre ! – » celui-là aura su faire rire et, partant, désarmer M. Saint-Pierre.
Maurice Donnay.
À l’œil
Positivement, il devenait assommant, ce capitaine de Boisguignard, avec ses éternelles histoires de bonnes fortunes. Et à l’œil, vous savez, tout le temps à l’œil.
Car c’était sa grande vanité et sa gloire suprême, au capitaine de Boisguignard, de posséder toutes les femmes de L..., sans bourse délier, toutes, depuis la femme du trésorier général jusqu’aux petites modistes de la rue Nationale et passant par les dames du théâtre et des domiciles faciles.
Comme c’était une manie chez lui, aucun de ses collègues n’y faisait plus attention. Parfois, au récit de ses aventures amoureuses, quelqu’un risquait :
– À l’œil, naturellement ?
Et Boisguignard répondait sans sourciller :
– Bien entendu.
Le soir du dernier Mardi Gras, ces messieurs les officiers avaient joyeusement fêté le carnaval. La gaieté battait son plein, et la Folie agitait ses grelots si vertigineusement qu’on aurait juré une sonnerie électrique.
Le jeune vicomte de la Folette, sous-lieutenant frais émoulu de Saint-Cyr, lisait tout haut dans l’Avenir militaire des circulaires apocryphes du général Boulanger qu’il inventait avec beaucoup d’imagination et de sang-froid : « Mon général, à partir du 1er juin, vous voudrez bien veiller à ce que l’infanterie soit montée. Quant à la cavalerie, dorénavant, elle ira à pied. C’est bien son tour. Agréez, etc. Signé : Boulanger. »
Ou bien encore : « Mon cher général, j’ai décidé que le port du vélocipède serait autorisé dans l’armée pour les caporaux et brigadiers, etc., etc. Signé : Boulanger. »
Et, c’était, à toutes les tables, des éclats de rire... Un vrai succès pour le sous-lieutenant de la Folette.
Un capitaine l’interpella :
Mais, à propos de Boulanger, expliquez-nous pourquoi vous ne profitez pas de sa décision relative à la barbe ?
De la Folette rougit un peu, car c’était son grand désespoir. Quoique ses vingt ans fussent bien révolus, jusqu’à présent sa peau rose ne s’était encore estompée d’aucun duvet. Pourtant, il répondit sans se troubler :
– J’en profite plus que vous ne croyez, car je ne me suis jamais rasé.
Pendant ce temps, Boisguignard causait de ses conquêtes. Il s’agissait, cette fois-ci, d’une chanteuse de café-concert, nouvellement débarquée à L... Quelqu’un demanda timidement :
– À l’œil, bien entendu ?
Et Boisguignard répondit comme d’usage :
– Naturellement.
Cela avec un aplomb si comique que tout le monde ne put s’empêcher de sourire. Boisguignard, furieux, s’en prit au jeune de la Folette.
– Eh bien, oui, à l’œil. Qu’est-ce que vous avez à rire ?
– Je ne ris pas, mon capitaine... Je souris avec un respect nuancé de doute.
Boisguignard éclata :
– Mais parfaitement, à l’œil ! Et je donne vingt-cinq louis à celui qui me verra fiche un sou à une femme !
Le sous-lieutenant tint le pari et, comme c’était un garçon fertile en ressources, messieurs les officiers se promirent de s’amuser beaucoup à ce petit jeu.
Vingt jours après cette soirée mémorable, arriva la Mi-Carême. Il y avait le soir, à l’Alcazar de l’endroit, grand bal paré et costumé. Tout l’élément joyeux de L..., civil ou militaire, s’y rendit, le capitaine de Boisguignard comme les autres.
Au dessert, le jeune de la Folette s’était retiré, en proie, disait-il, à une violente migraine.
Un bal paré et costumé à L..., vous le voyez d’ici.
La plus franche cordialité ne cessa d’y régner, mais, malgré tout, c’était un peu rural.
Vers minuit, comme Boisguignard et quelques-uns de ses collègues se disposaient à sortir, un domino entra qui fit sensation. Ce devait être, autant qu’on pouvait en juger à travers le costume et le masque, une jeune femme d’une rare distinction.
Elle rencontra Boisguignard dans le bal et lui planta dans les yeux son regard doux et bleu. L’ardent capitaine frémit sous la secousse, et s’approcha de la dame, lui murmurant d’habiles galanteries.
Tout d’abord, elle ne répondit pas.
Mais bientôt, s’enhardissant, elle prononça quelques paroles d’une voix basse, sourde et entrecoupée par l’émotion.
Finalement, après mille manières, elle consentit à accompagner Boisguignard dans un cabinet particulier.
Dire la fierté du capitaine serait chose impossible. Il aurait voulu défiler, avec sa compagne au bras, devant tout le régiment, colonel en tête.
Le fait est qu’elle avait un chic !...
Quand ils furent enfermés dans le cabinet, et qu’il l’eut conjurée de se démasquer enfin, elle sembla prendre un grand parti :
– Écoutez, monsieur, dit-elle, en me livrant à vous, je fais une folie ; je voudrais que cette folie ne fût pas sans profit pour moi. Ce sera vingt-cinq louis.
– Mais comment donc !
Et de la façon la plus naturelle du monde, en homme qui a souvent pratiqué cette opération, Boisguignard sortit de son portefeuille cinq jolis billets de cent francs.
Le domino compta la somme, l’inséra soigneusement dans un élégant petit carnet de nacre, et, enlevant brusquement son masque, il s’écria :
– Vingt-cinq louis, ça fait le compte, mon capitaine !
La belle mystérieuse n’était autre que cet affreux petit sous-lieutenant de la Folette.
Inutile d’ajouter que la somme fut immédiatement bue et mangée en joyeuse compagnie.
Mais, depuis ce temps-là, chaque fois qu’au mess ou au café la conversation tombe sur les femmes, le capitaine de Boisguignard cause d’autre chose.
Vitrail
Tous les étés, jusqu’à ma douzième année à peu près, j’allais passer quelques semaines chez une tante que j’avais dans un petit pays qu’on appelle Houlbec.
Houlbec, malgré la prétention de ses habitants, n’est qu’un gros bourg sans intérêt, à part une vieille église en bois qui date des Northmans. Moi, trop jeune à ce moment pour admirer les beautés de l’archéologie, j’étais insensible à cette architecture scandinave, mais une chose me charmait dans cette église, me charmait à ce point que je ne me rappelle pas avoir jamais éprouvé un sentiment aussi intense de charme et de séduction.
C’était un très vieux, très vieux vitrail représentant le martyre de sainte Christine, patronne de la paroisse d’Houlbec.
Sainte Christine est là, sur un bûcher ardent qui semble une coulée de rubis en fusion, pendant qu’un cruel païen, vêtu d’un vert exorbitant, attise le feu avec un acharnement coupable. Sur le saphir délicieusement pâle du firmament s’enlève le front radieux de la martyre et de tout son beau visage émane une mansuétude tendre et résignée qui excitait en moi la plus intime émotion.
Tout de suite, je ne sais pourquoi, je m’étais pris pour sainte Christine d’une affection violente et presque maladive, au point d’attendre fiévreusement le dimanche et de rêver une vengeance éclatante contre l’affreux homme vert qui brûlait ma pauvre aimée.
Sous le vitrail, c’était l’orgue.
En face, de l’autre côté de l’autel, le banc de ma tante où j’assistais aux offices avec mes petites cousines.
Un vieil aveugle tenait l’orgue et en tirait des sons d’une harmonie mélancolique que ne chasseront jamais de mon souvenir les plus fameux orchestres.
Pauvre vieil organiste, j’adorais sa musique et, pour moi, ses grands morceaux n’étaient jamais trop longs.
Un dimanche, – oh ! je me le rappelle comme si j’y étais encore, – quand retentit la sonnette de l’enfant de chœur pour l’élévation, tous les fidèles s’agenouillèrent, la tête dans les mains.
Alors, dans la vieille église, monta une musique si douce, si plaintive, si intimement vibrante que je sentis se mouiller mes paupières.
Une idée bizarre germa soudain dans mon cerveau d’enfant. Il me sembla que sainte Christine ne devait pas être insensible à cette musique suave comme elle, et je levai les yeux vers le vitrail.
La vierge n’avait plus cette expression de suprême sérénité. Son regard s’était abaissé sur moi.
Elle me souriait d’un sourire aimant et chaste de grande sœur.
Et toujours s’épandait l’harmonie, planante, éperdue et comme exhalée par des êtres célestes.
Ma muette extase dura pendant toute l’élévation. Puis on se releva, la musique cessa et sainte Christine reprit son air ineffable de martyre résignée.
La semaine qui suivit cet événement me parut d’une longueur désespérante. Je comptais les jours et les heures qui me séparaient de mon rendez-vous, car j’étais persuadé que, de son côté, sainte Christine m’attendait, impatiente en son haut vitrail. Enfin le dimanche arriva et le moment de l’élévation. J’étais si pressé d’en venir au mystérieux instant, que je levai les yeux vers la vierge avant que la sonnette de l’enfant de chœur eût complètement fini de tinter.
Sainte Christine, impassible, me désola d’abord. Mais, dès que vibrèrent les premières mesures de l’orgue, lentement, elle abaissa ses longs cils blonds et je me sentis comme enveloppé de l’infinie caresse de son regard qui m’imprégnait tout entier.
Absolument détaché de la matière, il me semblait que sur les nuages bleutés de l’encens, j’allais voleter jusque vers la sainte, et que nous allions nous envoler tous deux au ciel, au son de la divine musique des anges.
Un grand bruit de chaises remuées m’arracha à mon extase, et lourdement je retombai à terre, tout froissé du rêve inachevé.
L’élévation était finie.
Que de fois plus tard, dans ma vie amère et désespérée, n’ai-je point évoqué le sourire apaiseur de ma chère martyre ! Aux moments les plus cruels, je me plaisais à croire que, si mes yeux pouvaient rencontrer son regard, tout serait fini de mes peines.
Et pourtant, paresse ou manque d’occasion, jamais je n’étais revenu la voir.
Cette année, les hasards de la villégiature m’ont amené à Houlbec.
C’est précisément le dimanche matin. Sous un futile prétexte, j’ai abandonné mes camarades de route, et, mi-ému, mi-souriant, je me suis installé sur une chaise en face de mon ancienne adoration.
Elle est toujours belle, sainte Christine, toujours sereine en son éternelle béatitude, avec je ne sais quoi de bien humain et de moderne. Elle a plutôt l’air d’une toute jeune femme très raisonnable que d’une vierge.
Essayant de plaisanter en moi-même, je me disais que si la bienheureuse consentait à descendre de son vitrail, je me chargerais volontiers de lui procurer un logis plus capitonné.
L’office se déroule lentement, sans prestige ni magnificence. Le vieil organiste aveugle, mort sans doute, a laissé sa place à un jeune homme dénué de virtuosité. Le maître d’école peut-être.
C’est l’élévation.
Le firmament du vitrail laisse transparaître de petits nuages blancs qui courent dans le vrai ciel.
Tout le monde s’est agenouillé.
Le grand soleil du dehors flamboie dans l’ardent bûcher.
Comme jadis, les yeux de sainte Christine ont quitté leur contemplation pour se fixer sur moi, mais cette fois avec une expression de morne angoisse et de stupeur affreuse. J’ai cru lire un douloureux reproche dans les traits convulsés de la martyre, et, précipitamment, avant que personne ne se soit relevé, je me suis enfui de l’église.
Vert-Vert
Pauvre diable !
Je le vois encore arrivant le matin, hâve, blême, enveloppé dans sa maigre et luisante redingote de professeur infortuné.
Comme il était très doux et très triste, ses élèves – dont moi – le jugeaient extrêmement ridicule et ne manquaient pas une occasion de le rendre malheureux, en bons petits bourgeois que nous étions déjà, cruels et lâches.
Mâtin ! qu’il faisait froid cette année-là !
Et, malgré la pluie, le vent, la neige, notre professeur arrivait simplement vêtu de sa maigre et luisante redingote dont il relevait le col.
Pourtant, au retour des vacances du jour de l’an, le pauvre diable entra le matin à la classe enveloppé dans un pardessus...
Non, mes amis, un pardessus !...
La joie que nous éprouvâmes à la vue de ce vêtement tint du délire épileptiforme.
Et nous ne savions pas ce que nous devions le plus admirer en ce chef-d’œuvre, ou sa forme, ou sa couleur.
Inénarrable, sa forme ! Gauchement taillé, godant par ci, tirant par là, remontant dans le cou. Et les manches ! Et les poches ! Et les boutons !
Mais ce qui nous mettait le plus en gaieté, c’était encore sa couleur.
Imaginez que, dans une forêt vierge du Brésil, on tue une grande quantité de perroquets, parmi les plus verts des perroquets du Brésil, et que, de leur plumage, on tisse une étoffe, vous pourrez vous imaginer la couleur du fameux pardessus.
Immédiatement, nous baptisâmes notre professeur Vert-Vert, et un spirituel loustic de la classe poussa un : As-tu déjeuné, ma petite cocotte ? des plus comiques.
Le pauvre Vert-Vert devint plus triste encore que de coutume, et il me sembla bien que deux larmes lui perlèrent aux yeux.
Le fameux pardessus nous amusa une grande semaine, et puis, un beau matin, Vert-Vert, sans doute dégoûté de sa pelure, nous arriva simplement vêtu de sa maigre et luisante redingote.
Et pourtant, nom d’un chien ! il faisait une sacrée bourrasque, ce jour-là.
Le lendemain, pas de Vert-Vert.
Le principal nous annonça que notre professeur, ayant perdu sa mère, serait remplacé par un pion pendant deux jours.
Vert-Vert nous revint, au bout des deux jours, plus blême, plus hâve, plus triste et plus doux qu’avant.
Devant la désolation du pauvre diable, nous voulûmes bien désarmer. On lui jeta un peu moins de papier mâché à la figure.
À quelque temps de là, un jeudi, je fouillais à l’étalage d’une fripière, à la recherche d’un livre cochon, quand j’aperçus dans le fond de la boutique, devinez quoi ?
Accroché avec d’autres nippes, le pardessus de Vert-Vert éclatait de tout le triomphe de sa verdure étincelante.
L’occasion était trop belle, vraiment.
– Combien ce pardessus ?
– Douze francs.
En marchandant longuement, j’obtins une notable réduction et, pour six francs, le chef-d’œuvre devint ma propriété.
J’eus beaucoup de peine à me procurer les six francs, je vendis quelques livres, j’extorquai par intimidation une menue somme à ma sœur et je crois bien que je pris le reste dans le comptoir paternel.
Le lendemain, pour bien jouir de mon triomphe, drapé dans ma verte acquisition, j’arrivai à la classe un peu en retard.
Nulle plume humaine ne saurait dépeindre mon indescriptible triomphe.
Mes camarades levèrent les yeux, m’aperçurent, et ce fut un éclat de rire formidable et inextinguible.
Moi, de mon air le plus naturel du monde, je gagnai ma place.
Vert-Vert, effroyablement pâle, s’était levé.
– Monsieur, s’écria-t-il, vous avez mon pardessus !
– Mais pas du tout, m’sieu, c’est à moi. Je l’ai acheté hier chez la mère Polydore.
– Apportez-le moi, je vous le confisque.
– Non, m’sieu, j’vous l’apporterai pas. Vous n’avez pas le droit de confisquer les effets.
La discussion s’aggrava. Vert-Vert me mit à la porte. Je me plaignis au principal qui me donna raison.
Le soir même, je rencontrai le pauvre diable dans la rue. Il m’appela et voici ce qu’il me dit :
– J’ai eu tort ce matin de crier. Ce pardessus est à vous puisque vous l’avez payé. Mais si vous voulez être bien gentil, ne le mettez pas pour venir au collège, ça me fait trop de peine... Vous savez que j’ai perdu ma mère l’autre jour. Eh bien, c’est elle qui l’avait fait. Elle avait trouvé un coupon d’occasion, elle l’avait taillé et cousu elle-même. En me le donnant pour mes étrennes, la brave femme me dit : « Tiens, mon pauvre garçon, voilà un manteau, il n’est pas très beau, mais il te tiendra chaud. » Deux ou trois jours après, elle est tombée malade... Nous ne sommes pas riches ; nos petites ressources se sont vite épuisées, et, un beau jour, pour acheter du bois, j’ai dû vendre le pardessus. Oh ! je ne l’ai pas vendu bien cher... Et puis, quelque temps après, ma mère est morte. Alors, vous comprenez, quand vous vous moquez de mon pardessus vert, il me semble que vous vous moquez de ma pauvre maman, et ça me fait beaucoup de peine.
À ce moment, il me regarda ; je pleurais comme une grosse bête.
Je lui demandai pardon et, le soir même, je tins à lui rendre sa relique que je ne trouvais plus ridicule.
Et, depuis ce temps-là, quand je vois des paletots gauchement taillés, avec des drôles de manches, et des drôles de poches, je pense que c’est peut-être une pauvre vieille maman qui a passé une nuit à le coudre et qui le matin a dit : « Tiens, mon garçon, il n’est pas beau, mais il te tiendra chaud. »
Et je ne ris pas.
Les bourgeois
Le bon sculpteur Ferrod est l’homme le plus doux de la terre, causant peu par timidité et disant toujours des choses excellentes.
Je ne lui connais qu’une haine, mais une haine implacable, une haine sauvage : contre les bourgeois.
Au seul mot de bourgeois, sa physionomie fine et placide semble devenir la gueule d’un dogue, et un flot de gros mots sort de sa bouche.
Souvent, j’avais essayé de le raisonner :
– Voyons, mon vieux Ferrod, tu sais bien que c’est une vieille blague, les bourgeois. Il y a des bourgeois plus artistes que les artistes, et des artistes plus bourgeois que les bourgeois.
– Oui, je sais bien, mais ça ne les empêche pas d’être de rudes salauds.
– Ferrod, tu es idiot.
– C’est facile à dire, à toi. Mais si les bourgeois t’avaient fait ce qu’ils m’ont fait, tu verrais un peu.
– Mais que t’ont-ils fait de si terrible ?
Alors Ferrod détournait la conversation. Pourtant un jour il me dit :
– Je ne veux pas te dire ce qu’ils m’ont fait, parce que, quand j’en parle, je me prends à pleurer comme le jour où ça s’est passé... Les cochons !
Je grillais de la connaître, cette terrible histoire, mais comme ce souvenir paraissait véritablement pénible à mon pauvre ami, je n’osais trop insister.
La semaine dernière, Ferrod et moi, nous nous rencontrons.
Un vent de flânerie souffle sur nos têtes, et nous déjeunons ensemble.
Que faire à Paris, l’après-midi ?
Nous consultons tout un jeu d’affiches. La seule distraction consiste en une exposition de chemins de fer et autres à Vincennes.
Pourquoi pas ?
Et nous voilà partis à Vincennes.
Arrivés au bois, Ferrod paya la course au cocher et nous continuâmes à pied.
Ferrod me paraissait drôle, bizarre, fureteur.
– Viens par ici, me disait-il... Non, plutôt par là.
À la fin, nous arrivâmes à une manière de petite clairière, tout à fait à la lisière du bois.
– C’est là, je me rappelle, s’écria Ferrod. Ah ! les vaches ! Ah ! les salauds !
(N’ayant pas l’autorité de M. Zola, je ne défilerai pas le chapelet des indignations colorées de mon ami Ferrod. Qu’il suffise à mes lecteurs de savoir que les adjectifs, substantifs, verbes, etc. de la Terre sont une toute petite bière auprès du vocabulaire de Ferrod.)
J’étais ému. Je la sentais venir, la terrible histoire.