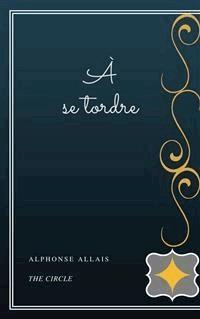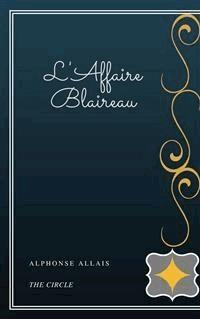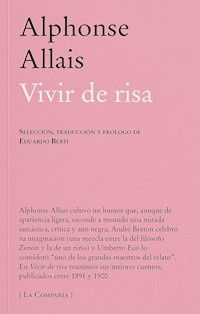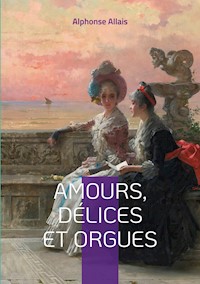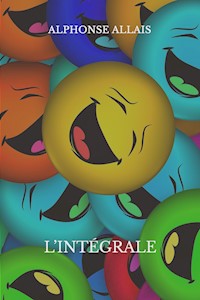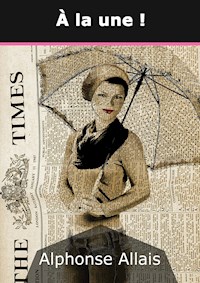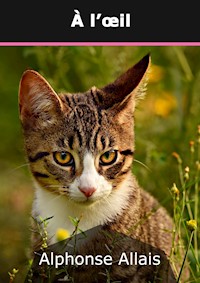2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
J'ai intitulé ce livre le parapluie de l'escouade pour deux raisons que je demande, au lecteur, la permission d'égrener devant lui. 1º Il n'est sujet, dans mon volume, de parapluie d'aucune espèce ; 2º La question si importante de l'escouade, considérée comme unité de combat, n'y est même pas effleurée. Dans ces conditions-là, toute hésitation eut constitué un acte de folie furieuse : aussi ne balançai-je point une seconde. J'ai la ferme espérance que cette loyale explication me procurera l'estime des foules et que ces dernières achèteront, par ballots, le parapluie de l'escouade, tant pour leur consommation propre que pour envoyer à leurs amis de la République Argentine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Le parapluie de l'escouade
Pages de titre(Œuvres anthumes)PréfaceComme les autresLa question socialeLe tripoliCafé d’affairesTrop de kanguroosDoux souvenirFeuIl neigeait... !Inconvénients du baudelairisme outrancéL’enfant de la balleLe réveil du 22Quelques chiffresLapins de France et grenouilles belgesPoème morneL’excès en tout est un défautUne vraie perleTitreCompletUne hallucinationUn nouvel éclairageCruelle énigmeUne importante réformeDalle en penteLa fausse blasphématriceHalf and halfEssai sur une nouvelle division de la FranceLe patron bon au fondRéversibilitéLes TempliersHistoire du petit Stephen GirardPosthumeLéon GandillotChez ÉdisonToto au LuxembourgUn miracle de l’amourFabrique de veuvesUne excellente affaireDe plus fort en plus fortUne petite femme bien modernePage de copyrightAlphonse Allais
(Œuvres anthumes)
Le parapluie de l’escouade
Édition de référence :
Paris, Paul Ollendorff, Éditeur, 1893.
À Léon Gandillot.
Préface
J’ai intitulé ce livre le parapluie de l’escouade pour deux raisons que je demande, au lecteur, la permission d’égrener devant lui.
1º Il n’est sujet, dans mon volume, de parapluie d’aucune espèce ;
2º La question si importante de l’escouade, considérée comme unité de combat, n’y est même pas effleurée.
Dans ces conditions-là, toute hésitation eut constitué un acte de folie furieuse : aussi ne balançai-je point une seconde.
J’ai la ferme espérance que cette loyale explication me procurera l’estime des foules et que ces dernières achèteront, par ballots, le parapluie de l’escouade, tant pour leur consommation propre que pour envoyer à leurs amis de la République Argentine.
L’auteur.
Comme les autres
La petite Madeleine Bastye eût été la plus exquise des jeunes femmes de son siècle, sans la fâcheuse tendance qu’elle avait à tromper ses amants avec d’autres hommes, pour un oui, pour un non, parfois même pour ni oui ni non.
Au moment où commence ce récit, son amant était un excellent garçon nommé Jean Passe (de la maison Jean Passe et Desmeilleurs).
Un brave cœur que ce Jean Passe et, disons-le tout de suite, l’honneur du commerce parisien.
Et puis, il aimait tant sa petite Madeleine !
La première fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine :
– Pourquoi m’as-tu trompé avec cet homme ?
– Parce qu’il est beau ! répondit Madeleine.
– Bon ! grommela Jean.
Toute-puissance de l’amour ! Irrésistibilité du vouloir ! Quand Jean rentra, le soir, il était transfiguré et si beau que l’archange saint Michel eût semblé, près de lui, un vilain pou.
La deuxième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine :
– Pourquoi m’as-tu trompé avec cet homme ?
– Parce qu’il est riche ! répondit Madeleine.
– Bon ! grommela Jean.
Et dans la journée, Jean inventa un procédé permettant, avec une main-d’œuvre insignifiante, de transformer le crottin de cheval en peluche mauve.
Les Américains se disputèrent son brevet à coups de dollars, et même d’eagles (l’eagle est une pièce d’or américaine qui vaut 20 dollars. À l’heure qu’il est, l’eagle représente exactement 104 fr. 30 de notre monnaie).
La troisième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine :
– Pourquoi m’as-tu trompé avec cet homme ?
– Parce qu’il est rigolo ! répondit Madeleine.
– Bon ! grommela Jean.
Et il se dirigea vers la librairie Ollendorff, où il acheta À se tordre, l’exquis volume de notre sympathique confrère Alphonse Allais.
Il lut, relut ce livre véritablement unique, et s’en imprégna tant et si bien que Madeleine faillit trépasser de rire dans la nuit.
La quatrième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine :
– Pourquoi m’as-tu trompé avec cet homme ?
– Ah !... voilà ! répondit Madeleine.
Et de drôles de lueurs s’allumaient dans les petits yeux de Madeleine. Jean comprit et grommela : Bon !
......................................................
Je regrette vivement que cette histoire ne soit pas pornographique, car j’ai comme une idée que le lecteur ne s’ennuierait pas au récit de ce que fit Jean.
......................................................
La cinquième fois que Madeleine trompa Jean...
Ah ! zut !
La onze cent quatorzième fois que Madeleine trompa Jean, Jean dit à Madeleine :
– Pourquoi m’as-tu trompé avec cet homme ?
– Parce que c’est un assassin ! répondit Madeleine.
– Bon ! grommela Jean.
Et Jean tua Madeleine.
Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l’habitude de tromper Jean.
La question sociale
Je ne fus pas peu surpris – l’avouerai-je ? – en recevant, hier soir, un petit mot de M. Carnot m’invitant à passer à l’Élysée le plus tôt possible. « Communication urgente », ajoutait le billet.
Mes rapports avec M. Carnot, très cordiaux dans le début de sa vie politique, se sont considérablement rafraîchis par la suite, d’abord après cette regrettable scène du Moulin-Rouge demeurée présente à tous les esprits, ensuite à cause de l’étrange parti pris que mit M. Carnot à m’éloigner de toutes les combinaisons ministérielles. (Je me suis expliqué sur cette question, ici même, voilà tantôt deux mois.)
Quoi qu’il en fût, je n’hésitai pas à me rendre à l’appel du président. Peut-être y allait-il du salut de l’État.
Tout de suite, M. Carnot se précipita sur mes mains, qu’il serra très fort en m’appelant son cher Alphonse. Puis, il me demanda ce que je prenais.
– Un verre d’eau sucrée avec un peu de fleur d’oranger, fut ma réponse.
(Je ne bois jamais autre chose et m’en trouve fort bien.)
– Mais ce n’est pas tout ça, reprit vivement le chef de l’État, je ne vous ai pas fait venir pour des prunes. Nous sommes très embêtés, en ce moment, avec la question sociale. Je connais votre ingéniosité presque fabuleuse ; avez-vous une solution pour la question sociale ?
– Enfant, répondis-je avec un doux sourire, n’ai-je point solution à tout !
– Je bois vos paroles.
– Laissez-moi, mon cher Sadi, comparer la société à une échelle.
Une nuance d’étonnement passa sur le visage du petit-fils de l’organisateur de la victoire.
– Une échelle, poursuivis-je, se compose généralement de deux montants et d’un nombre d’échelons ou barreaux variant avec la longueur de l’instrument.
Les échelons parallèles entre eux s’enchâssent perpendiculairement dans la face interne des montants. D’ailleurs, ne savez-vous pas toutes ces choses aussi bien que moi, vous, l’orgueil de Polytechnique ?
M. Carnot s’inclina.
– Quand un certain nombre de personnes sont appelées (ou est appelé) à évoluer sur cette échelle, il est préférable que cette tourbe s’éparpille sur tous les échelons au lieu de séjourner sur le même.
– Bien sûr.
– Oui, mais voilà : les gens qui sont contraints à demeurer sur les échelons inférieurs (c’est ceux d’en bas que je désigne ainsi), en proie à l’humidité sociale, trop près des crapauds pustuleux du mauvais destin, paludéennes victimes d’une sale organisation, envient ceux d’en haut, qui se prélassent sur des barreaux de peluche et d’or, en haut, au bel azur du ciel...
Et comme j’allais m’emballer, tel un poète saoul, M. Carnot me rappela à la question.
– Eh ! bien, conclus-je, la solution, la voici : Il est monstrueux que des gens soient fatalement voués, et pour jamais, à un patrimoine de détresse, de misère et de travail (lequel est le pire des maux), cependant que de jeunes bougres n’ont qu’à naître pour mener une existence de flemme, de haute cocotterie et de bicyclette en aluminium. La vraie devise sociale devrait être : Chacun son tour. Ou bien encore : C’est pas toujours les mêmes qui doivent détenir l’assiette au beurre.
– Au fait ! grommela le principal locataire de la rue du Faubourg-Saint-Honoré.
– À votre place, je créerais une énorme tombola sociale, composée de lots variant entre cinq cent mille livres de rente et peau de balle et balai de crin1, en passant par mille positions intermédiaires. Autant de lots que de citoyens français. Tirage, chaque année (au 1er avril, pour rigoler un peu). Dès lors, la vie deviendrait exquise et habitable. Le tumulte des passions s’assoupirait. L’envie reploierait ses odieuses ailes vertes. Et renaîtrait l’espoir ! Tel qui détiendrait, pour le moment, la peau de balle ou le balai de crin, se croirait le plus fortuné des bougres, à l’espérance que, dans un an, ce serait lui qui ferait son petit tour de lac ou, tout au moins, qui jouirait d’une bonne petite vingtaine de mille livres de rente.
Visiblement frappé de l’horizon que je lui ouvrais, le président se grattait la tête. Puis, sans me laisser achever, il ajouta, en imitant Dupuis à s’y méprendre :
– La voilà bien, la solution de la question sociale ! La voilà bien !
Expressions triviales correspondant, à peu près, à ce que les mathématiciens dénomment zéro.
Le tripoli
À Hermann Paul.
C’était un homme de ma compagnie qui s’appelait Lapouille, mais que nous avions baptisé l’Homme, à cause d’une histoire à lui arrivée récemment.
En manière de parenthèse, voici cette histoire :
Puni de consigne – comme il lui advenait plus souvent qu’à son tour – l’excellent Lapouille avait, tout de même, jugé bon de faire en ville un petit tour hygiénique, lequel se prolongea jusque vers les onze heures du soir.
Aussi, dès son retour à la caserne, fut-il invité par monsieur l’adjudant à terminer à la salle de police une nuit si bien commencée.
Lapouille, sans murmurer, revêtit la tenue d’usage, empoigna sa paillasse et se dirigea, d’un pas philosophe, vers les salles de discipline.
– Comment, encore un ! s’écria le sergent de garde. Mais, c’est complet, ici !
– Bon, fit tranquillement Lapouille, n’en parlons plus. Je vais aller coucher à l’hôtel.
– La salle de police des hommes est pleine... On va vous mettre dans la salle des sous-officiers. Justement il n’y a personne.
Mais Lapouille n’entendait pas de cette oreille. Il protesta froidement :
– Pardon, sergent, je suis un homme, et j’entends subir ma peine dans la salle de police des hommes.
– Puisque je vous dis que c’est plein, espèce d’andouille !
– Je m’en f... sergent, je suis un homme, je ne connais que ça !
– Mais, bougre d’imbécile, vous serez bien mieux dans la salle des sous-offs.
– Il ne s’agit pas de bien-être, là-dedans ! C’est une question de principe. Suis-je un homme ? Oui. Eh bien ! on doit me mettre dans la salle des hommes. Quand je serai sergent, vous me mettrez dans la salle des sous-officiers, et je ne dirai rien. Mais, d’ici là... je suis un homme.
Arrivé, sur ces entrefaites, et impatienté de ce colloque, l’adjudant ne parlait de rien moins que de saisir Lapouille par les épaules, et le pousser dans la boîte avec un coup de pied quelque part. Lapouille prit alors un air grave.
– Monsieur l’adjudant, je suis dans mon droit. Si vous me violentez, j’écrirai à la République française.
Pourquoi la République française, de préférence à tout autre organe ? On n’en a jamais rien su. Mais, c’était le suprême argument de Lapouille ; pour peu qu’un caporal le commandât un peu brusquement de corvée de quartier, Lapouille parlait, tout de suite, d’écrire à la République française.
Devant cette menace, l’adjudant perdit contenance. Diable ! la République française.
Et Lapouille continuait, infatigable.
– Je suis un homme, moi. Je ne connais que ça ! Je suis un homme ! Je veux la salle de police des hommes !
Finalement, on l’envoya coucher dans son lit.
Le nom lui en resta : on ne disait plus Lapouille, on disait l’Homme ; l’Homme par ci, l’Homme par là.
Ce trait indique assez le caractère de mon ami Lapouille, le type du soldat qui arrive à toutes ses fins, celui qu’on désigne si bien dans l’armée : celui qui ne veut rien savoir.
Non, Lapouille ne voulait rien savoir, ni pour les exercices, ni pour les corvées, ni pour la discipline.
– Mais vous n’en f... pas un coup ! lui disait un jour le capitaine.
– Non, mon capitaine, répondait poliment Lapouille, pas un coup.
Et il développait, pour sa flemme et sa tranquillité, des trésors de force, d’inertie, des airs d’idiot incurable, de géniales roublardises, et puis surtout une telle quiétude, un tel insouci des châtiments militaires, une si folle inconscience (apparente, du moins), qu’on n’osait pas le punir, et souvent il ramassait deux jours de consigne pour des faits qui auraient envoyé n’importe lequel de ses camarades à Biribi.
Le damoclésisme de la fameuse République française lui rendait les plus vifs services auprès des caporaux et sergents, braves bougres pour qui la crainte de la presse est le commencement de la sagesse.
Dans les environs de Noël, Lapouille fit comme les autres et sollicita une permission de huit jours pour aller à Paris, se retremper un peu dans le sein de sa famille.
Lapouille ne vit pas son désir exaucé, sa conduite précédente ne le désignant nullement pour une telle faveur.
Notre ami ne manifesta aucun désespoir, n’éleva aucune réclamation, mais je puis vous assurer que le jour de Noël, quand, à l’appel du soir, le caporal de chambrée nomma Lapouille, personne ne répondit, par cette excellente raison que Lapouille se trouvait à Paris, en train de sabler le vin chaud avec quelques-uns de ses amis.
La petite fête dura six jours.
Le jeune Lapouille semblait s’occuper de son régiment comme de ses premières galoches. Il avait retrouvé une petite bonne amie, de joyeux camarades, carotté quelque argent à sa famille. Le temps se tuait gaiement.
Le soir du sixième jour, comme il dînait en joyeuse compagnie, un copain, qui avait servi, lui dit tranquillement, au dessert :
– Tu n’as pas l’air de t’en douter, mon bonhomme, mais c’est ce soir que tu vas être porté déserteur !
Malgré son mépris des règlements militaires, Lapouille éprouva un petit tressaillement désagréable... Déserteur !
Il eut une rapide et désenchanteresse vision de Bat d’Af, de silos, de cailloux cassés sur une route peu ombragée.
En un mot, Lapouille ne rigolait plus.
Il acheva de dîner, passa la soirée avec ses amis et se retira discrètement vers onze heures.
Vingt minutes après, il était place Vendôme et abordait le factionnaire du gouvernement de Paris.
– Bonsoir, mon vieux. Sale temps, hein !
Le factionnaire, un garçon sérieux, ne répondit point. Lapouille insista :
– C’est là que demeure le gouverneur de Paris, dis ?
– Oui, c’est là.
– Eh bien, va lui dire que j’ai à lui parler.
– Dis donc, t’es pas fou, toi, de vouloir parler au gouverneur de Paris, à c’t’heure-là ?
– T’occupe pas de ça, mon vieux. Va lui dire que j’ai à lui parler, tout de suite.
– Tu ferais mieux d’aller te coucher. T’es saoul, tu vas te faire f... dedans.
– Tu ne veux pas aller chercher le gouverneur de Paris ? Une fois, deux fois...
– M... !
– Bon, j’y vais moi-même.
Et comme Lapouille se disposait à pénétrer, le factionnaire dut croiser la baïonnette et appeler à la garde.
– Sergent, reprit Lapouille, allez dire au gouverneur de Paris qu’il y a quelqu’un en bas qui le demande.
On essaya de parlementer avec Lapouille, de le raisonner, de l’envoyer se coucher. Rien n’y fit. Lapouille ne sortait pas de là, il tenait à voir le gouverneur de Paris.
Un officier, attiré par le bruit, perdit patience :
– F...-moi cet homme-là au bloc. On verra demain.
Le lendemain, dès le petit matin, le poste retentissait des clameurs de Lapouille.
– Le gouverneur de Paris ! Le gouverneur de Paris ! J’ai quelque chose de très important à communiquer au gouverneur de Paris.