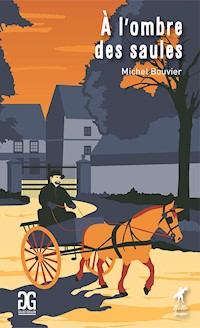
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gilles Guillon Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Suivez l'aventure du Commissaire Dewiquet, qui vous plongera dans le monde de la Belle Epoque !
En 1900 à Marquise dans l’arrière-pays, à quelques kilomètres de la mer, c’est déjà la campagne avec ses paysans taiseux, mais aussi les ouvriers des carrières et des usines métallurgiques. C’est dans ce décor que le commissaire Gaston Dewiquet se voit confier la recherche d’un anarchiste en fuite. L’homme aurait pu trouver asile dans un village vers Wimereux, où il a de lointains cousins.
Découvrez le troisième roman historique de Michel Bouvier et soyez transportés dans la belle région de la Côte d'Opale
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien professeur à l’université catholique de Lille,
Michel Bouvier est l’auteur de plusieurs romans policiers. Aujourd’hui retraité, il consacre son temps à l’écriture et anime une émission littéraire sur l’antenne lilloise de RCF.
À l’ombre des saules est son troisième roman historique après
L’Emasculé du Cran-aux-Œufs (Pôle Nord, 2017) et
La Folle de la rue Guyale (GG, 2019).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans la collection Belle Epoque
1. Un Américain sur la Côte d’Opale, Jean-Christophe Macquet
2. Le Secret de la petite demoiselle, Jess Kaan
3. Amandine et les brigades du Tigre, Lucienne Cluytens
4. Les 400 Coups du Kronprinz, Jacques Thelen
5. Le Diamant jaune, Philippe Valcq
6. L’Emasculé du Cran-aux-Œufs, Michel Bouvier
7. Le Trésor perdu des Rothschild, Jean-Christophe Macquet
8. Amandine à la cour du Tsar, Lucienne Cluytens
9. La Folle de la rue Guyale, Michel Bouvier
10. Echec à Raspoutine, Jean-Christophe Macquet
11. A l’ombre des saules, Michel Bouvier
12. Rapts à Malo, Philippe Waret
Gilles Guillon BP 11 287 59014 Lille Cedexwww.gillesguillon.com ISBN : 978-2-491114-19-0 ISBN numérique : 9782491114336 © Gilles Guillon 2021 Reproduction même partielle interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
Du même auteur
Lambersart-sur-Deuil (Ravet-Anceau, 2012)
Le Silencieux (Ravet-Anceau, 2013)
Sous les ponts (Ravet-Anceau, 2015)
L’Emasculé du Cran-aux-Œufs (Pôle Nord, 2017)
La Folle de la rue Guyale (GG, 2019)
Prologue
Cyrille Frédun poussa la porte et sentit aussitôt une odeur qui lui déplut. Chaque matin, quand il entrait dans sa grange, il humait l’odeur de ses foins, de sa paille, qu’il aurait reconnue en n’importe quelle saison et par n’importe quel temps. Aujourd’hui, il faisait calme et doux, et il y avait une odeur d’homme des chemins derrière la porte. Il prit machinalement la fourche qui était appuyée au premier poteau, et il s’avança vers la ligne de paille. Il vit tout de suite la forme sombre : un drôle dormait là, dans sa grange, sans même avoir eu la convenance de demander l’asile. Parce que chez les Frédun, on acceptait que des gens de passage dorment dans la paille, pourvu qu’ils n’aient pas trop sale trogne ; on leur offrait même le pain graissé de lard et l’eau. Mais il fallait demander, le chapeau à la main. Celui-ci avait manqué à la règle, de quoi donner au fermier de la mauvaise humeur. Il fit pivoter la fourche dans sa main pour réveiller le bonhomme du bout pommé du manche. L’homme étendu se releva d’un coup, s’agrippant au manche de la fourche pour l’écarter tout en s’en servant pour s’équilibrer. Il ne s’était pas rasé depuis des jours, et ses vêtements crasseux jetaient dans l’air matinal toutes sortes d’humeurs suries.
– Du calme ! ordonna le fermier, tout en essayant de reprendre la maîtrise de son ustensile.
Mais au lieu de le laisser contrôler sa fourche, le gaillard la manœuvra avec un grand ahan afin de tourner les pointes vers le fermier, puis il poussa sur le manche pour l’en piquer. Surpris par ces façons inhabituelles – d’ordinaire, les chemineaux interpellés par les paysans s’excusaient bassement et filaient – le fermier réagit maladroitement, et il sentit les pointes de la fourche lui griffer la poitrine.
Lorsqu’il vit un peu de sang sur la chemise du paysan, le bougre lui arracha l’outil des mains, se jeta de toutes ses forces contre lui en le visant des quatre pointes, qui s’enfoncèrent dans sa poitrine en la faisant craquer. Puis il ramassa son bissac, sortit, repoussa la porte. L’aurore attisait ses braises dans un ciel rayé par l’ébouriffement d’une ligne de saules têtards. Il leur tourna le dos, vérifia que personne n’approchait, se pressa vers la barrière de l’enclos, s’engagea d’un pas farouche sur le chemin de terre et de cailloux qui rejoignait la route.
Chapitre 1
Morgane croyait aux fées, mais elle avait une façon bien à elle d’y croire. Les fées étaient capables de se rendre toutes petites afin de se cacher sous les cailloux des chemins secs, sous les brins d’herbe les plus fins qui les bordaient. Il fallait les chercher en soulevant délicatement les éclats de pierre, en peignant de ses doigts l’herbe fine, celle qui vient tout juste de sortir de terre. Il fallait retenir son souffle, parce que les fées filaient à la moindre haleine. Mais si on en voyait une, si on avait le temps de la voir avant qu’elle ne file, alors on pouvait lui demander tout ce qu’on voulait. Elles n’en faisaient qu’à leur tête, mais justement, on pouvait toujours penser qu’elles seraient gentilles, puisqu’elles étaient des fées. Le signe qu’elles avaient envie de l’être, c’était qu’elles grandissaient jusqu’à devenir de la taille de Morgane, qu’elles s’asseyaient sur la mousse et qu’elles lui souriaient, comme madame la comtesse quand la petite fille portait le beurre et les œufs au château.
Morgane avait été recueillie par sa marraine à la mort de ses parents, le père disparu en mer en novembre 1894, la mère piétinée dans une émeute de la faim sur le port de Boulogne, peu après. La fillette avait dû quitter le bord de mer, les odeurs de marée pour celles du fumier et de la terre labourée. Sa marraine était fermière à Wierre-Effroy. Elle s’appelait Hictrude, prénom descendu d’une aïeule flamande, mais tout le monde lui donnait du Madame George, du nom de son mari, un fort gaillard au ventre débordant, qui conduisait ses chevaux à la longe comme un cocher de manège, en faisant des « hue » et des « ho » qui lui montaient de la gorge avec des roulements de crachats rocailleux. Marraine avait déjà trois fils, Jean, Gilles et Romain, qui traitaient Morgane en intruse, la regardant avec des yeux méchants, ne lui adressant la parole que pour lui donner des ordres, ou la poursuivre en prétendant jouer.
Son plaisir était de porter le beurre et les œufs au château. Ils n’en avaient pas besoin, du beurre et des œufs des George, puisqu’il y avait une immense ferme derrière le château ; mais madame la comtesse l’avait exigé, qu’on envoyât la petite Morgane au château avec son panier, parce qu’elle s’était éprise de cette enfant, elle qui ne parvenait pas à en mettre au monde, et avait inventé que les œufs et le beurre des George étaient les meilleurs du canton afin de se donner un prétexte solide. La comtesse n’était que l’épouse du maire, qui n’était pas comte, mais on lui avait toujours donné ce titre dans le village, avec du respect, parce qu’elle connaissait les simples et en cultivait une grande variété dans son jardin médicinal. Elle était aidée dans cette tâche par un jardinier qui ne parlait pas plus que les carpes de l’étang devant le château, et qui faisait peur à Morgane, parce qu’il s’arrêtait pour la regarder se diriger vers la bâtisse blanche, les mains croisées en appui sur la potence de sa bêche. Morgane avait peur des hommes qui la regardaient avec cette insistance, comme faisait aussi Guillaume Sautieux, le maréchal-ferrant du bourg, qui, lui, l’obligeait à faire un détour en allant à l’école, parce qu’il avait toujours l’air de vouloir l’attraper en lui faisant les cornes. Pour éviter le jardinier, elle aurait pu traverser la grande prairie, mais il y avait des trous remplis d’eau boueuse et de petites grenouilles qui sautaient dans tous les sens ; alors, elle préférait suivre l’allée sableuse qui contournait le jardin des simples, baissant les yeux et pressant ses pas. Ce qui lui donnait du courage, c’était l’accueil de madame la comtesse, dont elle gardait tout un cahier d’images dans sa mémoire enluminée.
Le sourire de cette dame était large comme un pain, elle avait la bouche toute ronde pour le former, comme si elle y avait tenu un œuf, pas un gros œuf de poule, un petit œuf de caille avec des points dorés. Elle tenait ses mots entre ces lèvres si bien arrondies qu’on avait envie de les y cueillir. Et sa robe envoyait des odeurs de fleurs dans toutes les directions quand elle se mettait en marche pour inviter Morgane à la suivre dans le grand salon. Parce que madame la comtesse avait cette gentillesse distinguée de recevoir la fillette avec son panier de ferme dans le grand salon, où elles s’asseyaient côte à côte sur la banquette de reps bleu pour tenir une conversation de dames, sur les travaux des champs, les jeux des cochons, des lapins, des veaux, dont la grande dame voulait avoir des nouvelles comme si les bêtes des George avaient été de sa famille.
Elle aimait aussi évoquer sa belle-mère, qui vivait au château dans une suite du premier. Impotente, elle ne quittait le lit que pour un fauteuil mécanique, dont Madame la Comtesse imitait les bruits que faisaient les différentes manivelles qui permettaient de l’actionner. Elle tournait une manivelle imaginaire et couinait de diverses façons ; puis elle disait qu’il allait falloir ajouter un peu d’huile sur les pignons, ce qui la faisait rire.
– Ernest ne supporte pas l’idée qu’on puisse graisser le fauteuil de sa mère ! confiait-elle. Il prétend que cela risquerait de tacher ses tapis. Il faut donc que nous supportions les grinchouillis de cette machine infernale. Tu as bien de la chance de ne pas devoir habiter cette grande maison, tu sais, ma gentille Morgane.
Disant cela, elle lui passait la main le long des joues. Morgane trouvait cela bien agréable, ces longs doigts parfumés qui glissaient sur sa peau. Pour mieux en profiter, elle laissait ses paupières descendre sur ses yeux, se rejoindre en croisant les cils du haut avec ceux d’en-bas. Sa marraine ne la touchait jamais, ni personne d’autre. Son corps n’existait agréablement que pour madame la comtesse, qui sentait bon et parlait avec de la crème sur la langue. La crème qu’on faisait à la ferme, on en mangeait peu, tandis qu’à la cuisine du château, on en faisait une grande consommation. Morgane pensait que c’était d’en manger qui donnait aux phrases de madame la comtesse leur douceur extraordinaire.
Ce jour-là pourtant, madame la comtesse sentait le sur, comme de la crème qui aurait traîné dans une jatte sur l’évier, une odeur qui venait de ses jupons et qui ressemblait à celle de la Rousse, la vache qui venait de vêler et dont le veau était mort au matin. Ce qui avait fait jurer George. La voix de George roulait sur de la boue granuleuse avant de sortir, elle dispersait des odeurs de fiente de canard et toute une bruine collante. Morgane avait dû la recevoir sur les joues, sur les paupières, sur le menton une fois qu’elle avait écrasé un œuf dans son tablier, en glissant sur les pavés souillés. Elle avait dû laver elle-même son tablier au baquet, avec la grosse brosse de chiendent qui était énorme pour sa main, et lui échappait à tout instant. Mais George ne l’avait pas frappée, il s’était contenté de tenir la main levée au-dessus de sa tête et de brailler des phrases noires, dans cette langue sauvage qu’il employait quand il était en colère.
En sentant cette odeur dans les jupons de madame la comtesse, Morgane avait pensé qu’elle était peut-être malade, qu’elle avait mis au monde un enfant mort la nuit dernière. Comme elle avait le ventre toujours rond, difficile de juger si elle était grosse ou non. Tout le village savait qu’elle ne mettait au monde que des enfants morts, qu’elle ne les gardait pas assez longtemps dans son ventre. Que le maire en était malheureux, mais qu’il croyait en remettant ça que la nature finirait par lui obéir, ou céder au docteur Fonsicourt, qui essayait incessamment des nouveaux remèdes, jusqu’ici sans effets. Morgane espérait attraper une fée qui donnerait un enfant à sa bienfaitrice, mais elle n’y arrivait pas. Elle n’osait rien dire de ce qu’elle sentait, mais elle parla de la Rousse et de son veau. Madame la comtesse l’écouta gentiment comme elle savait si bien faire, puis elle lui dit de ne pas se tracasser, que la Rousse ferait un autre veau, que c’était un accident comme il en arrive. Que c’était embêtant pour sa marraine, mais qu’elle avait d’autres vaches. Morgane rentra plus contente à la ferme, cependant, elle n’osa quand même pas prendre par la grande prairie, dont les flaques étaient habitées par les petites grenouilles.
Chapitre 2
Gaston Dewiquet descendit de cheval d’un ample mouvement de la jambe droite, il flatta l’encolure de sa jument Soyeuse, passa le bout des rênes dans l’anneau accroché au mur du presbytère, et fit un nœud qu’il serra énergiquement. Il aurait aimé un peu plus de lumière dans l’air, mais au moins, il n’y avait ni vent ni pluie, ce qui était déjà bien agréable. Il heurta violemment le marteau de porte, ce qui fit résonner le couloir qu’il devina long et vide. Il n’était jamais venu chez le curé de Wierre-Effroy, dont on lui avait dit qu’il était jeune et aimable. Catholique attiédi, le commissaire avait de moins en moins de goût pour les choses de la religion, mais il restait curieux des hommes d’Église, dont il appréciait le savoir peut-être plus encore que la bienveillance. Il pratiquait irrégulièrement, mais il recherchait le calme particulier qu’on trouve dans les églises et les bâtiments religieux. Quand on lui avait annoncé qu’un dangereux anarchiste pourrait s’être caché dans ce gros bourg et qu’on le chargeait de le trouver, il avait tout de suite pensé rendre visite au curé plutôt qu’au maire, pour la raison, qu’il ne reconnaissait pas, que la piété du petit Pierre le tracassait, et que peut-être il pourrait en parler avec ce prêtre.
Depuis qu’il l’avait recueilli et mis à l’école de Marquise, l’enfant était devenu plus angélique encore qu’il n’était lorsque le commissaire l’avait tiré de la grande ferme de Waringzelle, au-dessus du Cran-aux-Œufs11. L’influence de Germaine, la gouvernante dévote dont le commissaire avait fait sa femme, n’y était sans doute pas pour rien, mais il avait découvert peu à peu que cela venait de plus loin. Il avait cru sortir du petit Pierre une manière de chef-d’œuvre en l’éduquant selon son ambition, et voilà qu’il rencontrait une âme aimable qui lui résistait, s’en allait avec entêtement sur des voies qui le troublaient. Il en avait vaguement parlé au baron d’Estrainette, qui avait une fille religieuse dont il n’était pas bien fier, mais le baron avait détourné la conversation, comme il avait l’habitude de faire quand on lui proposait un sujet qui le mettait mal à l’aise, préférant les assauts de l’escrime à ceux de la réflexion.
Une vieille femme ouvrit, qui portait un tablier d’un noir si usé qu’il s’en éclaircissait dans la lumière du jour ; elle sourit au commissaire en chiffonnant ses rides, lui proposa d’entrer dans le salon où le jour glissait une lumière molle, « pariant sur la descente fort prochaine » de monsieur le curé, qui finissait ses prières « là-haut, dans son oratoire clos ». Dewiquet remarqua plaisamment ses façons de dire, les savoura. Elle accompagnait toutes ses paroles de mouvements de ses mains longues et grises, sans trop remuer les bras qu’elle maintenait au long du corps, quoique sans raideur. Elle se déplaçait en claudiquant d’une hanche plus faible, ce qui remuait dans ses vêtements des parfums de savon noir et de cendres ; parfois elle s’essoufflait à tenter de se débarrasser d’un chat qui lui venait dans la gorge. Cette gêne fit remarquer au commissaire que le presbytère était frais, à la limite de l’humide, ce qui lui donna un frisson, fit tourner ses pensées vers l’image d’une belle flambée dans la haute cheminée de pierre d’Honglevert, bien qu’il sût qu’il ne devait pas l’espérer ici, dans cette bâtisse mal vieillie.
Le curé Grimont lui plut dès qu’il le vit sur le seuil du salon, avec son sourire brutal, qui vous forçait à la sympathie, ou à la haine, sans possibilité d’hésiter. Pour Gaston Dewiquet, ce serait la sympathie. Ce qui rendait ce sourire brutal, c’était la puissante mâchoire du jeune prêtre, noire d’une barbe que le rasage le plus soigneux ne pouvait effacer. Une lourde mèche de cheveux de charbon coupait le front haut et bombé comme un chaudron, attirant si fortement le regard qu’on n’en voyait d’abord ni les yeux ni le nez, lesquels se révélaient ensuite successivement, le nez d’abord, long, droit, serré, puis les yeux, qui grésillaient comme des morceaux de lard dans une poêle de fer. Curieusement, le cou était mince, n’emplissant pas le col romain de la soutane, mais les épaules rondes gonflaient le vêtement noir, d’un noir qui absorbait toute velléité d’éclat, toute tentative de reflet.
– Monsieur le commissaire de Marquise, soyez le bienvenu dans mon presbytère frisquet. Voulez-vous que nous passions dans la cuisine ? Pauline y entretient grand feu.
– Volontiers, répondit sans manière le commissaire, en se demandant cependant à quoi ce prêtre avait vu qu’il était gêné par l’humidité.
Quand ils entrèrent dans la cuisine, Pauline en sortit, habituée à la discrétion obligée de la servante d’un homme qui confesse. Ils s’installèrent à la grande table centrale, le jeune prêtre plaça ses coudes de telle manière qu’il pût poser son menton sur ses mains aux doigts imbriqués, et plongea son regard dans les yeux du commissaire, qui se tortilla un peu sur le siège de paille où ses fesses ne trouvaient pas tout de suite leur place.
– Mon confrère de Marquise, l’abbé Crampion, m’a vaguement expliqué le sujet de votre visite, mais je n’y ai pas compris grand-chose, à part que vous aviez des inquiétudes quant à un homme dangereux qui pourrait se cacher sur le territoire de ma paroisse. Vous savez, je ne suis pas informé de toutes les allées et venues, et je n’ai pas une âme d’espion, mon secours donc…
– M. le curé, je sais que ce n’est pas dans vos fonctions de surveiller vos ouailles, néanmoins, il est certain que vous êtes un de ceux qui connaît le mieux la vie ordinaire de ce bourg, et vous m’avez déjà confirmé que vous percevez bien des choses cachées.
– Moi ? Comment cela ? demanda le prêtre avec un grand sourire incrédule.
– En devinant que l’humidité m’était désagréable, par exemple.
L’abbé Grimont partit d’un rire tonitruant, qu’il accompagna d’un grand remuement de tout son corps, tel qu’on aurait pu penser qu’il allait se mettre debout et marcher au long de la table, ce qui fit que Dewiquet redressa plus fièrement le buste. Quand l’abbé se fut calmé, il s’expliqua :
– Je n’ai rien deviné du tout ! C’est moi qui ne supporte pas l’humidité de ce rez-de-chaussée en pierres, surtout de mon vieux salon, avec ses fauteuils de velours poussiéreux que mon prédécesseur m’a laissés, et ses grandes tentures dont je crains toujours qu’elles ne se décrochent de fatigue ! Soyez bien rassuré : je ne suis pas sorcier pour un jambon. D’ailleurs, mes paroissiens finauds l’ont vite remarqué, qui me roulent gentiment dans la farine avec leurs façons de crieurs de marée. Vous savez comme sont nos paysans de ce finistère : le vent du large, la fragilité du rivage, l’odeur des poissons et des algues, tout cela les a rendus roublards, encore plus que ceux des terres profondes, que je connais mieux pour en être issu.
– La mer n’est pourtant pas si proche.
– Croyez-moi, Wierre-Effroy a beau être à une belle distance, les gens d’ici ont le caractère des gens de la côte, surtout quand je les compare aux villageois de chez moi.
– Les gens de Marquise sont bien des gens des terres, et Wierre-Effroy est encore plus dans les terres…
– Vous n’êtes pas obligé de m’approuver, je ne m’en chagrinerai pas plus que d’une chaussette trouée ! Quoi qu’il en soit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, même si je sais que mon pouvoir ne va pas loin. D’où vient ce dangereux personnage ? A-t-on sur lui quelques informations susceptibles de m’éclairer ?
– L’abbé Crampion ne vous a rien précisé ?
– Des choses floues, emballées dans des phrases mal tournées. Vous avez dû remarquer qu’il s’agit d’un homme dont l’éloquence est courte, non par incapacité, dont d’ailleurs je n’ai pas à juger, mais par une discrétion de pasteur expérimenté : à force de fréquenter les gens d’ici, on en comprend l’obligation, de ne pas aller plus loin que les mots d’usage…
– L’homme en question est un anarchiste, une sorte de Ravachol, ou du genre de cet Italien qui assassina l’impératrice Sissi sur les bords du Léman.
– Oui, je me souviens, bien que ça remonte déjà à deux ou trois ans. Triste époque, n’est-ce pas ?
Le commissaire ne releva pas cette remarque banale.
– Il aurait quitté la capitale, où il était trop bien pourchassé, pour se mettre en sécurité par ici ; il aurait, croit-on, des attaches dans le canton, peut-être de lointains cousins. On est resté très évasif, comme vous voyez.
– On vous a peut-être donné son nom ?
– On lui en connaît plusieurs. Louis Schlitt, Fernand Lemel, ou encore Joël Garrick. D’autres aussi, que j’ai oubliés.
– Aucune famille d’ici ne porte l’un de ces noms. Mais il s’agit sûrement de noms forgés au gré des circonstances.
– Tout juste. Ces gens-là se regroupent aujourd’hui en organisations qui ignorent les frontières. Ils voyagent, profitent de complicités en différents pays, parfois très loin. Schlitt fait penser à l’Allemagne, Garrick à l’Angleterre, mais encore aux États-Unis. Quant à Lemel, celui-là pourrait être un patronyme local. Il y a une famille Laumel à Pittefaux, à ce que m’a dit le brigadier de gendarmerie ; il aurait un peu déformé ce nom-là, ou un autre.
– Tout cela complique singulièrement votre tâche.
– Des gens qui ont déclaré la guerre à la société ne vont pas lui donner les moyens de les attraper si facilement.
– Pardonnez-moi, je n’ai pas l’habitude de ces raisonnements-là.
Le commissaire regarda intensément le curé de Wierre-Effroy, qu’il trouvait soudain étrange, tant il lui semblait que ce genre de raisonnements tombait sous le sens, pouvait être compris par n’importe qui. De plus, il lui semblait qu’un prêtre, qui entendait en confession des choses surprenantes, devait avoir l’habitude d’entrer dans la tête de gens de toutes sortes. Évidemment, l’abbé Grimont était encore jeune : à vue de nez, il n’avait pas dépassé les 35 ans. Mais peut-être faisait-il le mariole pour ne pas avoir à venir en aide à la police ? Cette idée dérouta le commissaire de Marquise. Il lui paraissait normal qu’un homme d’Église aidât la police, mais en même temps, il repensait à ce que Germaine lui avait dit de l’attitude de Monseigneur Myriel, dans Les Misérables, soutenant qu’il avait eu grand tort de ne pas dénoncer Jean Valjean aux gendarmes, alors que celui-ci venait de le voler. Gaston Dewiquet pensait comme sa femme que la charité, dans ces cas-là, était une mauvaise excuse, mais le curé de Wierre-Effroy pouvait, lui, être d’accord avec Victor Hugo. Il voulut s’en assurer en disant :
– Il n’empêche que ces bandits sont d’autant plus dangereux qu’ils sont plus malins, et leur malice consiste aussi à embobeliner les braves gens, qui n’ont pas l’habitude de raisonner à leur façon.
L’abbé Grimont ne cilla pas sous la pique, qu’il l’eût sentie ou non, continuant de regarder le commissaire avec les mêmes yeux clairs, hochant légèrement la tête par approbation. Ces façons ne signifiaient rien de clair : il pouvait lui aussi être un bon comédien, « ce que sans doute on devait leur apprendre au séminaire, afin de les former à l’art de garder leurs secrets », pensa Gaston Dewiquet, qui sentit une petite colère monter en lui, devant cet homme qui lui avait semblé d’abord sympathique, car il se disait maintenant qu’il l’était trop, sympathique, pour que ce ne soit pas aussi une ruse pour endormir son attention. Il songea qu’il ne fallait jamais se laisser aller à ses émotions, même avec un curé. L’idée lui vint aussi qu’il devrait peut-être demander à visiter le presbytère, qu’il y avait sans doute un grenier, où le bandit aurait pu être mis à l’abri.
– Prendrez-vous un petit café ? dit soudainement le prêtre, avec une gentillesse pateline. J’ai négligé de vous en proposer, pardonnez-moi.
Le commissaire accepta ; cela lui permettrait de s’installer, de voir comment les choses allaient se mettre en place, d’essayer de percer à jour ce chafouin. Pauline reparut, demanda si elle remettait « le marabout au feu », ou si elle « faisait du frais ».
– Du frais, voyons, pour monsieur le commissaire.
Pauline prit le moulin à café sur une étagère, s’assit en le coinçant entre ses cuisses, et se mit à tourner lentement la manivelle. « À ce train-là, pensa Gaston Dewiquet, j’ai du temps devant moi », et il demanda si le presbytère n’était pas trop grand.
– Mon vicaire loge avec moi. Il fait des visites en ce moment, je ne crois pas qu’il rentrera assez vite pour que vous le voyiez, mais je lui transmettrai tout ce que vous m’avez dit, vous vous en doutez. C’est un natif de l’endroit ; il aime s’attarder dans les fermes écartées, qui lui rappellent sa jeunesse. Vous comprenez, on a beau avoir renoncé aux attraits du monde, notre enfance nous tient par trop de fils.
– Comme les marionnettes en somme.
– Vous exagérez, commissaire, et j’espère que ce n’est pas par mauvais esprit. Je sais que la société n’est pas faite que de bons fidèles ; dans les villes en particulier, il y a aujourd’hui des anticléricaux. Vous ne venez pas d’une trop grosse ville ?
– J’ai fait une carrière de soldat. Maître d’armes auprès de messieurs les officiers à Arras. Ce n’est pas un milieu tout uniment chrétien, mais formé de gens d’honneur, profondément attachés à nos valeurs.
– Nos valeurs, dites-vous ? Celles de la République, j’imagine.
– Qui sont des valeurs universelles.
– Vous savez, l’histoire nous apprend qu’il n’y a guère de valeurs universelles. Les Romains, qui faisaient dévorer les chrétiens dans l’arène pour amuser le peuple, n’avaient peut-être pas ces valeurs que vous jugez universelles. Je les vois mal se battant pour notre devise ! Sans parler des Turcs, des Chinois, ou encore des anthropophages, qui apprécieraient nos missionnaires au bouillon, à ce qu’on dit.
Gaston Dewiquet se sentit encore plus mal à l’aise devant ce jeune prêtre à l’humour combatif, qui s’appuyait sur une culture que le commissaire de Marquise n’avait pas : il se souvenait évidemment des chrétiens jetés aux lions, mais ce souvenir n’entrait pas dans ses raisonnements, ce n’était qu’une image revenant de ses anciens livres de classe, une image aux traits simples et nets, alors qu’il savait par expérience combien les hommes sont embrouillés, combien leur âme est semblable aux greniers, emplis de vieilleries jetées pêle-mêle dans la poussière et l’oubli.
L’odeur du café, qui commençait à se répandre, apaisa son désordre : il estimait naïvement que, dans une maison où on fait du café parfumé, il ne peut y avoir de grandes méchancetés. Il avait plutôt l’habitude de l’odeur âcre d’un café réchauffé avec de la chicorée, comme on en trouve à tiédir sur le coin de presque tous les poêles dans la campagne, aussi celui-ci l’enchantait-il particulièrement. Il demanda au prêtre où il se procurait des grains qui fleuraient si agréablement, pensant en lui-même qu’il pouvait s’agir de produits de contrebande venus d’Angleterre, qui coûtaient cher, mais qu’un curé devait pouvoir se payer.
– C’est un cadeau de Mme la comtesse. Je crois qu’elle le fait venir de Belgique, où elle aurait de la famille à ce qu’elle m’a dit. Par ici, nous avons de solides relations avec la Belgique à cause de tous ces ouvriers qui viennent travailler dans les usines. Ce ne fut pas toujours le cas, si j’en crois l’histoire de cette pauvre sainte Godeleine, qui fut tellement maltraitée par son mari, un petit seigneur brabançon. Mais vous connaissez notre grande sainte locale ?
– Un peu. Mon épouse est venue en pèlerinage à sa chapelle, il y a quelques mois, avec notre petit Pierre, dont les yeux larmoyaient.
– Voilà qui va bien ! C’est à examiner, enfin, c’est un avis que je donne sans prétention, des anarchistes qui se mêleraient aux ouvriers belges qu’on embauche, à Rinxent ou à Marquise.
– Pour Marquise, c’est exact, les ouvriers reviennent après la crise. Mais il y a aussi Outreau, où la gendarmerie a déjà enquêté. Je ne sais comment vous voyez la chose, mais pour nous, ces migrations ouvrières sont une plaie, même si les patrons d’industrie qui les organisent s’en félicitent, tout en se plaignant que nous ne faisons pas assez respecter l’ordre, en particulier quand ils doivent faire face à des mouvements de révolte dans leurs boutiques. Ils voudraient alors que nous trouvions les meneurs et les expulsions, certains rêvant même secrètement que nous les faisions condamner plus sévèrement. Vous devez en avoir parmi vos paroissiens, de ces braves gens qui aiment qu’on punisse leurs prochains !
– À Wierre-Effroy, voyez-vous, je ne crois pas. Je vous l’ai dit : nos paroissiens sont plutôt des gens de la mer. Les marins ne s’agitent pas comme les ouvriers. Ils ont leurs façons. C’est selon ce qu’on leur fait subir aussi, car la vie est rude pour les petites gens. Mais la police ne prend pas cela en considération, n’est-il pas vrai ?
Décidément, ce jeune prêtre avait des idées dangereuses.
– Je vous ferai observer, monsieur le curé, qu’il y a la police et les policiers, comme il y a l’Église et les prêtres. Il est toujours facile de prendre un groupe sans vouloir distinguer selon les personnes qui le constituent, mais n’est-ce pas une manière de s’aveugler, qui doit bien porter un nom de péché dans les manuels de confession ?
Le curé de Wierre-Effroy retint le grand rire qui lui revenait, se contenta d’un sourire comprimé, qui assombrit encore son menton puissant. Il laissa Pauline servir le café avant de répondre :
– Si vous ne m’aviez dit votre ancien emploi dans l’armée, j’imaginerais volontiers en vous un séminariste dont la vocation aurait avorté. Vous montrez en effet la finesse d’un casuiste.
– Je pourrais aussi vous faire remarquer que, pour un curé de campagne, vous êtes bien subtil. En tous cas, je n’en ai pas croisé d’aussi louvoyant que vous, ce qui n’est peut-être pas un compliment.
– Monsieur le commissaire, vous avez la parole franche et de bonnes répliques, ce qui me donne du plaisir à vous entretenir. J’ai plutôt l’habitude de parler à gros sentiments avec mes paroissiens, et même avec mon directeur à qui j’ouvre mon âme, mais à qui je ne puis guère faire part de mes pensées. Il n’y aurait que le vicaire général, avec qui j’ai l’impression que mon esprit respire mieux. Malheureusement, je le vois peu, et pas toujours avec la liberté suffisante pour que s’établisse ce qu’on appelle une conversation.
Gaston Dewiquet écoutait ces confidences avec prudence : un homme intelligent qui paraît se confier, pensait-il, pourrait bien être un habile à la manœuvre. Il fallait voir. C’était une de ses règles, de laisser les choses aller leur train, d’attendre avec une attention renforcée. Il prit donc le temps de boire son café doucement, soufflotant des lèvres serrées afin de l’attiédir avant de le laisser s’étaler sur la langue. Cette manière de faire lui permit de savourer pleinement le breuvage.
– Si Mme la comtesse vous offre un si bon café, dit-il entre deux lichées, c’est qu’elle a de bons fournisseurs, certes, mais surtout qu’elle vous apprécie.
– Ou qu’elle me soigne. Un curé est un personnage qu’il faut flatter quand on est l’épouse du maire, et même quand on est seulement une femme qui sait vivre.
Le commissaire n’eut pas le temps d’ouvrir la bouche que la porte d’entrée s’ouvrit avec vacarme et qu’un pas martelé alarma les vieilles dalles du pavement. Le curé resta impassible ; il leva même la main d’un geste d’apaisement, afin de signifier au policier qu’il ne devait pas s’inquiéter de cette intrusion.
– Mon vicaire, c’est son pas, eut-il à peine le temps de murmurer.
La porte de la cuisine fut bousculée, un gros prêtre en soutane de voyage entra en soufflant comme une locomotive, rouge d’émotion.
– Monsieur le curé, tonna-t-il d’une voix de terrorisé qui aurait échappé au Diable, le grand Cyrille ! Cloué sur sa grange, un coup de fourche, tout ce sang, horrible !
Le curé blêmit, se redressa en prenant appui sur la table, bouscula sa tasse à café qui versa, la rattrapa et se reprit.
– Allons ! allons ! dit-il en rétablissant son équilibre. Monsieur l’abbé, est-ce possible ?
– Je l’ai vu, de mes yeux vu ! Le temps d’appeler, et j’arrive.
– Vous auriez pu peut-être l’assister…
– Il était bien trop mort parbleu ! mort de mort. Ah, monsieur le curé ! Quelle vision ! J’ai seulement dit aux femmes d’éloigner les gosses. Vous savez comme ils sont, curieux à la façon des buses.
Gaston Dewiquet songea que ce gros gaillard n’avait pas été à l’armée, que ça lui manquait sans doute, mais qu’on ne pouvait pas faire des prêtres avec des soldats. Voilà en tous cas qui confirmait ses informations : le bandit était dans le coin, ce ne pouvait être que lui, l’auteur d’un meurtre aussi spectaculaire.
– Pouvez-vous me conduire sur les lieux ? demanda-t-il au vicaire.
Pour éclairer son adjoint, qui roulait des yeux de chat ébouillanté, le curé précisa qui était son visiteur, puis il proposa de faire atteler la carriole pour se rendre tous ensemble à la ferme des Saules, qui n’était pas trop proche de l’église.
– Je vous suivrai à cheval, dit le commissaire avec une fermeté qui n’autorisait pas de réplique.
Chapitre 3
Il y avait du monde à tourner autour du corps allongé sur le sol envahi de paille effondrée, qu’on avait dû décrocher de la grande porte de la grange où le vicaire disait qu’il était cloué, et sur le bas de laquelle des coulées de sang brunissaient. Le maire, un homme imposant qui travaillait à réparer une clôture pas très loin, était déjà sur place ; mais ce n’était pas lui qui avait fait décrocher le malheureux. Interrogé, le vicaire reconnut qu’il ne l’avait pas vu cloué sur la porte, qu’il avait sans doute employé des mots excessifs, emporté par son imagination troublée. Quand il était entré dans la grange, il l’avait vu assis adossé à la partie fixe de cette porte vers l’intérieur, la fourche encore plantée au niveau de la poitrine, mais déjà retombante, le manche s’étant bloqué dans un creux du sol de briques. Quelqu’un avait dû enlever la fourche, qui était maintenant appuyée aux ballots de paille, les piques ensanglantées vers le bas, et tirer le corps par les jambes afin qu’il fût allongé comme on le voyait. Mais aucun de ceux qui étaient là n’était intervenu en ce sens, et personne n’avait vu qui que ce soit s’éloigner lorsqu’il était arrivé.
Le commissaire se fit présenter la victime, un fermier dans la force de l’âge, qui travaillait avec son père, propriétaire de la ferme des Saules, une des grandes fermes du bourg, où on faisait à la fois de la culture et de l’élevage, vaches, chèvres et porcs, mais pas de chevaux crut-on bon de préciser. Cyrille Frédun était marié, père de trois garçons de 5, 7 et 10 ans ; sa femme les avait emmenés dans la grande salle, où ils pleuraient silencieusement. Le père, Alphonse Frédun, veuf depuis près de trois ans, regardait le corps de son fils en marmonnant des propos inaudibles. Ses deux autres enfants, des filles qui travaillaient aussi à la ferme, mais dont les maris étaient engagés aux usines, se tenaient à côté de lui, muettes, n’osant rien faire, même pas gémir.





























