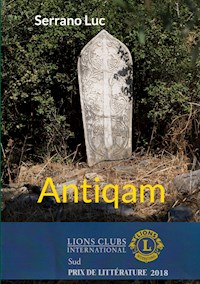
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Quand certains actes condamnables liés au conflit franco algérien refont surface après plusieurs dizaines d'années, c'est tout un petit village au sud de Toulouse qui va âtre le théâtre d'une succession d'évènements tragiques et mystérieux qui vont mettre en péril la vie de certains des habitants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR
14 février(roman), chez BoD, août 2015
pour Françoise,
ma compagne qui supporte mes longues heures d’écriture.
“Aussi longtemps qu’on médite sa vengeance,
on garde sa blessure ouverte.”
THOMAS FULLER
Physicien anglais
1652 - 1734
Sommaire
Incipit
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Explicit
Epilogue
Incipit
Hameau d’Aïnour,
Kabylie, Algérie
1959
Le jour est à peine levé sur les montagnes de Kabylie, dans le hameau de Aïnour tout près d’Aït Idir, quand Ahmed, accompagné de ses deux frères, ferme pour la dernière fois la porte de la vieille maison de pierre qui les a vu naître.
C’est aussi là, que les deux plus âgés ont vécu toute leur jeunesse, avant que le destin ne s’acharne sur leur famille. La guerre d’abord, qui a éloigné le père durant plusieurs années avant qu’il ne revienne blessé, un éclat d’obus lui ayant fait perdre un oeil, le décès de leur mère, ensuite, morte en couches lors de la naissance de son troisième enfant.
Il se retourne une dernière fois pour essayer d’imprimer dans sa mémoire l’image de l’endroit où il a grandi, mais il ne peut effacer de son esprit celle de son père, gisant sur le sol dans une flaque de sang, la gorge ouverte, massacré par des fanatiques agissant au nom de la libération du pays.
Il avait eu le tort, aux yeux de ses tortionnaires, d’avoir servi dans l’armée coloniale française. Ce qui leur avait suffi pour motiver ce geste barbare et exécuter froidement un de leurs compatriotes sans en ressentir le moindre remords.
Il ne restait alors à Ahmed et ses frères plus aucune famille, excepté un oncle très âgé, qui vivait dans un hameau voisin. Comme il ne pouvait assumer la charge des trois jeunes enfants, il avait convaincu les deux plus grands de se rendre en France où résidait un lointain cousin de la famille parti lui, bien des années plus tôt. Ce dernier avait alors promis de s’occuper des trois frères et de trouver, sans problème, du travail aux deux plus grands.
Le vieil homme avait expliqué à Ahmed, pour le convaincre, qu’ils seraient certainement plus heureux là-bas et, que, grâce aux états de service de leur père dans l’armée, ils obtiendraient certainement de l’aide de la part des autorités françaises.
Il avait organisé au mieux le voyage des enfants, et avant le départ, avait confié au plus grand quelques maigres économies.
Le malheureux croyant agir dans leur intérêt, ne pouvait imaginer le sombre destin qui les attendait de l’autre côté de la Méditerranée.
Ahmed vient d’avoir dix-sept ans, son frère Noham, quinze, le plus petit, Akim, lui n’a que trois ans. Il ne comprend pas ce qui se passe et s’imagine simplement partir pour une longue promenade, avec ses deux frères.
Leurs bagages se résument à une vieille valise en carton dont les fermetures laissent à désirer et qu’ils ont consolidées comme ils ont pu avec de la ficelle, ainsi qu’un maigre baluchon contenant le peu de nourriture nécessaire pour la durée du voyage. Donnée par leur oncle, elle se résume à quelques galettes de blé et des dattes sèches.
Pour rejoindre le village de Tizi El Korn, situé à plus de dix kilomètres de là, ils doivent suivre un long chemin caillouteux. Pendant près de trois heures de marche sous le soleil brûlant qui commence à s’élever haut dans le ciel sans nuage, ils se relaient à tour de rôle pour porter sur le dos le plus petit qui a beaucoup de mal à suivre le rythme. Ses deux frères eux, sont habitués depuis longtemps aux longs parcours à travers les montagnes arides.
Ils finissent par atteindre épuisés, le village et la grande route.
Assis sur le talus, à l’ombre d’un maigre bosquet d’arbres, ils doivent maintenant patienter en attendant l’hypothétique passage de l’antique autobus, qui, si tout va bien, devrait les conduire jusqu’au bord de la mer à Bejaia.
Après de longues heures de patience, ils prennent place sous les regards indifférents des quelques passagers présents, dans le fond du véhicule brinquebalant, qui démarre, en laissant derrière lui un panache de fumée noire, symptôme du grand âge de sa mécanique.
Secoués par les nids de poules et les virages incessants, ils arrivent en fin de journée, épuisés par le voyage et la chaleur, à la « grande ville ». Heureusement pour eux, l’autobus les dépose devant la gare, ce qui leur évite d’avoir encore à marcher.
Il leur faut patienter jusqu’au départ du prochain train pour la capitale, qui n’aura lieu que le lendemain matin.
La gare étant fermée pendant la nuit, ils s’installent devant l’entrée, à l’abri sous le grand porche. Après avoir partagé quelques dates en guise de repas, ils essaient de trouver le sommeil.
Le petit Akim, fatigué par cette si longue et dure journée, s’endort presque immédiatement. Ahmed lui, reste éveillé toute la nuit, ne se sentant pas en sécurité au milieu de cette ville inconnue.
A plusieurs reprises quelques larmes coulent sur ses joues, lorsqu’il repense à son village et à leur vie d’avant, avant que toute cette succession de malheurs qui se sont acharnés sur la famille, ne vienne briser leurs existences d’adolescents.
Le vieil autorail met presque six heures pour rejoindre, après un nombre incalculable d’arrêts, la ville d’Alger. Dès leur arrivée, ils quittent la gare et se dirigent vers le port où, suivant les indications de leur vieil oncle, ils vont se renseigner sur le prochain bateau en partance pour Marseille. Cette fois, ils n’auront pas longtemps à patienter, le « Ville de Marseille » appareillant pour la France le soir même.
Seul Akim ne cesse de s’émerveiller de tout ce qu’il découvre, les deux grands, eux, sont submergés par la tristesse de quitter leur pays et c’est empreints de nostalgie qu’ils voient s’éloigner depuis le pont du bateau les blanches maisons de la casbah d’Alger encore éclairées par la lumière orangée du soleil couchant.
Le lendemain soir, ils débarquent sur la terre de France, épuisés, sales et affamés. Ils se rendent aussitôt à l’adresse du cousin qui vit dans une cité, en périphérie de la ville. Ils sont surpris de l’accueil froid qui leur est réservé et là où ils pensaient trouver un peu de réconfort, ils se voient obligés de s’entasser, sans même avoir pu faire leur toilette, dans l’unique chambre de l’appartement, déjà occupée par les quatre enfants de la maison.
Ayant depuis longtemps terminé leurs maigres provisions, Ahmed demande s’ils peuvent manger quelque chose et pour tout repas il se voit remettre, un morceau de pain et une barre de chocolat à partager avec ses frères.
De bon matin, l’homme qui les a reçus, vient, sans donner aucune explication, chercher le petit Akim, et après une rapide toilette, la femme de la maison lui enfile des vêtements propres qui le rendent plus présentable. On explique aux deux grands que leur frère va être placé dans une famille de Marseille qui va très bien s’occuper de lui, et avant même qu’ils aient pu protester, ils voient pour la dernière fois leur petit frère, les yeux pleins de larmes, leur faire un signe de la main en guise d’au revoir.
Akim est conduit dans une belle villa, appartenant à une famille d’origine juive allemande. Ils sont venus se réfugier à Marseille, il y a bientôt vingt ans, chassés eux aussi de leur pays par une autre guerre. N’ayant jamais pu avoir d’enfants, ils ont, un peu à contre coeur, mais c’était là un de leurs derniers espoirs, fait appel à un réseau clandestin qui contre une grosse somme d’argent leur a promis de répondre à leur attente.
La transaction est très rapide et l’homme repart, une grosse liasse de billets dans la poche, se disant que la journée commence bien pour lui.
Il reste cependant les deux grands dont il ne sait que faire et dont il n’a aucune envie de s’encombrer. Il invente alors un autre membre de la famille travaillant dans une ferme près de Toulouse, et qui, il le promet, va leur trouver du travail dans une exploitation de la région.
Après avoir remis quelques pièces de monnaie à chacun et payé les deux billets de train, il les abandonne en fin de journée sur le quai de la gare Saint Charles.
Ahmed apprécie le confort des trains qui est pour lui d’un véritable luxe, comparé au vieil autorail qui les a conduits jusqu’à Alger. Ils commencent alors à se dire qu’ils ont eu raison de venir en France, la vie y semble en effet tellement plus agréable.
Mais ils déchantent vite lorsqu’à peine sortis de la gare, ils sentent des regards hostiles autour d’eux et comprennent rapidement que, contrairement à ce qu’ils pensaient, ils ne sont peut-être pas aussi bienvenus que cela sur le territoire français. Ils n’ont alors d’autre solution que de quitter la ville pour rejoindre l’adresse fournie par leur cousin.
Si la ferme existe bien il n’y a aucun employé algérien qui y travaille, il n’y en a même jamais eu, et on leur fait vite comprendre que leur présence n’est pas perçue d’un bon oeil.
Abattus et désespérés, comprenant qu’ils se sont fait berner par leur malhonnête cousin, il ne leur reste plus sans argent et sans nourriture, qu’à prendre leur sort en main.
Ils décident de partir au hasard, en direction du sud. Après plusieurs jours d’errance, où ils se voient à chaque fois, refuser la moindre aide, quand ce ne sont pas les chiens que l’on envoie à leur trousse, journées durant lesquelles ils sont obligés de chaparder pour se nourrir un minimum, dormant à la belle étoile, ils arrivent dans une ferme, à la sortie d’un petit village.
La patronne, veuve depuis peu, trop contente de trouver enfin de la main d’oeuvre bon marché, ne fait pas la fine bouche et leur propose, à condition qu’ils dorment dans la grange, de les nourrir et de leur donner un maigre pécule chaque semaine en échange de leur travail.
Enfin soulagés de ne plus avoir à vivre comme des vagabonds, ils vont pouvoir se laver et faire leur lessive au bassin dans la cour. Cette nuit ils auront même, luxe suprême pour eux, un toit pour les protéger.
Ils acceptent sans hésiter et le soir-même prennent leur premier vrai repas autour d’une table, depuis leur départ d’Aïnour.
1
Saint-Ettifal,
Haute Garonne, France
Lundi 28 avril 2003
Le jour ne s’est pas encore levé, des filaments de brumes restent accrochés à la cime des arbres. De rares oiseaux manifestent leur présence par de petits cris discrets. La forêt est encore endormie.
C’est l’heure qu’il préfère pour venir, à l’abri des regards, parcourir les bois dont il connaît maintenant chaque recoin.
Le territoire sur lequel il se promène est une propriété privée et de plus la chasse y est interdite. C’est une des raisons de son choix, les animaux s’y trouvant en abondance. Il arrive, quelquefois, qu’un malheureux lièvre croise sur sa route un des pièges minutieusement installés et finisse ainsi au fond de sa gibecière.
Durant tous ces longs moments passés dans la forêt, il se sent libre et léger, alors que dans le village il est considéré comme un moins que rien, qu’il doit marcher en baissant la tête s’il ne veut pas apercevoir les grimaces et les gestes obscènes et entendre les ricanements et les moqueries proférés sur son passage.
Sa seule crainte au milieu de ce bois serait de se retrouver face à face avec l’un des nombreux sangliers qui ont élu domicile dans ces lieux tranquilles.
La forêt est immense, plus personne ne la parcourt et ne l’entretient depuis longtemps.
La dernière baronne, ultime descendante féminine de la lignée des Martinet du Bois de Lapierre, s’est éteinte quelques années après son mari, ne laissant derrière elle qu’un seul fils.
Ce dernier, occupe seul le château, et vit dans cette immense bâtisse au confort rudimentaire, grâce au maigre héritage laissé par ses parents. Il ne fréquente que très peu les habitants du village, laissant courir à son sujet de bien étranges rumeurs.
Ses modestes revenus, ne lui permettent pas d’entretenir toute la propriété, ce qui explique l’état d’abandon de la partie boisée. Le domaine comprenait à l’époque de sa splendeur des centaines d’hectares de terres aux alentours, et l’on y trouvait, en plus des bois, de la vigne, des vergers et des pâturages. Mais au fil des siècles, afin de pallier les dépenses colossales que nécessitaient son entretien et surtout celui du château, de nombreuses parcelles ont été vendues.
Une route a même été percée sur les terres, pour faciliter la circulation autour du bourg, ce qui justifie la présence des magnifiques pins multi-centenaires en bordure de cette nouvelle voie de circulation. C’est aussi l’origine de tous ceux que l’on peut apercevoir dans plusieurs endroits du village. Quant aux fermes qui étaient propriétés du domaine, il y a bien longtemps qu’elles ont, elles aussi, été cédées pour subvenir au train de vie qu’avait encore conservé la famille au début de ce siècle.
Selon le contenu testamentaire de la vieille baronne, sans doute une fervente amie de la nature et de la cause animale, la totalité des terres restantes devront définitivement rester privées et la chasse y être strictement interdite. Si ces deux points venaient à ne plus être respectés par ses légataires, le domaine deviendrait d’office propriété d’une association de préservation de la nature qui a d’ailleurs été chargée de veiller au respect de ces volontés quelques peu surprenantes, mais tout à fait à l’image de l’excentrique dame.
Les responsables de l’association en question restent bien sûr vigilants et prêts à sauter sur l’occasion de faire valoir leurs droits, s’ils venaient à remarquer le non-respect de ces conditions.
Voilà une des raisons qui fait que les bois ne sont plus fréquentés. Mais ce n’est pas la seule, ils ont aussi acquis une mauvaise réputation dans toute la région suite à certains évènements obscurs qui s’y seraient déroulés durant le conflit franco-algérien. On raconte en effet, que deux personnes, auraient disparu dans cette forêt, et on ne les aurait plus jamais retrouvées.
Aujourd’hui, dame nature a repris ses droits et peu à peu envahi les allées et les sentiers. Plus personne n’ose s’aventurer dans les sombres profondeurs de cette épaisse végétation craignant de ne pas retrouver son chemin. Personne, excepté Zaius.
Les cent cinquante hectares de broussailles et de bois sont devenus son domaine à lui seul.
Zaius, n’est pas son nom, mais un sobriquet dont il est affublé depuis son enfance.
Alors qu’il était encore à l’école primaire, est apparu sur les écrans de cinéma, avec beaucoup de succès, le premier volet de la saga de « La Planète des Singes ». Son facies un peu simiesque et sa démarche voutée, encombrée par des bras plus longs que la normale, lui ont valu aussitôt, d’être affublé par ses petits camarades, du surnom d’un des principaux personnages du film, un singe dénommé Zaius.
Aujourd’hui tout le monde l’appelle par ce surnom, beaucoup ne connaissant même pas sa véritable identité.
Il habite presque comme un ermite dans une vieille maison sans confort, seul héritage laissé par ses parents, un peu à l’écart, après la sortie du village - village qu’il n’a d’ailleurs jamais quitté.
Depuis la mort de sa mère, veuve très tôt, il survit grâce à de petits boulots, avec une fâcheuse tendance à se faire exploiter par ceux qui l’emploient. Il est petit à petit devenu la tête de turc du village et quelques personnes malveillantes ont rapidement fait courir des rumeurs l’accusant de toutes sortes de vices.
Le seul lieu qu’il fréquente est la médiathèque car il a depuis toujours, et cela peut surprendre, une grande passion pour la lecture.
Il se réfugiait déjà dans les livres au cours de son enfance pour oublier l’ingratitude des autres enfants et il continue aujourd’hui de prendre un immense plaisir à s’évader au fil des lignes. Il adore les romans et grâce aux conseils de la responsable des lieux, il a ainsi découvert peu à peu, les principaux classiques de la littérature française, ainsi que de nombreux auteurs modernes.
Il s’y rend fidèlement chaque semaine dès l’ouverture de la permanence du mardi après-midi car il est presque sûr de ne rencontrer personne à cette heure-là.
Les autres moments où il ressent un peu de bonheur, sont ceux durant lesquels il arpente seul cette immense forêt à l’abandon, certain là aussi, de n’y trouver personne. Il en connaît depuis longtemps, les moindres recoins et se dirige sans hésiter à travers les taillis et les grands arbres.
Un de ses endroits préférés est une petite clairière entourée de grands chênes où l’herbe moussue n’a pas encore été envahie par toutes sortes de buissons et d’arbustes. C’est un des rares lieux où le soleil traverse les frondaisons et arrive jusqu’au sol. Il s’y est aménagé un abri de branchages, et il peut s’y reposer en écoutant vivre la forêt autour de lui.
Quand il y arrive ce matin-là, le jour commence à peine à poindre et la lumière a beaucoup de mal à pénétrer sous le couvert des grands arbres. Il regagne sa place préférée, d’où sa vue embrasse la clairière tout en restant lui-même dissimulé derrière les branches feuillues.
Il n’a pas choisi au hasard le tronc contre lequel il s’adosse. En effet, il est pourvu sur toute sa partie basse de moignons de branches, formant une sorte d’échelle, de telle façon qu’en cas de danger il pourrait y grimper facilement. Il sait que plusieurs hardes de sangliers vivent sur le domaine, et il n’a aucune envie de faire face à une charge de ces imposantes bestioles.
Après avoir croqué, en guise de petit déjeuner, la pomme chapardée dans un verger sur le chemin, la luminosité devenant plus intense, il commence à remarquer que la terre a été soulevée par endroits, la mousse et l’herbe arrachées. Il pense aussitôt qu’il s’agit certainement de l’oeuvre des groins d’une troupe de cochons sauvages en quête de nourriture.
Une tache claire, au milieu des mottes de terre brune attire son attention. Intrigué, il se redresse, sort de son abri et s’approche doucement, craignant que ne se confirme la première idée venue à son esprit sur l’origine de cette forme blanche.
Arrivé à quelques pas, il n’a plus aucun doute, il s’agit bien d’un morceau d’ossement. Sa forme arrondie lui évoque le sommet d’un crâne. Il pense tout d’abord qu’il s’agit des restes d’un animal qui est venu mourir ici, il y a bien longtemps, et que les défenses de la harde ont mis à jour en retournant le sol.
Pour s’en assurer, il se munit d’un bâton et continue à creuser autour. Au fur et à mesure qu’il dégage la terre, il sent une sueur froide l’envahir et son rythme cardiaque s’affoler.
En faisant levier avec son morceau de bois il fait sortir d’un coup sec, sa découverte, de la gangue de terre dans laquelle elle devait séjourner depuis longtemps. Il ne peut retenir un juron tout en sentant un long frisson parcourir son corps à la vue de ce qui vient d’apparaître devant lui.
Avec deux orbites noires remplies de terre qui le fixent, et deux rangées de dents figées dans un sourire morbide, c’est bien un crâne humain qui lui fait face, posé maintenant dans l’herbe. Dans sa frayeur, il lui semble presqu’entendre un sinistre ricanement parvenir de ces mâchoires sordides.
C’en est trop pour son maigre courage, il s’éloigne en courant de cette vision qui lui a glacé le sang. Il ne s’arrête que lorsqu’à bout de souffle, il a mis assez de distance entre lui et sa macabre découverte.
Après avoir quitté la forêt, il s’empresse de traverser le village en évitant de se faire remarquer et rentre s’enfermer chez lui comme pour se persuader que les moments qu’il vient de vivre n’ont pas existé.
Terré à l’abri des volets clos qu’il n’ouvre d’ailleurs presque jamais, allongé tout habillé sur son vieux matelas, une couverture sur le visage, Zaius tente de chasser de son esprit sa découverte matinale. Mais plus il fait d’efforts en ce sens, plus il lui semble que les détails lui reviennent avec précision. Il revoit devant lui ces deux grands trous noirs qui le fixent et malgré sa volonté de se persuader qu’il a rêvé tout cela, il lui semble percevoir encore, fruit de son imagination, cet horrible ricanement.
Il reste ainsi, prostré, une grande partie de la journée.
Il essaie de se raisonner en imaginant que ces restes sont sûrement très anciens. Il y a bien longtemps que plus personne ne s’aventure dans ces bois. Malgré tous ses efforts il ne peut se détacher de cette vision presqu’irréelle.
Comme il ne veut pas que les gens du village apprennent ses longues promenades dans cet endroit interdit, il lui est impossible de parler à qui que ce soit de sa découverte. Et de plus, il sait d’avance que personne ne prêterait crédit à son histoire et l’on mettrait encore cela sur le compte de son esprit, soi-disant, dérangé.
Au milieu de la nuit, après avoir longtemps réfléchi, sa décision est prise, il va retourner là-bas et enterrer à nouveau les ossements pour effacer toute trace de cet épisode maudit. Il espère ainsi pouvoir tout oublier et retrouver son calme. Il cherchera ensuite une autre clairière pour ses moments de repos, et évitera de retourner dans celle-ci.
Aux dernières heures de la nuit, il se remet en route muni, cette fois d’une pelle pliante dissimulée dans son vieux sac à dos, vestige d’un ancien équipement de l’armée ayant appartenu à son père. Il se dirige grâce à la lueur de la lune encore présente dans le ciel clair, et arrive rapidement sans hésiter aux abords de la clairière.
À peine a-t-il le temps de s’apercevoir que le crâne n’est plus là où il l’avait abandonné, qu’il reçoit un violent coup sur la nuque et sombre aussitôt dans le noir total.
…
Le dernier Baron Louis Clément de Martinet du Bois de Lapierre, puisque c’est ainsi qu’il se nomme pour l’Etat Civil, est un personnage bien étrange. De sa longue lignée de noblesse, il a conservé le port altier d’aristocrate, accentué encore par sa haute stature et la canne au pommeau d’ivoire dont il ne se sépare presque jamais.
Il est difficile de lui donner un âge précis, seules ses tempes légèrement grisonnantes peuvent laisser imaginer qu’il a dépassé la quarantaine. D’épais sourcils noirs lui donnent un air sévère qui effraie les enfants croisant sa route, déjà peu rassurés à son sujet par les réflexions entendues dans la bouche de leurs parents.
Pour les gens du village et des alentours, il est le « châtelain » ou le « baron », mais peu l’appellent par son nom, beaucoup d’ailleurs ne le connaissent même pas.
Il a toujours habité le château et a fréquenté quelques années, les bancs de l’école du village, celle-là même que son aïeule avait jadis fait construire.
C’est cette même école qui était à l’origine destinée aux filles du village, les garçons, plus favorisés avaient déjà la leur sur la place de la mairie. Elle est ensuite devenue, après avoir été agrandie pour y accueillir tous les enfants, l’école publique communale. Aujourd’hui remplacée par des bâtiments plus modernes et fonctionnels, elle abrite désormais les locaux de la médiathèque municipale.
Il a ensuite continué ses études au renommé Lycée Fermat de Toulouse, avant de poursuivre un cursus d’histoire ancienne qui l’a mené jusqu’à une thèse de doctorat obtenue dans la ville rose, à l’Université du Mirail.
Après le décès de sa mère alors qu’il n’avait que vingt-sept ans, il est revenu vivre au château avec son père. Ce dernier n’a malheureusement survécu que peu d’années à son épouse.
Depuis ce jour, Louis Clément s’est replié sur lui-même, et ne quitte que très rarement le domaine. Il lui arrive cependant d’y recevoir quelquefois, les visites d’anciens amis de la famille ou des relations conservées après ses années d’études.
Sur les terres du château, se trouve à quelques dizaines de mètres, une immense ferme ou jadis toute une vie agricole intense devait se dérouler. Il ne reste plus aujourd’hui que des bâtiments à l’abandon et des écuries vides où pendent encore tristement à leur patère les harnachements des nombreux chevaux qui y ont séjourné
Durant l’enfance du Baron, elle était encore occupée par un jeune couple qui, en échange du logis, rendait de nombreux services. Les dernières terres n’étant plus exploitées car toutes mises en fermage, le mari était chargé de l’entretien des abords des bâtiments, et des menus réparations à l’intérieur. Le couple ne cultivait plus qu’un vaste potager au centre de la grande cour et utilisait encore quelques volières aux fins d’élevage de volailles et de lapins. Son épouse, Marie-Louise, mais qui a toujours été appelée Marinette, faisait office de cuisinière et accessoirement de nourrice pour le petit Louis Clément.
Aujourd’hui, Marinette est veuve, elle n’habite plus son ancien logement dans la ferme, mais, à la demande du Baron, lorsque celui-ci s’est retrouvé seul au décès de son père, elle est venue vivre au château.
C’est grâce à ses services qu’il peut se sustenter quotidiennement de repas dignes de ce nom. Elle prend aussi soin de ses vêtements et du ménage dans les pièces encore occupées.
Le château est construit en briques foraines typiques de la région toulousaine. Son imposante façade avant, percée de nombreuses ouvertures lui confère une majesté imposante.
Deux petites avancées, simulacres de tours, encadrant la partie centrale, lui donnent la forme d’un U tronqué, tournée vers le parc. Á l’arrière une aile plus basse, à angle droit, délimite une grande cour gravillonnée bordée de lauriers, tandis que deux cyprès centenaires épousent de leurs frondaisons les vieux murs roses.
Il a été entièrement reconstruit tout près de l’emplacement du château originel du XIIIème siècle érigé alors, à l’initiative du Comte de Comminges. Son édification, a été faite en s’appuyant sur les vestiges des fossés de l’époque et date, elle, du XVIIIème siècle. Cette particularité lui vaut de posséder des sous-sols très anciens et quelques peu mystérieux.
Les bâtiments sont de style classique, imposants par leurs dimensions, mais avec des façades restées très sobres, seuls les encadrements des portes et des fenêtres sont sobrement soulignés par des rangées de briques en saillies.
Sur le grand nombre de pièces que compte la bâtisse, Louis Clément n’en occupe que quatre. Il a conservé sa chambre de jeunesse, au premier étage de la partie droite, accolée à un cabinet de toilette, comme d’ailleurs toutes les chambres. Elle est encore emplie de ses souvenirs et il aime s’y réfugier comme au temps de son adolescence, lorsqu’il avait besoin de fuir quelques instants, le protocole imposé par ses parents.
Le reste de « ses appartements » se situe au rez-de-chaussée. Ils se composent d’une salle à manger, meublée d’une immense table permettant d’accueillir sans problème une vingtaine de convives et qu’il n’a plus utilisée depuis bien longtemps car, quotidiennement, il préfère prendre ses repas dans l’office en compagnie de Marinette. Il dispose aussi d’un grand salon et d’un bureau aménagé dans la bibliothèque. Ces deux pièces sont les plus agréables car elles donnent directement sur le parc et la vue depuis leurs fenêtres est des plus reposantes.
La bibliothèque a d’ailleurs toujours été le joyau du château. D’immenses rayonnages en chêne et en noyer en recouvrent tout le pourtour et se complètent même d’une petite galerie supérieure accessible grâce à un magnifique escalier de bois en colimaçon.
Des centaines, voire plusieurs milliers, de volumes amassés au fil des siècles, par les occupants successifs, en garnissent tous les rayonnages et elle est éclairée de plusieurs lampadaires fixés au plafond par de très longues suspensions, qui viennent diffuser leur douce lumière au-dessus d’une table de lecture disposée au centre de la vaste pièce.
C’est dans le fond de ce bel endroit, dans une sorte d’alcôve, abritée sous le plancher de la galerie supérieure, que Louis Clément a installé son bureau, un très beau meuble de style empire, complété de deux superbes fauteuils qui lui font face et destinés à ses rares visiteurs.
Le salon, appelé le « salon rouge », est resté une grande salle d’apparat qui était le lieu où se déroulaient les réceptions et les bals donnés par les ancêtres du Baron, et où l’on pouvait apercevoir tout ce que la région comptait alors de nobles et de notables. Elle est aujourd’hui meublée de grands canapés et de fauteuils, mais l’on n’y danse plus depuis longtemps.
Toutes les autres pièces, à l’exception de deux modestes chambres d’amis ainsi que celle de Marinette, sont entièrement vides. Le mobilier ayant été vendu au fil des ans, afin de parer aux dépenses énormes que nécessite l’entretien de la seule bâtisse.
Durant les froids hivers, apparaissent des moyens de chauffage anachroniques dans un tel endroit, poêles à gaz ou à pétrole et radiateurs électriques. Ils viennent palier les grandes cheminées, insuffisantes pour maintenir une température confortable dans ces immenses espaces.
L’endroit le mieux chauffé durant cette saison-là est situé dans l’aile basse à l’arrière du château, c’est la grande cuisine, l’office comme le baron l’appelle. C’est le domaine de Marinette où elle entretient en permanence du feu dans la vieille cuisinière à bois.
Voilà pourquoi ils y passent tous deux de longs moments après le repas de midi, chacun ayant son occupation, la lecture pour le Baron, et pour Marinette, la couture, le tricot ou la confection de délicieuses pâtisseries dont raffole son Petit Louis, comme elle prend plaisir à l’appeler encore, bien que cela lui déplaise et qu’il lui en fasse fréquemment la remarque.
Le Baron étant quelqu’un de peu bavard, leurs discussions sont assez brèves et ne concernent la plupart du temps que des questions matérielles à propos de leur vie commune.
Le parc, qui ne se résume plus aujourd’hui, qu’à une vaste pelouse parsemée de pins centenaires et de quelques bosquets d’arbustes, vestiges de jardins jadis certainement plus élaborés, est entretenu très épisodiquement, par une entreprise paysagère locale.
Au-delà de ce grand espace libre, commencent les bois dont seuls les premiers mètres sont encore rarement fréquentés par le Baron ou Marinette à la recherche de quelques champignons dans le but d’agrémenter les repas automnaux, ou de petit bois mort destiné à l’allumage de la cuisinière ou des cheminées.
Sur le côté du château, une piscine et un terrain de tennis datant des années cinquante rappellent eux aussi les périodes fastes de la vie des lieux. Par manque d’entretien ils ont perdu une grande partie de leur éclat et, si la piscine reste encore en eau, la terre rouge du tennis est devenue grise au fil des ans, les lignes ont disparu et le vieux filet, endommagé par les intempéries, pend lamentablement en travers du terrain.
Aujourd’hui, la seule utilité des anciens bâtiments de la ferme, les granges et les écuries, laissés dans un état de semi abandon, est d’abriter sous une bâche l’automobile du Baron. En effet les rares fois où il quitte son domaine, c’est toujours en voiture. C’est aussi là que Marinette a conservé un petit poulailler pour avoir à sa disposition oeufs et volailles.
Louis Clément utilise encore la vieille Mercédès noire, un des deux véhicules ayant appartenu à son père. Il s’agit d’une « 450 SEL 6,9 », un des fleurons de la marque durant les années soixante-dix, équipée d’un fabuleux moteur dont le seul inconvénient aujourd’hui est sa gourmandise démesurée en carburant.
Malgré son grand âge, la carrosserie a conservé de sa superbe et l’intérieur de cuir rouge lui donne encore une prestance qui la fait immanquablement remarquer sur son passage.
Quand il traverse le village au ralenti, nécessité oblige, car l’étroitesse de certaines rues et la largeur de l’auto sont à peine compatibles, il ne manque pas d’apercevoir les regards se tourner dans sa direction.
Lui s’efforce de rester imperturbable, les yeux rivés vers l’avant, comme s’il visait la route à travers l’étoile argentée fixée au bout du long capot noir.
2
Saint-Ettifal,
Mardi 29 avril
Ce jour-là, Marinette a décidé de préparer pour le déjeuner, son fameux gratin de pommes de terre en accompagnement d’un poulet de sa production, qu’elle a fait dorer avec soins, dans le four de la vieille cuisinière.
Les célèbres tubercules de Monsieur Parmentier, constituent en effet, de par leur faible coût, une des principales denrées des repas quotidien du Baron, ce qui explique qu’ils soient achetés en grande quantité auprès d’un producteur local et stockés dans l’immense cave du château.
Munie d’une petite corbeille en osier que lui avait fabriquée il y a bien longtemps son mari, elle se dirige vers le sombre escalier dont l’entrée se trouve au fond de l’arrière-cuisine. C’est à partir de là que l’on retrouve les vestiges des anciens fossés de la bâtisse du XIIIème siècle et qui ont depuis été en partie emménagées en caves.
Après avoir ouvert la vieille porte de bois, elle descend avec précaution les marches de pierre faiblement éclairées par une unique et modeste ampoule et, de plus, rendues glissantes par l’humidité des lieux.
A son âge la moindre chute pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour sa santé et son avenir auprès de son protégé.
Elle atteint enfin le sol de terre battue et s’engage sous la longue voûte au milieu de laquelle est rangé dans des larges panières posées sur des étagères de bois le stock de pommes de terre.
La consommation hivernale en a nettement fait baisser le volume et il n’est pas rare qu’elle en trouve quelques-unes pourries ou attaquées par les dents d’un des nombreux rongeurs hantant les lieux, malgré la chasse perpétuelle qu’elle leur fait.
Ici aussi, une seule ampoule pendue par son fil au plafond, diffuse avec peine le minimum de lumière nécessaire à cet endroit.
Le fond de l’immense cave reste, lui, plongé dans l’obscurité, et Marinette, bien que très courageuse, n’a jamais éprouvé l’intérêt de s’y aventurer, se contentant seulement de la partie éclairée. Elle s’empresse de regagner la surface dès que son panier est rempli.
Cette fois pourtant elle ne peut s’empêcher de tourner la tête vers le fond de la pièce et d’essayer de percer la pénombre car il lui a semblé percevoir un bruit provenant de cette direction. On aurait dit que quelqu’un remuait des pierres.
Elle tend l’oreille mais malgré sa concentration elle ne perçoit plus que le silence. Elle en arrive à la conclusion que tout cela ne doit être que le fruit de son imagination.
Elle s’empresse de regagner la cuisine, après avoir pris bien soin de refermer à clé la porte derrière elle.
Comme tous les mardis, fidèle à ses habitudes, le Baron s’est rendu au bourg voisin pour effectuer quelques emplettes dont Marinette lui a remis la liste avant son départ du château.
A son retour, après avoir acheté, en plus des ingrédients notés sur la liste, luxe ultime, le Petit Journal de la semaine ainsi qu’un hebdomadaire féminin commandé par sa gouvernante, et surtout l’imposante miche de pain qui accompagnera leurs repas durant plusieurs jours, il reprend la route en direction du château.
En montant la Côte de la Vierge, il a pris l’habitude de ralentir à cet endroit pour jeter un oeil à la grille dissimulée audessus du fossé, dans un amas presqu’inextricable de buissons. Elle se trouve tout près de l’ancienne fontaine désaffectée, et d’ailleurs beaucoup d’habitants la confondent avec les restes de cette construction qui alimentait jadis en eau, une partie du village.
Cette porte à claire-voie fait en quelque sorte « partie » de sa propriété, car elle ferme l’issue d’un des nombreux souterrains qui rejoignent le château et qui datent de la première construction. Il tient cette information de son père, mais lui, ne s’est jamais intéressé à l’existence réelle ni à l’état dans lequel se trouvent aujourd’hui ces anciens passages, pas assez téméraire pour cela. Il n’a d’ailleurs jamais essayé de savoir à quel endroit du château ils prenaient leur origine.
Quelque chose l’intrigue ce jour-là. Il arrête la voiture et fait aussitôt une brève marche arrière pour vérifier sa première impression. La grille semble être bien en place mais les buissons devant l’entrée sont couchés, un peu comme s’ils avaient été piétinés. Il pense que cela a dû certainement être causé par un promeneur curieux, intrigué par cet endroit, et qui a voulu s’approcher un peu plus de l’ouverture pour tenter de deviner la raison de sa présence.
Arrivé sous la grange il gare la Mercédès, la recouvre précautionneusement de la bâche protectrice, et alors qu’il se dirige vers l’entrée du château, encombré des journaux, du pain, de son chapeau et de son inséparable canne, il a déjà oublié le petit détail qui l’a interpelé en route quelques instants auparavant.
A peine entré dans le hall, il est happé par les agréables effluves de cuisine arrivant de l’office. Il s’y dirige rapidement pour déposer le pain et la revue qui lui a été commandée, puis rejoint son bureau afin d’entreprendre la lecture minutieuse de son journal, dont l’édition bien qu’hebdomadaire, traite de tous les petits potins des environs dont il aime à se délecter.
La grande horloge comtoise de l’entrée sonne la demie de douze heures, et comme chaque jour à cette heure précise, il se rend à l’office pour s’y attabler en compagnie de Marinette. Cette dernière n’est pas peu fière lorsqu’elle dépose sur la grande table de bois le gros poulet rôti encore frémissant dans son plat et qui répand aussitôt dans la pièce l’alléchante odeur d’une cuisine simple mais toujours aussi appétissante.
Après s’être copieusement servi d’un morceau du volatile accompagné d’une grosse portion de gratin, il répond à Marinette qui l’interroge sur les personnes aperçues le matin au Bourg. Elle ne quitte quasiment jamais le domaine, et les récits des sorties de son petit Louis sont pour elle les rares traits d’union avec l’extérieur.
Elle profite de ce moment pour l’informer que la provision de pommes de terre arrive à sa fin et qu’il faudra peut-être en racheter quelques sacs avant la nouvelle récolte.
Confiant dans la gestion de sa cuisinière, il sait qu’il n’a pas besoin d’aller vérifier et après lui avoir demandé la quantité qui lui paraît nécessaire pour terminer la saison, il lui promet de téléphoner dès le lendemain à la ferme voisine pour s’en faire livrer.
Après avoir remercié et félicité Marinette pour cet excellent repas, il se saisit de sa tasse de café et rejoint son bureau pour y pousuivre sa lecture qui se conclura sans doute comme à son habitude, par un assoupissement dans les bras de son fauteuil.
Elle, elle doit d’abord débarrasser le couvert et faire la vaisselle avant de s’octroyer un petit moment de repos pour boire son café et commencer à feuilleter son magazine.
Mais aujourd’hui, ces tâches accomplies, assise sur le grand banc de bois, elle reste préoccupée par le petit incident du matin lors de sa présence dans la cave.
Comme elle est une personne qui n’aime pas rester dans le doute, elle décide de retourner dans la cave, munie cette fois d’une lampe de poche.
Sans faire le moindre bruit, une fois arrivée à la même place qu’au matin, elle reste un moment immobile prêtant l’oreille. Aucun bruit ne lui parvient, elle dirige le faisceau de la lampe vers la partie plongée dans l’obscurité, et avance doucement en évitant les nombreuses toiles d’araignées qui pendent du plafond. Elle marque plusieurs arrêts pour tendre l’oreille mais aucun son ne vient troubler le silence pesant de l’endroit.
La voûte est de moins en moins haute et elle est obligée de progresser en baissant la tête. En fait ce n’est pas la voûte qui s’abaisse, mais le sol qui s’élève car cette partie n’a pas été creusée, contrairement au début de la salle, et elle y retrouve ici la hauteur d’origine.
Elle est impressionnée par la profondeur des lieux, n’ayant jamais imaginé que l’endroit puisse être aussi vaste.
Peu à peu les côtés se rapprochent pour former une sorte de goulet qui se termine par une porte de bois. À en juger par son état elle n’a pas dû être manoeuvrée depuis longtemps et de plus la fermeture ne paraît pas bien solide.
Marinette retourne sur ses pas à la recherche d’un objet qui lui permettrait de faire céder la vieille ferraille.
Elle revient munie d’un gros galet et la serrure rouillée ne résiste pas longtemps sous les coups de la pierre. En s’aidant de son épaule elle peut alors pousser la porte et découvre un passage étroit et bas, ressemblant à une sorte de tunnel.





























