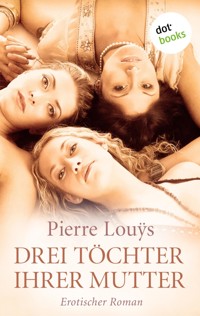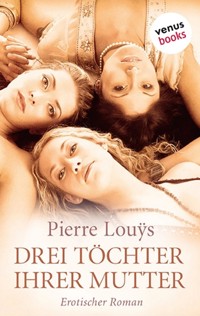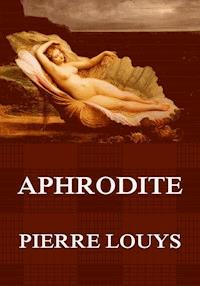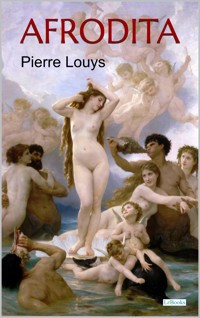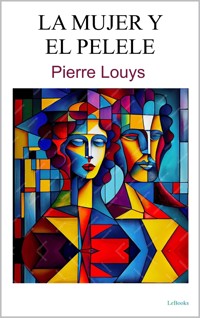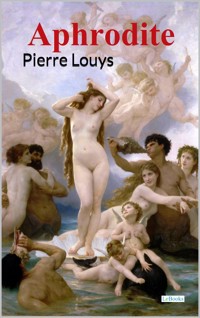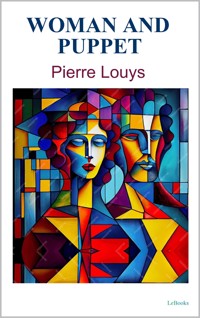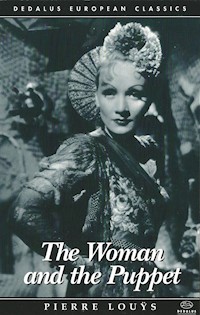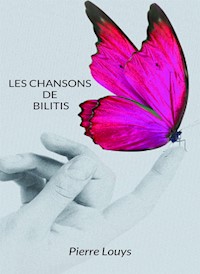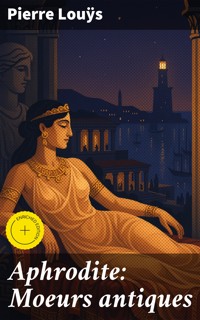
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Französisch
Dans "Aphrodite: Moeurs antiques", Pierre Louÿs nous plonge dans les profondeurs de la vie amoureuse et sensuelle de la Grèce antique, tout en se servant d'un style à la fois poétique et riche en détails. Le roman s'articule autour de l'histoire d'Aphrodite, déesse de l'amour, et de ses diverses incarnations dans les relations humaines, révélant une exploration des mœurs sexuelles au travers d'une prose luxuriante. Louÿs, par son talent, crée une atmosphère envoûtante, où légende et réalité se confondent, tout en se situant dans un contexte littéraire marqué par le symbolisme et un désir d'évasion face aux conventions bourgeoises du début du XXe siècle. Pierre Louÿs, écrivain et poète français né en 1870, a navigué entre le mouvement symboliste et le décadentisme, influencé par une érudition classique qui l'a conduit à écrire sur des thèmes souvent jugés tabous. Son appréciation pour les arts, son amour de la beauté, et sa fascination pour les mœurs anciennes se traduisent dans ce texte, qu'il a composé à la recherche d'une forme d'expression authentique, loin des normes conservatrices de son époque, en particulier dans la représentation de la sexualité féminine. Je recommande vivement "Aphrodite: Moeurs antiques" à tous ceux qui s'intéressent à la littérature érotique et à la culture antique. Ce livre offre non seulement une perspective unique sur l'amour et le désir dans une société ancienne, mais il incarne également une quête sublime de beauté littéraire, faisant de cette œuvre une lecture enrichissante tant sur le plan intellectuel qu'esthétique. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Aphrodite: Moeurs antiques
Table des matières
Introduction
Entre la beauté que l’art promet et la brûlure du désir, Aphrodite met en scène une lutte où chaque regard est une prise de pouvoir, dans une Alexandrie bruissante de fêtes, de temples et de marchés, où les corps deviennent des emblèmes, les objets des fétiches, et la gloire un théâtre périlleux, si bien que la frontière entre la création et la possession, entre l’offrande et la capture, vacille sans cesse, tandis qu’une ville-monde, polie par la mer et les voix, impose à ses habitants un rituel de splendeur qui révèle, sous l’or et le parfum, la vérité nerveuse des appétits et des ambitions.
Aphrodite: Mœurs antiques est un roman de Pierre Louÿs, publié en 1896, au cœur de la sensibilité fin-de-siècle qui associait esthétisme, érotisme et fascination pour l’Antiquité. L’action se déroule à Alexandrie, cité cosmopolite et fastueuse de l’époque hellénistique, décor idéal pour une exploration des relations entre art, luxe et pouvoir social. Louÿs, en romancier, y construit un univers fictionnel nourri de références classiques et de détails sensuels, sans se soumettre au roman historique strict. L’ouvrage appartient à une veine où la mise en scène du passé sert de miroir aux désirs modernes, et où l’exactitude documentaire cède la place à l’intensité plastique.
La prémisse tient à la rencontre d’un sculpteur recherché pour son génie formel et d’une courtisane dont la beauté gouverne les foules, figures que la ville porte au pinacle et oppose dans une joute d’orgueil, de curiosité et d’attrait. Autour d’eux, salons, jardins et sanctuaires composent des tableaux successifs où l’apparence commande, et où la réputation vaut monnaie. Le récit privilégie la sensation et la mise en scène: scènes qui s’ouvrent comme des bas-reliefs, déplacements mesurés, attentions au geste. On y lit moins une intrigue à ressorts qu’un enchaînement de situations calculées, où se jouent désir, prestige et définition de soi.
Le style de Louÿs se distingue par une prose ciselée, abondante en images tactiles et lumineuses, un lexique choisi qui convoque marbres, étoffes, parfums et métaux. Les phrases, amplement cadencées, installent une musicalité qui soutient la lenteur volontaire de la narration, tandis que l’énumération d’objets et l’attention au détail plastique créent une impression d’ekphrasis continue. L’ensemble offre une voix à la fois sensuelle et distante, qui décrit sans commenter, laissant au lecteur la charge d’inférer le poids moral des gestes. La lecture s’apparente à une traversée de salles, chaque scène résonnant comme un tableau dont la lumière glisse et se dérobe.
Par-delà son décor antique, le livre interroge la valeur de la beauté et son prix social, la circulation du désir comme langage, et la puissance des images dans la fabrication des destins. Art et morale s’y heurtent, le sacré frôle le profane, et le corps devient à la fois offrande, masque et instrument de négociation. La renommée, si visible à Alexandrie, y apparaît autant promesse d’élévation que menace de chute, selon la façon dont chacun en joue. En filigrane, la fiction mesure ce que l’on cède de soi pour atteindre l’œuvre ou l’extase, et ce que le regard d’autrui érige en loi.
Si Aphrodite conserve sa force aujourd’hui, c’est qu’il propose une méditation sur la mise en scène de soi, la valeur d’échange des images et la politique du regard, questions qui traversent encore nos sociétés saturées de représentations. Le roman rappelle combien la beauté peut être pouvoir et vulnérabilité, selon qui en dispose et qui en jouit, et comment la sphère publique reconfigure les désirs privés. Son recours à l’Antiquité n’est pas un refuge mais un dispositif critique: la distance du décor permet d’examiner, sans thèse, les tensions entre liberté, plaisir et contrainte sociale, que chaque lecteur réinvestit à l’aune du présent.
Lire Aphrodite, c’est accepter une immersion sensuelle et réglée, où l’œil, plus que l’action, conduit l’émotion, et où l’éclat des surfaces révèle une profondeur d’ambivalences. L’ouvrage demeure exemplaire d’une esthétique fin-de-siècle qui fait de la langue un objet sculptural et de l’Antiquité un laboratoire de modernité. Sans dévoiler les dénouements, on peut dire que la confrontation entre art, désir et prestige y trouve des formes à la fois troublantes et limpides. Ce roman invite à éprouver la séduction d’un monde construit comme un décor total et, en même temps, à questionner ce décor pour mesurer ce qu’il exige de nous.
Synopsis
Aphrodite: Mœurs antiques de Pierre Louÿs, publié en 1896, situe son intrigue à Alexandrie sous les Ptolémées, au cœur d’un monde polythéiste de luxe, de rites et de spectacles. L’ouvrage emprunte à l’érudition archéologique et à la sensibilité fin-de-siècle pour peindre une cité où l’art, le culte d’Aphrodite et les plaisirs règlent les comportements. Louÿs compose un récit romanesque qui tient à la fois du tableau de mœurs et de la méditation esthétique, en abordant la question du pouvoir des images et du désir. Dès les premières pages, la tension entre idéal artistique, sensualité et norme sociale organise la progression narrative.
Deux figures dominent: Démétrios, sculpteur renommé recherchant la forme parfaite, et Chrysis, courtisane célébrée, souveraine des regards et des fêtes. Démétrios, comblé d’honneurs, se lasse des commandes officielles et de la flatterie; son art aspire à saisir une beauté qui excède les règles. La rencontre avec Chrysis, dont la séduction est aussi une stratégie de prestige, met en jeu l’opposition entre l’œuvre idéale et le corps désiré. Leurs échanges, mêlés d’orgueil, de calcul et d’attirance, définissent une relation où chacun tente d’imposer son pouvoir symbolique, révélant les hiérarchies d’Alexandrie et l’ambivalence d’un monde voué à l’apparence.
Refusant de se donner sans preuves de rareté, Chrysis place l’accès à sa faveur sous le signe de l’épreuve. Elle exige de Démétrios des gages qui incarnent la force, la richesse ou la sacralité, autant de signes capables d’asseoir un renom. Pour le sculpteur, ces défis se heurtent à la loi, à la religion et à sa propre conception de l’art. À mesure qu’il s’y engage, le roman interroge ce qu’un créateur peut sacrifier pour approcher un modèle vivant qui semble concentrer l’essence d’Aphrodite. Le désir devient moteur d’actions irréversibles et de compromis moraux dont les conséquences se répercutent dans la cité.
Le décor alexandrin fonctionne comme un personnage: temples, gymnases, palais, ports, ateliers et jardins tissent un réseau où se croisent prêtres, magistrats, artistes et étrangers. Fêtes, processions et banquets donnent lieu à des descriptions où les gestes rituels voisinent avec la recherche du plaisir. Au centre, l’atelier de Démétrios et un projet sculptural dédié à une déesse cristallisent débats et rivalités. Le roman multiplie récits enchâssés, souvenirs et scènes d’atelier pour faire sentir l’écart entre l’idéalisation et l’expérience. Cette dramaturgie de la forme oppose la statue, promesse de durée, à l’éclat périssable de la beauté incarnée par Chrysis.
Les épreuves acceptées par Démétrios franchissent des limites que la société juge intangibles, introduisant le thème de la transgression publique. Des objets prisés pour leur valeur politique ou religieuse deviennent enjeux de possession et d’image. L’ombre de la dénonciation, des rivalités et d’une justice exemplaire s’étend, tandis que Chrysis mesure sa puissance à l’échelle de la ville. Louÿs met en scène la griserie du succès et sa fragilité, la fascination que suscitent le scandale, l’exploit et l’ornement. La progression dramatique resserre l’étau autour des protagonistes, tout en laissant ouvertes les motivations intimes et l’ambiguïté de leurs promesses.
À l’approche de cérémonies et de décisions qui engagent l’ordre civique, la tension se condense en un affrontement d’interprétations: l’art peut-il justifier l’acte, et la beauté racheter la faute? L’intrigue place les personnages face à des rituels où s’entrecroisent honneur, foi et renommée, sans lever prématurément le voile sur l’issue. Le symbole d’Aphrodite, entre amour, désir et forme parfaite, devient l’arène d’un jugement esthétique et moral. Démétrios et Chrysis portent chacun une logique cohérente, mais incompatible, dont la confrontation met en péril œuvres, statuts et alliances, tout en ménageant le dévoilement des dernières conséquences.
Par son style sensuel, ses tableaux précis et son érudition assumée, le roman s’inscrit dans le climat décadent de la fin du XIXe siècle et a contribué à la renommée de Louÿs. Au-delà de l’érotisme, il propose une réflexion durable sur l’autonomie de l’art, les masques sociaux et la puissance des images à l’ère des spectacles. La reconstitution d’Alexandrie fournit un laboratoire où mesurer le prix de la gloire et le rôle des mythes dans la conduite des vies. Cette exploration de la beauté et de la loi conserve sa résonance par la clarté de ses questions, sans dépendre d’un dévoilement final.
Contexte historique
Aphrodite: Mœurs antiques paraît en 1896, au cœur du Paris fin-de-siècle, dans un milieu littéraire marqué par le symbolisme et l’esthétisme. Pierre Louÿs, proche d’André Gide et d’Oscar Wilde, fréquente les « mardis » de Mallarmé où se forge un goût pour l’Antiquité stylisée et la sensualité raffinée. Les débats sur la morale, l’art et l’érotisme animent la presse et les salons, tandis que l’édition de luxe attire les bibliophiles. Le roman connaît un succès immédiat et parfois controversé. En choisissant l’Antiquité comme écran, Louÿs propose une réflexion moderne sur le désir et la beauté qui dialogue avec les tensions morales de son époque.
Le récit situe son action à Alexandrie à l’époque hellénistique, après la fondation de la ville par Alexandre le Grand en 331 av. J.-C. et sous la dynastie lagide. Capitale méditerranéenne, la cité concentre port, palais et quartiers spécialisés, et abrite des institutions savantes comme le Musée et la Bibliothèque, ainsi que des sanctuaires majeurs, dont le Sérapéum. La coexistence de populations grecques, égyptiennes et levantines favorise un syncrétisme religieux et artistique. En reconstituant ce cadre cosmopolite et lettré, Louÿs met en scène un monde où l’élégance urbaine et la culture érudite environnent l’intrigue, et éclairent les liens entre luxe, pouvoir et savoir.
Le pouvoir alexandrin repose sur la monarchie des Ptolémées, qui s’appuie sur une administration royale, des garnisons et des réseaux fiscaux couvrant le delta et la vallée du Nil. La ville, dotée d’institutions grecques comme le gymnase et des tribunaux pour les citoyens hellènes, cohabite avec des pratiques juridiques et religieuses égyptiennes. La hiérarchie sociale distingue colons macédoniens, notables grecs, artisans, esclaves et une foule de travailleurs liés au port. Les hétaïres, courtisanes de haut rang, participent à l’économie du prestige et du don. En plaçant une figure de courtisane et un sculpteur au centre, le roman interroge statut, patronage et art.
Le paysage religieux alexandrin conjugue cultes grecs et égyptiens. Sous les Ptolémées, le dieu Sérapis est promu comme divinité commune, aux côtés d’Isis, d’Aphrodite, de Dionysos et d’innombrables dieux locaux. Processions, fêtes dynastiques et banquets sacrés rythment la vie urbaine, tandis que les temples commandent statues, ex-voto et parures. La culture de la beauté corporelle, des parfums et des arts de la parure, attestée par l’archéologie et la poésie hellénistique, irrigue ce monde. En inscrivant l’intrigue dans cet environnement rituel et esthétique, Louÿs explore l’imbrication du sacré et du désir sans rompre avec les pratiques attestées, et interroge leurs usages sociaux.
Le XIXe siècle français nourrit une intense redécouverte de l’Antiquité. Le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion (1822), la fondation de l’École française d’Athènes (1846) et de l’Institut français d’archéologie orientale au Caire (1880) stimulent fouilles, catalogues et traductions. Les voyageurs, musées et revues popularisent l’Alexandrie gréco-égyptienne, tandis que philologues et historiens éditent la poésie hellénistique. Louÿs s’inscrit dans cet horizon érudit, déjà illustré par ses Chansons de Bilitis (1894), pastiche présenté comme traduction. En combinant savoir livresque et imaginaire sensuel, Aphrodite reflète une modernité fascinée par l’archéologie et interroge la frontière entre reconstruction savante, citation et stylisation littéraire.
Dans les arts visuels de la fin du XIXe siècle, l’Antiquité inspire à la fois académisme et symbolisme. Gérôme et Alma‑Tadema multiplient les scènes antiques minutieuses, tandis que Gustave Moreau réinvente les mythes dans un climat onirique. La vogue des éditions illustrées et l’essor de l’Art nouveau exaltent lignes sensuelles, motifs floraux et artefacts précieux. Les débats sur l’idéal du nu, l’atelier et la commande irriguent critiques et Salons. En plaçant un sculpteur au cœur de l’action, Louÿs met en résonance ces préoccupations esthétiques contemporaines et questionne la transformation du corps, de l’objet et de la beauté en valeurs d’échange.
Les lettres françaises sortent d’un demi‑siècle de polémiques morales. Les procès de 1857 contre Flaubert et Baudelaire, avec la condamnation partielle des Fleurs du Mal, ont durablement balisé la notion d’“outrage aux bonnes mœurs”. Sous la Troisième République, ligues de moralité, critiques et tribunaux surveillent encore l’érotisme littéraire, tandis que le procès d’Oscar Wilde (1895) nourrit en Europe un climat de suspicion envers l’esthétisme. Dans ce contexte, Aphrodite adopte l’écran antique, la précision érudite et une langue travaillée pour traiter du désir. Le roman reflète ainsi la tension entre liberté artistique et normes publiques qui structurent la fin du siècle.
À sa parution, l’ouvrage bénéficie d’un lectorat avide d’Antiquité sensuelle et de reconstitutions exotiques. La période est marquée par l’orientalisme européen et par l’expansion coloniale autour de la Méditerranée, qui nourrissent curiosité, fantasmes et collections. Rééditions et traductions se multiplient rapidement, assurant à Louÿs une notoriété durable. Cette réception éclaire la manière dont le roman mobilise un passé grec‑égyptien pour réfléchir aux désirs contemporains, à la marchandisation du corps et à l’autorité de l’art. En projetant sur Alexandrie les préoccupations de 1896, Aphrodite propose à la fois un miroir et une critique implicite des valeurs esthétiques et sociales fin‑de‑siècle.
Aphrodite: Moeurs antiques
PRÉFACE
Les ruines elles-mêmes du monde grec nous enseignent de quelle façon la vie, dans notre monde moderne, pourrait nous être rendue supportable.
Richard Wagner.
L'érudit Prodicos de Céos[1], qui florissait vers la fin du Ve siècle avant notre ère, est l'auteur du célèbre apologue que St Basile recommandait aux méditations chrétiennes, Héraclès entre la Vertu et la Volupté. Nous savons qu'Héraclès opta pour la première, ce qui lui permit d'accomplir un certain nombre de grands crimes, contre les Biches, les Amazones, les Pommes d'Or et les Géants.
Si Prodicos s'était borné là, il n'aurait écrit qu'une fable d'un symbolisme assez facile; mais il était bon philosophe, et son recueil de contes, les Heures, divisé en trois parties, présentait les vérités morales sous les divers aspects qu'elles comportent, selon les trois âges de la vie. Aux petits enfants, il se plaisait à proposer en exemple le choix austère d'Héraclès; sans doute aux jeunes gens il contait le choix voluptueux de Pâris; et j'imagine qu'aux hommes mûrs il disait à peu près ceci:
—Odysseus errait un jour à la chasse au pied des montagnes de Delphes, quand il rencontra sur sa route deux vierges qui se tenaient par la main. L'une avait des cheveux de violettes, des yeux transparents et des lèvres graves; elle lui dit: «Je suis Arêtê.» L'autre avait des paupières faibles, des mains délicates et des seins tendres; elle lui dit: «Je suis Tryphê.» Et tous deux reprirent: «Choisis entre nous.» Mais le subtil Odysseus répondit sagement: «Comment choisirais-je? Vous êtes inséparables. Les yeux qui vous ont vues passer l'une sans l'autre n'ont surpris qu'une ombre stérile. De même que la vertu sincère ne se prive pas des joies éternelles que la volupté lui apporte, de même la mollesse irait mal sans une certaine grandeur d'âme. Je vous suivrai toutes deux. Montrez-moi la route.»—Aussitôt qu'il eut achevé, les deux divisions se confondirent, et Odysseus connut qu'il avait parlé à la grande déesse Aphrodite.
* **
Le personnage féminin qui occupe la première place dans le roman qu'on va feuilleter est une courtisane antique; mais, que le lecteur se rassure: elle ne se convertira pas.
Elle ne sera aimée ni par un saint, ni par un prophète, ni par un dieu[1q]. Dans la littérature actuelle, c'est une originalité.
Courtisane, elle le sera avec la franchise, l'ardeur et aussi la fierté de tout être humain qui a vocation et qui tient dans la société une place librement choisie; elle aura l'ambition de s'élever au plus haut point; elle n'imaginera même pas que sa vie ait besoin d'excuse ou de mystère: ceci demande à être expliqué.
Jusqu'à ce jour, les écrivains modernes qui se sont adressés à un public moins prévenu que celui des jeunes filles et des jeunes normaliens ont usé d'un stratagème laborieux dont l'hypocrisie me déplaît: «J'ai peint la volupté telle qu'elle est, disent-ils, afin d'exalter la vertu.» En tête d'un roman dont l'intrigue se déroule à Alexandrie, je me refuse absolument à commettre cet anachronisme.
L'amour, avec toutes ses conséquences, était pour les Grecs le sentiment le plus vertueux et le plus fécond en grandeurs. Ils n'y attachèrent jamais les idées d'impudicité et d'immodestie que la tradition israélite a importées parmi nous avec la doctrine chrétienne. Hérodote (I, 10) nous dit très naturellement: «Chez quelques peuples barbares c'est un opprobre que de paraître nu.» Quand les Grecs ou les Latins voulaient outrager un homme qui fréquentait les filles de joie, ils l'appelaient μοῖχος ou mœchas, ce qui ne signifie pas autre chose qu'adultère. Un homme et une femme qui, sans être engagés d'aucun lien par ailleurs, s'unissaient, fût-ce en public et quelle que fût leur jeunesse, étaient considérés comme ne nuisant à personne et laissés en liberté.
On voit que la vie des anciens ne saurait être jugée d'après les idées morales qui nous viennent aujourd'hui de Genève.
Pour moi, j'ai écrit ce livre avec la simplicité qu'un Athénien aurait mis à la relation des mêmes aventures. Je souhaite qu'on le lise dans le même esprit.
A juger les Grecs anciens d'après les idées actuellement reçues, pas une seule traduction exacte de leurs plus grands écrivains ne pourrait être laissée aux mains d'un collégien de seconde. Si M. Mounet-Sully jouait son rôle d'Œdipe sans coupures, la police ferait suspendre la représentation. Si M. Leconte de Lisle n'avait pas expurgé Théocrite, par prudence, sa version eût été saisie le jour même de la mise en vente. On tient Aristophane pour exceptionnel? mais nous possédons des fragments importants de quatorze cent quarante comédies, dues à cent trente-deux autres poètes grecs dont quelques uns, tels qu'Alexis, Philétaire, Strattis, Euboule, Cratinos nous ont laissé d'admirables vers, et personne n'a encore osé traduire ce recueil impudique et charmant.
On cite toujours, en vue de défendre les mœurs grecques, l'enseignement de quelques philosophes qui blâmaient les plaisirs sexuels. Il y a là une confusion. Ces rares moralistes réprouvaient les excès de tous les sens indistinctement, sans qu'il y eût pour eux de différence entre la débauche du lit et celle de la table. Tel, aujourd'hui, qui commande impunément un dîner de six louis pour lui seul dans un restaurant de Paris eût été jugé par eux aussi coupable, et non pas moins, que tel autre qui donnerait en pleine rue un rendez-vous trop intime et qui pour ce fait serait condamné par les lois en vigueur à un an de prison.—D'ailleurs, ces philosophes austères étaient regardés généralement par la société antique comme des fous malades et dangereux: on les bafouait sur toutes les scènes; on les rouait de coups dans la rue; les tyrans les prenaient pour bouffons de leur cour et les citoyens libres les exilaient quand ils ne les jugeaient pas dignes de subir la peine capitale.
C'est donc par une supercherie consciente et volontaire que les éducateurs modernes, depuis la Renaissance jusqu'à l'heure actuelle, ont représenté la morale antique comme l'inspiratrice de leurs étroites vertus. Si cette morale fut grande, si elle mérite en effet d'être prise pour modèle et d'être obéie, c'est précisément parce que nulle n'a mieux su distinguer le juste de l'injuste selon un critérium de beauté, proclamer le droit qu'a tout homme de rechercher le bonheur individuel dans les limites où il est borné par le droit semblable d'autrui, et déclarer qu'il n'y a sous le soleil rien de plus sacré que l'amour physique, rien de plus beau que le corps humain.
Telle était la morale du peuple qui a bâti l'Acropole, et si j'ajoute qu'elle est restée celle de tous les grands esprits, je ne ferai que constater la valeur d'un lieu commun, tant il est prouvé que les intelligences supérieures d'artistes, d'écrivains, d'hommes de guerre ou d'hommes d'état n'ont jamais tenu pour illicite sa majestueuse tolérance. Aristote débute dans la vie en dissipant son patrimoine avec des femmes de débauche; Sapho donne son nom à un vice spécial; César est le mœchus calvus;—mais on ne voit pas non plus Racine se garder des filles de théâtre, ni Napoléon pratiquer l'abstinence. Les romans de Mirabeau, les vers grecs de Chénier, la correspondance de Diderot et les opuscules de Montesquieu égalent en hardiesse l'œuvre même de Catulle. Et, de tous les auteurs français, le plus austère, le plus saint, le plus laborieux, Buffon, veut-on savoir par quelle maxime il entendait conseiller les intrigues sentimentales: «Amour! pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres et le malheur de l'homme?—C'est qu'il n'y a dans cette passion que le physique qui soit bon, et que le moral n'en vaut rien.»
* **
D'où vient cela? et comment se fait-il qu'à travers le bouleversement des idées antiques la grande sensualité grecque soit restée comme un rayon sur les fronts les plus élevés?
C'est que la sensualité est la condition mystérieuse, mais nécessire et créatrice, du développement intellectuel. Ceux qui n'ont pas senti jusqu'à leur limite, soit pour les aimer, soit pour les maudire, les exigences de la chair, sont par là même incapables de comprendre toute l'étendue des exigences de l'esprit. De même que la beauté de l'âme illumine tout un visage, de même la virilité du corps féconde seule le cerveau. La pire insulte que Delacroix sût adresser à des hommes, celle qu'il jetait indistinctement aux railleurs de Rubens et aux détracteurs d'Ingres, c'était ce mot terrible: eunuques!
Mieux encore: il semble que le génie des peuples, comme celui des individus, soit d'être, avant tout, sensuel. Toutes les villes qui ont régné sur le monde, Babylone, Alexandrie, Athènes, Rome, Venise, Paris, ont été, par une loi générale, d'autant plus licencieuses qu'elles étaient plus puissantes, comme si leur dissolution était nécessaire à leur splendeur. Les cités où le législateur a prétendu implanter une vertu artificielle, étroite et improductive, se sont vues, dès le premier jour, condamnées à la mort totale. Il en fut ainsi de Lacédémone, qui, au milieu du plus prodigieux essor qui ait jamais élevé l'âme humaine, entre Corinthe et Alexandrie, entre Syracuse et Milet, ne nous a laissé ni un poète, ni un peintre, ni un philosophe, ni un historien, ni un savant, à peine le renom populaire d'une sorte de Bobillot qui se fit tuer avec trois cents hommes dans un défilé de montagnes sans même réussir à vaincre. Et c'est pour cela qu'après deux mille années, mesurant le néant de la vertu spartiate, nous pouvons, selon l'exhortation de Renan, «maudire le sol où fut cette maîtresse d'erreurs sombres, et l'insulter parce qu'elle n'est plus».
* **
Verrons-nous jamais revenir les jours d'Éphèse et de Cyrène? Hélas! le monde moderne succombe sous un envahissement de laideur. Les civilisations remontent vers le nord, entrent dans la brume, dans le froid, dans la boue. Quelle nuit! un peuple vêtu de noir circule dans les rues infectes. À quoi pense-t-il? on ne sait plus; mais nos vingt-cinq ans frissonnent d'être exilés chez des vieillards.
Du moins, qu'il soit permis à ceux qui regretteront pour jamais de n'avoir pas connu cette jeunesse enivrée de la terre, que nous appelons la vie antique, qu'il leur soit permis de revivre, par une illusion féconde, au temps où la nudité humaine, la forme la plus parfaite que nous puissions connaître et même concevoir puisque nous la croyons à l'image de Dieu, pouvait se dévoiler sous les traits d'une courtisane sacrée, devant les vingt mille pèlerins qui couvrirent les plages d'Éleusis; où l'amour le plus sensuel, le divin amour d'où nous sommes nés, était sans souillure, sans honte, sans péché; qu'il leur soit permis d'oublier dix-huit siècles barbares, hypocrites et laids, de remonter de la mare à la source, de revenir pieusement à la beauté originelle, de rebâtir le Grand Temple au son des flûtes enchantées et de consacrer avec enthousiasme aux sanctuaires de la vraie foi leurs cœurs toujours entraînés par l'immortelle Aphrodite.
Pierre Louÿs.
LIVRE PREMIER
ICHRYSIS
Couchée sur la poitrine, les coudes en avant, les jambes écartées et la joue dans la main, elle piquait de petits trous symétriques dans un oreiller de lin vert, avec une longue épingle d'or.
Depuis qu'elle s'était éveillée, deux heures après le milieu du jour, et toute lasse d'avoir trop dormi, elle était restée seule sur le lit en désordre, couverte seulement d'un côté par un vaste flot de cheveux.
Cette chevelure était éclatante et profonde, douce comme une fourrure, plus longue qu'une aile, souple, innombrable, animée, pleine de chaleur. Elle couvrait la moitié du dos, s'étendait sous le ventre nu, brillait encore auprès des genoux, en boucle épaisse et arrondie. La jeune femme était enroulée dans cette toison précieuse, dont les reflets mordorés étaient presque métalliques et l'avaient fait nommer Chrysis par les courtisanes d'Alexandrie.
Ce n'étaient pas les cheveux lisses des Syriaques de la cour, ni les cheveux teints des Asiatiques, ni les cheveux bruns et noirs des filles d'Égypte. C'étaient ceux d'une race aryenne, des Galiléennes d'au delà des sables.
Chrysis. Elle aimait ce nom-là. Les jeunes gens qui venaient la voir l'appelaient Chrysé comme Aphrodite, dans les vers qu'ils mettaient à sa porte, avec des guirlandes de roses, le matin. Elle ne croyait pas à Aphrodite, mais elle aimait qu'on lui comparât la déesse, et elle allait quelquefois au temple, pour lui donner, comme à une amie, des boîtes de parfums et des voiles bleus.
Elle était née sur les bords du lac de Génézareth, dans un pays d'ombre et de soleil, envahi par les lauriers roses. Sa mère allait attendre le soir, sur la route d'Iérouschalaïm, les voyageurs et les marchands, et se donnait à eux dans l'herbe, au milieu du silence champêtre. C'était une femme très aimée en Galilée. Les prêtres ne se détournaient pas de sa porte, car elle était charitable et pieuse; les agneaux du sacrifice étaient toujours payés par elle; la bénédiction de l'éternel s'étendait sur sa maison. Or, quand elle devint enceinte, comme sa grossesse était un scandale (car elle n'avait point de mari), un homme, qui était célèbre pour avoir le don de prophétie, dit qu'elle donnerait naissance à une fille qui porterait un jour autour de son cou «la richesse et la foi d'un peuple». Elle ne comprit pas bien comment cela se pourrait, mais elle nomma l'enfant Sarah, c'est-à-dire princesse, en hébreu. Et cela fit taire les médisances.
Chrysis avait toujours ignoré cela, le devin ayant dit à sa mère combien il est dangereux de révéler aux gens les prophéties dont ils sont l'objet. Elle ne savait rien de son avenir. C'est pourquoi elle y pensait souvent.
Elle se rappelait peu son enfance, et n'aimait pas à en parler. Le seul sentiment très net qui lui en fût resté, c'était l'effroi et l'ennui que lui causait chaque jour la surveillance anxieuse de sa mère qui, l'heure étant venue de sortir sur la route, l'enfermait seule dans leur chambre pour d'interminables heures. Elle se rappelait aussi la fenêtre ronde par où elle voyait les eaux du lac, les champs bleuâtres, le ciel transparent, l'air léger du pays de Gâlil. La maison était environnée de lins roses et de tamaris. Des câpriers épineux dressaient au hasard leurs têtes vertes sur la brume fine des graminées. Les petites filles se baignaient dans un ruisseau limpide où l'on trouvait des coquillages rouges sous des touffes de lauriers en fleurs; et il y avait des fleurs sur l'eau et des fleurs dans toute la prairie et de grands lys sur les montagnes.
Elle avait douze ans quand elle s'échappa pour suivre une troupe de jeunes cavaliers qui allaient à Tyr comme vendeurs d'ivoire et qu'elle aborda devant une citerne. Ils paraient des chevaux à longue queue avec des houppes bigarrées. Elle se rappelait bien comment ils l'enlevèrent, pâle de joie, sur leurs montures, et comment ils s'arrêtèrent une seconde fois pendant la nuit, une nuit si claire qu'on ne voyait pas une étoile.
L'entrée à Tyr, elle ne l'avait pas oubliée non plus: elle, en tête, sur les paniers d'un cheval de somme, se tenant du poing à la crinière, et laissant pendre orgueilleusement ses mollets nus, pour montrer aux femmes de la ville qu'elle avait du sang le long des jambes. Le soir même, on partait pour l'Égypte. Elle suivit les vendeurs d'ivoire jusqu'au marché d'Alexandrie.
Et c'était là, dans une petite maison blanche à terrasse et à colonnettes, qu'ils l'avaient laissée deux mois après, avec son miroir de bronze, des tapis, des coussins neufs, et une belle esclave hindoue qui savait coiffer les courtisanes. D'autres étaient venus le soir de leur départ, et d'autres le lendemain.