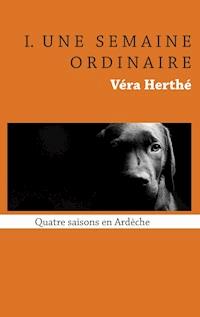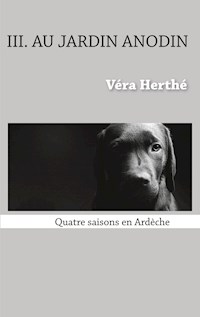
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Quatre saisons en Ardèche
- Sprache: Französisch
Une semaine de février en Ardèche. Alors que la France se relève lentement des attentats de Charlie, à Joyeuse, petit village ardéchois, les habitants vaquent à leurs quotidiens. Comme Claudie, qui taille, depuis quelques jours, les nombreux mûriers autour de sa maison, voisine du cimetière. un matin, elle assiste, depuis son jardin, à l'enterrement d'une vieille dame qu'elle n'a jamais rencontrée : Théodora Baswell, Anglaise loufoque et richissime. Bien vite le testament est ouvert et nomme, comme seule légataire, une nièce, Emmy. Seulement voilà, personne n'a jamais revu Emmy depuis qu'elle s'est enfuie de chez Théodora, un soir d'automne 1980. Il n'en faut pas plus pour que Justin, le journaliste singulier du village, ne se lance dans l'enquête, entraînant Claudie dans son sillage, sans se douter une seconde que ce qu'ils vont découvrir aura de lourdes conséquences pour la jeune femme. Et l'énorme chien qui rôde alentour, semble toujours leur montrer la piste à suivre...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Véra Herthé est un nom d’emprunt. Travaillant dans le médical, elle vit dans le Sud de la France avec son mari et ses trois filles. Ce roman est le troisième d’une série de quatre histoires (I. Une semaine ordinaire, II. La femme banale, III. Au jardin anodin, IV. Dans les bois communs), toutes situées dans le joli village de Joyeuse, en Ardèche, région chère à son cœur.
Cette histoire est une pure fiction, une totale création. Certains lieux existent, mais sont systématiquement transformés selon sa fantaisie. Les histoires qu’elle relate, et les personnages qu’elle dépeint, sont uniquement issus de son imagination, et même les références à certains faits historiques ou ayant existés, sont transformées selon son bon vouloir. Toute ressemblance possible avec la réalité serait le fruit du plus pur hasard. Et en aucun cas, l’auteur ne voudrait blesser quiconque croirait se reconnaître en ces lignes.
« L’absence ni le temps ne sont rien quand on aime »
Alfred de Musset
Sommaire
1-Le journal de Théa -1962
Chapitre I
2- Le journal de Théa -1962
Chapitre II
3- Le journal de Théa -1962
Chapitre III
4- Le journal de Théa -1968
Chapitre IV
5- Le journal de Théa -1969
Chapitre V
6- Le journal de Théa -1976
Chapitre VI
7- Le journal de Théa -1976
Chapitre VII
8- Le journal de Théa -1976
Chapitre VIII
9- Le journal de Théa- 1976
Chapitre IX
10- Le journal de Théa -1976
Chapitre X
11- Le journal de Thea -1976
Chapitre XI
12- Le journal de Théa –1976
Chapitre XII
13- Le journal de Théa –1976
Chapitre XIII
14- Le journal de Théa –1977
Chapitre XIV
15- Le journal de Théa –1977 à 1980
Chapitre XV
16- Le journal de Théa -1980
Chapitre XVI
17- Le journal de Théa –1982
Chapitre XVII
18- Le journal de Théa -1983
Chapitre XVIII
19- Le journal de Théa –1983
Chapitre XIX
20- Le journal de Théa -Septembre 1992
1-Le journal de Théa -1962
Je suis une vilaine fille. C’est ce que dit ma sœur.
« Méchante Babel ! »
Elle dit bien d’autres choses encore, trop souvent des horreurs.
Mais je n’écoute rien de ce que dit Babel.
Parfois, je ne m’en souviens pas bien non plus. Pourquoi s’énerve-t-elle contre moi aujourd’hui ?
Les voix m’embrouillent les idées ; elles répètent en boucle : « méchante Babel !»
La voilà qui me fixe de son regard noir, avec ses petits yeux porcins sous ses sourcils broussailleux. Ses prunelles sombres me lancent des éclairs menaçants tandis que sa bouche me crache du venin. Moi je reste muette, hypnotisée par son visage si laid de cochon.
« Oh ! Babel, tu ressembles à un cochon ! Mais ton venin est celui du serpent » susurrent les voix.
Babel bougonne sans cesse que je suis folle.
Mais je te connais ma sœur, tu ne vaux pas mieux que moi.
Avant, il y a longtemps, elle pouvait sourire. Même si déjà, les regards se détournaient de son visage disgracieux. Dorénavant, elle ne sourit jamais.
Nous sommes si différentes : je suis la belle, elle est la laide, je chante, elle ne sait pas même siffler, je peins quand elle n’a aucune notion artistique, je babille tandis qu’elle aboie, je charme alors qu’elle rebute.
Ce n’est qu’une grosse femme toujours penchée sur sa terre ou ses plantes sèches.
« Elle ne sait même pas se faire des amis ! » ricanent les voix.
Babel ne sait que biner, creuser, piocher et bêcher. Ses ongles sont noirs d’humus et de saletés. Je ne supporte pas qu’elle me touche. Mais la voilà qui s’approche avec ma piqûre, je dois me calmer.
Pauvre Babel si terrestre, si banale, si terne d’esprit. Quelle morne vie tu as, ma sœur.
Que deviendrais-je sans Babel ? Elle nous a sauvées du dragon, nous a trouvé un toit et une nouvelle vie. Elle me laisse à mes pinceaux et mes amis, me nourrit et me veille. Elle seule sait comment faire taire les voix. Une vie de riens pour elle, de plaisirs pour moi. Sans ma sœur, je n’aurais jamais pu survivre, je serais déjà au ciel. C’est Babel qui me sauve, Babel qui veille sur moi, Babel qui sait. Elle me connaît et moi, je la reconnais. Nous sommes inséparables, chacune à nos secrets.
Même les voix ne sont pas toujours mes amies.
Alors que deviendrais-je sans elle ? Probablement rien de bon.
Mais ce soir, je la déteste.
« Méchante Babel ! »
I
Un lundi matin de février 2015.
Claudie s’éveille doucement, recroquevillée sous sa couette épaisse. Dans le rayon de soleil blafard qui se faufile à la jointure des vieux volets en bois, elle observe, immobile, les poussières virevolter. Elle voudrait que ce moment dure à l’infini, elle, immobile, au chaud dans son cocon, et les minuscules particules en mouvement devant ses yeux. Elle voudrait pouvoir traîner au lit comme bon lui semble. Mais dans sa famille, on ne le faisait pas. Se sentant coupable, comme toujours, elle balance ses jambes hors la couette avec une belle énergie, et grimace brusquement tandis que tous ses muscles endoloris se rappellent à son bon souvenir : voilà quatre jours qu’elle taille les mûriers de son terrain, avec John. Orpheline depuis longtemps, elle a l’habitude de gérer seule les impondérables. Mais tailler chaque année les nombreux mûriers de son terrain est une première pour elle, le fermier, qui s’en occupait jusqu’à présent, ayant pris sa retraite à l’été. John s’est spontanément proposé et elle a accepté sans hésiter. Une coopération qu’elle n’aurait pas envisagée une seconde, quelques mois plus tôt.
Claudie secoue la tête tout en enfilant une robe de chambre épaisse. Il faut dire que John est un type singulier. Ils se sont croisés, pour la première fois, au cours de l’été 2014 et revus de temps en temps, pendant l’automne, dans le village. C’est un garçon au visage doux, avec des grands yeux bleus et des cheveux blonds mi-longs. Un corps nerveux et sec que l’on sent prompt à en découdre cache une personnalité secrète, difficile à déchiffrer, car l’homme n’est pas un bavard.
Débarqué un beau matin de son Angleterre natale, et sans domicile fixe, longtemps, il a erré alentour en squattant à droite et à gauche, en fuyant les gens et les embrouilles. Les rares amis de Claudie, Justin et David, l’ont tout de suite adopté dans leur groupe, remuant ciel et terre pour le loger aux premiers frimas ; la colocation avec Claudie a même été envisagée un temps, puisque la maison est vaste et qu’elle y vit seule, mais la jeune femme ne s’est pas engagée, méfiante et farouchement indépendante. En même temps, John semblait se ficher du froid à venir, il ne demandait rien. Et le hasard fait parfois bien les choses puisqu’une bonne âme lui a proposé un toit, en échange de quelques travaux sur place. John n’est pas bavard mais il est manuel ; il sait tout faire depuis qu’il traîne sur les routes. Maintenant, il vit et s’active sur son chantier, à quelques centaines de mètres de chez Claudie.
Mais depuis quatre jours, il a rejoint la jeune femme et, de bon cœur, s’est attaqué aux dix-neuf mûriers parsemés sur le terrain de Claudie, et cela sans rétribution. Elle se demande brusquement comment il faudra le remercier. Elle sait pertinemment qu’aucun objet ne lui sera utile, détaché qu’il est, des choses matérielles. Peut-être nécessite-t-il juste son amitié ?
Elle hausse les épaules et fonce sous la douche brûlante. Elle se sèche devant le grand miroir de sa chambre et observe ses cheveux bruns coupés courts, encadrant un visage qu’elle décrit comme banal et sans attrait, un visage rond, presque poupin avec ses yeux couleur noisette, un nez droit et une bouche mince. Puis, elle s’habille chaudement et se précipite jusqu’à la cuisine où elle lance sa bouilloire. Sa maison n’est pas très pratique, il y a de petits escaliers partout, les pièces se succèdent en enfilade, encombrées de vieux meubles et de bibelots, et les volets de bois sont lourds à manier matin et soir. Mais elle s’en fiche, elle s’y sent bien, c’est chez elle, depuis peu. Une grande maison de pierres noires, à Joyeuse, en Ardèche, située en face du cimetière, certainement trop grande pour elle, vieillotte et mal isolée mais si belle… Une maison héritée en 2010 d’une grand-tante originale. Un lieu devenu au fil du temps son refuge, comme une évidence.
Tandis que l’eau bout, la jeune femme relance le feu dans sa cheminée, tout en frissonnant, les cheveux encore humides. Elle souffle sur les braises de la veille et ajoute de petites bûches. Bientôt les flammes surgissent et, ravie de la chaleur bienvenue, elle jette dans l’âtre deux gros morceaux de chêne bien sec.
Au village le clocher sonne les neuf heures et la jeune femme rêvasse avec son thé devant ses fenêtres. D’ordinaire, la rue est vide mais pas ce matin : elle aperçoit trois employés municipaux munis de grandes pelles qui fument leurs clopes en soufflant dans leurs mains. Les portes du cimetière sont ouvertes : pas de doute, un enterrement s’annonce. Quelques voitures se garent avec difficulté près de la sienne sous les cyprès, et la jeune femme scrute les courageux, engoncés dans leurs manteaux sombres, qui se rassemblent en petits groupes malgré la froidure hivernale. Elle détaille les visages mais ne reconnaît personne.
Claudie hausse les épaules, dépose sa tasse dans l’évier et enfile son bonnet ainsi qu’une doudoune polaire sans manches mais très épaisse, avant de sortir sur la terrasse. Le froid la saisit immédiatement et elle sautille sur place avant de descendre au jardin. En chemin elle attrape le sécateur coupe branches resté hier sur le muret de la terrasse. Ce matin, John avait à faire, mais elle peut continuer seule : les branches coupées parsèment le terrain et à elle la corvée de les débiter en petites bûches, idéales pour allumer le feu dans sa cheminée. Courageusement, Claudie se met à l’ouvrage en commençant par le mûrier le long de la route.
Du coin de l’œil, elle suit l’agitation qui s’amplifie devant le cimetière. La cérémonie l’intrigue un peu, d’ordinaire il n’y a pas foule, mais aujourd’hui, les rangs des vivants ne cessent de grossir. La jeune femme se demande bien qui est le mort, personne n’a cru bon de l’informer. Probablement parce qu’elle ne connaît pas, personnellement, la victime. En coupant mécaniquement mais inexorablement les branchages, elle se fustige elle-même de sa curiosité morbide, et se rassure illico en se disant que son activité professionnelle de journaliste n’est pas étrangère à cette manie. Le temps tourne et la jeune femme ne le voit pas passer. Telles des métronomes, ses mains actionnent le sécateur et les branches coupées s’éparpillent peu à peu tout autour de ses pieds. Elle donne encore un coup et s’éponge le front car malgré le froid, elle sue comme un bœuf sous son bonnet.
« Je dois être trop sexy, vraiment ! » pense-t-elle en secouant la tête, un sourire aux lèvres.
Dans la rue, le brouhaha diffus des conversations s’est arrêté tandis que les cloches de l’église retentissent et qu’au loin, un cortège silencieux apparaît. L’image, même triste, est belle, de ce village médiéval ardéchois qui se dessine en arrièreplan. Les maisonnettes se volent la vedette, enchevêtrées les unes aux autres, regroupées autour du château de Joyeuse, transformé en mairie.
La maison de Claudie est la dernière de cette rue, bien tranquille à l’écart.
Le corbillard avance lentement, entouré de fidèles. Devant les grilles du cimetière, le véhicule stoppe délicatement et quatre hommes en retirent un cercueil immaculé. Surprise, la jeune femme écarquille les yeux. Ce blanc étincelant dans cette matinée grisâtre et froide lui coupe le souffle. Elle en déduit que, probablement, ce choix indique le décès d’une personne trop jeune pour quitter le monde. Elle se sent triste tout à coup, bêtement, ne pouvant s’empêcher de suivre la cérémonie, et se reprochant intérieurement d’être une indiscrète.
Entre temps, la foule a fondu dans le cimetière, disparaissant derrière les hauts murs. Claudie secoue la tête et se remet au travail : elle ramasse ses bûchettes fraîchement coupées pour les déposer sous la terrasse, là où elle a pris l’habitude de ranger son bois, à l’abri de la pluie. Mécaniquement, elle fait de nombreux allers-retours, les bras chargés et la tête vide.
Soudain les grandes portes du cimetière claquent bruyamment et la foule s’éparpille sous les cyprès. Les conversations se mélangent, les gens s’embrassent et se saluent tandis que le corbillard, vide, s’en va vers la grande route. Au loin les cloches sonnent midi. Claudie n’a pas vu l’heure tourner, toute à son activité.
Elle reconnaît deux figures locales dans l’attroupement : Lucie Chauvet et Madame Kleber, deux vieilles dames, qui sont les dernières à sortir, à petits pas comptés.
« La pauvre Lucie a de plus en plus de mal à marcher » remarque Claudie en suivant, inquiète, l’avancée chaotique du duo, aussi rapide qu’une limace. Les deux petites têtes chapeautées et leurs maigres bras s’agitent en mouvements brusques, au risque de totalement les déséquilibrer.
Claudie fronce les sourcils et lâche à haute voix :
-Mais…on dirait qu’elles s’engueulent ?
Alors, dans un mouvement impulsif, la voilà qui jette son tas de bûchettes, s’approche de son portillon, telle une sentinelle devant les deux mémés et les interpelle d’une voix forte :
-Bonjour mesdames !
Son intervention a stoppé net le duo. Claudie ne se démonte pas et reprend :
-Voulez-vous vous reposer un petit peu ? Ou alors je vous raccompagne en voiture ?
Les deux vieilles dames s’interrogent du regard.
C’est la plus ancienne, Lucie Chauvet, quatre-vingt-quinze ans au compteur, qui répond finalement :
-Oui ! Excellente idée, Claudie ! Je veux bien profiter de ta voiture ! Nous sommes restées une éternité debout dans le cimetière et mes vieilles jambes ne me portent plus ! En hiver je suis percluse de rhumatismes…
-Ne bougez pas, j’arrive !
La jeune femme fonce chercher ses clefs et embarque tout le monde, cahin-caha dans sa petite voiture.
Après quelques mètres, Claudie n’y tient plus et lance la question qui lui brûle les lèvres :
-Dites-moi, qui a-t-on enterré ce matin ? Il y avait beaucoup de monde…
-Oh oui ! répond Lucie. C’est une vieille amie à nous, mais je pense que tu ne la connaissais pas : Théodora Baswell. Ce nom te dit-il quelque chose ? -Non. Mais j’ai remarqué le cercueil, si blanc…je croyais à une jeune fille.
Lucie a un petit rire :
-Oh oui ! Une drôle d’idée, non ? Mais notre chère Théodora était coutumière des idées un peu loufoques, vois-tu, ajoute la vieille dame en agitant ses petits doigts gantés.
A ses côtés, Madame Kléber n’a toujours pas ouvert la bouche. Claudie ne la connaît pas bien, elle vit dans une petite maison, près du chantier de John, un quartier au pied des Grads, la colline qui barre l’horizon.
« On dirait qu’elle boude » se dit la jeune femme, conduisant avec le plus de douceur possible pour ménager les vieux os.
Dans son dos, en chuchotis pour sourds, la conversation entre les deux voyageuses reprend :
-Je vous assure qu’elle n’avait aucune famille à part sa sœur décédée il y a si longtemps, commence Madame Kléber. Pensez-donc, je visitais cette pauvre Théa toutes les semaines ! Et pour avoir discuté avec les infirmières, personne d’autre ne lui rendait visite !
-Et moi je vous dis que je les fréquentais dans le temps, bien avant votre venue, répond Lucie en croisant les bras. Et j’allais régulièrement faire l’école à leur pauvre nièce ! Ça je ne l’ai pas inventé tout de même !
-Mais depuis le temps, elle serait venue les voir quand même ! répond Madame Kléber.
-Elles se sont fâchées. Cette jeune fille est restée jusqu’à sa majorité puis elle est partie, comme une malpropre, sans un mot d’adieu ou de remerciement ! Je me souviens très bien de la fureur et de l’inquiétude d’Isabel ! Quant à Théodora…il a toujours été difficile de deviner ce qu’elle avait en tête.
-De toutes façons, nous le saurons bien assez tôt, répond Madame Kléber. Il va y avoir le testament. Mais je maintiens que Théa n’a jamais indiqué la moindre famille en dehors de sa sœur Isabel !
-C’est peut-être vrai. Mais vous n’avez connu QUE Théodora qui perdait la tête, et à un âge canonique en plus. Et moi je sais ce que j’ai vécu.
Dans son rétroviseur, Claudie observe Lucie, l’institutrice retraitée qu’elle aime beaucoup, mais ne voit rien de son visage caché sous son petit chapeau noir à voilette ; elle distingue juste ses lèvres pincées. Une expression peu courante sur le visage de la vieille dame au caractère d’ordinaire si bienveillant.
La voiture stoppe enfin devant chez Madame Kléber et la jeune femme ne coupe pas le moteur. Patiemment elle aide la frêle dame chapeautée à s’extirper de l’habitacle et la raccompagne jusqu’à sa porte. Un dernier signe de la main et Claudie s’engouffre à nouveau dans sa voiture. Elle opère un demi-tour sur la route et repart en sens inverse, toujours en douceur. Derrière elle, c’est le silence, encore.
Claudie s’inquiète :
-Ça a l’air de vous chagriner cette histoire de nièce, non ?
Les petits yeux fanés de Lucie la fixent dans le rétroviseur, puis un sourire apparaît sur le visage parcheminé.
-Ne t’inquiète pas ma brave Claudie, tu sais, à nos âges, un rien nous tourneboule. On craint tellement de perdre la tête ! Mais je suis certaine de ce que j’avance et je lui riverai son clou à cette Kléber-qui-sait-tout ! Tiens, je me souviens même du prénom de cette jeune fille : Emmy. Très anglais comme ses tantes, mais pas moyen de me rappeler son nom de famille, si je l’ai su un jour, d’ailleurs. Les sœurs Baswell n’étaient pas très loquaces. Enfin, nous verrons bien ce que le notaire découvrira.
-Elle était riche cette Théodora ? questionne Claudie.
-Oh ça oui ! Quand on voit sa maison on ne dirait pas, cela ne ressemble pas à un château. C’est une ruine maintenant, et puis elle a subi la forte crue de 1992. Elle est fermée depuis si longtemps… Tout doit être moisi.
La vieille dame semble réfléchir. Un ange passe.
Ses yeux se font soudain mélancoliques.
-C’était si joli cet endroit dans le temps ! Isabel y avait créé un jardin merveilleux, fleuri et bucolique, avec une mare, un puits, des statues, plein de recoins ombragés et emplis de fleurs de toutes les couleurs. J’adorais y flâner, même si elle ne le permettait pas toujours. Elle cultivait les herbes aromatiques de façon un peu anarchique, et craignait toujours qu’on les écrase. Elle en avait tellement…
Perdue dans ses souvenirs, Lucie se tait les yeux rêveurs, puis reprend :
-En réalité, concernant leur fortune, ma pauvre Claudie, j’avance des choses mais je n’en suis plus très sûre. Les soins de Théodora toutes ces années n’ont pas dû être gratuits. A l’époque où je les fréquentais, elles étaient riches, oui, mais maintenant, je ne sais pas. En revanche, l’histoire de la nièce, ça j’en suis certaine ! Je me souviens même des dates : fin des années soixante-dix ! J’y étais, tu comprends ?
Claudie sourit pour la rassurer. « C’est fou comme on devient grincheux pour de petites choses en vieillissant ».
-Nous voici arrivées ! annonce-t-elle en stoppant devant l’imposante masure.
Pleine de sollicitude, elle aide la vieille dame à sortir de son carrosse et l’accompagne avec douceur jusqu’au seuil. Les petites mains ridées tournent la clef dans la serrure puis serrent chaleureusement le bras de la jeune femme. Un dernier regard et la douce Lucie disparaît entre les murs épais de son royaume. Claudie se précipite dans sa voiture et manœuvre pour rentrer chez elle. Maintenant, dans l’air glacial, toute la sueur de sa matinée champêtre lui gèle le dos. Le soleil ne parvient pas à percer le ciel gris hivernal, une légère brume recouvre le paysage, renforçant encore l’impression de froid intense. Claudie ne rêve plus que d’une bonne douche bouillante et d’un bon repas.
Le fossoyeur donne un dernier coup d’œil à l’ensemble : avec ses collègues, ils ont bien remis la plaque de marbre noir en place et disposé dessus toutes les couronnes et compositions florales apportées tôt ce matin. Comme le cercueil qu’ils viennent de descendre dans la fosse, il n’y a que des fleurs blanches. Quelle drôle d’idée !
L’homme crache dans l’allée en rajustant sa casquette, se faisant la réflexion que celle qui dort maintenant pour l’éternité sous le marbre était véritablement barjot. Et la sœur enterrée il y a des années, aussi. Elles doivent être heureuses de se retrouver dans l’autre monde maintenant. En tous cas, elles ne manqueront à personne ces deux vieilles biques !
Quelques images du passé lui reviennent en mémoire, lorsqu’il y a vingt-trois ans, pour Isabel Baswell, déclarée noyée, emportée par la crue, il creusait cette tombe. Le cercueil était bien léger et pour cause, car il était vide. Malgré leurs recherches, le corps n’avait jamais été retrouvé. Un cercueil noir comme la suie pour la première ; tout l’inverse d’aujourd’hui.
En fronçant le nez, il revoit ce triste jour de 1992, le premier de son embauche, où la sœur survivante hurlait son désespoir, à genoux entre les tombes du cimetière, sans aucune retenue, les cheveux hirsutes, paralysant de gêne toute l’assistance de cet enterrement. Il avait fallu qu’il intervienne avec ses hommes pour la retenir de se jeter vivante dans la fosse. Même à quatre, ils avaient eu un mal fou à la maîtriser. Après ça, elle avait fini au Cantou, le seul endroit approprié pour les foldingues comme elle. Certaines familles sont maudites, elles accumulent le désespoir.
L’homme crache à nouveau devant la tombe et se détourne, en rajustant, encore une fois, sa casquette.
2- Le journal de Théa -1962
J’ai toujours eu des journaux secrets. Notre mère aussi noircissait des cahiers entiers. Nous n’avons pu les emporter avec nous lorsque nous sommes parties du manoir. Le dragon avait dû les brûler.
Babel dit que je suis comme maman. Elle aussi entendait les voix, même si nous n’avons pas beaucoup de souvenirs de notre mère. Elle vivait peu avec nous, surtout en voyage, avec papa, pour les affaires, dans de lointains pays. Nous restions au domaine, avec les domestiques. Nos parents nous manquaient beaucoup, petites. Jusqu’au jour fatal où ils ont totalement disparu de nos vies.
« Fichue automobile et fichue pluie ! »
Avec Babel, nous avons décidé que nous ne conduirions jamais. Nous devons rester ensemble, toujours.
Il nous reste les bons souvenirs, comme le répète Babel.
Je me souviens de Baswell Manor et de ses jardins si verts, si bien entretenus, avec la ferme à côté pour nous nourrir. J’ai peu de souvenir de père, trop accaparé par ses affaires, mais j’aime me rappeler maman. Elle était très gaie. Sa longue chevelure rousse brillait dans le matin. Elle aimait les longues robes fleuries mais pas les bijoux que papa lui offrait. Elle collectionnait les grands chapeaux et les châles à franges, qu’elle portait pour se promener sur la lande. Après nos leçons, elle trépignait de venir nous chercher, Babel et moi, nous prenait la main et nous courions comme des folles, les pieds nus dans la pelouse. Puis elle nous lisait des histoires rocambolesques, nous déguisait comme des princesses de contes enchantés et nous couvrait de ses bijoux.
Je me souviens d’une fois où papa avait piqué une colère épouvantable parce que je portais un diadème de rubis pour courir dans les bois. Papa hurlait tout rouge. J’étais très étonnée de le regarder s’agiter ainsi. Babel baissait les yeux, penaude, mais moi j’avais éclaté de rire avec maman. Bien entendu, on m’avait battue. C’est Babel qui m’avait consolée après. Je ne sais où avait disparu notre mère pendant ma correction, emportée brutalement par ce père bouillonnant. Et les bijoux avaient été mis au coffre. Je n’en avais perdu aucun pourtant !
Babel m’avait sermonnée aussi, un peu, de son petit air important.
« Quel air sérieux elle avait déjà petite ! »
Mais elle souriait quand nous faisions la ronde avec maman. Oui ! je me souviens : elle souriait ! Maman doit lui manquer, peut-être, depuis toutes ces années ?
Mais pas à moi.
Moi, les voix m’accompagnent, je n’ai besoin de personne.
Ou plutôt si, de Babel, mon esclave.
II
Un lundi après-midi de février 2015.
Claudie et John finissent leur corvée. Le jeune homme est venu la rejoindre après le repas. Prenant ensemble le thé, assis sur la terrasse, Claudie n’a pas pu s’empêcher de raconter comment elle avait raccompagné les deux voisines qui se chamaillaient dans sa voiture. Il n’a rien répondu, se contentant de hocher la tête puis, il a pris la direction du jardin et avec sa tronçonneuse s’est escrimé sur les derniers arbres. Sacré John ! Impossible de connaître ses pensées.
Claudie le rejoint et continue de débiter les branches coupées au sol et de transporter ses bûches. Mais il y en a tellement que John a proposé d’allumer un feu au milieu du pré pour brûler tout le surplus. Accroupi dans l’herbe, il essaie déjà de démarrer le brasier. Dans peu de temps, la nuit va tomber. Claudie se fait la remarque que, même sans dialogue, ils s’entendent bien. Sa méfiance naturelle semble s’éloigner peu à peu. Elle observe en douce son compagnon et approuve les gestes graciles qui l’animent. Une petite voix lui chuchote à l’oreille que peut-être il sera l’élu de son cœur, un jour, elle qui erre solitaire depuis si longtemps.
« Ma pauvre, tes hormones s’affolent pour un rien ! »
Elle secoue la tête comme pour chasser l’idée incongrue et se dépêche d’apporter le plus de branches possible près du foyer. Elle reprend ses aller-retour, chargée comme un mulet. L’humidité et la fraîcheur tombent avec l’obscurité mais la jeune femme ne les sent pas, transpirante dans sa doudoune. Elle a mal partout, surtout dans le dos et à l’arrière des jambes à force de se courber vers le sol, mais elle se sent bien, elle est heureuse, la tête vide.
Le portillon du jardin grince légèrement, annonçant une visite impromptue. Et la voix de stentor de Justin, leur ami, retentit :
-Salut à vous !
Claudie sourit en détaillant son vieux comparse débouler dans le pré : comme à son habitude, il avance vivement de sa démarche chaloupée, tandis qu’un grand imperméable se déploie autour de sa silhouette longiligne, ses longs cheveux emmêlés s’étirant derrière lui.
« On dirait vraiment un poulpe en mouvement au fond de l’eau, avec des tentacules qui s’agitent » se dit-elle.
Ravie de le voir, elle constate qu’ils ne s’étaient pas croisés depuis plusieurs semaines, chacun vaquant à ses occupations. Elle sait que s’ils se voyaient tous les jours, ils ne se supporteraient pas, mais aussi, que le voir régulièrement lui est essentiel. Journaliste, comme elle, Justin est le correspondant local des petits évènements du village. Il vivote, habitant encore chez son père, car sa grande passion, celle qui lui mange son temps et son argent, est une quête, celle des vieilles histoires criminelles du passé. Souvent il poursuit des chimères, mais parfois, parfois il tombe juste. Dès lors, plus rien ne l’arrête, tel un bulldozer il fonce selon ses pensées jusqu’à la découverte de la vérité. Claudie admire sa ténacité et son abnégation depuis les cinq années qu’ils se côtoient. Mais il sait aussi devenir terriblement irritant.
Le grand échalas se rapproche des deux autres et se laisse happer par la beauté des flammes qui s’élancent haut vers le ciel, le bruit du crépitement des branches encore vertes devenu assourdissant. Tous les trois restent ainsi plusieurs minutes tandis que l’obscurité se fait plus grande. Et dans un même élan, ils décident de rentrer au chaud.
Dans la cuisine, Justin se laisse tomber sur une chaise et étire ses longs bras vers le plafond en lançant :
-Alors, les mûriers, c’est la fin ?
-Oui, presque, répond Claudie. Et toi ? Quelles sont les nouvelles ?
-Bof, rien de précis. Tout le monde ne parle que de Charlie, de Nice et de menace islamique, au journal. Difficile de trouver d’autres sujets.
-Ben quand même Justin, c’est grave, c’est même monstrueux ! Pense à tous ces innocents morts qui n’ont rien demandé. Tout ça pour des idées rétrogrades ! Et ça fout la trouille, on ne sait jamais où ça va tomber : Paris, le Nigeria, la Libye. C’est mondial !
-Tu as raison, je ne nie pas. Aux dernières nouvelles, des tombes ont été profanées dans un cimetière juif du Bas-Rhin. On se demande ce qui se passe autour de nous… Je ne comprends pas le but.
John ne parle pas mais il acquiesce de la tête, vigoureusement. Ils sirotent leurs tisanes bouillantes, le regard dans le vague, silencieux, très sérieux.
-Ça ne m’arrange pas, tout ça, reprend Justin.
-Qu’est-ce que tu veux dire ? demande Claudie.
Il semble réfléchir, la tête entre ses mains aux doigts noueux et reprend à faible voix :
-Imagine une fourmilière bien organisée où chacun vaque à ses petites occupations. Bon. Tu sais bien que moi, je cherche la petite fourmi qui sort du lot, celle qui travaille quelque chose en marge de l’organisation générale. Tu comprends ce que je veux dire ?
Claudie fronce les sourcils mais en filigrane, elle devine ce qu’il essaie de lui expliquer. A de nombreuses occasions, Justin s’est penché sur de menus détails que personne ne voyait, pour creuser un peu derrière les faits et déterrer telle une taupe, les secrets de famille peu ragoûtants.
Justin reprend :
-Visualise la fourmilière bien organisée. Tu as une image d’ensemble plutôt régulière qui fait que le moindre mouvement hors cadre est bien visible. Enfin pour moi.
-T’as qu’à t’envoyer des fleurs, balance Claudie avec un sourire narquois.
-Mmmm. Bon maintenant il y a les attentats de Charlie, les prises d’otages, les tueries, les tombes profanées, etc. Peu à peu, la fourmilière s’affole, les fourmis s’agitent en tous sens et la belle cohésion, la belle organisation, volent en éclats ! s’écrie-t-il en jetant ses bras comme deux tentacules vers le plafond.
Claudie et John en ont sursauté dans un bel ensemble mais restent pendus aux lèvres du poulpe qui conclut :
-Et dans tout ce fatras, comment veux-tu voir le petit caillou qui finira dans une chaussure ?
La jeune femme est consternée :
-Mon pauvre Justin, tu es définitivement fou. Tes théories sont bien belles mais il y a des morts, innocents, c’est bien plus grave que tous tes mystères qui remontent à Mathusalem, dont tout le monde se fout et qui ne blessent que les vivants.
-Mmmm, je sais ce que tu penses, Mademoiselle Chance, mais un jour, tu verras que j’avais raison.
-Oh tu m’énerves avec ce surnom ridicule. Et en y réfléchissant bien, tu as tort ! Si je reste dans le schéma de ta fourmilière, je crois que toi, tu chasses plutôt la petite fourmi qui ne fait pas de vagues, justement, celle qui continue ses petites activités louches alors que tout le monde s’agite autour ; donc tu devrais la voir encore mieux aujourd’hui.
Le poulpe semble y réfléchir intensément et Claudie jubile de l’avoir ainsi mouché.
-Je vais prendre un douche, propose John en se levant.
Les deux autres le regardent partir sans lui répondre. -J’adore son français, commente Claudie en le suivant du regard.
-L’important c’est de se comprendre, répond Justin. Tu es bien vilaine ce soir de te moquer de lui.
-Non je ne suis pas vilaine. Je ne me moque pas ! J’aime bien l’entendre, je te jure. C’est mélodieux, voire exotique. Mais bon, toi, tu ne sais pas ce que je veux dire par là.
Elle se mord la lèvre, se demandant soudain si elle ne va pas trop loin avec ses insinuations. Il y a peu, Justin lui avait confié être diagnostiqué sociopathe, à l’abri de toute sensibilité. Et il l’avait émue en se livrant ainsi, même si, comme justifiant le diagnostic, il n’avait pas semblé en souffrir. Il n’empêche, elle craint l’avoir blessé avec ses insinuations acerbes. Elle n’ose le regarder, se demandant même brusquement, si elle aussi, ne souffre pas du même trouble. Sinon comment expliquer qu’à presque quarante ans, elle soit toujours célibataire et qu’aucun homme ne trouve grâce à ses yeux ?
« Ou alors je suis homo et je ne le sais même pas ! » Justin lui jette un œil interrogateur, puis il pose sa tasse et éclate de son grand rire silencieux. Tout son corps est agité de soubresauts tandis qu’il se tient les