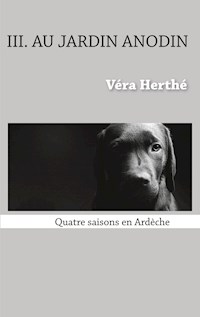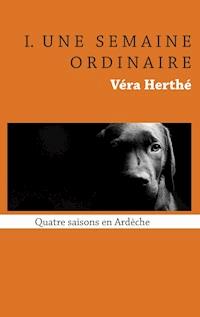
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Quatre saisons en Ardèche
- Sprache: Französisch
Une semaine de novembre, en Ardèche... Claudie revient sur les lieux de ses vacances d'enfant pour enterrer sa dernière parente, Alice, morte subitement ; une vieille femme secrète qu'elle a mal connu finalement. Dans la grande maison isolée qu'elle lui lègue, Claudie plonge dans les souvenirs de sa grand-tante, troublée peu à peu par ce qu'elle découvre... L'énorme chien noir qui rôde autour de la bâtisse et l'impression d'être sous la surveillance permanente des villageois, mettent les nerfs de la jeune femme à rude épreuve. C'est au-delà des apparences que Claudie découvrira alors la part de mystère dissimulée en ces lieux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Véra Herthé est un nom d’emprunt, pour cet auteur novice qui vit dans un petit village du sud de la France avec son mari et ses filles et travaille dans le médical.
Ce roman est le premier qu’elle publie et le premier d’une série de quatre histoires toutes situées dans cette région, si belle et chère à son cœur, qu’est l’Ardèche.
C’est une fiction, tirée de son imaginaire ; rien de ce qui est écrit dans ces pages et aucun de ses personnages n’existent ou ont existé. Une ressemblance possible serait le fruit du pur hasard…
« Il ne faut pas dire toute la vérité,
mais il ne faut dire que la vérité »
Jules Renard
Sommaire
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
I
Lundi, dans l’après-midi
Claudie shoote dans la bogue tombée à ses pieds. Celle-ci décolle du sol comme une fusée pour aller s’écraser cinq mètres plus loin et s’ouvrir, libérant ainsi trois minuscules châtaignes luisantes.
L’Ardèche, l’autre pays de la châtaigne.
« Mais pourquoi suis-je là ? » se demande-t-elle soudain.
Comme un besoin subit, elle avait pris sa voiture en début d’après-midi, cheminant sur les routes sinueuses de ses souvenirs, et elle avait rejoint cette forêt de châtaigniers, avant la Croix de Bauzon. Elle était seule, encore et toujours, elle en avait pris l’habitude. Mais ce jour-là, elle n’en pouvait plus de se retrouver face à elle-même.
Elle avançait sur le chemin de randonnée sillonnant la forêt et seuls ses pas crissaient dans le silence environnant. Elle marchait, comme si elle fuyait ses pensées.
Revenue sur les traces de son enfance par obligation, depuis deux jours, elle avançait dans ses souvenirs, sa façon à elle d’entamer le deuil de sa grand-tante Alice, morte soudainement voilà quelques jours. Une fois les formalités remplies et la cérémonie passée, elle avait commencé à ranger la maison, triant des papiers, des vêtements, encore du linge et les souvenirs accumulés par une petite vieille solitaire et sèche. Non, pas si sèche que ça finalement, juste un peu… indépendante.
Claudie lève les yeux au ciel ; il fait encore bon en ce mois de novembre et les arbres ont revêtu leur plumage de feuilles d’automne aux couleurs criardes, formant comme une haute voûte au-dessus d’elle. Partout, la nature n’est qu’oranges et jaunes, comme une multitude de touches impressionnistes miroitantes dans les rayons du soleil. Elle respire la douce odeur du feuillage humide, ses pas provoquant un bruissement continu, et aperçoit de part et d’autre quelques têtes de mycocètes. Bien entendu, que des mauvais !
« Le jour où je tomberai sur de bons champignons, les poules auront des dents… Mademoiselle Chance, c’est comme cela que m’appelaient Christine et Christelle, ouais, mademoiselle Chance… »
Les souvenirs arrivent par grappes, sans cohérence.
Elle se revoit vers cinq ans, découvrant pour la première fois sa grand-tante et son grand-oncle, les yeux écarquillés de surprise et de curiosité ; son premier séjour chez eux quelques mois après, rythmé par les corvées de la maison, les courses, les jeux de cartes, les histoires lues, la télévision en fin de journée et les bonnes odeurs de tarte ou de clafoutis s’échappant du four. Quelques promenades aussi, le dimanche, dans les environs : ils prenaient la voiture et tous les trois s’en allaient dans les forêts de châtaigniers, de sapins ou vers le lac d’Issarlès, pour marcher en silence quelques heures. L’année d’après, le grand oncle n’était plus, mais Alice avait quand même tenu à ce que la petite Claudie vienne passer l’été, puis les suivants, tous au même rythme. Quand l’enfant sut nager, sa grand-tante l’emmena alors à la rivière de l’autre côté du village, les après-midis de beau temps. La maison étant un peu à l’écart, face au cimetière, sans voisins proches, il fallait marcher environ un Km avant de rejoindre le centre du village grouillant de touristes l’été, et encore un Km pour atteindre la plage de galets. La vieille dame s’isolait loin des foules, à l’ombre des platanes avec son siège pliant, son chapeau de paille, sa robe légère à fleurs et son livre. La petite Claudie allait alors barboter à son aise dans la zone peu profonde de la retenue d’eau, se découvrait des amies, Christine et Christelle, et courait pêcher les têtards. Vers dix-neuf heure on rangeait les affaires, les serviettes, et toujours à pied on repartait en sens inverse. Une douche, un petit repas en tête à tête et la petite fille allait se coucher heureuse, le cerveau plein de rêves et de jeux, de promesses pour le lendemain. Les jours se suivaient et se ressemblaient, selon un calendrier bien établi et précis, mais sans lassitude.
Claudie ne se souvient pas d’un quelconque conflit avec la vieille Alice durant toutes ces années. Elle se creuse les méninges mais non, jamais un mot plus haut que l’autre. Il faut dire qu’enfant, Claudie n’était pas une violente, non, plutôt une enfant calme et paisible, plongée dans les bouquins et silencieuse, une enfant dans l’observation et la retenue. C’était ainsi à la maison : « occupe-toi donc seule et surtout ne fais pas de bruit ! ». Il fallait que ses parents puissent l’oublier totalement, le jour et la nuit. Sans frères et sœurs, sans cousins et cousines, elle apprit à aimer cette distance, le silence et la réflexion. Une des raisons aussi qui explique sa bonne entente avec Alice. L’une et l’autre tellement semblables par tous ces côtés. Et puis quelque part, Claudie a toujours eu un peu peur de la vieille dame. Elle ne sait pas pourquoi, un regard peut-être ?
Voilà Claudie vers dix ans, ses cheveux foncés coupés à la Mireille Mathieu, un peu boulotte, traînant derrière ses deux amies du même âge, Christine et Christelle, sur la place du petit village ardéchois. Depuis leurs huit ans, elles se retrouvaient chaque été pendant les grandes vacances, au gré des congés pris par leurs parents. Claudie, elle, venait les deux mois car ses parents travaillant, il n’y avait guère que la tante de son père pour accepter de la garder si longtemps, ses grands-parents ayant tous disparu trop tôt. Et la petite fille était heureuse de ces séjours, car la vieille dame lui fichait, il faut le dire, une paix royale : si elle restait intransigeante sur l’heure des repas et la présence de la fillette à ces occasions, elle lui laissait toute liberté le reste de la journée, sachant bien que de toutes façons, cette petite trop raisonnable resterait proche de ses amies, elles-mêmes chaperonnées de près par leurs familles. Claudie indiquait donc à sa tante son programme du jour et partait tranquillement rejoindre ses amies. Elles se surnommaient « les trois C », avec en plus pour elle, le surnom de Mademoiselle Chance.
Le matin les gamines faisaient les boutiques, bijouteries, papeteries, artisanat local, touchant tout et achetant peu ; l’après-midi elles se donnaient rendez-vous pour aller à la rivière. Là, sur la plage de sable grossier, entre les grands rochers à fleur d’eau, elles retrouvaient d’autres enfants de vacanciers, d’abord des fillettes de leur âge, puis plus tard les premiers garçons, les premiers baisers,… les premiers émois.
Ces jours heureux avaient pris fin brutalement alors que Claudie avait seize ans, en 1992. Cette année-là, la grand-tante avait été malade et hospitalisée. La jeune Claudie avait dû rester à Montpellier, chez ses parents, à s’ennuyer ferme. Les années suivantes, elle ne retourna pas non plus en Ardèche : on avait peur qu’elle fatigue la vieille dame. Claudie rêvait de paysages vallonnés et de forêts, tout l’été, dans la petite cour parentale.
Puis vint l’année 1995. A dix-neuf ans elle devenait orpheline subitement, ses parents emportés par un accident de la route. Et la grand-tante, seule rescapée d’une famille réduite au fil des ans, vint aider plusieurs mois la jeune fille à surmonter l’épreuve et s’organiser. Mais très vite la cohabitation se détériora, poussant la vieille femme vers le départ, au grand soulagement de la jeune fille. Depuis ce temps, elle appelait régulièrement Alice, mais ne venait plus que rarement. Manque de temps, manque d’envie…
Aujourd’hui, petite et trapue, Claudie a perdu son embonpoint. Elle porte encore ses cheveux bruns au carré avec une frange, mais plus longs, pour pouvoir les attacher quand même. Ils encadrent un petit visage rond et sérieux, des yeux noisette et un nez un peu busqué. Claudie ne distingue rien d’extraordinaire dans son reflet à travers le miroir, pas de signe particulier ni de beauté étrange. Un physique banal, passe partout, de ceux qu’on ne remarque pas, de ceux que l’on oublie facilement.
Elle revoit sa grand-tante, si blonde, le regard si bleu, une beauté froide. Elle avait dû être belle dans sa jeunesse ; avec les ans son petit visage fripé conservait malgré tout une certaine noblesse.
Elle regrette maintenant de n’avoir pas accordé plus de temps à la vieille dame, de n’avoir pas discuté avec elle, de ne pas l’avoir forcée à raconter son histoire, car elle en sait si peu… Alice ne se racontait pas. Elle choisissait ses mots avant de parler, réfléchissait avant chacune de ses réponses. Beaucoup de silences entre les mots. Même les autres vieilles venues à l’enterrement n’avaient pas l’air de bien la connaître : « une originale votre tante, une secrète, un ermite moderne… ».
C’est vrai qu’au travers de tous ses souvenirs d’été, Claudie se voit toujours seule invitée dans cette maison. Pas d’amis sur la terrasse, pas de coups de téléphone, pas de visites impromptues, sauf celles le mercredi matin de la femme de ménage qu’elle apercevait à peine, le mercredi étant jour de marché. Même au village, pour les courses, la vieille dame saluait ses congénères d’un signe de tête discret et continuait son chemin.
Elles ne furent pas nombreuses de fait, à l’enterrement…
On récolte toujours ce que l’on sème.
Madame Pichon avait contacté le journal dans lequel Claudie finissait sa journée le vendredi précédent. Après s’être présentée comme la dame de compagnie de sa tante et sa femme de ménage, elle lui avait annoncé avoir commencé les formalités exigées.
‒ Les quoi ? avait demandé Claudie abruptement.
‒ Les formalités, mademoiselle. La gendarmerie a demandé une enquête parce que comme votre tante est morte des suites d’une chute dans son petit escalier, en pleine nuit, et ben dans ces cas-là, ils ont dû faire une enquête, avec l’autopsie et tout. Je vous ai laissé un message sur votre répondeur, vous ne l’avez pas eu ?
‒ Ah non. Mais je ne pense jamais à l’écouter…
‒ C’est bien ce que j’ai pensé, reprend madame Pichon, la voix tremblotante. Voilà pourquoi je vous appelle au travail. Vous vous souvenez de moi ?
Claudie mouline, elle aperçoit une image floue.
‒ J’ai trouvé votre grand-tante, madame Coliéni, morte dans son salon ce mercredi midi, je lui portais des courses et heureusement que j’ai les clefs ! Elle a dû tomber dans son petit escalier pendant la nuit. Vous comprenez, elle était toute froide... Alors j’ai appelé mon mari et les gendarmes. Le docteur a dit qu’elle avait fait une crise cardiaque, mais comme elle n’était pas dans son lit, les gendarmes ont ouvert une enquête.
L’histoire est un peu chaotique mais Claudie comble les blancs, attentive et silencieuse.
‒ Maintenant que l’enquête est finie, ils vont rendre le corps. Mais votre grand-tante m’a tout indiqué depuis longtemps et surtout qu’il fallait le faire vite. Ce matin j’ai donc téléphoné aux pompes funèbres et la cérémonie pourrait avoir lieu ce dimanche matin. Je pense que c’est normal que je vous prévienne, même si votre tante ne tenait pas à ce que je le fasse ; elle voulait quelque chose de simple et de rapide, avec personne.
Ouais une vraie originale la tante, qui ne tenait même pas à ce que le dernier membre de sa famille soit présent pour ses obsèques.
Mais madame Pichon avait ajouté que le notaire du village se tenait déjà prêt à la recevoir pour la succession. Une affaire rudement menée !
Claudie, encore sonnée par la nouvelle, avait prévenu sans tarder son patron de son départ, était rentrée chez elle préparer une valisette – que mettre dedans ? - s’était couchée pleine de souvenirs, avait mal dormi et au petit matin du samedi, elle était partie dans sa voiture direction l’Ardèche.
Une heure trente de route. Assez peu au final. Alors pourquoi ne pas être venue plus souvent ? Claudie se mord la lèvre, pleine de rancœur envers elle-même. Elle n’a pas d’explication valable. Juste un « parce que »…
La bonne madame Pichon l’avait accueillie à son arrivée devant la maison, l’avait délestée de sa valise et de son manteau, et menée tout droit devant la porte de la chambre du fond, la chambre de sa grand-tante : pas de corps dans la pièce, il restait à la morgue après l’autopsie.
Du plus loin qu’elle remonte dans ses souvenirs, aucun n’a cours dans cette pièce. C’était la chambre d’Alice, un espace protégé, comme interdit. Bien sûr, la vieille dame ne lui avait jamais formellement interdit d’y entrer, mais qu’y aurait-elle fait ? La porte toujours fermée, même sans clefs, laissait un message clair. Et la petite enfant calme l’avait compris très vite. De toutes façons, les rares fois où elle avait pu entrapercevoir l’intérieur de la chambre, si la porte était restée ouverte par exemple, elle n’avait rien vu de remarquable à ses yeux. Elle préférait sa propre chambre et surtout le jardin.
Comme coupable d’un sacrilège, Claudie avait tourné la poignée et poussé la porte.
Le lit avait été changé et fait mais tout était resté en l’état : les vieux bas de contention reprisés sur le fauteuil près de la fenêtre, la robe de chambre en pilou pliée en bout de lit et les chaussons bien alignés sur la descente. La moquette marron, les rideaux de velours vert, une pièce sombre. Un fauteuil de satin jaune, une armoire, une commode et un lit en noyer dont la tête énorme et sculptée d’aigles, écrasait toute la pièce de sa présence.
Les volets clos, les ombres ondulaient au gré des petites bougies placées sur la commode. La jeune femme laissa son regard errer, glissant sur les meubles massifs. Elle ouvrit l’armoire, caressa les robes encore pendues et parfumées de lessive. Dans le tiroir du petit chevet, une vieille montre qui fonctionnait encore, un paquet de kleenex et des pastilles Vichy. Au fond, un petit écrin qu’elle ouvrit pour y trouver à l’intérieur, une vieille clef, drôle d’idée. Sous le tiroir, le petit pot de chambre en métal bleuté, pour les envies subites de la nuit.
La main de Claudie caressa la courtepointe verte à fleurs jaunes qui couvrait le lit. Elle marcha vers la commode, ouvrit les tiroirs, mais sans chercher quoi que ce soit, juste pour voir : des draps, des chemises de nuit bien pliées et des sous-vêtements de vieille dame, le tout dans les effluves des petits sachets de lavande.
Claudie muette laissa son esprit vagabonder. Elle revoyait le petit visage doux et délicatement parfumé de violette de sa grand-tante Alice, ses yeux bleus malicieux ou vagues, son regard souvent perdu dans le lointain, et sa petite bouche rose, avare de baisers et de mots. Un visage adorable mais une retenue permanente ; l’absence de tendresse derrière le masque de douceur. Et pourtant Claudie ne lui en voulait pas. Dans sa famille on était comme ça, sec comme un coup de trique, de génération en génération, comme malhabile avec les sentiments humains. Une famille de fantômes, de masques, d’icebergs.
Claudie reprenait la succession avec beaucoup d’habileté.
Un jour un collègue lui avait même jeté à la figure « tu es une handicapée des sentiments », tout ça parce qu’elle refusait ses invitations à sortir. Oui, elle restait dans sa lignée, mais pas fière.
Après réflexion, ce manque de chaleur lui avait permis de se forger une carapace contre les autres, les déceptions, les désirs impossibles… Mais le prix à payer restait élevé : solitude. Il fallait gérer cette solitude du mieux possible ; ses parents qui ne comptaient que peu d’amis l’avaient fait, mais à deux ; sa grand-tante avait finalement, apparemment eu recours à une amie, madame Pichon.
Mais elle, Claudie ?
Lui restaient ses collègues de travail, mais ils ne se voyaient pas hors du boulot. Ses week-ends, elle les passait à se promener ou à bosser chez elle.
Lorsque l’heure de midi avait sonné à l’horloge de la maison, madame Pichon avait convié la jeune femme à se sustenter un peu dans la salle à manger. Claudie n’avait pas faim, elle préférait rester encore un peu dans la chambre. Et là, dans la pénombre, installée dans le fauteuil, elle avait pleinement réalisé qu’elle était la dernière de la famille pour de bon. Il ne restait plus qu’elle, à part peut-être de lointains cousins du troisième degré, inconnus. Elle avait retrouvé les meubles de son enfance, les chandeliers à sept branches illuminés de flammes, et compris les miroirs recouverts de draps. Sa tante avait, par amour, adopté la religion juive, mais elle ne le montrait que rarement, à petites touches ou quand cela l’arrangeait. En réalité elle n’était d’aucune confession, sauf la sienne propre, un mélange de toutes et d’aucune. Probablement, madame Pichon qui avait cru bien faire en respectant les consignes de base lors d’un deuil pseudo-juif.
Elle visualisa sa tante, lui parla dans sa tête, se reprocha beaucoup de choses et sortit faire un tour dans le jardin où le soleil brillait de mille feux, la tête enfin vide.
Alerté de son arrivée, le notaire du village se présenta tôt dans l’après-midi. Il était chauve mais arborait une moustache énorme, plutôt poivre que sel. Derrière ses lunettes sans monture on voyait s’agiter ses petits yeux chafouins. A mots pesés il expliqua à Claudie ce qu’elle devinait déjà, à savoir qu’elle était l’unique héritière de sa tante mais que les biens financiers ne se montaient pas à grand-chose, une fois les frais de succession retirés.
‒ Il vous reste toujours cette maison et ce terrain. La maison se délabre un peu plus chaque année car le terrain argileux ne la soutient pas vraiment, ce qui explique les lézardes que vous voyez sur la plupart des murs intérieurs et il faudrait engager des travaux colossaux pour la réparer ou l’entretenir ; mais il y a un grand terrain et je peux vous trouver facilement un acquéreur, je pense.
Cause toujours mon coco, se disait Claudie, je te vois venir. Les lézardes existent depuis belle lurette.
‒ Merci, fut le seul mot qu’elle prononça en signant les formulaires adéquats. Elle ne raccompagna même pas l’homme de loi qui masqua sa dignité froissée derrière son énorme favori, devenu tout à coup hirsute.
Le dimanche, madame Pichon, absolument indispensable, accompagna Claudie jusqu’à l’entreprise de pompes funèbres où le petit corps raccommodé d’Alice attendait dans un cercueil des plus simples. Ce dernier avait été fermé, masquant aux yeux curieux les premiers dégâts de la décomposition. Claudie ne put ainsi pas jeter un dernier regard à la morte. En un sens, cela l’arrangeait, elle avait déjà eu son quota de masques mortuaires.
Seules dans la pièce calme, les deux femmes n’osaient croiser leurs regards, comme les deux étrangères qu’elles étaient. Madame Pichon avait les lèvres qui tremblaient comme si elle réfrénait les mots qui voulaient en sortir ; de minutes en minutes elle essuyait les larmes qui perlaient au coin de ses yeux.
Claudie, le regard sec, le cerveau vide, se demandait au final quel rôle elle jouait dans cette scène dont elle se sentait si étrangère. Aucune pensée sensée ne lui venait à l’esprit ; et en même temps elle culpabilisait de ne pas se sentir plus émue. Elle se laissait bercer par la musique suave déversée en sourdine.
Au bout d’une heure de gêne palpable, elles sortirent à la suite des employés qui portaient le cercueil léger jusqu’au véhicule de l’entreprise. Une camionnette grise, vide de fleurs et de couronnes, comme l’avait souhaité la défunte. Claudie prit le volant de sa voiture avec, à ses côtés, sa nouvelle compagne, et toujours dans le silence, suivit le fourgon, seuls véhicules du cortège, jusqu’au cimetière en face de « sa » maison. Là devant le grand portail, quelques mamettes attendaient vêtues de noir. Comme des oisillons elles se groupèrent autour de madame Pichon en chuchotant, et à la suite de Claudie, suivirent les porteurs jusqu’au caveau familial : Alice rejoignait sa dernière demeure, et du même coup sa sœur, son beau-frère et son mari. Tout autour, les tombes croulaient sous les fleurs et les jardinières. Des chrysanthèmes surtout, de toutes les couleurs, énormes. Malgré tout, quelqu’un avait fait les choses comme il faut : sur le marbre moucheté de gris, un énorme bouquet anonyme de lys blancs avait été posé sans vase.
Pas d’église ni de rabbin, comme l’avait exigé sa grand-tante : un dernier au revoir et la plaque du caveau que l’on scelle à jamais. Le serrement de mains molles et les yeux que l’on fuit du regard, les mamettes étaient reparties, laissant les deux silhouettes féminines dans la brume.
Après le départ des pompes funèbres, Claudie avait suivi madame Pichon jusqu’à la maison, s’était laissée servir un frugal repas par celle-ci, l’avait rassurée que tout irait bien et enfin remerciée pour tout. Puis elle s’était claquemurée dans la maison, et comme dans un songe, s’était allongée sur le lit de l’autre chambre, la sienne, pour finalement s’endormir comme une souche, et ne se réveiller qu’au petit matin du lendemain.
Claudie secoue la tête, comme pour chasser ses pensées, et fait demi-tour sous les châtaigniers pour rejoindre sa voiture. L’après-midi touche à sa fin et il lui tarde maintenant de finir de ranger chez sa tante et de rentrer chez elle, dans son petit appartement de Montpellier. Elle se fait la remarque qu’elle n’a croisé personne aujourd’hui, de nos jours les gens ne marchent plus dans les forêts, ou alors on est un jour de semaine ? Elle ne sait même plus quel jour on est…
A l’orée du bois, elle s’arrête brusquement : il y a un chien assis à côté de sa bagnole, un gros chien.
Claudie n’ose plus avancer, pétrifiée sur place, elle a toujours eu peur des chiens, surtout des molosses comme celui-là.
Si je ne bouge pas il va sentir que j’ai peur, pense-t-elle. Et s’il sent que j’ai peur, il risque d’attaquer. Il faut que je fasse comme si tout était normal… Mais à qui est ce clebs ? Les gens sont fous de laisser un monstre pareil sans laisse. Si je les chope, je te leur passe un de ces savons !
Elle se met en mouvement, doucement, sans quitter des yeux le chien mais évitant de le fixer, les mains dans les poches, histoire de les protéger peut-être…
‒ Salut le chien ! lui dit-elle d’une voix calme mais un peu forte. Alors, mon gros, t’es tout seul ? Et où sont tes maitres ? Ce qui est sûr c’est qu’ils sont à pied non ? Car je ne vois de voiture nulle part… bon tu vas peut-être me laisser rentrer dans ma bagnole, car tu es un gentil toutou non ?
Le chien au pelage noir, qui semble d’une espèce inconnue, mélange de beauceron, de rottweiler et peut-être de grizzli, se met sur les pattes et toujours sans aboiement, remue la queue. Il est vraiment énorme, planté comme ça sur ses quatre pattes. Presque aussi haut qu’un poney, mais bien moins engageant… Et sa gueule doit faire au moins deux fois la taille du visage de Claudie.
‒ Ah ! Tu veux jouer ? Ouais, mais moi j’ai pas envie et j’ai la pétole tu vois, alors je ne vais pas te toucher, pas jouer mais rentrer tranquillement chez moi… Tu n’as même pas de collier on dirait…
Elle ouvre sa portière délicatement, monte en voiture et referme prestement derrière elle, poussant un imperceptible soupir de soulagement. Son cœur bat la chamade et elle s’en veut de se créer de telles émotions pour un vulgaire chien même pas méchant au final ; « oui mais on ne se refait pas ! » se dit-elle tout haut.
Le bon gros toutou s’écarte tranquillement de la voiture quand Claudie démarre, et se rassoit sur le bord de la route, comme s’il attendait quelque chose qui n’est pas venu cette fois.
En partant, Claudie jette un coup d’œil sur celui-ci dans le rétro, « trop bizarre ce clebs », puis son image disparaît dans le premier virage et elle continue sa route. La nuit tombe tôt en cette saison.
Place de la Grand Font, le grand maigre et le petit gros se retrouvent, dans le café. Il n’y a pas grand monde ce soir, la télévision en sourdine allumée sur la chaîne sport ; un brouhaha de semaine d’automne.
‒ Toujours aussi maigre ? attaque la baleine.
‒ Et toi toujours aussi gros ?
Leur façon de se dire bonjour depuis plus de vingt ans.
Des physiques totalement opposés et pourtant ils se ressemblent tellement au fond d’eux.
‒ T’as les papiers que je t’ai demandé ? chuchote le maigre.
‒ Ouais, répond la baleine en jetant une grosse enveloppe kraft sur la table en zinc, et franchement, je comprends pas bien ton problème.
J’ai eu un peu de mal à remonter le temps, tout simplement parce que j’ai rien trouvé. C’est le vide total, il n’y a rien. Tellement que c’en est louche d’ailleurs…
‒ Ça c’est à moi de le découvrir, c’est ma partie…
Le gros baisse la tête en triturant son verre, les yeux cachés derrière sa frange grasse.
‒ J’aime bien ta façon de dire merci.
Et les deux hommes de sourire, complices.
Après ils prendront un autre verre, une petite bière probablement, et à demi-mot ils se conteront le temps qui a passé depuis leur dernière rencontre, il n’y a pas si longtemps que ça, jetant un œil distrait au match en cours et aux autres habitués qu’ils connaissent bien sûr. Tout le monde se connaît dans les petits villages. Surtout des gars comme eux, ça se remarque forcément.
Et quand il se fera tard, à la fermeture ou presque, ils se serreront la main devant la porte du bistrot et chacun retournera chez lui, l’un perdu dans ses pensées obscures, l’autre dans ses schémas informatiques.
Le journal de Mona 1
Parce qu’un jour nous décidons de changer, Parce que le temps nous rattrapera, parce qu’un jour j’aurai peut-être tout oublié…
Mais avant, je me dois, pour qui, pour quoi, je ne sais, de couvrir ces pages.
Peut-être pour l’enfant ?
Peut-être juste pour moi, pour mon âme ?
Ces mots éclaireront ils ceux qui les liront ? Ces phrases expliqueront-elles qui nous fûmes et ce que nous en fîmes ?
Je ne crois pas au grand pardon, je ne fus pas toujours juste.
Mais je n’ai pas de remords, juste des regrets…car les choses eussent pu être différentes alors.
Nous ne croyions qu’en nous, nous vivions comme des dieux loin de la justice des hommes. Elle nous a effleurés souvent, mais jamais attrapés. Et aujourd’hui que le temps s’amenuise, que tu n’es plus là mon adoré, je me dois de confier mon secret. Il est devenu trop lourd, cherchant à toute fin de vouloir s’enfuir, mais pourquoi maintenant ?
Qui peut comprendre cet amour, si puissant, si fort, si absolu ?
Rien ne put lui résister alors.
Il naquit en nous et fut notre seul bien, notre seul trésor. Je l’ai chéri tel quel et aujourd’hui je reste avec lui et mes souvenirs.
Personne ne comprendra, c’était au-delà des mots, mais je veux tenter au travers de ces pages de le décrire, de m’en délecter une dernière fois…
II
Lundi, le soir
Un petit crachin tombe sur la région quand Claudie se gare devant le cimetière. Comme d’habitude, pas un chat à l’horizon. En face, la maison est là, énorme et menaçante dans l’obscurité, toute en pierres apparentes avec un gros mûrier en guise de sentinelle au pied des marches du perron, à l’entrée.