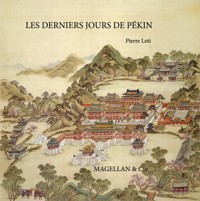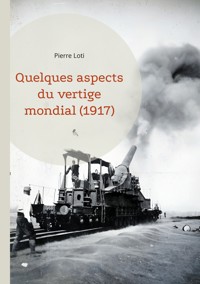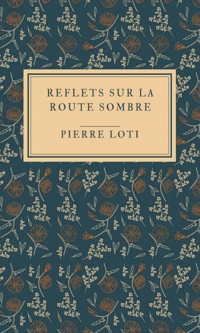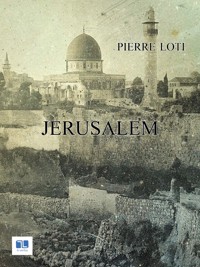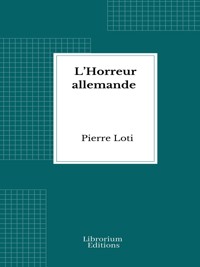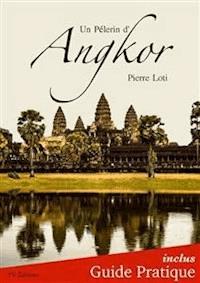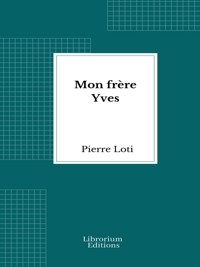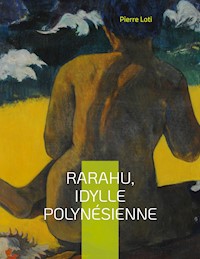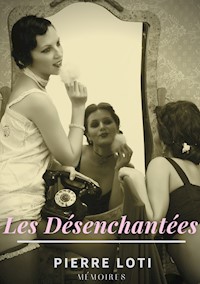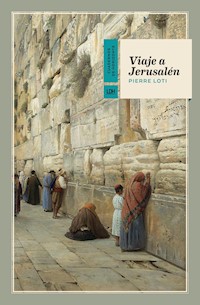Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Au Maroc, un voyage fascinant au cœur de l'Orient mystérieux et envoûtant. Dans ce livre captivant, Pierre Loti nous transporte dans un pays aux mille et une merveilles, où les traditions ancestrales se mêlent harmonieusement à la modernité.Au fil des pages, l'auteur nous dévoile ses rencontres avec les habitants chaleureux et accueillants du Maroc, ainsi que ses découvertes des villes animées telles que Tanger, Marrakech et Fès. Il nous fait partager ses émotions face aux paysages grandioses du désert, aux somptueux palais et aux souks colorés.Mais Au Maroc est bien plus qu'un simple récit de voyage. Pierre Loti nous offre une plongée profonde dans l'âme marocaine, en nous dévoilant les coutumes, les croyances et les traditions qui font la richesse de ce pays. Il nous fait ressentir la magie des contes des Mille et Une Nuits, tout en nous confrontant aux réalités parfois douloureuses de la vie quotidienne.Avec une plume poétique et sensible, Pierre Loti nous transporte dans un univers à la fois exotique et familier, où se mêlent les parfums enivrants des épices, les chants envoûtants des muezzins et les couleurs chatoyantes des tapis berbères. Au Maroc est un véritable hymne à la beauté et à la diversité de ce pays, qui ne manquera pas de captiver les amoureux de voyages et d'aventures.Plongez dans les pages de ce livre envoûtant et laissez-vous emporter par la magie du Maroc, un pays qui ne cesse de fasciner et d'émerveiller.Extrait : ""Des côtes sud de l'Espagne, d'Algésiras, de Gibraltar, on aperçoit là-bas, sur l'autre rive de la mer, Tanger la Blanche. Elle est tout près de notre Europe, cette première ville marocaine, posée comme en vedette sur la pointe la plus nord de l'Afrique ; en trois ou quatre heures, des paquebots y conduisent, et une grande quantité de touristes y viennent chaque hiver."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MINISTRE DE FRANCE AU MAROC
Hommage d’affectueuse reconnaissance.
P.L.
J’éprouve le besoin de faire ici une petite préface, – je prie qu’on me pardonne, parce que c’est la première fois.
Aussi bien voudrais-je mettre tout de suite en garde contre mon livre un très grand nombre de personnes pour lesquelles il n’a pas été écrit. Qu’on ne s’attende pas à y trouver des considérations sur la politique du Maroc, son avenir, et sur les moyens qu’il y aurait de l’entraîner dans le mouvement moderne : d’abord, cela ne m’intéresse ni ne me regarde, – et puis, surtout, le peu que j’en pense est directement au rebours du sens commun.
Les détails intimes que des circonstances particulières m’ont révélés, sur le gouvernement, les harems et la cour, je me suis même bien gardé de les donner (tout en les approuvant dans mon for intérieur), par crainte qu’il n’y eût là matière à clabauderies pour quelques imbéciles. Si, par hasard, les Marocains qui m’ont reçu avaient la curiosité de me lire, j’espère qu’au moins ils apprécieraient ma discrète réserve.
Et encore, dans ces pures descriptions auxquelles j’ai voulu me borner, suis-je très suspect de partialité pour ce pays d’Islam, moi qui, par je ne sais quel phénomène d’atavisme lointain ou de préexistence, me suis toujours senti l’âme à moitié arabe : le son des petites flûtes d’Afrique, des tam-tams et des castagnettes de fer, réveille en moi comme des souvenirs insondables, me charme davantage que les plus savantes harmonies ; le moindre dessin d’arabesque, effacé par le temps au-dessus de quelque porte antique, – et même seulement la simple chaux blanche, la vieille chaux blanche jetée en suaire sur quelque muraille en ruine, – me plonge dans des rêveries de passé mystérieux, fait vibrer en moi je ne sais quelle fibre enfouie ; – et la nuit, sous ma tente, j’ai parfois prêté l’oreille, absolument captivé, frémissant dans mes dessous les plus profonds, quand, par hasard, d’une tente voisine m’arrivaient deux ou trois notes, grêles et plaintives comme des bruits de gouttes d’eau, que quelqu’un de nos chameliers, en demi-sommeil, tirait de sa petite guitare sourde…
Il est bien un peu sombre, cet empire du Maghreb, et l’on y coupe bien de temps en temps quelques têtes, je suis forcé de le reconnaître ; cependant je n’y ai rencontré, pour ma part, que des gens hospitaliers, – peut-être un peu impénétrables, mais souriants et courtois – même dans le peuple, dans les foules. Et chaque fois que j’ai tâché de dire à mon tour des choses gracieuses, on m’a remercié par ce joli geste arabe, qui consiste à mettre une main sur le cœur et à s’incliner, avec un sourire découvrant des dents très blanches.
Quant à S.M. le Sultan, je lui sais gré d’être beau ; de ne vouloir ni parlement ni presse, ni chemins de fer ni routes ; de monter des chevaux superbes ; de m’avoir donné un long fusil garni d’argent et un grand sabre damasquiné d’or. J’admire son haut et tranquille dédain des agitations contemporaines ; comme lui, je pense que la foi des anciens jours, qui fait encore des martyrs et des prophètes, est bonne à garder et douce aux hommes à l’heure de la mort. À quoi bon se donner tant de peine pour tout changer, pour comprendre et embrasser tant de choses nouvelles, puisqu’il faut mourir, puisque forcément un jour il faut râler quelque part, au soleil ou à l’ombre, à une heure que Dieu seul connaît ? Plutôt gardons la tradition de nos pères, qui semble un peu nous prolonger nous-mêmes en nous liant plus intimement aux hommes passés et aux hommes à venir. Dans un vague songe d’éternité, vivons insouciants des lendemains terrestres, et laissons les vieux murs se fendre au soleil des étés, les herbes pousser sur nos toits, les bêtes pourrir à la place où elles sont tombées. Laissons tout, et jouissons seulement au passage des choses qui ne trompent pas, des belles créatures, des beaux chevaux, des beaux jardins et des parfums de fleurs…
Donc, que ceux-là seuls me suivent dans mon voyage, qui parfois le soir se sont sentis frémir aux premières notes gémies par des petites flûtes arabes qu’accompagnaient des tambours. Ils sont mes pareils ceux-là, mes pareils et mes frères ; qu’ils montent avec moi sur mon cheval brun, large de poitrine, ébouriffé à tous crins ; à travers des plaines sauvages tapissées de fleurs, à travers des déserts d’iris et d’asphodèles, je les mènerai au fond de ce vieux pays immobilisé sous le soleil lourd, voir les grandes villes mortes de là-bas, que berce un éternel murmure de prières.
Pour ce qui est des autres, qu’ils s’épargnent l’ennui de commencer à me lire ; ils ne me comprendraient pas ; je leur ferais l’effet de chanter des choses monotones et confuses, enveloppées de rêve…
26 mars 1889.
Des côtes sud de l’Espagne, d’Algésiras, de Gibraltar, on aperçoit là-bas, sur l’autre rive de la mer, Tanger la Blanche.
Elle est tout près de notre Europe, cette première ville marocaine, posée comme en vedette sur la pointe la plus nord de l’Afrique ; en trois ou quatre heures, des paquebots y conduisent, et une grande quantité de touristes y viennent chaque hiver. Elle est très banalisée aujourd’hui, et le sultan du Maroc a pris le parti d’en faire le demi-abandon aux visiteurs étrangers, d’en détourner ses regards comme d’une ville infidèle.
Vue du large, elle semble presque riante, avec ses villas alentour bâties à l’européenne dans des jardins ; un peu étrange encore cependant, et restée bien plus musulmane d’aspect que nos villes d’Algérie, avec ses murs d’une neigeuse blancheur, sa haute casbah crénelée, et ses minarets plaqués de vieilles faïences.
C’est curieux même comme l’impression d’arrivée est ici plus saisissante que dans aucun des autres ports africains de la Méditerranée. Malgré les touristes qui débarquent avec moi, malgré les quelques enseignes françaises qui s’étalent çà et là devant des hôtels ou des bazars, – en mettant pied à terre aujourd’hui sur ce quai de Tanger au beau soleil du midi, – j’ai le sentiment d’un recul subit à travers les temps antérieurs… Comme c’est loin tout à coup, l’Espagne où l’on était ce matin, le chemin de fer, le paquebot rapide et confortable, l’époque où l’on croyait vivre !… Ici, il y a quelque chose comme un suaire blanc qui tombe, éteignant les bruits d’ailleurs, arrêtant toutes les modernes agitations de la vie : le vieux suaire de l’Islam, qui sans doute va beaucoup s’épaissir autour de nous dans quelques jours quand nous nous serons enfoncés plus avant dans ce pays sombre, mais qui est déjà sensible dès l’abord pour nos imaginations fraîchement émoulues d’Europe.
Deux gardes au service de notre ministre, Sélem et Kaddour, pareils à des figures bibliques dans leurs longs vêtements de laine flottante, nous attendent au débarcadère pour nous conduire à la légation de France.
Ils nous précèdent gravement, écartant de notre route, avec des bâtons, les innombrables petits ânes qui remplacent ici les camions et les chariots tout à fait inconnus. Par une sorte de voie étroite, nous montons à la ville, entre des rangées de murs crénelés, qui s’étagent en gradins les uns au-dessus des autres, tristes et blancs comme des neiges mortes. Les passants qui nous croisent, blancs aussi comme les murs, traînent sans bruit leurs babouches sur la poussière, avec une majestueuse insouciance, et, rien qu’à les voir marcher, on devine que les empressements de notre siècle n’ont pas prise sur eux.
Dans la grande rue, qu’il nous faut traverser, il y a bien quelques boutiques espagnoles, quelques affiches françaises ou anglaises, et, à la foule des burnous, se mêlent, hélas ! quelques messieurs en casques de liège ou quelques gentilles misses voyageuses, ayant des coups de soleil sur les joues. Mais, c’est égal, Tanger est encore très arabe, même dans ses quartiers marchands.
Et plus loin – aux abords de la légation de France où l’hospitalité m’est offerte – commence le dédale des petites rues étroites ensevelies sous la chaux blanche, demeuré intact, comme au vieux temps.
Le soir de ce même jour d’arrivée, au coucher du soleil, je vais faire ma première visite à notre campement de route, qui se prépare là-bas, en dehors des murs, sur une hauteur assez solitaire dominant Tanger.
C’est tout une petite ville nomade, déjà montée, déjà habitée par nos Arabes d’escorte ; alentour, nos chevaux, nos chameaux, nos mules de charge, entravés par des cordes, paissent une herbe rase, très odorante ; on dirait une tribu quelconque, un douar ; l’ensemble exhale une forte odeur de Bédouin, et des chants tristes en voix de fausset, des sons grêles de guitare, sortent de la tente des chameliers.
C’est le sultan qui a envoyé tout cela au ministre, matériel, bêtes et gens. Je regarde longuement ces personnages et ces choses, avec lesquels il va falloir se familiariser et vivre, qui vont bientôt s’enfoncer avec nous dans ce pays inconnu.
La nuit qui vient, le vent froid qui se lève au crépuscule, accentuent – comme il arrive toujours – l’impression de dépaysement que ce Maroc m’a causée dès l’abord.
Le ciel du couchant est d’une limpidité profonde, dans des jaunes pâles extrêmement froids ; Tanger, qui paraît dans le lointain, sous mes pieds, semble à cette heure un éboulement de cubes de pierres sur une pente de montagne ; ses blancheurs, en s’obscurcissant, tournent au bleuâtre glacé ; au-delà s’étend la mer d’un bleu sombre ; – au-delà encore, en silhouette d’un gris d’ardoise, se dessine l’Espagne, l’Europe, une proche voisine avec laquelle ce pays, paraît-il, fraye le moins possible. Et cette pointe de notre monde à nous, que j’ai quittée il y a quelques heures à peine, vue d’ici me fait l’effet tout à coup de s’être effroyablement reculée.
Je reviens à Tanger par la place du Grand-Marché, qui est un peu au-dessus de la ville, à l’extérieur des vieux murs crénelés et des vieilles portes ogivales. Il y fait presque nuit. Par terre, sur une étendue d’une centaine de mètres carrés, il y a une couche de choses brunes qui grouillent faiblement : chameaux agenouillés, prêts à s’endormir, pêle-mêle avec des Bédouins et des ballots de marchandises ; caravanes qui sont parties peut-être des confins du désert, par les routes dangereuses et non tracées, pour venir jusqu’ici où finit la vieille Afrique ; jusqu’ici, en face de la pointe d’Europe, au seuil de notre civilisation moderne. Des bruits de voix humaines très rauques et des grognements de bêtes s’élèvent de ces masses confuses qui couvrent le sol de la place. Devant un petit feu, qui flambe jaune, au milieu d’un cercle de gens accroupis, un sorcier nègre chante doucement et bat du tambour. L’air de la nuit, de plus en plus frais, promène des exhalaisons fauves. Le ciel s’étoile partout, dans une limpidité profonde. Et voici qu’une grande musette arabe commence à gémir, dominant tous les autres bruits de sa voix aigre et glapissante… Oh ! j’avais oublié ce son-là, qui, depuis pas mal d’années, n’avait plus glacé mes oreilles !… Il me fait frissonner, et j’éprouve alors une très vive, très saisissante impression d’Afrique ; une de ces impressions des jours d’arrivée, comme on n’en a déjà plus les lendemains quand la faculté de comparer s’est émoussée au contact des choses nouvelles.
Elle continue, la musette, avec une sorte d’exaltation croissante, son air monotone qui déchire ; je m’arrête pour mieux l’entendre ; il me semble que ce qu’elle me chante là, c’est l’hymne des temps anciens, l’hymne des passés morts… Et j’ai un instant de plaisir étrange à songer que je ne suis encore ici qu’au seuil, qu’à l’entrée profanée par tout le monde, de cet empire du Maghreb où je pénétrerai bientôt ; que Fez, but de notre voyage, est loin, sous le dévorant soleil, au fond de ce pays immobile et fermé où la vie demeure la même aujourd’hui qu’il y a mille ans.
Huit jours d’attente, de préparatifs, de retards.
Pendant cette semaine passée à Tanger, nous avons fait de nombreuses allées et venues, pour examiner des tentes, choisir et essayer des chevaux ou des mules. Et, bien des fois, nous sommes montés sur la hauteur là-bas, où notre campement s’est augmenté peu à peu d’un nombre considérable de gens et d’objets, en face toujours des côtes lointaines de l’Europe.
Enfin le départ est fixé à demain matin.
Depuis hier, les abords de la légation de France ressemblent à un lieu d’émigration ou de pillage. Les petites rues tortueuses et blanches d’alentour sont encombrées de ballots énormes, de caisses par centaines ; tout cela recouvert de tapis marocains à rayures multicolores et lié de cordes en roseau.
4 avril.
Pour garder nos innombrables bagages, nos gens ont couché dans la rue, effondrés dans leurs burnous, la tête cachée sous leurs capuchons, semblables à d’informes tas de laine grise.
À pointe d’aube, tout cela sort de sa torpeur accroupie, s’éveille et s’agite. D’abord des appels timides, des pas incertains de gens qui dorment encore ; puis bientôt des cris, des disputes. Du reste, avec les duretés et les aspirations haletantes de la langue arabe, entre hommes du peuple, on a toujours l’air de se vomir des torrents d’injures.
Et cette grande rumeur d’ensemble, qui augmente toujours, couvre les bruits habituels du matin : chants de coqs, hennissements de chevaux et de mulets, grognements de chameaux dans le plus voisin caravansérail.
Avant le soleil levé, c’est déjà devenu quelque chose d’infernal : des cris suraigus comme en poussent les singes ; un brouhaha sauvage à faire frémir. Dans mon demi-sommeil, je m’imaginerais, si je n’étais habitué à ces tapages d’Afrique, que l’on se bat sous mes fenêtres, et même de la façon la plus barbare ; qu’on s’égorge, qu’on se mange… Tout simplement je me dis : « Ce sont nos bêtes qui arrivent, et nos muletiers qui commencent à les équiper. »
C’est une rude affaire, il est vrai, que de charger une centaine de mules entêtées et de chameaux stupides, dans des petites rues qui n’ont pas deux mètres de large. Des bêtes, qui ne trouvent plus la place de tourner, hennissent de détresse ; des caisses trop grosses accrochent les murs en passant ; il y a des rencontres, des collisions et des ruades.
Vers huit heures le tumulte est à son comble. Du haut des terrasses de la légation, au plus loin qu’on puisse voir dans le voisinage, c’est un tassement confus de gens et d’animaux hurlant à plein gosier. En plus des mulets de charge, il y a ceux des Arabes d’escorte, harnachés de mille couleurs, avec des fauteuils sur le dos, et des tapis de drap rouge, de drap bleu, de drap jaune, leur faisant comme des robes. Des cavaliers à visage brun et à burnous blanc sont déjà en selle, le long fusil mince en bandoulière. – Et tout ce train de voyage, qui doit nous précéder sous la conduite et la responsabilité d’un caïd envoyé par le sultan, se met en marche peu à peu, péniblement, individuellement ; à force de cris et de coups de bâton, le tout s’écoule vers les portes de la ville, finissant par laisser libres les petites rues autour de nous.
Alors vient le tour des mendiants, – et ils sont nombreux à Tanger ; – les fous, les idiots, les estropiés, les gens sans yeux ayant des trous saignants en guise de prunelles, – assiègent la légation pour nous dire adieu. Et, suivant la coutume, le ministre, paraissant sur le seuil, jette au hasard des poignées de pièces blanches, afin de nous mériter les prières qui porteront bonheur à notre caravane.
C’est à une heure de l’après-midi que nous devons nous mettre en route nous-mêmes. Le point de rendez-vous est la place du Grand-Marché, – cette place sur laquelle j’ai eu, le soir de mon arrivée, une première et inoubliable audition de musette arabe.
Au-dessus de la ville s’étend cette vaste esplanade, terreuse et pierreuse, sans cesse encombrée d’une couche compacte de chameaux agenouillés, et où grouille perpétuellement une foule en capuchon, qui est aussi d’une couleur rousse de terre. Tout ce qui arrive de l’intérieur, de par-delà le désert, et tout ce qui va s’y rendre, se groupe et se mêle sur cette place. Et là, du matin au soir, retentit le tambour, gémit la flûte des sorciers jeteurs de sorts, des mangeurs de feu et des charmeurs de serpents.
Aujourd’hui, la formation de notre caravane apporte dans ce lieu un surcroît de mouvement et de cohue. Dès midi, au beau soleil, arrivent nos premiers cavaliers, notre escorte d’honneur, nos caïds, et le porte-drapeau du sultan, qui pendant tout le voyage marchera à notre tête.
Jour de grand marché : des centaines de chameaux, pelés et hideux, sont à genoux dans la poussière, allongeant de droite ou de gauche, avec des ondulations de chenille, leur long cou chauve ; – et la masse des paysans ou des pauvres, en burnous gris, en sayon de laine brune, s’agite confusément parmi ces tas de bêtes couchées. C’est un immense fouillis d’une même nuance terne et neutre, qui fait davantage resplendir là-bas, dans la magnifique lumière des lointains, la ville toute blanche surmontée de minarets verts, et la Méditerranée toute bleue. Et, sur le fond monotone de cette foule, éclate aussi plus vivement le coloris oriental des cavaliers de notre suite, les cafetans roses, les cafetans oranges, les cafetans jaunes, les selles de drap rouge et les selles de velours.
Notre mission, sous la conduite de M. J. Patenôtre, ministre de France, se compose de quinze personnes, parmi lesquelles nous sommes sept officiers ; nos uniformes aussi ajoutent à ce tableau de départ un peu de diversité, de couleur et d’or. Cinq chasseurs d’Afrique, en manteau bleu, nous accompagnent. De plus, presque toute la colonie européenne est montée à cheval pour nous faire cortège : des ministres étrangers, des attachés d’ambassade, des peintres, d’aimables gens quelconques.
Et voici le pacha de Tanger, qui vient également nous conduire hors de ses domaines, vieillard à tête de prophète, à barbe blanche, tout de blanc vêtu, sur une mule blanche à selle rouge que quatre serviteurs tiennent en main. Notre ensemble a l’air d’une fête travestie, d’un joyeux méli-mélo de cavalcade.
Retournons-nous une dernière fois pour dire adieu à Tanger la Blanche, dont les terrasses dévalent au loin vers la mer sous nos pieds ; disons adieu surtout à ces montagnes bleuâtres qui se dessinent encore de l’autre côté du détroit et qui sont l’Andalousie, la pointe extrême d’Europe prête à disparaître.
Il est une heure, l’heure fixée pour se mettre en route. Le drapeau de soie rouge du sultan, qui doit nous guider jusqu’à Fez, se déploie devant nous, surmonté de sa boule de cuivre ; pour musique de boute-selle, nous avons les tambourins et les flûtes des sorciers du marché ; et notre colonne s’ébranle, en grand désordre, très gaiement.
Dans la banlieue, sur du sable, nos chevaux, fort gais eux aussi, prennent l’allure sautillante des débuts de promenade. Nous passons d’abord entre des villas à l’européenne, des hôtels, où une quantité de belles dames touristes sont aux balcons, aux vérandas, groupées sous des ombrelles pour nous regarder défiler. Et vraiment on pourrait se croire tout simplement en Algérie à quelque marche militaire, à quelque parade de fête ; bien que cependant le mauvais état des chemins et l’absence complète de voitures donnent à ces abords de ville quelque chose d’inusité et de singulier…
Du reste, autour de nous, tout change d’aspect bien vite. Au bout de quatre ou cinq cents mètres, l’espèce d’avenue bordée d’aloès par laquelle nous étions partis se perd complètement dans la campagne à l’abandon, s’efface, n’existe plus. Pas de routes, au Maroc, jamais, nulle part. Des sentiers de chèvres, tracés à la longue par le passage des caravanes ; et le droit de traverser à gué les rivières qui se présentent.
Ils sont bien mauvais aujourd’hui, ces sentiers ; le sol, détrempé par les pluies de l’hiver, cède partout sous les pieds de nos chevaux, qui s’enfoncent dans de la boue noirâtre, dans de la tourbe molle.
Les uns après les autres, les amis qui nous reconduisaient abandonnent la partie, reviennent sur leurs pas, après des poignées de main et des souhaits de bon voyage. Tanger a d’ailleurs très promptement disparu, derrière des collines désertes. Et bientôt nous nous trouvons seuls à suivre l’étendard rouge du sultan, nous qui devons continuer pendant une douzaine de jours la promenade, seuls au milieu d’un grand pays silencieux, sauvage, tout inondé de lumière…
Le même jour, à huit heures du soir. À la lueur d’un fanal, sous ma tente, dans un lieu quelconque où nous avons campé pour la nuit. Très seul tout à coup au milieu d’un profond silence, très tranquille après les agitations de la journée, et délicieusement reposé sur mon lit de camp, je me complais à avoir conscience des grandes étendues obscures d’alentour, qui sont sans routes, sans maisons, sans abris et sans habitants.
La pluie fouette les toiles tendues qui composent mes murailles et ma toiture, et j’entends le vent gémir. Le temps, qui était si beau au départ, s’est gâté à l’approche de la nuit.
Nous avons fait courte étape pour cette première fois : vingt kilomètres à peine. Avant la tombée du jour, nous avons aperçu devant nous notre petite ville nomade qui nous attendait, gaie et hospitalière, toute blanche au milieu des solitudes vertes ; partie de bon matin à dos de mulet, elle était déjà arrivée, déjà dépliée, déjà remontée, et les deux pavillons de France et de Maroc flottaient au-dessus, l’un en face de l’autre, amicalement.
C’est le caïd responsable de ces tentes, qui a charge de faire lever notre camp chaque matin et de le faire dresser chaque soir – dans des lieux toujours choisis d’avance, près des rivières ou des sources, et autant que possible sur des terrains secs recouverts d’une herbe courte.
Mon lit, très léger, est confortablement posé sur mes deux cantines, qui l’éloignent autant qu’il faut du sol, des grillons et des fourmis ; ma selle, en guise d’oreiller, le soulève du côté de la tête, et j’y suis enveloppé d’une couverture marocaine rayée de vert et d’orange, en haute laine, qui me tient très chaud, tandis que le vent frais de la nuit passe sur moi parfumé d’une odeur saine et sauvage, d’une odeur de foins et de fleurs. Au-dessus de ma tête, mon toit a naturellement forme d’immense parapluie ; il est blanc, les nervures en sont garnies de galons bleus et terminées par des trèfles en maroquin rouge. Tout autour, comme une de ces draperies retombantes qui servent à fermer les cirques ou les chevaux-de-bois, est accroché un tarabieh, c’est-à-dire une sorte de petit mur circulaire en toile Blanche, garni des mêmes rubans bleus, des mêmes trèfles rouges, et maintenu par des pieux fichés en terre. C’est le modèle uniforme de toutes les tentes de maître, de chef usitées au Maroc ; il y aurait place pour cinq ou six lits comme le mien ; mais la magnificence du sultan nous a donné à chacun une maison particulière.
Pour plancher, j’ai l’herbe fine, fleurie d’une minuscule variété d’iris : c’est un beau tapis violet doucement odorant, au milieu duquel trois ou quatre soucis, piqués çà et là, éclatent comme de petites rosaces d’or.
Mes compagnons de voyage et nos Arabes d’escorte sont en train de faire comme moi sans doute ; ils se couchent et vont s’endormir ; dans le camp, on n’entend plus aucun bruit humain.
Et tandis que j’apprécie ce calme, ce silence, ces senteurs fraîches, cet air vivifiant et pur, voici que dans une Revue emportée par hasard, je jette les yeux sur un article de Huysmans célébrant ses joies en sleeping-car : la fumée noire ; la promiscuité et les puanteurs des cellules trop étroites ; surtout les charmes de son voisin d’en dessus, monsieur d’une cinquantaine d’années, adipeux, flasque et crachotant, avec breloques sur le ventre, lorgnon à l’œil et cigare aux lèvres… Alors mon bien-être s’augmente encore à sentir très loin de moi ce voisin de Huysmans, – lequel est, du reste, un type peint de main de maître du monsieur âgé contemporain, important voyageur d’express. Et même, dans ma joie de songer que cette sorte de personnage ne circule pas encore au Maroc, j’éprouve un premier mouvement de reconnaissance envers le sultan de Fez pour ne point vouloir de sleeping dans son empire, et pour y laisser les sentiers sauvages où l’on passe à cheval en fendant le vent…
À minuit la grêle tambourine dehors et une grande rafale secoue les toiles de mon logis. Puis j’entends confusément des voix rudes qui se rapprochent ; un fanal fait le tour de ma maison, dessinant, par transparence sur l’étoffe tendue, les arabesques noires qui décorent l’extérieur : ce sont des gens de veille qui viennent, sous la direction de leur caïd, renfoncer à coups de mailloche tous les piquets de ma tente, de peur que le vent ne l’emporte.
… Quand le sultan est en voyage, sous sa grande tente à lui, qu’il faut soixante mules pour transporter, il paraît que si par hasard au milieu de la nuit le vent d’orage se lève, on ne se sert pas de mailloches, de peur de troubler le sommeil du maître et des belles dames du harem. Mais on réveille un régiment qui s’assied en rond autour du palais nomade et y reste jusqu’au jour, tenant dans ses innombrables doigts toutes les cordes du mur. – Quelqu’un, qui a vécu longtemps auprès de Sa Majesté me contait cela aujourd’hui, tandis que nos chevaux trottaient côte à côte ; – cette bourrasque me le remet en mémoire – et je me rendors en rêvant à cette cour de Fez, où habitent, derrière des murs et sous des voiles, tant de mystérieuses belles…
Vers deux heures du matin, nouvelle alerte nocturne : des ébrouements de chevaux affolés, des galops martelant le sol, des cris d’Arabes. Nos bêtes, qui se sont détachées, se battent, épeurées par je ne sais quoi d’invisible, prises de panique générale !… Pourvu que tout cela se passe loin de moi, ne vienne pas s’entraver les pieds dans les cordes de ma tente et la chavirer ; quel ennui ce serait, sous l’ondée qui ruisselle toujours ?
Allah soit loué ! La galopade échevelée prend une autre direction, s’éloigne, se perd dans le noir d’alentour.
Puis j’entends qu’on ramène les fugitifs, et le calme revient, – le silence, – le sommeil…
5 avril.
À six heures, au grand jour, le clairon d’un de nos chasseurs d’Afrique sonne le réveil.
Vite il faut se lever, se sangler, se guêtrer. Déjà des Arabes ont envahi mon logis pour le démolir, – mon logis de toile blanche tout trempé de la pluie de la nuit.
En un tour de main, c’est fait ; le vent aidant, cela s’envole, flotte un instant avec un bruit de voile de navire, puis retombe aplati sur l’herbe mouillée, et j’achève à l’air libre d’attacher mes éperons, de mettre la dernière main à ma toilette.
Les petites fleurs qui ont dormi sous mon toit vont recouvrer la liberté, l’arrosage des averses et la solitude.
Et toute notre ville se démonte de la même manière, se plie, s’attache serré dans des quantités de ficelles ; puis se charge sur des mules qui ruent, sur des chameaux qui grognent ; en route, notre camp est levé !
Au départ, les chevaux dansent, hennissent, se défendent ou s’amusent.
Nous commençons notre étape du second jour dans des montagnes uniformément couvertes de broussailles de chênes verts, de bruyères et d’asphodèles. Presque jamais d’arbres, au Maroc ; mais, en revanche, toujours ces grandes lignes tranquilles des paysages vierges que n’interrompt ni une route, ni une maison, ni un enclos. Un pays inculte, à peu près laissé à l’état primitif, mais qui semble merveilleusement fertile. Quelques champs de blé, çà et là, quelques champs d’orge auxquels on ne s’est pas cru obligé de donner la forme carrée usitée chez nous, et qui ont l’air de prairies d’un vert tendre. Comme cela repose les yeux, après notre petite campagne française tout en damier, morcelée et découpée… J’ai déjà connu ailleurs cette sorte de bien-être, de soulagement particulier que l’on éprouve dans les pays où l’espace ne coûte rien et n’est à personne ; dans ces pays-là, il semble aussi que les horizons s’élargissent démesurément, que le champ de la vue soit très agrandi, que les étendues ne finissent plus.
Et toujours, à quelque cinquante mètres en avant de nous, sur les tranquilles lointains verts sans cesse déroulés, – toujours se dessine cette même première avant-garde, qui nous guide et que nous suivons dans sa continuelle fuite : trois cavaliers de front ; celui du milieu, un grand vieux nègre de majestueuse allure, en cafetan de drap rose, en burnous et turban de fine étoffe blanche, portant haut l’étendard du sultan, l’étendard de soie rouge à boule de cuivre ; ceux des côtés, nègres aussi, pareillement coiffés, tenant en main leurs longs fusils, dont les canons brillent sur l’uniformité bleuâtre des fonds, des montagnes et des plaines.
Vers dix heures, sous le ciel toujours gris, dans la campagne toujours verte et sauvage, nous apercevons là-bas devant nous une ligne immobile de bonshommes à cheval, postés pour nous attendre. C’est que nous allons changer de territoire, et tous les hommes de la tribu chez laquelle nous arrivons se tiennent sous les armes, caïd en tête, pour nous recevoir. Ainsi qu’il est d’usage pour les ambassades qui passent, ils nous feront escorte à travers leur pays, et les autres, venus de Tanger, s’en retourneront.
Oh ! les étranges cavaliers, vus au repos et dans le lointain ! Sur leurs petits chevaux maigres, sur leurs hautes selles à fauteuil, on dirait des vieilles femmes enveloppées de longs voiles blancs, des vieilles poupées à figure noire, des vieilles momies. Ils tiennent en main de très longs bâtons minces recouverts de cuivre brillant, – qui sont des canons de fusil ; – leur tête est tout embobelinée de mousseline, et leurs burnous, sur la croupe de leurs bêtes, traînent comme des châles.
On s’approche et, brusquement, à un signal, à un commandement jeté d’une voix rauque, tout cela se disperse, essaime comme un vol d’abeilles, gambade avec des cliquetis d’armes, en poussant des cris. Leurs chevaux, éperonnés, se cabrent, sautent, galopent comme des gazelles effarées, queue au vent, crinière au vent, bondissant sur les rochers, sur les pierres. Et, du même coup, les vieilles poupées ont pris vie, sont devenues superbes aussi, sont devenues des hommes sveltes et agiles, à beau visage farouche, debout sur de grands étriers argentés. Et tous les burnous blancs qui les empaquetaient se sont envolés, flottent maintenant avec une grâce exquise, découvrant des robes de dessous en drap rouge, en drap orange, en drap vert, et des selles qui ont des tapis de soie rose, de soie jaune ou de soie bleue à broderies d’or. Et les beaux bras nus des cavaliers, fauves comme du bronze, sortent des manches larges relevées jusqu’aux épaules, brandissant en l’air, pendant la course folle, les longs fusils de cuivre qui semblent devenus légers comme des roseaux…
C’est une première fantasia de bienvenue, pour nous faire honneur. Dès qu’elle est finie, le caïd qui l’avait conduite s’avance vers notre ministre et lui tend la main. Nous disons adieu à nos compagnons d’hier qui s’éloignent, et nous continuons notre route escortés de nos nouveaux hôtes.
J’ai souvenance d’avoir traversé toute l’après-midi de cette même journée d’immenses, d’interminables plateaux de sable recouverts de fougères, – comme sont nos landes du sud de la France. Ces plaines étaient d’un vert tendre et frais, à l’infini, d’un vert tout neuf d’avril ; un rayon atténué de soleil les éclairait obstinément, au seul point précis où nous étions, comme si cette lueur nous eût suivis, tandis qu’alentour les grands horizons de montagnes, où pesaient des nuages sombres, se confondaient avec le ciel dans des obscurités lourdes et sinistres. Des rideaux de brume tamisaient une sorte de lumière couleur d’argent doré, de vermeil pâli, et c’était inattendu de voir ainsi fraîches et voilées ces campagnes africaines.
Le frôlement de notre passage, les sabots de nos chevaux brisant les tiges, développaient très fortement la senteur des fougères – qui me rappelait les beaux matins de juin dans mon pays, l’arrivée au marché des mannequins de cerises. – (En Saintonge, les cerises ne voyagent jamais sans être enveloppées de cette sorte de feuillage ; aussi ces deux senteurs sont-elles inséparables dans mon souvenir.)
Et, de chaque côté de notre colonne, en sens inverse de notre marche, toutes les cinq minutes, des groupes de cavaliers arabes passaient comme le vent. Sur ces tapis de plantes, sur ces sables, on entendait à peine le galop de leurs chevaux ; tout le bruit qu’ils faisaient en fendant l’air était un léger cliquetis de cuivre et un flottement échevelé de burnous ; on croyait plutôt entendre une bourrasque dans des voiles de navire, ou un grand vol d’oiseaux. À peine aussi avait-on le temps de se garer pour n’être pas frôlé par eux. Et, au moment même où ils nous croisaient, ils poussaient un cri rauque, puis tiraient à poudre un coup de leur long fusil, nous couvrant de fumée.
À chaque instant, à droite ou à gauche, recommençait cette vision rapide, cette espèce de cauchemar de guerre, qui fuyait terriblement vite.
Vers le soir seulement, ces fantasias cessèrent. Autour de nous, la teinte verte était de plus en plus belle, le pays devenait presque boisé ; il y avait des bouquets d’oliviers, et les palmiers-nains étaient si vieux, si hauts, qu’ils ressemblaient à de vrais arbres. Des hameaux apparaissaient çà et là sur des collines : murs de terre battue et toits de chaume gris ; le tout entouré, gardé, à demi caché par des haies d’énormes cactus-raquettes d’un vert presque bleu. Et des femmes en haillons de laine grise sortaient, à notre approche, de ces formidables clôtures tout hérissées d’épines, criant : « You ! you ! you ! » pour nous faire honneur, avec des voix stridentes, perçantes, comme en ont les martinets, les soirs d’été, lorsqu’ils tourbillonnent dans le ciel.
Puis cette région habitée s’éloigna de nous et, après deux ou trois gués franchis, nous aperçûmes dans une prairie, dans un bas-fond très frais, notre camp qui achevait de se monter. Nos chevaux hennirent de plaisir en le reconnaissant.
Toujours pareille, notre petite ville, toujours disposée de la même manière, comme si elle se transportait d’une seule pièce, sur des roulettes. Et, dès l’arrivée, chacun de nous, sans hésiter, se rend tout droit dans sa maison, qui, par rapport aux autres, n’a pas changé de place ; il y retrouve son lit, son bagage et, par terre, sur un premier tapis d’herbe et de fleurs, son tapis marocain, étendu. Nous voyageons avec tout le confort des nomades, n’ayant à nous occuper de rien, n’ayant qu’à jouir du grand air, du changement, de l’espace.
Nos quinze tentes forment un cercle parfait, laissant au milieu une sorte de place, de prairie intérieure où nos chevaux paissent. Toutes sont semblables, le mât central surmonté d’une grosse boule de cuivre, et les parois ornées, au-dehors, de plusieurs rangs d’arabesques d’un bleu noir, qui tranchent sur la blancheur de l’ensemble. (Ces arabesques, faites de morceaux d’étoffe découpés et cousus, sont d’un dessin toujours le même, extrêmement ancien, consacré par des traditions millénaires : espèces de créneaux dentelés qui se succèdent en séries, les mêmes que les Arabes taillent dans de la pierre au sommet de leurs murailles religieuses, les mêmes qu’ils brodent au bord de leurs tentures de soie, les mêmes qui entourent leurs mosaïques de faïence, et que l’on voit aussi aux lambris de l’Alcazar ou de l’Alhambra.)
Et autour de nos tentes, formant un second cercle enveloppant, il y a celles de nos chameliers, de nos muletiers, de nos gardes ; plus petites, plus pointues, celles-ci, et tout uniment grisâtres, disposées avec moins d’ordre, elles composent un quartier tout bédouin, qu’encombrent nos bêtes de somme, et où d’étranges musiques se font entendre le soir aux veillées.
L’apparition de la mouna est toujours l’évènement le plus considérable de nos fins d’étapes ; c’est au crépuscule généralement que cela arrive, en long cortège, pour se déposer ensuite sur l’herbe devant la tente de notre ministre. Pardon pour ce mot arabe, mais il n’a pas d’équivalent en français : la mouna, c’est la dîme, la rançon, que notre qualité d’ambassade nous donne le droit de prélever sur les tribus en passant. Sans cette mouna, commandée longtemps à l’avance et amenée quelquefois de très loin, nous risquerions de mourir de faim dans ce pays sans auberges, sans marchés, presque sans villages, presque désert.
Notre mouna de ce soir est d’une abondance royale. Aux dernières lueurs du jour, nous voyons s’avancer au milieu de notre camp français une théorie d’hommes graves, drapés de blanc ; un beau caïd, noble d’allure, marche à leur tête, avec lenteur. En les apercevant, notre ministre est rentré sous sa tente et s’est assis, comme le prescrit l’étiquette orientale, pour les recevoir au seuil de sa demeure. Les dix premiers portent de grandes amphores en terre, pleines de beurre de brebis ; puis viennent des jarres de lait, des paniers d’œufs ; des cages rondes, en roseau, remplies de poulets attachés par les pattes ; quatre mules chargées de pains, de citrons, d’oranges ; et enfin douze moutons, tenus par les cornes – qui pénètrent à contrecœur, les pauvres, dans ce camp étranger, se méfiant déjà de quelque chose.
Il y a de quoi nourrir dix caravanes comme la nôtre ; mais refuser serait un manque absolu de dignité.
D’ailleurs nos gens, nos cavaliers, nos muletiers, attendent, avec leurs convoitises d’hommes primitifs, cette mouna pour se la partager ; toute la nuit, ils en feront des bombances sauvages, ils en revendront demain, et il en restera encore des débris par terre pour les chiens errants et les chacals. C’est l’usage établi depuis des siècles : dans un camp d’ambassadeur, on doit faire continuelle fête.
À peine le ministre a-t-il remercié les donateurs (d’un simple mouvement de tête comme il convient à un très grand chef), la curée commence. Sur un signe, nos gens s’approchent ; on se partage le beurre, le pain, les œufs ; on en remplit des burnous, des capuchons, des cabas en sparterie, des bâts de mulet. Derrière les tentes de cuisine, dans un petit recoin de mauvais aspect, qui semble se transporter, lui aussi, avec nous chaque jour, on emmène les moutons, – et il faut les y traîner, car ils comprennent, se défendent, se tordent. Au crépuscule mourant, presque à tâtons, on les égorge avec de vieux couteaux ; l’herbe est toujours pleine de sang, dans ce recoin-là. On y égorge aussi des poulets par douzaines, en les laissant se débattre longuement le cou à moitié tranché, afin de les mieux saigner. Puis des feux commencent à s’allumer partout, pour des cuisines bédouines qui seront pantagruéliques ; sur des tas de branches sèches, des petites flammes jaunes surgissent çà et là, éclairant brusquement des groupes de chameaux, des groupes de mules qu’on ne voyait déjà plus dans l’obscurité, ou bien de grands Arabes blancs, aux airs de fantôme. On dirait maintenant d’un camp de gitanos en orgie – au milieu de ce pays désert qui est déployé en cercle immense alentour et qui, tout à coup, dès que les feux brillent, paraît plus profond et plus noir.
Temps toujours couvert, très sombre, presque froid. Nous sommes dans une région de prairies, de marécages. Et, pendant ces préparatifs de festins, les grenouilles nous commencent de tous les côtés à la fois, jusque dans les lointains extrêmes, leur musique nocturne, leur même ensemble éternel, qui est de tous les pays et qui a dû être de tous les âges du monde.
Vers huit heures, comme nous finissons de dîner nous-mêmes sous la grande tente commune qui nous sert de salle à manger, quelqu’un avertit le ministre qu’on vient de lui immoler une génisse, là, dehors, à la porte de son propre logis. Et nous sortons, avec une lanterne, pour savoir ce que signifie ce sacrifice et qui l’a accompli.