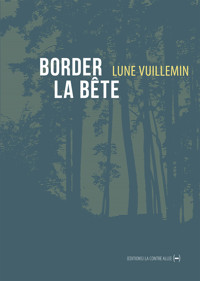
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sur les berges d’un lac gelé, la narratrice assiste au sauvetage d’une orignale. Touchée par Arden, la femme aux mains d’araignée, et Jeff, l’homme à l’oeil de verre, qui se démènent l’un et l’autre pour sauver l’animale, elle décide de les accompagner dans le refuge dont ils s’occupent.
Au coeur d’une nature marquée par les saisons, où humains et non-humains tentent de cohabiter, notre narratrice apprivoisera ses propres fêlures tout en apprenant à soigner les bêtes sauvages, et à interpréter les sons et les odeurs de la forêt et de la rivière. Dans ces lieux qui façonnent les êtres qui les peuplent, comment exister sans empiéter sur ce qui nous entoure ?
À PROPOS DE L' AUTRICE
Née en 1994, Lune Vuillemin a grandi au fond d’une forêt de l’Aude puis a vécu en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. Aujourd’hui, elle réside dans le Sud de la France, où elle écrit, toujours à la recherche du vivant, aussi petit soit-il, en forêt, à flanc de falaise ou dans la garrigue, un roman et son carnet d’écriture dans la poche. En 2019, "Quelque chose de la poussière" paraissait aux éditions du Chemin de fer. "Border la bête" est son premier roman à La Contre Allée.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Border la bête
Lune Vuillemin
Délaissant les grands axes, j’ ai pris la contre-allée
A. Bashung et J. Fauque
Paradoxalement, les institutions devraient garantir
le droit à la fragilité des individus. Le droit, en somme,
de ne pas renoncer à sa propre humanité…
Roberto Scarpinato
Vous avez entre les mains la première impression
de Border la bête et nous vous en remercions.
© (éditions) La Contre Allée (2024)
Collection La sentinelle
Border la bête
Lune Vuillemin
Listening in wild places, we are audience to conversations in a language not our own.
Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants
Robin Wall Kimmerer
Écouter la nature sauvage, c’est être à la fois spectateur et auditeur de conversations
dans un langage qui n’est pas le nôtre.
Traduction de Véronique Minder
(Tresser les herbes sacrées,
éditions Le Lotus et l’Éléphant, 2021)
Quand le vent reprend son souffle, l’air se fige au-dessus du lac Petit. La glace soliloque sous le ciel blanc, parfois elle grince des dents, se met à rire et sa mâchoire claque. Sa peau blanche gercée de bleu semble forte et prête à recevoir les baisers ardents du printemps. Il y a d’abord une expiration de brume sur les sapins baumiers, puis le froid bondit d’un bout à l’autre du lac à la manière des chevreuils en fuite. Le chant de la glace rencontre le rire de la sittelle. Les trembles nus se tendent la main, si blancs et lourds d’une neige glacée. Dans la forêt, le pas silencieux des biches alertes, le ventre rond d’une mésange sur une branche tordue, une petite martre baille, dents minuscules et poils hérissés par une couverture de neige fondue tombée d’en haut. Le matin pointe le long de la rivière Babine. Elle vient du nord de la vallée et rejoint le lac Petit, séparé du lac Grand par une forêt dense qui fait ricocher les bruissements d’ailes, les fracas de la neige et les silences éphémères. Un corbeau sur une souche blanche, le bec enneigé, espiègle, regarde un peu alentour, surveille le lac Petit. Il neige, doucement et silencieusement, une neige fine et timide. Quelque chose grignote ou dépiaute, ça crépite comme un feu sec. Un groupe de trois mésanges sur une branche gigote, elles font les yeux doux à l’air piquant du matin. L’une d’elles plonge, flocon tacheté de noir, et disparaît. Le corbeau sur sa souche, avec sa moustache de poudreuse, croasse un coup, regarde par là, pense.
Haute sur ses pattes, l’orignale avance doucement. Elle traverse le matin blanc, grandes oreilles vers le ciel, narines écartées. Douceur dans le regard. La solitaire a le ventre rond, le poil épais et brun avec un cœur qui cogne en dessous, peut-être même deux. Ses longs doigts agiles évitent les roches et les branches dissimulées par la neige. Des yeux sous les pattes, elle avance confiante vers Lac Petit. La neige s’arrête, si l’on regarde bien. La troisième mésange se pose à nouveau sur la branche. Une chose indicible se déroule entre les trois petits oiseaux à tête noire. Sur la souche, en bas, au pied du sapin, le corbeau n’est plus là. Le lac chuchote sous la glace qui lui met la main sur la bouche. L’animal sur ses longues et fines jambes envisage la robe d’hiver de l’étendue d’eau qu’elle connaît bien. De l’autre côté elle longera la rivière Babine, remontera un peu vers les tourbières qui regorgent de vie, croisera quelques loutres au regard fourbe et rejoindra une autre forêt calme où l’on ne chasse pas. Y croquer les pousses de cèdres et de sapins. Le grand corbeau fend le ciel blanc, fait rebondir un chant de gorge entre les arbres. Derrière le lac, le long de la rivière aux rives recouvertes de névés, enflées comme des lèvres tuméfiées, les jeunes bouleaux ont la peau fragile.
Un ventre lourd s’abîme. Les muscles tendus dans les eaux de griffes, eaux-poignards. Des hommes aux bras fatigués ont extirpé la bête du lac blanc. Nous restons là, à observer le cervidé exténué couché sur son flanc. Les heures tournent comme nos regards perdus, nos sourcils qui se froncent. Sous le ventre gonflé d’angoisse et de vie qui s’affole, passer les sangles robustes. Dans le jour qui se couche, entendre les coyotes au loin et le moteur du débusqueur qui doucement soulève son treuil, sorte de poing fermé prêt à frapper la terre. Une grande femme aux épaules lourdes fait un signe à l’homme qui manœuvre le débusqueur. Il recule d’un coup sec, le moteur cale, l’orignale laisse échapper un râle. Je ne regarde que ses yeux qui cherchent à se fermer. Mes mains s’engourdissent de froid dans les poches de ma veste alors que l’animale est hissée vers un van à chevaux attelé à un pick-up. Elle paraît déjà morte, sa tête semble trop lourde à porter. Le treuil la dépose sur un tapis posé devant le van et les hommes aux bras fatigués aident à tirer la bête à l’intérieur. C’est long, il faut s’y reprendre à deux fois. La grande femme aux épaules lourdes me fait signe d’entrer dans le van avec elle. Elle pose une vieille serviette de bain sur le haut de la tête de l’animale, cache ses yeux, et je l’aide à étendre une couverture sur l’orignale. Je regarde les mains de cette femme, blanches et tordues comme des pattes d’araignées. Elle me parle avec le regard et le menton et je comprends tout, je crois. Son nez est incroyable, une falaise. Elle sort du van, jette un regard sur l’animale, puis sur moi, je hoche la tête. Elle fait basculer la porte arrière comme un pont-levis et je me retrouve dans l’obscurité avec la bête. Je peux voir par un hublot le paysage que nous traversons. Je pétris la poche d’électrolytes avec ce qu’il me reste de force dans les mains. Je n’ai pas dit au revoir au garde forestier qui m’a conduite ici, au bord d’un lac, en lisière d’une vallée que je ne connais pas. Nous partons vers un refuge, un sanctuaire, où cette femme au nez gigantesque accueille des animaux sauvages. Chacun de mes doigts se contracte et brûle mais je continue à pétrir le sac. L’orignale ne bouge plus. Je serre les dents sur ma peur qu’elle meure avant que nous arrivions. Entre nous, le cordon ombilical. Comme ça, sans prévenir, l’hiver a décidé d’ouvrir grand la bouche. Avaler cette mère dans le calme formidable du matin.
Au refuge, le pick-up continue sur un chemin qui contourne une grange bleu-gris un peu sinistre et s’arrête plus loin sur une piste forestière. Les pneus font craquer la fine couche de gel recouvrant la terre. Le pont du van s’ouvre sur une clairière flanquée d’épinettes hautes. Le poing du débusqueur fait à nouveau glisser la bête hors du van puis la hisse au-dessus du sol avec ses gestes mécaniques. L’homme et la femme parlent français, lui a un fort accent anglophone. Quelque chose dans sa voix à elle, comme un accent qui tente de se dérober. Une inflexion déguisée, qui me semble familière. Elle murmure un ordre sec et nos mains si petites se mettent à masser les pattes de l’orignale suspendue au-dessus de nous. Sous mes doigts la peau si dure, la peau froide et tendue, les murs d’une prison qui ne tombent pas. Des poils, longs comme mon annulaire, se collent à mes paumes. J’aimerais que mes phalanges pénètrent la chair de l’animale mais tout est si raide. Ça résiste. J’ai des poils dans la bouche. Je voudrais pleurer, je regarde les autres qui pétrissent les muscles avec force. Ils ont la même grimace au visage. Masque d’impuissance. Eaux froides du lac qui engloutissent la vie. J’essaye de chanter tout bas une chanson que j’aime mais les mots n’ont pas de sens. J’enrage et donne un coup de poing dans la cuisse glacée, l’orignale a encore les yeux ouverts mais plus rien ne semble battre sous la peau. Une tique, grosse comme un bleuet, trace un sillage dans le pelage brun. Une autre la suit, puis une autre encore. Petite meute à la queue leu leu dans les poils épais et trempés de l’orignale. Un vent désagréable se lève, personne n’a son manteau sur le dos. La grande femme aux épaules lourdes et l’homme ne massent plus. Elle lui dit quelque chose que je n’entends pas. J’abandonne aussi et nous restons un instant tête baissée, les mains noires de crasse, de poils et de terre, les genoux qui tremblent. Sous les épinettes frissonnantes, la nuit s’en vient. Je prie pour que, cette nuit, les coyotes épargnent l’orignale. Que personne n’ouvre ce ventre encore chaud, où un souffle respire peut-être encore. L’orignale, les yeux toujours ouverts, les membres tordus sous son lourd corps de bête des bois, garde la tête haute. Je regarde la grande femme aux épaules lourdes qui a enfilé un bonnet, elle a le visage marqué, elle pourrait avoir quarante ans, elle pourrait aussi en avoir cinquante. Au-dessus de nous, les grands corbeaux s’exclament et hoquettent, chantent et accompagnent une vie qui part. L’homme relève la tête vers moi.
— Avec ça, on ne s’est pas présentés. I’m Jeff, this is Arden.
Je serre sa main, tout est froid, la clairière et nos peaux. Il me sourit faiblement. Sous ses yeux se dessinent des arroyos qui s’écoulent vers la joue, parfois remontent vers la source de l’œil, la paupière crevassée de fines failles qui tranchent dans la peau. Un de ses yeux semble éteint. Il me demande si je crois en Dieu. Je lui dis que non, en tout cas pas celui auquel il pense, mais il m’arrive de prier, souvent, de m’adresser à d’autres… choses. I get that, il dit. Nous restons là, incapables de quitter l’orignale. Je me sens fatiguée. Mes doigts sont durs, petits cailloux ocre. Personne ne prie. Je ne trouve pas les mots pour cette animale merveilleuse que nous ne parvenons pas à sauver. Arden remonte la couverture sur l’encolure de l’orignale qui a posé son énorme tête au sol. Ce geste, remonter la couverture, sans recouvrir la tête, me donne comme un espoir que l’orignale s’en sorte. Pourtant le froid s’engouffre dans la clairière, chasse les corbeaux, fait trembler ma poitrine. Arden se redresse, me dit que je peux dormir chez elle, sur le canapé. On discutera demain. Je les suis jusqu’au van vide. Arden le referme et le décroche de l’attelage du pick-up. Jeff m’ouvre la porte passager, nous tenons à deux sur la banquette en nous serrant. Je regarde mes mains souillées et anéanties, je les rapproche de la petite bouche du chauffage qui crache sa chaleur. Fuck souffle Arden en manœuvrant pour faire demi-tour. Je regarde encore ses mains à elle. Longues et tordues, comme des pattes d’araignées. Jeff demande ce que je faisais avec le garde forestier. Je réponds qu’il m’a prise en stop une heure avant et qu’en chemin il y a eu le coup de téléphone. Il a parlé de l’orignale, m’a proposé de me laisser au premier motel mais je suis restée avec lui. Je voulais voir ça. Jeff ne demande pas où je vais mais d’où je viens.Je ne sais pas quoi répondre à ça. Une image me pénètre. J’essaye de la chasser. Jeff n’insiste pas. Je ne sais pas quoi faire de mes réponses. Arden ne dit rien. Je regarde ses doigts arachnéens sur le volant. Au-dehors la noirceur vient saisir le jour dans la forêt, je m’endors un peu dans une odeur qui, bientôt, sera aussi familière que la robe trouble d’une bière noire au café.
Arden me laisse dans le vestibule, le sol est brun et granuleux sous mes chaussettes mouillées. Des morceaux de terre séchée s’y collent. Il y a cette odeur de chien-poils-cuir-écorce-terre-femme. Je me suis réveillée quand Jeff a refermé la portière. Arden, le pick-up et moi avons continué à rouler dans la nuit. Je ne voyais rien, je n’avais pas compris qu’on faisait demi-tour, qu’on retournait vers l’orignale, vers le refuge. Dans ce territoire inconnu brouillé par la nuit, Arden s’est garée devant une petite maison. C’est peut-être là que tout commence. Et en même temps je ne sais pas s’il doit y avoir un début, ni où il se situe vraiment. Je dépose mon blouson par-dessus deux parkas sur le portemanteau qui étouffe. Derrière la porte du vestibule, il n’y a qu’une seule grande pièce dans laquelle Arden est accroupie devant la bouche ouverte d’un énorme poêle à bois. Je vois ses chaussettes qui traînent sur une couche de cendres recouvrant le parquet. Elle se redresse, me propose un café, je dis que je n’aime pas le café, enfin, j’aime le goût, par exemple dans certaines stouts, mais pas le café. Elle reste là, sourcils froncés, à me regarder. Je me rends compte à quel point elle est grande. Un thé alors. Dans un coin de la pièce, un frigo qui est aussi haut qu’elle, une cuisinière et une petite table ovale en bois sombre font office de cuisine. Elle fourrage dans les armoires et se retourne, triomphante, tenant à la main un sachet de thé. Je souris poliment. Je lui demande si je peux utiliser la salle de bain le temps qu’elle fasse le thé, lui montre mes mains poisseuses. Elle m’indique un petit escalier à l’autre bout de la pièce. Avant de me lever, je frotte mes pieds contre la barre latérale de la chaise pour me débarrasser des miettes de boue. Il fait encore frais. Le petit escalier en forme de coude mène à une toute petite chambre à coucher et à une salle d’eau si basse de plafond que je me demande comment une telle femme peut se mouvoir là-haut. Mes habits collent à ma peau, j’ai du mal à enlever mon sweat-shirt, comme si ma tête avait gonflé. J’étire mon cou et ça craque, je vois la glace qui cède en silence sous le poids de l’orignale et me demande si ça ressent la solitude, un animal aussi sacré, lorsque la mort s’empare de lui. Je m’assois dans la petite baignoire et pose le pommeau de douche sur mon ventre. L’eau coule, chaude, épaisse, elle rigole entre mes jambes et disparaît brune dans la bonde. Je gratte une piqûre d’araignée sur mon bras. Mes ongles s’enfoncent dans la chair de ma rose écarlate tatouée. Ses pétales sont plus forts que les jambes de l’orignale, car ils ne s’écroulent pas sous mes griffes. Quelque chose escalade mon œsophage alors que je revois les tiques recouvrir l’animale. Je lâche un petit glapissement pour ne pas pleurer et attrape le pain de savon. Je le frotte partout, mes mains, mes bras, mes pieds, le brun de mon ventre, sur les encres, mes seins, mes jambes, je frotte tout, même ce qui n’a pas touché l’orignale. Je ne peux pas laver mon cœur au savon. Dedans, la peine de ne pas l’avoir sauvée implose. J’entends Arden qui monte les escaliers et s’arrête derrière la porte de la salle de bain. Elle dit Le thé est prêt. Je me rince, je remplis ma bouche d’eau chaude, recrache.
Quand je descends, je m’arrête à l’articulation du coude de l’escalier, sur un minuscule palier, et regarde par la fenêtre posée là. C’est étrange d’avoir mis une fenêtre ici. Une forêt noire dans un carré. L’orignale est seule. J’ai une crampe à la main gauche. Il fait bien plus chaud au rez-de-chaussée maintenant que le poêle, bouche fermée, rumine le bois, le digère. Elle a posé une tasse sur la table basse près du canapé. J’aime qu’il n’y ait pas de télé mais un feu à regarder. Le thé est âpre, il a un goût de vieillesse et de calcaire. Le chaud fait du bien, alors je ne dis rien. Arden monte se laver, je termine mon thé. J’ai peur qu’en refroidissant il ne devienne encore plus écœurant. Je somnole un peu en écoutant l’eau de sa douche couler. Mes mains sont encore noires, l’orignale qui ne part pas. Quand Arden redescend, elle me tend un t-shirt propre, pour dormir. Je peux faire des œufs brouillés si tu as faim. Son visage tout blanc est boursouflé, la pointe de son nez rose. Elle a pleuré dans l’eau, comme moi. Quand les œufs sont prêts, elle s’assoit à côté de moi et nous partageons la même assiette. Elle a arrosé sa part de Tabasco. On ne parle pas. Le poêle miaule de temps en temps et je lui trouve un prénom dans ma tête. J’aimerais savoir d’où vient le prénom Arden, s’il veut dire quelque chose, qui sont ses parents, pourquoi elle vit seule ici, qui est Jeff, si elle se cogne beaucoup aux poutres et au plafond là-haut, pourquoi sauver les animaux. Je ne pose aucune question. Pas encore. Puis, je prends mon courage à deux mains et je plonge les dents de ma fourchette de son côté de l’assiette, œufs flous tachés d’une épaisseur de Tabasco. Elle me laisse faire, ne dit rien. Accord tacite, un silence pour dire que c’est OK de rester là un peu.
Alors je reste.
Au matin le froid se glisse sous la couverture, le feu s’est éteint pendant la nuit. J’ai envie d’aller aux toilettes mais je n’ose pas monter à l’étage. J’enfile mon sweat-shirt et le jean propre que j’ai dans mon sac. J’ouvre la gueule du poêle, y jette les mouchoirs écrasés au fond de la poche de mon jean sale, souffle sur les braises, réveille le feu, fourre une bûche entre les lèvres grises. Les braises s’en emparent. Dans le vestibule, je glisse mes pieds dans mes bottes et emprunte l’un des gros blousons suspendus à la patère : trop grand pour moi. Le ciel est rose et gris par-delà les sapins et les épicéas, les couleurs se répandent sur la glace. Le sol craquette comme une dizaine d’allumettes sous mes pieds. Mes mains se terrent dans les manches du blouson. Le froid s’empare de mes joues. Je contourne la maison en glissant parfois, cherchant l’équilibre sur cette terre nouvelle et derrière l’abri à bois je déboutonne mon jean et m’accroupis pour uriner sur la neige gelée.
Dans la cuisine, Arden, trop grande, est pliée comme un point d’interrogation au-dessus de la gazinière. Elle prépare une casserole de flocons





























