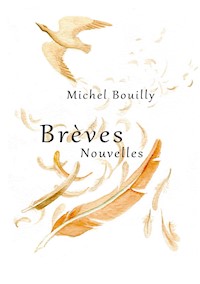
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sandi monte la garde à plus de trois cent mètres d'altitude, dans un froid débilitant. Elle dira tout à l'heure à son père, si elle réussit à l'avoir au téléphone satellite depuis l'Afghanistan, ce qu'elle n'a pu dire à personne et surtout pas à ses camarades de combat. Bernard dans son bureau de La défense souhaite, lui, préserver le secret de ses affaires alors que Jean curé de Bourg-Les-Essonnes craint d'avoir mal agit en partageant celui de la confession. Germaine et Robert ont peut-être choisis la rue à moins qu'elle ne les ait choisis. Le secret n'est qu'un des nombreux thèmes abordés dans ces histoires courtes qui oscillent entre sourires et larmes. Car du clochard au milliardaire, du gilet jaune au cadre supérieur, de l'invisible à l'acteur en pleine lumière, du chauffeur de camion dans les Andes au parachutiste à Mont de Marsan, du tenancier de bistrot parisien à la journaliste d'investigation, tous vivent des difficultés très différentes et pourtant semblables selon leur naissance ou leurs choix. Modèle en vogue, Claire vit, quant à elle, une transformation étrange, qu'elle n'a pas choisie et qui la terrifie, l'écriture sera son salut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Marguerite Duras
L’acte d’écrire peut ouvrir tant de portes, comme si un stylo n’était pas vraiment une plume mais une étrange variété de passe partout.Stephen King
À mes petits enfants de cœur et de sang dans l’ordre d’entrée en scène dans le grand livre de la vie.
Laurie Montès
Théa Montès
Alana Montès
Elya Bouilly
Manon Bessine
Lisa Bessine
Yaël Bouilly
Maël Boisson
Et à leurs parents qui se reconnaitront.
Ces textes vous appartiennent maintenant.
Pourquoi ces pages :
« J’ai toujours aimé écrire et j’ai toujours écrit. Mais ce n’est que depuis que je fréquente l’atelier d’écriture que j’ai le sentiment d’écrire.
Avant mon écriture était utilitaire. Elle avait pour fonction d’expliquer, de décrire ou de démontrer, de conseiller et de convaincre. Elle était corsetée, normalisée, attendue, sans
surprise et quasi machinale. Elle coulait de source mais la source était prosaïque, technique, parfois savante et recherchée mais il suffisait de la débusquer dans les textes existants, la jurisprudence ou les avancées récentes mais documentées.
L’imagination prenait rarement le pouvoir et lorsqu’elle le prenait c’était pour arriver à des solutions utiles, concrètes, pragmatiques.
Elle ne m’apportait comme véritable satisfaction que d’arriver à mes fins au profit de mes interlocuteurs destinataires de ma prose.
Jamais elle ne m’apportait d’émotion, de plaisir, de sensibilité, de surprise.
C’est la surprise qui me manquait le plus mais je ne le savais pas.
C’est grâce à l’atelier, à la force de la consigne, que j’ai découvert l’étonnement… et le plaisir de me retrouver tout à coup ailleurs. Sur des chemins que je n’avais pas, consciemment, choisi d’explorer dans des endroits où je n’aurais pas eu l’idée d’aller. Qui s’imposent à moi sans que je sache toujours pourquoi. Et c’est une sensation incroyable et paradoxale de liberté, une évasion.
Quand je commence à écrire je sais où je veux aller mais je ne sais pas quelle voie je vais prendre, par quel col enneigé, par quelle oasis ombragée, par quelle plage ensoleillée je vais y parvenir.
Je suis mon cap mais je tire parfois des bords improbables qui m’emplissent de joie…et parfois me font peur lorsqu’ils m’enferment dans un cul-de-sac. Mais quelle satisfaction d’en sortir et de retrouver le chemin.
Au plaisir d’écrire s’ajoute celui de lire aux autres, même si longtemps ce fut ma hantise car je peux être un lecteur compulsif et incompréhensible.
C’est là que mes écrits prennent sens. Qu’ils soient bien ou moins bien accueillis, ils vivent.
Les réactions de ce public restreint, complice mais sans complaisance, redoutable mais amical sont précieuses.
Il en résulte des textes toujours perfectibles mais qui sont notre petite musique à nous, celle de l’atelier La plume et l’oreille ».(1)
Ecrire est une sensation de liberté et une évasion plus puissante que la lecture.
Alors j’écris.
Et je partage, aujourd’hui, avec vous qui lirez ces nouvelles agencées en récit autour d’un ou plusieurs personnages récursifs, Robert indissociable de Germaine en première partie ou Claire en dernière partie et leurs proches, ou en nouvelles sur des thèmes divers en deuxième partie.
Dans ces histoires réunies sous le titre de « courtes fictions » deux personnages reviennent une fois, il s’agit de Marianne et de Bob.
Peut-être aimerez-vous tous ces personnages autant que j’ai aimé leur donner vie ?
(1) Extrait de ma présentation in Nouvelles de La plume et l’oreille 2014
SOMMAIRE
INSTANTS DE LA VIE DE ROBERT
Les mains sales
La nuit
La fuite
La peur
Les passeurs
Les vendanges à Haut-Brion
Je m’en vais
L’anniversaire
La petite boite
Les souvenirs
La photo
Le caddie
Les ombres errantes
La question
Le caddie récalcitrant
Par ici la monnaie
Coïncidences
COURTES FICTIONS
Freedom
Marianne au bistrot
Ce soir ils parlent
Tout le monde ne devrait pas être au parfum
Un beau matin d’été
En passant par la Vologne
Le bon, la brute et le truand
Une rencontre improbable
Léa et les invisibles
Une année folle
Le costard
Le jaquet, le chien et l’âne
Des cailloux et des pierres
Une journée particulière
Mondanités
Le serment
L’écharpe
La véritable histoire de Marie-Jeanne et de Billie-Joe
La trottinette
Une si belle journée de printemps
L’invitation
Dick Laurent est mort
On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans
La ville blanche
Dissonances
Patrick Giordano
Un soir comme les autres
Carrousel humide
La première fois
CLAIRE
Cinq ans plus tard
INSTANTS DE LA VIE DE ROBERT
Au fil du temps Robert est devenu un personnage récurrent que je vous propose de découvrir avec ceux qui partagent sa vie, proches ou moins proches.
Les mains sales
Sale journée songea Robert en regardant ses mains.
Elle avait pourtant bien commencé.
Il n’avait pas eu à attendre, contrairement aux autres jours, que le recruteur revienne pour distribuer les boulots les plus durs et les moins payés. Il avait tout de suite été choisi.
La chance était avec lui, et elle avait continué à lui sourire. Un des chauffeurs de la ferme était malade et il était le seul parmi les travailleurs présents à savoir conduire un camion.
C’était un gros bahut et ça faisait longtemps qu’il n’avait pas conduit.
Dans la cabine ses craintes firent place au plaisir. Il avait toujours aimé conduire.
Ça irait. Il y arriverait. Avant de tirer le démarreur les idées se bousculaient, elles disparurent quand le moteur répondit présent.
Il avait aidé à charger et avait vérifié et refait les niveaux d’eau et d’huile du camion, il était en sueur et ses mains étaient dégoûtantes.
Le contremaître ne l’avait pas autorisé à les laver. Il lui avait commandé de commencer sa rotation tout de suite. Robert avait obéi en pestant en silence.
Il avait trop besoin de ce travail et le bonhomme, il le savait, n’était pas commode.
Mais il n’aurait plus à charger, juste à conduire, la benne serait pleine lorsqu’il reviendrait et la noria se poursuivrait toute la journée.
Il obéit au type placé à la sortie de la ferme qui jouait les régulateurs et démarra avec précaution.
Il fallait être prudent dans ces chemins de terre qui serpentaient le plus souvent à flanc de montagne et pourtant il savait qu’on ne lui ferait pas de cadeau s’il ralentissait le rythme des autres camions.
Il en avait compté dix et les autres chauffeurs étaient habitués.
Il aurait bien aimé avoir les mains propres.
Détends-toi ça va aller. Respire, tu en as vu d’autres. Concentre-toi. Tiens bon le manche.
Ça y était, ça roulait. Le camion répondait bien malgré son apparence et son âge.
Robert se sentait mieux à présent. De mieux en mieux malgré ses mains sales. Il espéra pouvoir les laver à l’arrivée avant de repartir.
Il était parti troisième et s’efforça de calquer sa vitesse sur celui qui le précédait.
Il leur fallut une demi-heure pour arriver au quai de déchargement de la voie ferrée qui conduisait à l’usine de transformation. Là, il fit comme les autres chauffeurs et ne descendit pas de son camion.
Il avait compris que son espoir de se laver bientôt était assez compromis.
Les camions reprenaient la route aussitôt et croisaient ceux qui étaient partis après eux. Le retour en était rendu plus difficile et bien plus risqué. Certains passages le virent accroché à son volant comme à une bouée.
Fais gaffe. Serre les fesses. Te fous pas en l’air. Ça va aller.
Ce n’est qu’une fois revenu à son point de départ qu’il respira vraiment.
Il était en nage mais ça n’avait plus rien à voir avec sa transpiration du départ et il avait toujours les mains sales.
Il chercha depuis sa cabine s’il voyait un point d’eau tout en réalisant qu’il serait improbable qu’il puisse en profiter. En effet les camions recevaient aussitôt une benne pleine sans que les chauffeurs descendent de leur poste de conduite.
Il vit près d’un hangar une pompe auprès de laquelle semblaient s’affairer des femmes.
Il devait y avoir de l’eau.
C’est là qu’il pourrait se laver les mains, plus tard, dès que possible, au prochain tour peut-être ?
Et la course reprit.
Il serrait les dents et le volant , les chargements et déchargements se succédèrent sans temps mort.
Même pour manger leur maigre repas les chauffeurs ne s’éloignèrent pas de leur camion. Ils s’adossèrent au quai ou à leur bahut et il ne vit pas de point d’eau à proximité.
Moins de dix minutes plus tard, ils étaient repartis.
La noria se poursuivit au même rythme jusqu’au soir entre chien et loup.
Pour ce dernier voyage il ne desserra ni les dents, ni les fesses et il est probable que le volant garde la trace de ses doigts incrustée à jamais dans l’ébonite.
Enfin ils descendirent tous de leurs bahuts après les avoir alignés côte à côte et se dirigèrent vers la cabane où la paie était distribuée.
Mais avant d’y aller Robert courut vers la pompe qu’il avait vue plus tôt dans la journée.
Il l’actionna avec énergie et espoir, mais en vain. Il ne put obtenir d’elle qu’elle accepte de lui offrir la moindre goutte d’eau. Il constata qu’elle n’en avait sans doute plus donné depuis bien longtemps.
.
La nuit
Robert, sa paie en poche, se dirigea vers la sortie de la ferme. Il allait devoir faire les quelques kilomètres qui conduisaient au village avec les mains toujours sales car, il le savait, il n’y avait pas d’habitation ni le moindre point d’eau sur le chemin.
La nuit était déjà là, la lune avait remplacé le soleil et il distinguait parfaitement ceux qui, comme lui, retournaient vers les leurs par petits groupes. Les paroles qu’ils échangeaient s’élevaient dans l’air et semblaient parfois ricocher sur la montagne autour d’eux. Puis ce sont des chants qui s’élevèrent provenant du groupe le plus éloigné de lui, parmi lequel il reconnut des voix de femmes. Lui était seul. Il était aussi le dernier. Enfin c’est ce qu’il pensait.
Sans y prendre garde, il s’était rapproché du groupe qui le précédait depuis le départ.
Il entendait et comprenait même leur conversation mais eux ne l’entendaient sans doute pas.
Il comprit qu’ils parlaient de lui. Ils s’étonnaient qu’un type qui paraissait aussi misérable qu’eux sache conduire et s’occuper d’un camion. Il sait même peut-être lire supposa une des voix.
II était arrivé dans le village depuis moins d’un mois et n’avait pas vraiment cherché à lier connaissance avec les autochtones.
Il aurait dû le faire car maintenant la méfiance semblait de mise à son encontre et il n’avait pas besoin de ça.
Ce n’est pas avec la paie d’aujourd’hui qu’il pourrait facilement tailler la route et il n’en avait ni l’envie... ni le courage.
Il comprit aussi, en les écoutant, leur crainte qu’il prenne leur travail.
Aussi pénible fût-il, il leur permettait de vivre. Cependant aujourd’hui ils paraissaient plutôt contents. Ce n’était pas leur travail qu’il avait pris mais celui réservé à la caste des chauffeurs de camion de la ferme.
Devait-il en être rassuré ? Il voulait le croire.
Mais il décida de rester vigilant.
Il s’efforça de garder la même distance entre lui et eux jusqu’au village et de ne pas faire de bruit. En fait inconsciemment, il se laissa distancer.
On était encore loin de la plaine.
Le chemin serpentait à flanc de montagne, et de loin en loin on entendait des cailloux déplacés par les marcheurs dévaler la pente.
Il se mit à repenser à la journée qui venait de s’écouler, où il avait retrouvé le plaisir de conduire, mais où il avait aussi affronté la peur de finir dans le ravin. Ses doigts étaient encore douloureux d’avoir trop serré le volant.
Il espérait recommencer demain et même les jours suivants. Il s’habituerait, il dominerait sa peur, elle disparaîtrait c’est sûr.
Il avait encore perdu du terrain sur le groupe qui le précédait, il ne les entendait plus, depuis un grand moment lui semble-t-il, et soudain il eut conscience qu’il n’était plus seul.
Une ou plusieurs personnes étaient derrière lui, plusieurs personnes ou une seule, il ne savait pas qui essayaient de ne pas faire de bruit, qui cherchaient à le surprendre, ça il en était presque sûr, une ou plusieurs personnes qui ne lui voulaient pas du bien, ça il le sut, tout à coup sans le moindre doute.
Il se retourna et là, à moins de vingt mètres, il discerna les trois hommes qui se voyant découverts se mirent à courir vers lui. Trois hommes qu’il avait côtoyés lors de leur repas de midi adossés à leur bahut. Ils étaient armés de bâtons ou de manches de pioches. Cà, il le saurait bientôt.
Fuir ou faire face, c’est la question, mais quelle est la réponse ?
Le courage c’est de faire face mais la raison disait qu’a trois contre un il vaut mieux fuir. C’est ce qu’il fit.
Sans doute avait-il mis trop de temps à répondre à la question car déjà l’un des trois chauffeurs l’avait rejoint et là il sut que c’était un manche de pioche qui cherchait le contact avec son crâne.
Par chance il esquiva et déséquilibra son agresseur qui dévala la pente mais c’est un deuxième adversaire qui se rua sur lui avant qu’il ait put lui-même retrouver son équilibre. Il sentit les cailloux se dérober sous ses pieds et vit le deuxième manche de pioche au-dessus de lui.
Il eut le temps de voir le troisième poursuivant qui levait à son tour son arme quand « Il y eut un long grondement, et il lui sembla glisser sur une interminable pente. Et, tout au fond, il sombra dans la nuit. Ça, il le sut encore: il avait sombré dans la nuit. Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir. » (2)
2 Martin Eden de Jack London
La fuite
Là, un cochon qui court ! Robert l’aperçut au moment où il ouvrait une fenêtre du séjour pour laisser une dernière fois son regard glisser sur la place avant de quitter cet appartement à tout jamais.
Il avait toujours su qu’il ne pourrait pas rester là mais il aurait aimé que ça dure encore un peu.
Ça n’était pas vraiment un appartement, plutôt une case en adobe, mais elle avait un toit et la vue sur la place le mettait à l’abri des intrus et des surprises qui vont souvent avec.
Pourtant après la mésaventure d’hier au soir il n’avait pas le choix.
Les habitants de Rio Suarez ne voulaient pas partager leur misère avec lui.
Surtout, ils ne pouvaient pas partager le travail rare et mal payé avec lui.
Ils lui avaient signifié sans détour qu’ils le préféraient mort et lui voulait vivre, même une vie difficile.
Il devrait la vivre ailleurs.
Hier au soir, il avait cru mourir, un moment même il avait cru être mort.
Il avait été happé par un éboulis de pierres et avait perdu connaissance.
Il s’était réveillé dans la nuit, au fond du ravin, avec des égratignures, la bouche les oreilles et le nez pleins de terre, mais sauf.
Revenu à sa case et aussitôt lavé, il avait réuni ses maigres affaires dans le sac de toile noir qu’il avait en arrivant dans ce village.
Il n’avait pas eu le temps d’avoir peur.
Maintenant il avait peur.
Peur de leur misère qui interdisait d’accepter l’étranger qu’il était.
Peur de leur violence, celle du désespoir de ne pas être sûr de pouvoir nourrir leurs enfants.
Cette violence provoquée par celle des puissants dans la main desquels ils n’étaient pas plus que du bétail, des animaux de labeur dont ils suçaient la force pour en faire de l’argent.
Des animaux sans espoir et sans avenir qui ne savaient jamais si le maître, où le contremaître daignerait leur faire l’aumône de leur offrir du travail.
Il avait chaussé les grosses godasses de l’armée de type Rangers qui l’avaient conduit ici, quelques semaines plus tôt, et qu’il aurait voulu avoir rangées pour plus longtemps.
Ils étaient esclaves dans un monde où ce mot était récusé, nié, juridiquement absent et interdit mais abominablement réel.
Ils étaient révoltés mais ils n’exprimaient leur révolte qu’à l’égard de ceux qu’ils pouvaient atteindre, les pauvres et faibles comme eux.
Il avait eu le tort d’accepter le travail d’un chauffeur malade, père de quatre enfants, et leur crainte était que ce soit lui, l’étranger, qui soit désormais choisi tous les matins par le contremaitre.
C’est la caste des chauffeurs de camion de la ferme qui s’était inquiétée.
Il fallait qu’il disparaisse.
Les fermiers étaient trop forts à l’abri de leurs chiens bien nourris et de leurs hommes de main bien payés.
S’en prendre à eux signifiait mourir de faim ou de mort violente. Tous le savaient ou le croyaient.
Il prit son gros blouson de cuir marron lourd mais protecteur, endossa le sac noir et sortit.
Le cochon coureur et maigre était sur la place en terre battue avec les chiens jaunes.
Groin et truffes raclant le sol sec, ils cherchaient tous à manger.
Il était tard, largement après l’heure d’embauche par les recruteurs et pourtant beaucoup d’hommes et de femmes étaient là dans leurs ponchos colorés.
Le son d’une flute andine sortait d’une des maisons devant laquelle des enfants jouaient.
Il n’y avait, sans doute, pas eu beaucoup de travail distribué aujourd’hui, ou il l’avait été dans un autre village et pour moins cher.
Les firmes transnationales avaient toutes les stratégies imaginables pour réduire les coûts de main d’œuvre tout en affectant de n’en rien savoir et de n’y être pour rien.
Rendre le travail rare pour moins le payer était le fait des propriétaires fermiers pas de la multinationale acheteuse unique qui ne s’estimait pas responsable de ce dont elle était la cause.
Ses contrats d’achat stipulaient expressément cette exonération de responsabilité.
Dans le même temps sa communication financière insistait sur le respect scrupuleux d’une charte éthique pour une agriculture durable au profit des populations indigènes.
Les chiens aboyèrent en le voyant et coururent vers lui.
Puis se turent en le reconnaissant et l’ignorèrent car il n’avait rien à leur donner, comme d’habitude.
Il songea qu’il se comportait avec eux comme un de ces maîtres dont tous les hommes les femmes et les enfants d’ici souffraient.
Il partit sans se retourner.
La peur
Aveuglante, violente, la lumière entre à flots stressants dans la chambre obscure et inonde les draps du lit.
Robert a peur.
Depuis l’agression de la nuit dernière elle ne le quitte pas.
Il a réussi à quitter le village de Rio Suarez tôt ce matin, des femmes, des enfants et des hommes désœuvrés étaient là sur le pas de leur porte et ils l’ont vu partir.
Il a marché toute la journée en suivant la seule route possible, la seule existante, celle qui l’avait vu, hier, cramponné au volant d’un camion les fesses serrées et les mains sales, aller et venir toute la journée des champs au quai de déchargement sur la voie ferrée dans la vallée.
Il avait eu peur mais sa seule crainte avait été la sortie de route.
Il s’était concentré sur la route de pierres et cailloux et sur sa conduite.
Il avait souvent tutoyé le ravin mais avait réussi à ne pas l’embrasser.
Aujourd’hui il est à pied et c’est une autre peur qui l’oppresse depuis hier, depuis que les chauffeurs ont tenté de le tuer parce qu’il a pris la place d’un des leurs.
La violence de la lumière a fait ressurgir sa peur, aussi violente que la lumière.
Il ferme les yeux.
Lorsqu’un premier camion était arrivé derrière lui, il l’avait entendu au loin et il avait eu le temps de se cacher dans le fossé.
Il y était resté un long moment à observer et à évaluer le temps entre deux camions, ceux qui descendaient comme lui et ceux qui remontaient après avoir déchargé. Puis il était sorti pensant avoir trouvé le rythme de la noria. Il allait jouer avec.
Il ouvre les yeux, la lumière aveuglante l’agresse. Il se recroqueville dans le coin de la pièce le plus éloigné de la fenêtre et ferme à nouveau les yeux.
Raté, il n’était pas plutôt sorti du fossé qu’il lui avait fallu y retourner et se glisser dans une trouée entre les bambous.
Deux camions s’étaient croisés à sa hauteur mais les chauffeurs ne l’avaient pas vu, il en était presque sûr.
Cependant il décida de ne plus prendre de risque et de n’avancer, désormais, qu’en dehors de la route en la surplombant ou en contrebas dans la végétation parmi les podocarpus, les bambous, les cecropias et les orchidées.
Sa progression était devenue moins facile et moins rapide mais plus sûre…enfin il l’espérait.
Il n’ose pas rouvrir les yeux.
Il écoute. Aucun bruit n’accompagne la lumière.
Elle ne vient pas des phares d’un camion, les chauffeurs seraient déjà là, sinon ils seraient en train de le chercher et il les entendrait parler et marcher dans le gravier de la cour du motel.
Il se félicitait d’avoir chaussé ses godasses de l’armée et de n’avoir pas trop de poids dans son sac à dos en toile.
La végétation luxuriante et colorée et les oiseaux multicolores qui s’envolaient à son passage le consolaient d’avancer moins vite.
De temps à autre ce sont les petits mammifères de la forêt andine qui déboulaient devant lui et à qui il faisait parfois peur, ce qui n’atténuait pas la sienne.
Il tremble. Il a froid.
Il ouvre les yeux pour regagner le lit.
Il n’avait pas mangé depuis hier midi lors de la courte pause, adossé à son camion et son estomac disait son manque beaucoup trop fort pour qu’il l’ignore.
Il s’arrêta et en quelques minutes il avait mangé en cueillant et amassé assez de papayes, pitayas, anones et pacays pour calmer sa faim et se désaltérer en même temps.
Il avait aussi mangé quantité de baies toutes sucrées ou acidulées sauf une qu’il avait cru reconnaître et qu’il avait aussitôt recrachée tellement elle était amère et astringente.
Il avait fallu qu’il se nettoie les papilles en mangeant une grosse papaye qu’il avait gardée pour plus tard sans arriver à se débarrasser de la gêne.
Alors qu’il approchait d’un arroyo, un pécari brun et gris avec son collier de poils blancs traversa le sentier à quelques mètres de lui et s’arrêta sans la moindre once de peur.
Ce n’est qu’après avoir dégusté au bord du chemin une grosse limace brune, qu’il s’enfonça sans se presser dans les broussailles.
Robert songea qu’il aurait bien aimé être aussi décontracté que ce cochon.
Lui fuyait, le pécari non.
Sa course se poursuivit jusqu’à la fin de l’après-midi au moment où il avait rejoint le motel situé un peu à l’écart de la route.
Il avait décidé d’y passer la nuit avant de mettre encore plus de distance entre lui et les chauffeurs qui ne lui voulaient pas du bien.
Il faisait encore jour lorsqu’il s’était affalé sur le lit sans penser à tirer les rideaux.
Il a trop froid. Il faudrait qu’il se couvre.
La lumière ne lui semble plus agressive, elle lui parait même faible et blafarde.
Robert avait la bouche pâteuse et avait soif.
Il était couché et n’arrivait pas à dormir.
Il s’était réveillé en sursaut lorsque les lampadaires éclairant le parking et les enseignes du motel s’étaient allumés.
Le goût amer des baies recrachées était toujours là. Sa langue était épaisse et lourde.
Il faut qu’il boive.
Il se lève pour aller au lavabo et se rend compte que la lumière qui le terrifiait tout à l’heure n’a rien d’effrayant.
L’eau a mauvais goût mais moins que l’amertume qu’elle atténue sans la faire disparaitre.
Robert comprit tout à coup ce qui venait de lui arriver.
Les baies qu’il avait ingérées, même s’il en avait recraché le plus possible, avaient été la cause de son cauchemar à demi-éveillé.
Elles avaient des effets psychotropes et dans son premier sommeil, là où il avait vu une lumière aveuglante et violente, il n’y avait qu’une lueur banale.
Le passage de la demi-obscurité à l’éclairage du parking avait été perçu par ses rétines et son cerveau fatigué et stressé, par la peur qui l’habitait depuis hier au soir, comme si les phares des camions dont les chauffeurs voulaient sa mort, s’étaient subitement allumés.
Les passeurs
Un soleil insolent illumine la place de La Comédie et la façade du Grand Théâtre.
L’horloge affiche dix heures.
Le ciel est bleu sans le moindre nuage.
Tout serait pour le mieux si le caddie ne poussait des couinements bruyants et effrayants et s’il ne faisait déjà très chaud.
Robert est en nage.
Il se reproche de n’avoir pas suivi sa première idée de faire deux voyages.
Les cartons et les liasses de papier destinés pour l’essentiel à restaurer la cabane au bord de la Garonne auraient suffi pour le premier.
Il avait fallu qu’il décide dans un deuxième temps imprudemment, avec un peu de forfanterie peut-être, de prendre aussi tous les listings d’ordinateur qui prennent moins de place. Il n’avait pas pensé à leur poids.
Il n’est plus très sûr d’arriver à faire les six kilomètres qui le séparent de sa résidence en planches et cartons.
Le caddie geint sans retenue et Robert à l’impression que tous les regards sont sur lui.
Il n’aime pas attirer l’attention, même s’il n’est pas sûr que pour vivre heureux il suffise de vivre caché.





























