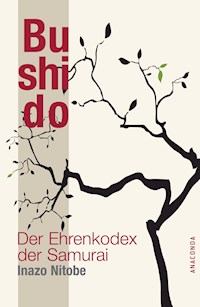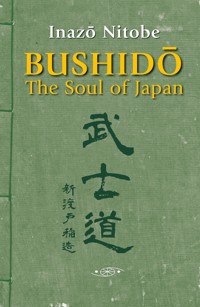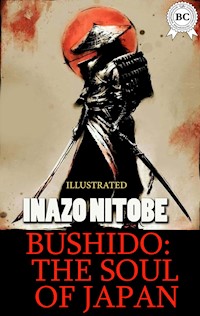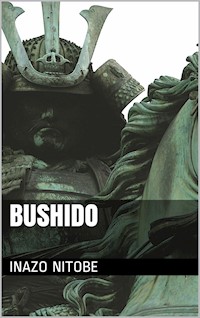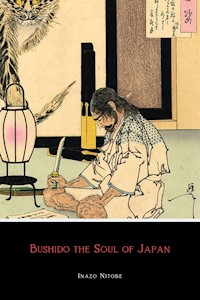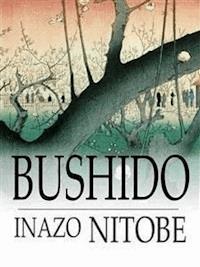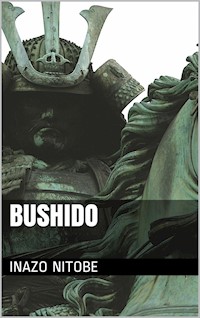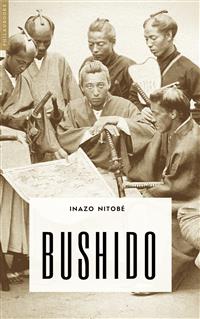
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’auteur développe l’éthique du Bushido, et explique ses ramifications dans la société de l’ancien Japon. Il nous la fait connaître en faisant des comparaisons avec ce qui est familier aux Occidentaux.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bushido, l’âme du Japon
Inazo Nitobé
Charles Jacob
philaubooks
Table des matières
Préface
Avant-propos
Avant-propos de l’édition française
1. Le Bushido, en tant qu’éthique
2. Les sources du Bushido
3. Rectitude ou Justice
4. Le courage, l’esprit d’audace et d’endurance
5. Bonté, pitié pour la douleur
6. La politesse
7. Véracité et sincérité
8. L’honneur
9. Le devoir de fidélité
10. L’ Education et le dressage d’un samourai
11. Le contrôle de soi
12. Les Institutions du suicide Réparation des torts
13. Le Sabre : âme du samourai
14. L’éducation et la condition de la femme
15. L’influence du Bushido
16. Le Bushido est-il toujours vivant ?
17. L’avenir du Bushido
À propos de l’auteur
Sur le Japon
Préface
Le livre de M. Inazo Nitobé, qui avait été traduit dans presque toutes les langues, ne l’avait pas encore été dans la nôtre. Grâce à M. Charles Jacob ce retard a été réparé, et aussi élégamment que possible. Le public français pourra lire une étude sur la chevalerie japonaise dont la grande originalité est d’avoir été écrite par un Japonais qui non seulement a reçu une très forte culture européenne, mais encore qui s’est fait chrétien. Sa culture européenne lui a permis de l’écrire pour les Européens et de la leur rendre plus sensible en la rapprochant de la nôtre et en invoquant le témoignage de nos philosophes. Son christianisme très sincère donne un démenti à ceux de ses compatriotes qui considèrent que la religion chrétienne est l’ennemie des traditions japonaises et que ses convertis deviennent de mauvais de nationalistes.
Il est difficile, en effet, de présenter le passé du Japon sous un plus beau jour et d’en parler avec une plus tendre piété que M. Nitobé. Il semble même qu’il en ait effleuré l’authentique beauté morale d’un rayon plus intime et plus doux dérobé à l’Evangile.
Dans mon second voyage au Japon, en cette sinistre année 1914, — j’ai déjà eu l’occasion de le dire, — un de mes étonnements fut d’entendre parler autour de moi du Bushido. Ce mot, qui signifie Voie du Guerrier, n’était point employé avant 1900, et, si j’ai bonne mémoire, il ne se rencontrait alors dans aucun dictionnaire japonais. Un Anglais, ancien professeur de philologie à l’Université Impériale de Tokyo, à qui nous devons des ouvrages excellents sur le Japon moderne, M. Basil Chamberlain, avait même publié à ce sujet, en 1912, une brochure assez mordante. Il avait eu, je crois, à se plaindre des Japonais, jugeait leur nationalisme menaçant et les accusait d’avoir, sous ce terme de Bushido, inventé, manufacturé une nouvelle religion. A vrai dire, le Bushido n’était pas une religion nouvelle. Mais le Japon, à la fois très particulier et très assimilateur, obéit à un rythme constant. Il se jette sur les nouveautés, s’y attache comme à son salut ; puis il s’en détache, travaille à en éliminer tout ce qui ne s’accorde pas à son génie et transforme le reste. C’est ce qu’il a fait jadis avec la civilisation coréenne et chinoise. Après un engouement excessif et dangereux pour les idées et les conceptions européennes, il s’était repris ; et le Bushido n’était qu’une des formes morales de cette reprise.
Il s’agissait d’empêcher que le peuple japonais pût oublier le code d’honneur non écrit, mais gravé dans le cœur de ses ancêtres, et de lui rappeler que ce n’étaient point les importations d’Europe qui avaient triomphé sur les champs de bataille de Mandchourie, mais bien le vieil héroïsme que la caste militaire lui avait transmis. C’était à ses antiques générations de samuraïs, dont l’esprit s’était communiqué à toute la nation, que le Japon devait d’avoir vaincu. Ce code consistait, comme le dit très bien M. Nitobé, en maximes orales ou recueillies par les moralistes, les poètes, les dramaturges. Il ressortait de la religion primitive du Shintoïsme qui divinisait les Empereurs, qui commandait la piété filiale, mais où la morale confucéenne s’était introduite et un peu de la résignation du Bouddhisme. Il se dégageait surtout des beaux exemples dont l’histoire japonaise fourmille.
Ce qu’il y a de certain, c’est que, dans cet archipel de l’Extrême Orient, une conception chevaleresque s’est formée dont nous ne trouvons la pareille ni en Chine, ni en Malaisie, ni dans l’Inde. Les premiers Européens qui y abordèrent en furent étonnés et émerveillés. Saint François Xavier, qui avait du sang de hidalgo dans les veines et qui, sous son humilité et son dévouement d’apôtre, gardait toujours le sentiment de son origine et de ses traditions, ne nous a pas caché sa surprise en découvrant chez ces païens des vertus qui allaient s’effaçant Europe et, par dessus toutes, le mépris de l’argent et la noblesse pauvre aussi honorée que la noblesse riche. L’idéal de politesse du chevalier japonais, du samuraï, n’était pas seulement, selon l’expression de M. Nitobé, un continuel effort vers la beauté, une grâce obtenue par la plus grande économie de mouvement ; c’était la mise en pratique des principes moraux les plus nécessaires. Il exigeait de l’homme un contrôle incessant de soi-même.
Le souci minutieux des détails auquel il l’astreignait, la rareté et la lenteur mesurée des gestes qu’il lui imposait, bridaient impatiences toujours si dangereuses ses dans un pays où le sabre jaillissait facilement du fourreau. Cette politesse jetait le guerrier sur un réseau de mailles fines, légères, mais serrées, qui réprimaient ses brusqueries et ses impulsions passionnées. Elle l’obligeait du moins à prendre le temps de la réflexion. Et comme si elle n’eût pas encore été assez sûre d’elle-même, elle cherchait un auxiliaire jusque dans les costumes d’apparat. Elle emprisonnait l’homme dans des vêtements où son corps était comme perdu. Les manches tombantes paralysaient la violence du premier mouvement ; les pantalons si larges, et d’une telle longueur que celui qui marchait dedans semblait se traîner à genoux, ne permettaient plus ni l’assaut ni la fuite. L’ampleur de ces voiles désarmait les individus, élevait entre eux des barrières infranchissables de soie bruissante.
Le chevalier japonais n’apprenait pas uniquement à se posséder ; il n’oubliait jamais les devoirs de la courtoisie qui nous commandent de penser aux autres avant de penser à nous-mêmes et de ne point les assombrir du spectacle de nos chagrins ou de nos maux. Il savait taire ses souffrances, donner à ses plus grands deuils un visage souriant, accepter les pires coups du sort avec une résignation si calme qu’il semblait ne pas en avoir été touché. Je ne crois pas qu’en aucun pays, à aucune époque de l’histoire, le stoïcisme ait été plus loin. Et surtout en face de la mort. La mort n’était point aux yeux des samuraïs une libératrice. L’idée qu’elle leur assurât une vie heureuse en échange de leur dernier soupir leur eût répugné à l’égal d’un marchandage. Trop fiers pour interroger qui se tait, considérant comme une inconvenance de scruter ses ténèbres, ils ne lui demandaient qu’une attestation d’honneur satisfait et de devoir accompli. Elle dépouilla pour eux son appareil de douleur et d’anxiété. Ils la vidèrent de toute idée troublante. Ils en firent une habitude, institution, le dénouement normal des difficultés de la vie. Un samouraï avait-il égaré le dépôt de son maître ? Il se tuait. Le maître l’avait-il offensé d’une parole ou d’un geste ? Il se tuait. On mourait pour protester contre une consigne ; on mourait pour n’avoir pu venger une injure. Se tuer paraissait la suprême élégance de la civilisation. Dans la cérémonie de l’ouverture du ventre, au moment où le samouraï agenouillé se frappait, son ami le plus cher, debout à côtés, lui tranchait la tête. Les sabres japonais opéraient avec une rapidité d’éclair. On les voyait, ne dit-on, que se relever,
M. Nitobé a cité la fameuse description du harakiri faite par l’Anglais Mitford dans ses Contes de l’Ancien Japon — un livre que je voudrais voir traduit, celui de tous les livres européens qui nous rend le mieux l’état du Japon féodal du temps où les étrangers y pénétrèrent Il n’avait pas changé depuis des centaines d’années. Cette description d’un, témoin oculaire est extraordinaire et pathétique. J’ai entendu de la bouche d’un de nos plus vieux résidents, à la fin du siècle dernier, un récit pareil et encore plus étonnant. Ce vieil homme en avait gardé un souvenir qui le poursuivait comme un cauchemar.
L’homme qui s’était tué devant Mitford avait été condamné pour avoir tiré sur les Européens : son exécution était politique. Mais le drame auquel avait assisté notre compatriote s ’était passé dans une école. Le fils d’un samuraï, un jeune homme de dix-huit ou vingt ans, avait volé la montre d’un de ses camarades. On le soupçonnait et on la découvrit, pendant son sommeil, dans ses vêtements. On l’éveilla ; il avoua ; et il comprit qu’il devait mourir. Séance tenante, en présence du directeur, des maîtres et de ses camarades, l’horrible cérémonie s’accomplit. Les parents, prévenus dès le matin, remercièrent le directeur d’avoir ainsi sauvegardé leur honneur.
Jamais la vie n’eut moins de prix que chez peuple ce qui pourtant en goûtait les fines douceurs. Fils et filles de samouraï étaient élevés à la dure, les uns maniant le sabre, les autres la lance. Dans le programme de leur éducation, la pensée de la mort jouait un tel rôle qu’on leur enseignait le cérémonial du suicide. A l’âge où les séductions de la vie sollicitent le cœur et les sens, les jeunes gens apprenaient dans quelle attitude et suivant quels rites une personne bien née devait s’ouvrir le ventre. D’aucuns même y témoignèrent d’une épouvantable précocité. Je ne crois pas qu’il eut plus de sept ans, ce petit Japonais dont on raconte l’histoire suivante. Des meurtriers dépêchés contre son père et abusés par une ressemblance rapportèrent à leur maître une tête dont personne ne pouvait dire si elle était celle du coupable. Le seigneur envoya chercher l’enfant et la lui découvrit. Celui-ci, comprenant l’erreur et la nécessité d’y fortifier les assassins, dégaina le poignard que, dès leur jeune âge, portaient les fils de samuraï, et, pour donner à son silencieux mensonge l’autorité du désespoir, tomba, les entrailles coupées, devant la face sanglante. Jamais l’idée de la gloire, car elle est au — fond de ces tous suicides, - n’a pareillement soutenu l’homme et n’a également violenté et maîtrisé les plus irréductibles instincts de la nature. Et c’est par là, je l’avoue, que les âmes japonaises nous restent le plus mystérieuses.
M. Nitobé nous en a exposé toutes les vertus ; et tout est vrai dans son livre ; mais, — ce n’est pas un reproche que je lui adresse, — il a laissé de côté la rudesse souvent inhumaine dont elles étaient la rançon. Un des exemples les plus curieux de la courtoisie japonaise, je l’ai trouvé dans un roman populaire, le Casque parfumé, qui eut un très grand succès après la guerre russe. Un célèbre guerrier du XVIIe siècle, Kimura, dit adieu à sa jeune femme Shirotai. Elle ne se fait aucune illusion ; elle sait qu’il ne reviendra pas du combat, car il lui a recommandé de parfumer son casque. Quand un bon samouraï était décidé à mourir sur le champ de bataille, il voulait que son casque embaumât le musc, afin qu’on reconnût sa noblesse et que le parfum rendît moins âcre au vainqueur l’odeur de la tête coupée. Quelle attention posthume ! Quelle politesse ! Et quel orgueil aussi !
Le Bushido, privilège d’une caste, subsiste-t-il encore ? Son influence a été considérable. Les classes inférieures reçoivent toujours leur direction morale de celle qui les dirige. Les histoires, les romans, les drames japonais sont pleins de marchands et de rustres qui savent mourir comme des samuraïs. On ne dira jamais assez tout qu’on peut obtenir de l’homme quand on fait appel à son amour-propre et quand on lui offre l’occasion de se distinguer. Mais il faut toujours que la leçon vienne d’en haut, que le branle soit donné par une aristocratie. C’est dans le roman russe que l’aristocrate demande au moujik des règles de conduite et le mot de sa destinée. S’il le fait, soyez sûr qu’il est dégénéré, sur le point d’abdiquer, n’ayant plus de boussole et ses étoiles étant éteintes. Le Bushido a déposé dans l’âme populaire japonaise des principes de grandeur, la conception d’un idéal qui n’est pas. mort. Et cependant, vers la fin de livre, M. Nitobé laisse percer quelque inquiétude. Il ne se dissimule pas que l’utilitarisme de la société moderne attaque et mine ce vieux code d’honneur écrit dans les consciences. Il a beaucoup voyagé ; il connaît l’Amérique, l’Angleterre, la France, l’Allemagne ; il a essayé toute sa vie de concilier l’esprit international avec son ardent patriotisme et son culte passionné des traditions nationales. On dit qu’il a rendu d’éminents services à la Société des Nations. Pour lui, le Christianisme et le matérialisme sont destinés à se partager le monde. Et il se demande de quel côté s’enrôlera le Bushido. Il souhaiterait de tout son cœur que la religion chrétienne recueillît ce qui reste de ce noble héritage et le conservât en lui donnant de nouvelles forces. Il rêverait d’un stoïcisme chrétien. C’est un beau rêve. Mais il a parfaitement raison quand il dit que, si le Bushido, en tant que code indépendant de morale, peut disparaître, il ne mourra pas plus que n’est mort l’antique stoïcisme. Et son livre s’achève en un acte de foi dans les destinées de peuple auquel son nous souscrivons bien volontiers.
ANDRÉ BELLESSORT.
Avant-propos
Il y a environ dix ans, alors que je passais quelques jours sous le toit hospitalier du distingué juriste belge, le regretté M. de Laveleye, notre conversation, au cours d’une de nos promenades, tomba sur la religion. « Voulez-vous dire, demanda le vénéré professeur, que vous n’avez aucun enseignement religieux dans vos écoles ? » — Sur ma réponse négative, il s’arrêta soudain fort surpris, et, d’une voix que je n’oublierai de longtemps, il répéta : « Pas de religion ! Comment alors arrivez-vous à donner une éducation morale ? » — La question me laissa tout d’abord désemparé. Je fus incapable d’y répondre, car ce n’est pas à l’école que m’avaient été donnés les préceptes moraux qu’on m’avait inculqués dans mon enfance ; et ce n’est que lorsque j’eus commencé à analyser les divers éléments dont se composaient mes notions du bien et du mal que je m’aperçus qu’elles n’avaient été suggérées et comme soufflées par Bushido.
Ce qui a été la raison déterminante de ce petit livre, ce sont les questions fréquentes que me posait sans cesse ma femme sur les motifs qui avaient fait prévaloir au Japon telles coutumes et telles idées.
En essayant de répondre d’une manière satisfaisante à M. de Laveleye et à ma femme, je m’aperçus que — à moins d’avoir compris l’époque féodale et le Bushido, — les idées morales du Japon actuel resteraient lettre close.
Profitant d’un repos forcé consécutif à une longue maladie, je transcrivis, dans l’ordre même présenté aujourd’hui au public, quelques unes des réponses données par moi au cours de nos causeries familières. Ce que ces réponses contiennent en substance, c’est principalement ce qui m’avait été enseigné et dit dans ma jeunesse, alors que la féodalité brillait encore de tout son éclat.
Entre Lafcadio Hearn et Mrs. Hugh Fraser, d’une part ; et, de l’autre, Sir Ernest Satow et le Professeur Chamberlain, on se sent vraiment un peu découragé quand on ose écrire, en anglais, quoi que ce soit sur le Japon. Le seul avantage que j’aie sur eux est que je puis m’arroger le privilège d’être le propre défenseur de ma cause au lieu que ces distingués écrivains, ne sont tout au plus que des avocats ou des procureurs. J’ai pensé bien souvent : « Ah ! s’il m’était donné de m’exprimer comme eux, comme en termes plus éloquents je présenterais la cause du Japon ! » Mais celui qui s’exprime dans une langue qui n’est pas la sienne doit s’estimer heureux s’il arrive seulement à se faire comprendre.
Dans cet essai, j’ai essayé d’illustrer, à la lumière d’exemples parallèles empruntés à l’histoire et à la littérature européenne, beaucoup des points que j’ai traités : en procédant ainsi, j’estimai que j’aiderais le lecteur étranger à bien comprendre.
Si quelqu’une de mes allusions : soit à des sujets religieux, soit à des membres du clergé, pouvait alarmer certaines susceptibilités, j’espère en tout cas que mon attitude envers le Christianisme ne sera jamais mise en doute. C’est pour les méthodes et les formes ecclésiastiques qui faussent les enseignements du Christ que j’ai peu de sympathie, non pour ces enseignements mêmes. Je crois en la religion qu’il a enseignée et qui nous a été transmise par le nouveau Testament, et je crois pareillement à la loi qui est inscrite dans le cœur. Je crois aussi que Dieu a fait un Testament qui peut être appelé « Ancien » par chaque individu et par chaque Nation : — Gentils ou Juifs, Chrétiens ou Païens. Quant au reste de ou ma théologie, j’en épargnerai l’exposé à la patience du public.
En terminant cette préface, je désire exprimer mes remerciements à mon amie Anna C. Hartsborne, pour beaucoup de précieuses suggestions.
I. N.
Avant-propos de l’édition française
Depuis son apparition, ce petit livre a eu une histoire assez inattendue et plus riche en résultats qu’on n’eût pu le prévoir.
Au Japon, il a jusqu’à ce jour été réimprimé 30 fois ; en langue anglaise il a atteint la douzième édition, et il a été également traduit en allemand, en polonais, en tchèque, en norvégien, en mahratti, en suédois, en italien, en espagnol et en japonais ; une traduction chinoise est projetée. Certains chapitres du Bushido ont été offerts aux lecteurs russes et hongrois dans leurs langues respectives.
Voici enfin, due à Madame Schroeder et à M. Charles Jacob, lauréat de l’Institut, la version française que le public lettré attendait.
J’ai été plus que récompensé en m’apercevant que mon petit ouvrage avait rencontré des lecteurs sympathiques dans des milieux très divers, prouvant ainsi que le sujet éveillait un intérêt universel, et je veux espérer que les lecteurs français lui réserveront à leur tour un bon accueil.
En revoyant la présente édition, j’ai ajouté un certain nombre d’exemples concrets. Je regrette de n’avoir pu écrire un chapitre sur la « Piété Filiale » : elle est considérée chez nous, avec le loyalisme, comme les deux roues du char qui porte la morale japonaise. La difficulté que j’éprouve à écrire un tel chapitre vient bien plutôt de mon ignorance des sentiments de l’Occident à l’égard de cette vertu particulière, que de l’ignorance de notre propre attitude vis-à-vis de ladite vertu : ce qui me manque, ce sont des termes de comparaison qui satisferaient mon esprit. J’espère bien revenir quelque jour sur cette question et sur d’autres non moins essentielles. Tous les sujets abordés dans ces pages pourraient, naturellement, être susceptibles de développements plus amples ; mais je ne vois pas très bien comment je pourrais faire ce volume plus gros qu’il n’est.
Cette préface serait incomplète et manquerait d’équité si j’omettais de dire tout ce que je dois à ma femme pour la diligence consciencieuse qu’elle a apportée à revoir le manuscrit, pour précieuses ses suggestions et, par dessus tout, pour l’encouragement constant qu’elle m’a donné.
I. N.
Koishikawa, Tokyo.
« Ce sentier
Sur la montagne, celui qui se tient dessus
Est enclin à douter si vraiment c’est un chemin ;
Tandis que, s’il l’aperçoit dans l’éloignement de la perspective,
La piste dès lors monte droit, nette de la base au sommet,
Et l’œil la suit aisément sans se tromper.
Qu’importe une ou deux solutions de continuité
Qui s’effacent sur les flancs de la montagne quand on
[regarde sa masse ?
Et ainsi (quand pénètre dans une philosophie nouvelle),
Qu’importe si les lacunes elles-mêmes doivent finalement
[servir à éprouver
Les moyens les plus parfaits
De former l’œil de l’homme, de lui enseigner ce qu’est la foi ? »
Robert BROWNING,
Apologie de l’Evêque Blougram.
« Il y a, si je puis ainsi dire, trois puissants esprits qui, de temps en temps, se sont avancés sur la surface des mers, et on donné une impulsion prédominante aux sentiments moraux et aux énergies de l’Humanité. Ce sont les esprits de liberté, de religion et d’honneur. »
HALLAM,
L’Europe au Moyen Âge.
« La Chevalerie est en elle-même la poésie de la vie. »
SCHLEGEL,
Philosophie de l’Histoire.
LE SAMOURAÏ
C’était un homme à deux sabres.
D’un doigt distrait frôlant la sonore biva,
A travers les bambous tressés en fine latte,
Elle a vu, par la plage éblouissante et plate,
S’avancer le vainqueur que son amour rêva.
C’est lui. Sabres au flanc, l’éventail haut, il va.
La cordelière rouge et le gland écarlate
Coupent l’armure sombre, et, sur l’épaule, éclate
Le blason de Hizen ou de Tokungawa.
Ce beau guerrier vêtu de lames et de plaques,
Sous le bronze, la soie et les brillantes laques,
Semble un crustacé noir, gigantesque et vermeil.
Il l’a vue. Il sourit dans la barbe du masque,
Et son pas plus hâtif fait reluire au soleil
Les deux antennes d’or qui tremblent à son casque.
JOSÉ-MARJA DE HERÉDIA.