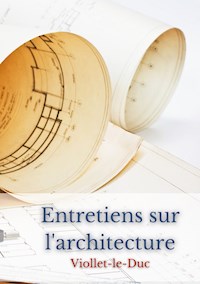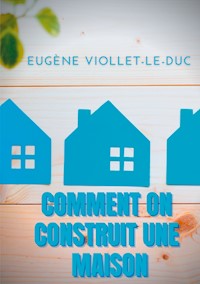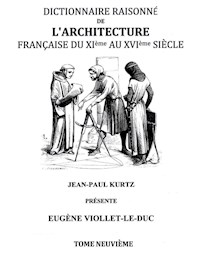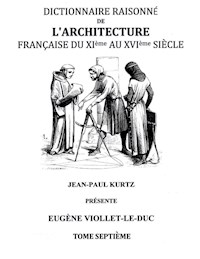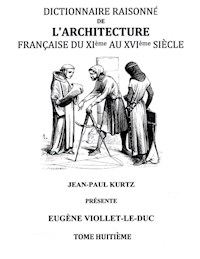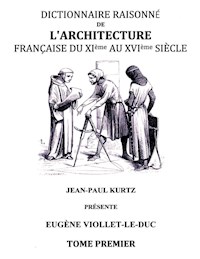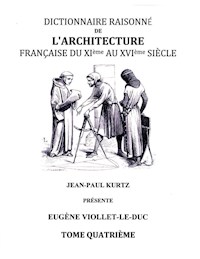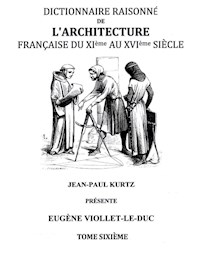Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Avec force précisions historiques, l'architecte et penseur nous livre un ouvrage richement documenté sur la restauration de Carcassonne.
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) demeure un personnage complexe et controversé encore aujourd’hui. Il fait partie de ces artistes et penseurs du début du XIXe siècle qui, loin de renoncer aux charmes de l’Italie, partent à la recherche d’un pittoresque national à travers de nombreux voyages en France. Architecte de grand talent, il se voit confier en 1851 la mission de restaurer la cité de Carcassonne, alors plutôt misérable… Le récit qu’il propose ici est révélateur de la vision architecturale de la plupart de ses chantiers : le décor et l’ornementation sont soumis à la structure avant tout. Il se révèle d’une grande précision, à la recherche de la véracité historique. Pour lui, le monument est un « témoin du passé », une « leçon d’histoire ».
Un voyage inédit à travers l'architecture française du XIXe siècle.
EXTRAIT
Quand on se présente devant la cité de Carcassonne, on est tout d’abord frappé de l’aspect grandiose et sévère de ces tours brunes si diverses de dimensions, de forme, et qui suivent, ainsi que les hautes courtines qui les réunissent, les mouvements du terrain pour obtenir un commandement
sur la campagne et profiter autant que possible des avantages naturels offerts par les escarpements du plateau, au bord duquel on les a élevées.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Intervenant sur les châteaux de Pierrefonds, Coucy, tours, Hendaye et Eu, sur les remparts d’Avignon, sur les hôtels de ville de Narbonne et Compiègne, sur les cathédrales et les basiliques d’Auxerre, Amiens, Vézelay, Clamecy, Carcassonne, Clermont, Lausanne, Paris, Saint- Denis, Toulouse..., Eugène Viollet-le-Duc, l’auteur du Dictionnaire raisonné de l’architecture française en dix volumes, a beaucoup voyagé, prenant à chaque fois le temps de la réflexion sur l’espace. À vingt ans, après avoir admiré le Mont-Saint-Michel, il part dix-huit mois en Italie pour un voyage d’études. Rien de ce qui touche à l’art de l’architecture, qu’elle soit religieuse, civile ou militaire, ne lui sera étranger. Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, n’a pas hésité à lancer ce jeune homme infatigable en lui confiant la restauration de nombreux monuments du patrimoine médiéval. Celle de la cité de Carcassonne en est l'une des plus connues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avertissement : cet ouvrage est la transcription de l’édition parue en 1878 chez A. Morel et Cie éditeurs, le choix a cependant été de ne pas reproduire dans la présente édition les schémas d’architecture et les textes un peu fastidieux s’y reportant.
Avant-propos
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) demeure un personnage complexe et controversé encore à l’heure actuelle. Il revient à Paul Gout, premier de ses biographes, la qualification la plus juste de ses talents d’« architecte, archéologue et restaurateur », néanmoins il oublie de mentionner ses talents d’écrivain et de théoricien.
Un voyageur romantique
Si Viollet-le-Duc mène une carrière florissante sous le Second Empire, il peut être considéré comme une figure romantique par son amour de la période médiévale, sa contestation de l’Académie et ses nombreux voyages. Il fait partie de ces artistes, écrivains et penseurs du début du XIXe siècle qui, loin de renoncer aux charmes de l’Italie, partent à la recherche d’un pittoresque national en effectuant de nombreux voyages en France, plus spécifiquement en Bretagne, en Normandie et dans les Pyrénées. Victor Hugo et Gustave Flaubert furent de ceux-là. Cette découverte des innombrables richesses de notre pays se double d’une recherche artistique et historique qui fera de la magnifique architecture gothique du XIIIe siècle un style national.
La mise en lumière d’une cité médiévale
Au début du XIXe siècle la cité de Carcassonne est devenue un quartier de miséreux, victime du désintérêt des autorités nationales, malgré l’attention portée par certains érudits locaux, alertés de son devenir. Parmi eux, Jean-Pierre Cros-Mayrevieille agit de manière à faire prendre conscience de la valeur historique des fortifications de la cité et de la basilique Saint-Nazaire dont il obtient le classement comme monument historique en 1839. Intervient alors Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques et proche de Napoléon III. Mérimée perçoit à Carcassonne un exemple de l’évolution de l’architecture militaire médiévale. En 1844, il missionne Viollet-le-Duc afin qu’il œuvre à la sauvegarde de la basilique Saint-Nazaire. Lors de ce premier séjour dans la cité, l’architecte accumule les relevés des fortifications ainsi que les observations sur les procédés de défense et l’évolution de l’architecture militaire. À la demande de la Commission des monuments historiques, il réalise des dessins restituant l’état des fortifications au début du XIVe siècle avant de se voir confier en 1851 la restauration des murailles et des tours. Ce chantier, maintes fois interrompu, sera achevé par son jeune collaborateur Paul Louis Boeswillwald. Conscient de l’existence de différentes périodes de construction, Viollet-le-Duc a souhaité donner une réelle unité au monument en choisissant de le restituer en son état de la fin du XIIIe siècle. Il met ainsi en œuvre ce qu’il énonce dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture : « Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné. »
Le récit d’un chantier
La présentation que donne Viollet-le-Duc de la cité carcassonnaise est révélatrice de la vision architecturale qu’il met en application dans la plupart de ses chantiers de restauration : une rationalité mise au service de la structure fondamentale. Le décor et l’ornementation sont alors soumis à celle-ci avant tout. Le texte de Viollet-le-Duc se révèle d’une grande précision, à la recherche de la véracité historique. Pour l’architecte, le monument est un « témoin du passé », une « leçon d’histoire ».
Ce récit est d’autant plus notable qu’en interdépendance avec le chantier mis en œuvre à Carcassonne, il permet de mettre en valeur une cité oubliée et de la sauver des ruines. La description précise de ses remparts en témoigne. Au-delà des aspects fortement techniques de son document, l’architecte participe aussi à la redécouverte d’une région dont l’histoire fut riche et puissante, et présente au grand public un des fleurons de son patrimoine.
Marie-Astrid Pourchet
HISTORIQUE
Vers l’an 636, le Sénat de Rome, sur l’avis de Lucius Crassus, ayant décidé qu’une colonie romaine serait établie à Narbonne, la lisière des Pyrénées fut bientôt munie de postes importants afin de conserver les passages en Espagne et de défendre le cours des rivières. Les peuples volces tectosages1 n’ayant pas opposé de résistance aux armées romaines, la République accorda aux habitants de Carcassonne, de Lodève, de Nîmes, de Pézenas et de Toulouse la faculté de se gouverner suivant leurs lois et sous leurs magistrats. L’an 70 avant J.-C., Carcassonne fut placée au nombre des cités nobles ou élues. On ne sait quelle fut la destinée de Carcassonne depuis cette époque jusqu’au IVe siècle. Elle jouit, comme toutes les villes de la Gaule méridionale, d’une paix profonde ; mais après les désastres de l’Empire, elle ne fut plus considérée que comme une citadelle (castellum). En 350 les Francs s’en emparèrent, mais peu après les Romains y rentrèrent.
En 407, les Goths pénétrèrent dans la Narbonnaise première, ravagèrent cette province, passèrent en Espagne, et, en 436, Théodoric, roi des Wisigoths, s’empara de Carcassonne. Par le traité de paix qu’il conclut avec l’Empire en 439, il demeura possesseur de cette ville, de tout son territoire et de la Novempopulanie, située à l’ouest de Toulouse.
C’est pendant cette domination des Wisigoths que fut bâtie l’enceinte intérieure de la cité sur les débris des fortifications romaines. En effet, la plupart des tours wisigothes encore debout sont assises sur des substructions romaines qui semblent avoir été élevées hâtivement, probablement au moment des invasions franques. Les bases des tours wisigothes sont carrées ou ont été grossièrement arrondies pour recevoir les défenses du Ve siècle.
Du côté méridional de l’enceinte, on remarque des soubassements de tours élevées au moyen de blocs énormes, posés à joints vifs et qui appartiennent certainement à l’époque de la décadence de l’Empire.
Quoi qu’il en soit, il est encore facile aujourd’hui de suivre toute l’enceinte des Wisigoths. Cette enceinte affectait une forme ovale avec une légère dépression sur la face occidentale, suivant la configuration du plateau sur lequel elle est bâtie. Les tours, espacées entre elles de vingt-cinq à trente mètres environ, sont cylindriques à l’extérieur, terminées carrément du côté de la ville et réunies entre elles par de hautes courtines. Toute la construction wisigothe est élevée par assises de petits moellons de dix à douze centimètres de hauteur environ, avec rangs de grandes briques alternées. De larges baies en plein cintre sont ouvertes dans la partie cylindrique de ces tours, du côté de la campagne, un peu au-dessus du terre-plein de la ville ; elles étaient garnies de volets de bois à pivots horizontaux et tenaient lieu de meurtrières. Le couronnement de ces tours consistait en un crénelage couvert. Des chemins de ronde des courtines, on communiquait aux tours par des portes dont les linteaux en arcs surbaissés étaient soulagés par un arc plein cintre en brique. Un escalier de bois mettait, à l’intérieur, l’étage inférieur en communication avec le crénelage supérieur qui était ouvert du côté de la ville par une arcade percée dans le pignon.
Malgré les modifications apportées au système de défense de ces tours, pendant les XIIe et XIIIe siècles, on retrouve toutes les traces des constructions des Wisigoths. Jusqu’au niveau du sol des chemins de ronde des courtines, ces tours sont entièrement pleines et présentent ainsi un massif puissant propre à résister à la sape et aux béliers.
Les Wisigoths, entre tous les peuples barbares qui envahirent l’Occident, furent ceux qui s’approprièrent le plus promptement les restes des arts romains, au moins en ce qui regarde les constructions militaires et, en effet, ces défenses de Carcassonne ne diffèrent pas de celles appliquées à la fin de l’Empire en Italie et dans les Gaules. Ils comprirent l’importance de la situation de Carcassonne, et ils en firent le centre de leurs possessions dans la Narbonnaise.
Le plateau sur lequel est assise la cité de Carcassonne commande la vallée de l’Aude, qui coule au pied de ce plateau, et par conséquent la route naturelle de Narbonne à Toulouse. Il s’élève entre la montagne Noire et les versants des Pyrénées, précisément au sommet de l’angle que forme la rivière de l’Aude en quittant ces versants abrupts, pour se détourner vers l’Est. Carcassonne se trouve ainsi à cheval sur la seule vallée qui conduise de la Méditerranée à l’océan et à l’entrée des défilés qui pénètrent en Espagne par Limoux, Alet, Quillan, Mont-Louis, Livia, Puicerda ou Campredon. L’assiette était donc parfaitement choisie et elle avait été déjà prise par les Romains qui, avant les Wisigoths, voulaient se ménager tous les passages de la Narbonnaise en Espagne.
Mais les Romains trouvaient par Narbonne une route plus courte et plus facile pour entrer en Espagne et ils n’avaient fait de Carcassonne qu’une citadelle, qu’un castellum, tandis que les Wisigoths, s’établissant dans le pays après de longs efforts, durent préférer un lieu défendu déjà par la nature, situé au centre de leurs possessions de ce côté-ci des Pyrénées, à une ville comme Narbonne, assise en pays plat, difficile à défendre et à garder. Les événements prouvèrent qu’ils ne s’étaient point trompés ; en effet, Carcassonne fut leur dernier refuge lorsqu’à leur tour ils furent en guerre avec les Francs et les Bourguignons. En 508, Clovis mit le siège devant Carcassonne et fut obligé de lever son camp sans avoir pu s’emparer de la ville.
En 588, la cité ouvrit ses portes à Austrovalde, duc de Toulouse, pour le roi Gontran ; mais peu après, l’armée française ayant été défaite par Claude, duc de Lusitame, Carcassonne rentra au pouvoir de Reccarède, roi des Wisigoths.
Ce fut en 713 que finit ce royaume ; les Maures d’Espagne devinrent alors possesseurs de la Septimanie. On ne peut se livrer qu’à de vagues conjectures sur ce qu’il advint de Carcassonne pendant quatre siècles ; entre la domination des Wisigoths et le commencement du XIIe siècle, on ne trouve pas de traces appréciables de constructions dans la cité, non plus que sur ses remparts. Mais, à dater de la fin du XIe siècle, des travaux importants furent entrepris sur plusieurs points. En 1096, le pape Urbain II vint à Carcassonne pour rétablir la paix entre Bernard Aton et les bourgeois qui s’étaient révoltés contre lui et il bénit l’église cathédrale (Saint-Nazaire), ainsi que les matériaux préparés pour l’achever. C’est à cette époque en effet que l’on peut faire remonter la construction de la nef de cette église.
Sous Bernard Aton, la bourgeoisie de Carcassonne s’était constituée en milice et il ne paraît pas que la concorde régnât entre ce seigneur et ses vassaux, car ceux-ci, battus par les troupes d’Alphonse, comte de Toulouse, venu en aide à Bernard, furent obligés de se soumettre et de se cautionner. Les biens des principaux révoltés furent confisqués au profit du petit nombre des vassaux restés fidèles, et Bernard Aton donna en fief à ces derniers les tours et les maisons de Carcassonne, à la condition, dit Dom Vaissète2 : « De faire le guet et de garder la ville, les uns pendant quatre, les autres pendant huit mois de l’année et d’y résider avec leurs familles et leurs vassaux durant tout ce temps-là. Ces gentilshommes, qui se qualifiaient de châtelains de Carcassonne, promirent par serment au vicomte de garder fidèlement la ville. Bernard Aton leur accorda divers privilèges, et ils s’engagèrent à leur tour à lui faire hommage et à lui prêter serment de fidélité. C’est ce qui a donné l’origine, à ce qu’il paraît, aux mortes-payes3 de la cité de Carcassonne, qui sont des bourgeois, lesquels ont encore la garde et jouissent pour cela de diverses prérogatives. »
Ce fut probablement sous le vicomte Bernard Aton ou, au plus tard, sous Roger III, vers 1130, que le château fut élevé et les murailles des Wisigoths réparées. Les tours du château, par leur construction et les quelques sculptures qui décorent les chapiteaux des colonnettes de marbre servant de meneaux aux fenêtres géminées4, appartiennent certainement à la première moitié du XIIe siècle. En parcourant l’enceinte intérieure de la cité, ainsi que le château, on peut facilement reconnaître les parties des bâtisses qui datent de cette époque ; leurs parements sont élevés en grès jaunâtre et par assises de quinze à vingt-cinq centimètres de hauteur, sur vingt à trente de largeur, et grossièrement appareillés.
Le 1er août 1209, le siège fut mis devant Carcassonne par l’armée des croisés, commandée par le célèbre Simon de Montfort.