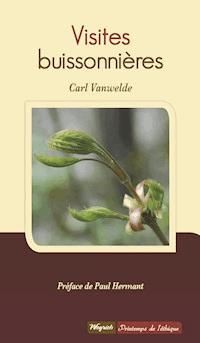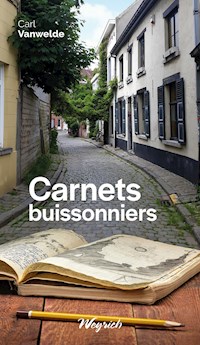
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ces Carnets ne sont pas un livre qu’on lit mais un livre où l’on se promène. Pour le paysage ? Non, mais pour les gens que l’on y croise, lors des consultations d’un médecin de famille qui partage ses petits émerveillements clandestins.Que resterait-il de ces moments fugitifs si l’écriture ne venait pas les sauver de l’engloutissement dans la cohue des jours ? Heureusement, le médecin se fait écrivain, il note, il consigne, il préserve. Ce qui aurait pu n’être qu’anecdotes devient pépites, et à les lire, comment ne pas être ému par la beauté des relations mystérieuses et fragiles qui se nouent dans ces moments où le praticien et le patient sont simplement deux personnes qui se parlent et s’écoutent.C’est un livre précieux que ces Carnets buissonniers. Un hommage à la vie. Tous ces textes sont traversés par la même petite musique modeste et entêtante, ici en mineur, là en majeur. Ce n’est pas une symphonie, rien de grandiose ici, mais de courtes sonates, variations douces- avec une pointe d’amertume parfois, une pincée de sel - sur la brièveté et la fugacité des choses de la vie. L’humain n’en sort ni grand ni fort, mais fragile et attendrissant. Et la petite magie du cœur qui bat est là, tendue sur le fil des rencontres.Francis Dannemark
Médecin généraliste, Carl Vanwelde partage ses réflexions issues de ses rencontres avec amour, humour et humanité. Des billets à piocher et à savourer au gré de vos envies.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Carl Vanwelde, médecin généraliste, est également professeur au Centre Académique de Médecine Générale de l’Université catholique de Louvain.
Fervent défenseur d’une pratique à visages humains, il aime à se voir comme un «gardien de phare». Pris dans la tempête de la maladie, le patient a besoin qu’on lui indique une voie pour regagner la terre ferme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Merci à Lydie, Samuel, Charles, Régis, Oriane et tant d’autres dont les prénoms et les traits distinctifs ont été soigneusement retouchés afin d’assurer leur anonymat mais sans qui ce livre n’existerait pas.
Préface
La médecine n’est pas seulement une science, elle est aussi un art. Et comme l’a écrit Claude Bernard il y a plusieurs siècles déjà, l’exercice de la médecine est donc inséparable de l’artiste qui la pratique.
C’est bien cela que nous donne à voir Carl Vanwelde dans ses Carnets buissonniers : à travers les multiples petites touches de son art, transparaît l’unité de l’artiste dans la profondeur de son être.
La longue amitié qui nous relie me permet d’affirmer que la quête de sagesse de ce médecin, qui est aussi père et grand-père, auteur, artiste a toujours été associée à un souci de partage, de transmission.
C’est peut-être cela qui nous permet d’en goûter à la fois la force et la tendresse.
Il y a quelque chose de lumineux dans l’écriture de Carl et cette lumière nous aide à apprivoiser notre ombre.
Il y a quelque chose de sobre dans le choix des mots, dans l’émoi qu’ils esquissent tout en délicatesse, et cette pauvreté nous enrichit.
Il y a quelque chose de doux dans la beauté des visages racontés, des visages rencontrés, et cette douceur apaise la souffrance que nous redoutons tant.
Il y a quelque chose de silencieux dans chacun des récits proposés et quand l’un d’eux se termine, ce silence nous met en joie parce qu’il célèbre la beauté.
Il doit bien y avoir un secret ? Sans doute…à moins que ce ne soit une évidence, tout simplement… En fidèle disciple de Paracelse, Carl sait que toute médecine est amour. Il aime ses patients, et c’est ce qui lui permet d’exercer la médecine avec toute sa personne.
Cela peut paraître incongru de parler d’amour au moment où l’exercice de la médecine est tenté de se soumettre à des preuves, des procédures, des certifications de toutes sortes. C’est bien pour cela que Carl n’a pas perdu son temps en rassemblant tous ces portraits de patients et que vous ne perdrez pas le vôtre en les découvrant.
Se penchant sur la solitude de l’un, captant une étincelle de lumière dans le regard d’un autre, écoutant avec délicatesse un silence, accueillant une main qui se tend pour la dernière fois, Carl est médecin de quartier, humblement, simplement, dans son village d’Anderlecht.
Les sentiers qu’il défriche depuis si longtemps sont autant de promesses pour l’avenir.
Témoins de tant d’histoires, ils ouvrent de nouveaux paysages à contempler, à aimer.
En vous laissant toucher par son écriture fine et ciselée, écoutez battre son cœur.
Il bat au rythme d’une médecine d’aujourd’hui et de demain, pour les humains d’aujourd’hui et de demain.
Cécile Bolly
Le premier billet de ce recueil (Louis) parut un jour dans le courrier des lecteurs du Journal du Médecin. Mon ami Maurice Einhorn, qui en était rédac-chef, souhaitait apporter une note poétique et positive au journal dont certaines pages donnaient de la profession une image parfois tristounette. Une quinzaine d’années séparent le premier de ces courts récits du dernier, avec une longue interruption au milieu. L’écriture, ainsi que le regard porté sur ces nombreux instantanés d’une pratique médicale, ont évidemment évolué dans l’intervalle et une relecture de l’ensemble m’a souvent laissé sur ma faim. Aurais-je écrit ces pages à l’identique avec le recul qu’apportent les années et de nouvelles expériences ? La lourdeur de certains passages, les tics d’écriture, des erreurs de jugement ou certaines réflexions péremptoires m’ont fait hésiter à en publier l’intégralité. Elles sont néanmoins significatives de la transformation que le contact des autres apporte, et il a été choisi de vous les offrir telles quelles dans leur imperfection.
Louis
Louis s’est alité pour de bon, le souffle rauque et transpirant à grosses gouttes. Rassasié de vie, il ne craint qu’une chose : devoir quitter la fenêtre par laquelle il a vue sur son jardin et le potager qui le borde. Tant d’années consacrées à semer, repiquer, arroser, tailler ne peuvent s’évaporer sur un brancard d’ambulance appelée dans l’urgence.
Louis fut ainsi mon premier patient, quatre jours avant que ne s’ouvre mon cabinet, sentant bon la peinture fraîche et la science récemment acquise. Je le vis à son domicile, mon jean et ma chemise tachés par le plâtre. Il voulait rester chez lui, ce qui bouleversait tous mes projets thérapeutiques acquis en faculté, mais c’est ainsi que le métier entre : je le laissai contempler son jardin. Il nous quitta le lendemain, doucement.
J’ouvris ma pratique à la date prévue. Avant d’avoir guéri un seul patient, j’avais déjà un mort, ce qui m’enseigna l’humilité.
Chambre 108
La porte s’ouvre sur un bouquet de roses que surmonte un regard émerveillé d’adolescent rieur. Elle a rougi imperceptiblement et sourit à son tour : « Tu es venu de si loin ? » Il l’embrasse, elle pleure maintenant. Leur bonheur est palpable. Elle le retient doucement, il reprend sa main, elle reprend sa nuque comme si elle voulait prolonger quelque peu ce moment inattendu de retrouvailles. Il lui effleure les cheveux, elle s’enivre des effluves de l’eau de toilette et de la voix qui l’accompagne. Elle dit qu’elle tourne et qu’elle ne sait pas pourquoi ; il dit qu’il fait sans doute trop chaud dans sa chambre et qu’il faudrait aérer. Ils sont deux et ne se quittent plus des yeux. Elle remonte ses draps, il lui retape son oreiller en lui soutenant la tête doucement.
Intimidé, je toussote, annonce que je repasserai demain. Il me découvre enfin et s’excuse de son entrée impromptue : « Je ne me suis pas aperçu de votre présence, docteur. Je serais passé plus tard ! » Je les rassure. Elle rougit à nouveau, se ressaisit, redevient patiente. Et il s’en retourne, voûté sur sa canne, emportant deux moments heureux que séparent cinquante années d’existence…
Chamroun
Je revois Chamroun me tendant une main d’adolescent, les yeux un peu chavirés par son exode au travers du golfe de Thaïlande sur une barge bourrée de réfugiés. Il a perdu toute trace de ses parents ainsi que de ses huit frères et sœurs, massacrés sans doute. Le périple jusqu’à sa famille d’accueil a été long et éprouvant, mais lui a trempé le caractère d’une volonté farouche d’entamer une nouvelle existence. Il n’a pu emporter que le souvenir de sa maison natale, son sourire. Sa nouvelle vie débute par une inscription dans une école de cuisine. Robuste, il n’aura recours à mes services que pour quelques documents administratifs. Dix années de stabilité s’égrènent.
Et soudain la fêlure. Une lettre abîmée par un long périple lui apprend que sa famille a échappé au carnage et le recherche. Il sollicite un congé sans solde pour les retrouver. À son retour en Belgique, il perd pied et plonge dans un délire aussi soudain qu’impressionnant : il est le nouveau Bouddha, la réincarnation du Messie, le Père nourricier universel. Une querelle avec son employeur tourne mal et il perd son emploi. Il exige des services sociaux qu’on lui fournisse une épouse, sollicite les faveurs de l’infirmière qui vient lui administrer son injection de neuroleptiques. Parfois le sourire réapparaît, fugace éclaircie aussitôt démentie par un rictus dément rappelant que la folie des hommes peut rattraper ceux qu’elle a laissés échapper.
Je referme ma trousse, songeur. Réfugiés sur terre, sommes-nous prémunis contre ces papiers fanés qui font basculer les existences ?
Geneviève
Certaines peaux brûlent les doigts. Geneviève, la trentaine radieuse, m’appelle à son domicile en raison d’une migraine tenace. Une bonne fée s’est penchée sur son berceau et une vie sans difficulté majeure a fait le reste. Professionnellement épanouie, cadette heureuse d’une tribu de six frères et sœurs, elle possède un regard pétillant qui fait sauter les bouchons. Je la connais de longue date, suffisamment pour percevoir la fêlure dans la pupille qui m’ouvre la porte. L’épaule inhabituellement dénudée sort de la douche et un « Je vous attendais plus tard » lui fait rosir les pommettes. Les plaintes sont diffuses, quelque peu désordonnées dans leur expression. Elle s’emmêle en un lapsus comique confondant « moucher » et « coucher » qui achève de la déstabiliser. Elle n’est plus maintenant qu’un cœur qui gambade à un rythme totalement désordonné que mon stéthoscope découvre sans insister. J’apprends entre deux respirations qu’elle vit une séparation non souhaitée qui l’a humiliée au plus profond d’elle-même. La fracture.
Je profite de la rédaction de ma prescription pour la laisser se reprendre, mesurant mes gestes avec prudence. Un de mes vieux maîtres bougons prétendait qu’il faut se garder d’allumer un feu de broussailles qu’on ne pourra éteindre et qu’aimer n’est pas aider. Un silence, un sourire complice et un échange anodin sur la vie qui passe ramènent quelque calme dans ces prunelles où couvait l’orage.
Je revis Geneviève à deux ou trois reprises au cours des dix années qui suivirent son remariage et son déménagement. La perte d’un emploi, la mort de ses parents, une fausse-couche sonnant le glas de ses espoirs de maternité me valurent ses visites, dans une grande sérénité. La séduction demeurait intacte, tacite. La migraine d’un instant d’égarement a fait place à un simple « Je souhaitais vous parler de quelque chose qui me tracasse ». J’ai l’impression chaque fois de la voir gravir les marches menant au refuge du gardien de phare, qui signale sa présence au loin dans la tempête par une loupiote tremblotante. Sa confiance m’est un souvenir heureux.
Pa’Jo
La science d’Esculape, c’est comme la vertu : il ne faut pas en abuser. Pa’Jo aime son médecin, c’est sûr, mais vu de loin. L’âge n’a guère altéré sa prestance, sa cordialité à mon égard est contagieuse. Il se méfie néanmoins de mes potions et remèdes divers, souverains pour traiter les misères des femmes et les douleurs passagères qu’une âme normalement trempée se doit de supporter sans se plaindre. Il ne consulte la Faculté qu’à bon escient, sans excès, comme on se rend chez le notaire ou l’embaumeur, c’est-à-dire lors des grands moments de la vie : l’arrêt définitif de la consommation des petits cigares hérités de sa tendre enfance, la mémorable crise de goutte qui a suivi le mariage de sa fille, la crise de colite de la Toussaint 1990 où il a senti le souffle du bistouri siffler à ses oreilles. Pour le reste, il estime que le Temps est bon médecin et se suffit amplement à lui-même ; d’instinct, je ne saurais lui donner tort.
Ses remèdes naturels flairent bon le malt, le raisin fermenté et le houblon, tous produits de la terre enrichis par de patients séjours à l’abri de la lumière dans de grandes barriques de chêne et ensuite dans sa cave. Il pratique l’épicurisme avec maîtrise, comme d’autres se soignent par homéopathie, phytothérapie ou acupuncture : il ne les comprend guère, ne pouvant imaginer qu’on puisse se faire du bien par piqûres, cataplasmes puants et potions amères alors que la nature se révèle si généreuse envers ceux qui savent l’apprécier.
Pa’Jo, je devine votre sourire amusé si, d’aventure, ce billet écrit à la hâte après vous avoir croisé en rue tombe entre vos vieilles mains noueuses : gardez-le, il vous servira de prescription en temps utile.
Pol
Pol se meurt. La voix étouffée progressivement par un envahissement du médiastin se fait aider par des gestes de la main, des regards, quelques paroles griffonnées à la hâte. Il atteint ainsi par étapes le terme d’une vie aimante qu’il ne quitte qu’à regret. Elvida le soutient en lui remontant les oreillers, le moral et le col du pyjama lorsque le fond de l’air se fait humide. Il y aura de la brume cette nuit, elle sera son gardien de phare. Le marin échoué meurt aux premières lueurs de l’aube.
Six mois déjà. La séparation fut paisible, un souffle qui s’éteint, une flamme de bougie qui vacille. Pol a laissé négligemment une cassette sur son dictaphone, qu’Elvida découvre ce matin. Une soudaine envie d’entendre la voix aimée met l’appareil en route. « Mon Elvida adorée… » Paroles d’outre-tombe, le timbre chaud d’un patient encore robuste qui vient d’être informé du mal qui le ronge enveloppe la pièce. Les phrases évoquent les confidences chuchotées le soir sur l’oreiller, au moment où se fait le bilan de la journée. Elles rappellent les moments heureux, les jours de pluie, donnent quelques conseils pour bien négocier le chemin qui s’annonce. « Je savais qu’un jour ou l’autre, l’envie te prendrait de m’écouter une dernière fois, alors autant te le redire : je t’aime. » Un grésillement, peut-être le fantôme d’un dernier baiser jeté à la hâte, pareil à ceux qui s’envolent d’un train qui quitte le quai, un déclic marque la fin de l’enregistrement. Elvida essuie furtivement une larme.
Sylvain
On dit que le geôlier est une autre sorte de captif, jaloux des rêves de ses prisonniers. Je n’ai jamais pu le vérifier, mais leur univers me fascine. Sylvain est gardien de prison depuis l’âge de vingt-cinq ans et a connu les plus grands : voleurs de grand chemin, escrocs de renom, tueurs de médecins, violeurs d’enfants, kidnappeurs, tronçonneurs de cadavres, toute l’actualité criminelle depuis les années soixante a pour lui un visage précis qu’il identifie. Il en parle peu, avec retenue, comme à regret. Il évoque leurs petits côtés et manies avec tendresse : « Les fortes chaleurs et la promiscuité les énervent parfois, mais, dans le fond, ce ne sont pas de mauvais bougres. » La proximité des repris de justice lui a permis de les découvrir avec un éclairage différent de celui des premières pages de nos quotidiens. Il les tutoie, connaît leur femme, le nom de leurs gosses, leurs préférences alimentaires et leurs rêves d’escapade. Il ne m’en parlera guère : l’univers carcéral est un monde qui a ses règles propres et connaît mieux que tout autre les valeurs de la discrétion.
On imaginerait un colosse bâti comme une armoire à glace, à la carrure d’athlète. Il en rit, considérant sa tête d’angelot et sa silhouette fluette comme un atout pour mieux apprivoiser ses pensionnaires : « Il ne sert à rien de les provoquer : il vaut mieux leur parler gentiment, cela les étonne toujours. » On imagine à l’entendre un berger menant au son du pipeau un troupeau de félins transformés en moutons. Il rit de plus belle, s’étonnant que son toubib puisse montrer tant d’intérêt à une profession aussi banale que la sienne. « Venez donc me rendre visite un de ces jours, mais ne tardez pas, car je serai pensionné dans un an. » Je finirai par croire qu’ils lui manqueront.
Ourson
Je l’avais perdu de vue depuis dix ans. Me restait le souvenir d’un adolescent frêle aux épaules tombantes, peu assuré, terminant à grand-peine une scolarité précaire. Je retrouvais une espèce d’Orson Welles barbu, immense, ventripotent, ayant fait de bonnes affaires dans le commerce de pièces détachées pour automobiles. Il me serre la main avec effusion, se rappelant à mon bon souvenir d’années de scoutisme communes, du temps où il s’appelait Ourson téméraire. La voix se veut forte, mais casse à la fin des phrases imperceptiblement : le tableau est moins assuré qu’il n’en donne l’apparence. Il s’assied lourdement, croise les jambes, me demande s’il peut fumer.
Soudain, Ourson pleure, avec de grosses larmes bruyantes entrecoupées de reniflements, par vagues successives de plus en plus sauvages. Le pied croisé tremble et il tente de le maintenir de la main, sort un mouchoir souillé avec lequel il s’éponge le visage. J’apprends par bribes l’envers d’une vie habitée par l’alcool, l’argent vite gagné et deux fois dépensé, les dettes, les huissiers, l’épouse qui a pris le large, les gosses dont il n’a plus de nouvelles depuis six mois. Il demande de l’aide, mais j’en distingue mal les contours : certains paysages recèlent tant de reliefs qu’on n’aperçoit jamais le fond de la vallée. Je propose de le revoir après une nuit de sommeil afin d’en échanger davantage. Il grogne, ce qui signifie qu’il acquiesce, replie approximativement son mouchoir, sort sans payer au nom de la vieille amitié qui nous lie. Le reverrai-je ?
Nicolas
Perpetuum mobile. Je devine sa présence dès son entrée dans la salle d’attente au mouvement perpétuel qui s’y installe aussitôt. Les patients qui le précèdent se révèlent anormalement crispés, irascibles, hypertendus. Ne cherchez pas : c’est que Nicolas est arrivé. Je m’attends à retrouver la Bérézina sur la table des magazines, un poisson mort de panique, une chaise dépaillée, un tapis souillé par les emballages de Bounty ou les cosses de cacahuètes. La mère en sourit, s’énerve, rit à nouveau, adepte d’une éducation à la liberté formatée par la lecture de Libres enfants de Summerhill quand elle entamait sa première année de psycho. L’agitation a maintenant gagné le pépé barbichu qui somnolait dans un coin et qui grogne d’un air peu amène. J’introduis Nicolas dans le cabinet en balisant son itinéraire comme on le ferait pour un groupe de hooligans un soir de match.
L’anamnèse se révèle aussi sommaire que l’examen est hasardeux. La maman nie farouchement toute possibilité de problème : il tousse, un point c’est tout. L’ausculter nécessite une immobilisation de quelques secondes, ce qui est aussi illusoire que la prise en main, avec un gant de Teflon, d’une anguille vivante roulée dans l’huile. Il refuse d’ouvrir la bouche mais tire la langue sans se faire prier, dix fois même. La mère rit et trouve qu’il est vraiment trop drôle. Il pète maintenant, rit à son tour. « Il est si heureux avec nous, vous savez, que je ne saurais me résoudre à le laisser partir en classe de neige. Vous me donnerez bien un certificat, n’est-ce pas ? » J’envie certains jours les jardiniers, les gardes forestiers et les gardiens de phare.
Ginette
Dame souhaite revoir Monsieur, âge mûr, affectueux, bonne situation. La cinquantaine autorise encore quelques projets, Ginette en caresse un par-dessus tout : revivre un rêve. La photo jaunie d’un couple enlacé, extraite d’une boîte à chapeau à mon arrivée, fut contemplée mille fois, si on en juge par les bords écornés. Les crocus et les perce-neiges raniment sans doute les ardeurs endormies. Elle replace amoureusement A Whiter Shade of Pale sur la platine du tourne-disque d’époque, s’assied face à la fenêtre et imagine… Nul ne connaît la trajectoire de l’aigle dans le ciel, du bateau sur la mer, du nom d’un homme dans la rêverie de la femme qui l’aime. Que fait-il en ce moment, que fait son épouse, que deviennent ses enfants ? Ginette attend, revit les paroles d’un soir, les mouvements de quelques danses tendres terminées dans l’extase d’une découverte. Depuis ce moment, elle hiberne, vit mal, dort par somnifères interposés, se nourrit d’espoirs. Elle relit Les Semailles et les Moissons en s’imaginant dans le personnage d’une des héroïnes, la plus délaissée. Le printemps peut faire mal.
André
Un spectre me croise en rue sans que je le reconnaisse. Il me salue furtivement, comme en s’excusant, poursuit sa route. Je mets quelques secondes à renommer André des tréfonds de ma mémoire et déjà sa silhouette s’estompe, voûtée sur sa canne, ombre grise dans la pénombre du jour levant. L’homme entrevu n’est plus qu’un reflet du patient pléthorique suivi pendant deux décades, périodiquement encouragé à perdre du poids, à faire de l’exercice, à limiter sa consommation de graisse, à boire moins sec… Il opinait du bonnet avec bonne volonté, promettait de mieux faire une prochaine fois, acquiesçant de la tête jusqu’à ce que l’appel des viscères reprenne le dessus. Deux fois par an, il poussait la porte du cabinet avec bonhomie et s’en allait rassuré : son sarcome cutané se portait bien, la cicatrice était belle, les aires ganglionnaires, libres, dix ans de vigilance armée s’étaient écoulés sans encombre.
Ne plus l’avoir revu depuis un an ne m’a pas vraiment alarmé, ne m’en étant pas aperçu. Son apparition furtive fut néanmoins un gâche-tournée. Mille questions tourbillonnent à présent dans ma tête comme autant de papillons de nuit dans une mansarde dont on a entrouvert la porte après une saison d’oubli. Que devient-il, le bougre ? Pourquoi a-t-il tant maigri soudainement ? Est-il encore sous surveillance, chez qui ? L’ai-je blessé sans m’en rendre compte ? Le recontacterais-je, que lui dire ? A-t-il entamé chez un confrère un régime plus efficace que mes conseils routiniers ? Son sarcome ne serait-il pas sorti d’hibernation ? A-t-il pris peur en constatant son amaigrissement et décidé de se passer de la Faculté ? L’autoradio décline les bulletins d’information sur la situation au Congo et au Kosovo, mais je n’y prête qu’une attention distraite, perdu dans mes pensées avec un vague sentiment de culpabilité : la notion de responsabilité médicale n’est pas une simple notion juridique. Un patient qui s’éloigne n’est anodin que dans les conversations de carabins lors de soupers de garde.
Mathieu
Mathieu a une passion cachée : la cérémonie du thé. La consultation se prolonge un peu par la description de ce rite immuable qu’il partage avec un groupe d’intimes férus de zen. Les bienfaits qu’il en retire valent mes prescriptions, ce qui explique la rareté de ses visites à mon cabinet.
J’apprends sur le tas et établis avec lui la liste des tranquillisants de substitution susceptibles de soulager les maux de notre époque : un moment musical cueilli au vent, le bonheur serein d’une sieste dans les champs, le spectacle de la neige tombant doucement, de la lune se levant avec majesté derrière les arbres dans la nuit claire ou la danse mystérieuse d’un rayon de soleil filtrant à l’intérieur d’une pièce.
Pris au jeu, j’allonge la liste en suggérant pêle-mêle d’essayer une promenade dans un parc à l’aube, la découverte émerveillée de la rosée du jardin, l’accompagnement des oiseaux dans le ciel ou les rêveries qu’on mêle à la course du ruisseau. Mathieu me conseille les courses éperdues contre le vent dans le fracas des vagues sur la plage, les mains que l’on trempe dans la cascade glacée d’un torrent de montagne, le visage apaisé sous le jet de la fontaine de ville par temps de canicule et le calme qui vous envahit dans le jardin qui s’endort.
Je prends congé, le remerciant pour cette curieuse consultation, cantate à deux voix sur la récolte de trésors quotidiens si oubliés.
Michel
Cette fois, l’école est bien finie. Oubliée pour de bon l’âcre poussière de la craie, rangés dans leurs boîtes d’archives les dossiers pédagogiques sans cesse remis sur le métier, frôlé une dernière fois le taille-crayon talisman sur le bureau lisse. Michel dépose son tablier en cette fin d’année scolaire pas comme les autres, le temps d’une dernière poignée de main aux collègues, d’un ultime encouragement aux élèves, d’un dernier conseil de lectures échangé.
Tout est vrai, successivement, aurait dit Peregrinos : l’heure a sonné de l’expérimenter dans sa propre vie. Il flotte comme un air d’envol de voilier dans l’air : le port se vide peu à peu et du rivage les derniers spectateurs scrutent le moment où la voile lointaine disparaîtra de la ligne d’horizon. Au moment précis où il se fond dans l’azur et où fusent les « Il est parti », à l’autre bout de la mer, d’autres spectateurs attendent : « Le voilà. » Un vent neuf fait claquer à nouveau les voiles qui se tendent vers le large. Autres rivages, nouvelles expériences, nouvelles amitiés : il va falloir réapprendre l’horaire libre des journées, redécouvrir patiemment sa respiration intérieure, s’autoriser enfin quelque repos, se refaire de la place à soi-même. Se recréer est un nouveau métier.
Benjamin
Quand je serai grand, qui sera moi ? Pas plus de quatre ans, déjà la question qui tue. Je me suis assis sur une grosse pierre, lui aussi. Il a jeté un caillou dans l’eau, observant les ronds concentriques et l’image fugace de cette réalité tenue en main qui disparaît quand l’étang l’engloutit. Tous les enfants du monde se retrouvent-ils au fond de la mer dès qu’ils deviennent grands ? Combien de cailloux faut-il faire ricocher pour passer de la spontanéité du petit enfant à la sagesse du grand-père, court-circuitant la période stressée que vivent papa et maman ? Seuls les ronds dans l’eau ont la réponse.
Anne-Marie
Un ange passe. Le temps se suspend une fraction de seconde, on pressent que le charme peut être rompu par un appel téléphonique, une sonnerie à la porte, le bruit d’un objet qui tombe, chacun retient son souffle. C’est comme un cristal qui tinte et l’oreille s’exerce à le prolonger. Cela ressemble à une goutte d’amour, c’est différent de l’amitié, c’est plus qu’une consultation. C’est la complicité fugace entre le soignant et le soigné, le court instant où ce dernier vient vous annoncer qu’il va mieux, que la vie lui sourit à nouveau et qu’il vous en remercie.
Dehors deux oiseaux filent dans le sillage d’un avion argenté, on dirait un trio ailé en formation, communiquant par les ailes. Anne-Marie me fait remarquer qu’elle aussi, elle vole à nouveau et que c’est tout bonnement délicieux. Un frôlement de main sert d’adieu, on prend congé en se promettant de ne pas se revoir – santé oblige – et bonjour la vie.
Justine
C’est une Justine métamorphosée qui se présente à la consultation, comme si la candeur, l’innocence, la grâce et le rire étaient redevenus des qualités d’aînés, un aboutissement de la vie et non son départ. Je l’interroge sur ce qui a changé : la découverte d’un nouvel antidépresseur, un héritage inattendu, la pratique du zen, des projets matrimoniaux ? L’explication est plus simple. Justine a une nouvelle amie qui aime rire, tout le temps, de tout, avec tout le monde. Elle s’adresserait à un chien avec un chapeau en rue et estime qu’après soixante ans de vie sérieuse, on a le droit de sourire sans honte des autres et de soi-même, ce qui demeure incontestablement la source de rire la plus abondante, la plus à portée, la plus inoffensive qui soit.
On a dit qu’il faut distinguer la joie du rire. Si la joie existe par elle-même, invisible, le rire est une houle sonore, prolongée, contagieuse. Elle allait seule, elles vont maintenant par deux, redécouvrant les terrasses ombragées où coule la trappiste dorée, les vitrines changeantes de l’entre-saison et les petites soldes qui vous habillent de neuf pour presque rien. Elle apprécie pour la première fois de sa vie les conciliabules prolongés sous les platanes et trouve, tout compte fait, que la vie est plus drôle que triste. Le rire est une guérison.
Roland
Ne meurt-on jamais quand on fut boulanger ? Roland nous a pourtant quittés un soir de Saint-Nicolas, nous léguant à jamais l’arôme onctueux des chocolats amoureusement préparés pour les fêtes. Une visite à la boulangerie pour un de ses enfants malades était une joie pour le médecin. On en sortait les bras chargés de gosettes aux groseilles encore tièdes, de boules de Berlin saupoudrées de sucre immaculé et de figurines en chocolat odoriférant. Par la porte entrouverte sur l’atelier, on devinait les énormes bras tournant dans la pâte grise, les lourds pains blonds alignés comme des militaires, toute une armée de boules, de miches, de couronnes, de baguettes, de flûtes et de ficelles défilant comme à la parade. Roland n’arrêtait guère une minute de pétrir les ingrédients de ce qui ferait le bon pain, gros et solide, dont on se disputerait la première croûte sur le chemin de la maison au retour de l’école.
Cinq ans ont passé et j’en garde le souvenir vivace lorsque je passe devant sa boulangerie durant la tournée, aux premières heures du jour. Roland a été remplacé au fourneau quelques jours après son décès par un de ses anciens ouvriers. D’épaisses volutes parfumées et chaudes sortent, comme avant, du soupirail s’ouvrant sur la rue commerçante, les bruits de cuisson des croûtes rousses et le chuintement du pétrin parviennent encore à mon oreille. Certains jours, je crois entendre la grosse voix familière s’agaçant de la cuisson oubliée des croissants au beurre et je devine qu’il s’est servi une goutte de Cointreau pour se remonter. Un patient boulanger, c’est de la poésie au quotidien.
Augustin
Il a été joliment écrit que le bonheur naît d’un malheur survenant au bon moment. L’histoire d’Augustin en témoigne.
Un pâle sourire inonde le vieux visage fripé en évoquant un malheur si doux qu’il le revivrait volontiers. Son métier d’alors lui faisait fréquenter les cimes, d’où la chute était un jour inévitable. Passant au travers d’un toit vitré, il se retrouva dans une arrière-cuisine, le bassin fracassé. Une accorte inconnue y faisait rissoler des pommes sautées. On dut jeter le contenu de la cassolette, hospitaliser Augustin. Quand il rentra de l’hôpital, il proposa de réparer la verrière et ne la quitta plus : refuse-t-on d’épouser quelqu’un qui vous tombe du ciel ? Un bonheur de soixante ans avait réduit le malheur au silence.
Abdelali
Je glane entre deux visites les bribes d’un débat radiodiffusé sur les différences culturelles, le vote immigré et la difficile intégration des populations étrangères dans certains quartiers de la capitale. Abdelali m’attend, assis sur le pas de sa porte. Il est vieux, ridé, noueux, à califourchon sur une vieille chaise. Il se tient compagnie à lui-même depuis tant d’années qu’il a oublié sa date de naissance et sa cité d’origine.
Un cornet de crème glacée mousseuse et fraîche lui dégouline sur les doigts, dont il rattrape les coulées d’un coup de langue gourmand en me souhaitant la bienvenue. Sur le trottoir d’en face, des enfants blonds l’imitent avec une délectation non feinte, surveillés par leur jeune mère qui sirote à la paille un sorbet aux couleurs d’arc-en-ciel. Le camion du glacier italien s’éloigne en carillonnant, laissant tout un petit monde apaisé et ravi.
Le scintillement du soleil à jour frisant sur les toitures me fait cligner des yeux et transforme un moment le tableau pittoresque en une chatoyante toile impressionniste. Tout ceci est rassurant en définitive : des êtres humains qui aiment les mêmes glaces parfumées dégustées les soirs d’été sous la treille sont-ils bien aussi différents que les tables rondes d’experts peuvent le croire ?
Maguy
La chaleur était étouffante, elle était lasse. Des soucis avec l’employeur, avec ses deux aînés qui filent un mauvais coton, avec Georges qui s’est mis au genièvre, son dos qui faisait mal. Il pleut tout d’un coup, de grosses gouttes pareilles aux premières larmes qu’on cherche à retenir et qui mouillent les feuilles comme le chiffon donne vie à l’aquarelle.
Dieu que c’était bon de lâcher prise ainsi. Elle ne se souvient plus de grand-chose si ce n’est la vague de plaisir qui l’a envahie soudainement, une lame de fond dont elle situait le départ entre sa nuque et ses reins, qui l’avait fait frissonner : la pluie. Un bref moment d’hésitation et elle replie le parapluie ridicule, un protège-adulte gris qu’elle trouve grotesque. Elle est en chemisier et ne se soucie plus guère de ses formes qui apparaissent, coquines et généreuses. La jupe courte lui colle aux cuisses maintenant, dégouline sur ses mollets. C’est mieux qu’une douche, mieux qu’un sauna ou un jacuzzi qu’elle ne saurait de toute manière pas s’offrir, c’est une ondée de perles qui lui inonde le visage et la transforme en princesse de mille et une nuits. Marguerite se sourit à elle-même, assise sur un banc pour prolonger l’instant, se laissant imprégner par un bonheur physique inattendu au terme d’une journée aussi lourde qu’une menace d’orage. Elle savoure pour elle seule ces rimes enfantines qui lui emplissent spontanément les oreilles : pluie, jolie, folie. Il peut être utile parfois de partir sans imperméable.
Giuseppa
Elle possède un visage de Piéta qui aurait mal vieilli, habillé d’un triste foulard usé par le malheur. Giuseppa a laissé dans sa Sicile natale le soleil d’une enfance trop rapidement interrompue par l’émigration. Elle vit depuis lors une existence de pendule arrêtée et hausse les épaules quand on lui propose de raconter son mariage, ses maternités, les petits emplois, son mal de vivre. Ses enfants l’évitent, son mari la trompe, ses employeurs l’exploitent et on voudrait qu’elle soit heureuse…
Je tente d’interrompre l’interminable description de ses misères en lui suggérant quelques modestes petits plaisirs susceptibles d’apporter une touche de couleur dans sa grisaille. Elle écoute et hoche la tête machinalement, comme si les paysages de malheur étaient les seuls dans lesquels elle se retrouverait vraiment, à la manière de cette héroïne de Pagnol qu’elle aime citer : « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants. »
Elle me demande une prescription pour un tranquillisant et sa pilule contraceptive – point n’est besoin de catastrophe supplémentaire –, s’enquiert du prix éventuel de la consultation si un jour elle était malade et sort très digne, madone de paradis triste comme l’enfer.
Jo
« C’est pour les jambes, docteur. » Difformes, énormes, bleuies par les varices, les jambes de Jo la perdront, c’est sûr. Elle consulte pour tenter de colmater une énorme plaie béante qui la fait souffrir depuis plusieurs semaines et qu’elle traite par d’innombrables cataplasmes et décoctions odoriférantes. Un petit cache-poussière dissimule mal la robe sans caractère, les bas roulés sur les chevilles, ayant abandonné de longue date toute intention de coquetterie. Un physique disgracieux l’a toujours dispensée des avances et séductions de la gent masculine, « que voulez-vous, certaines naissent sous le signe de pas de chance ». L’éducation de son grand fils, seul souvenir qui lui reste d’un lointain et malheureux mariage, occupe le plus clair de ses journées et de ses tourments.
Pendant l’effeuillage minutieux du pansement, mon regard surprend sa lecture en cours. Fiancée à un brigand. Nonchalamment ouvert sur un sofa, un ouvrage de littérature de gare marie une couverture suggestive à une bande-annonce explicite : « Subjuguée par un escroc, elle subit les pires outrages. » Le passage interrompu par mon arrivée devait être torride, le livre s’ouvrant spontanément sur une double page écornée de laquelle s’échappent encore des ondes de désir.
Le contraste entre le physique ingrat de Jo et le monde fantasmatique entrebâillé sur le divan me laisse rêveur. L’érotisme totalement absent de son intérieur petit-bourgeois et de sa personne s’engouffre soudainement comme une monture au galop qui désarçonne. Le contre-jour entre ces jambes souffre-douleur et l’imaginaire amoureux d’une femme en émoi quelques instants plus tôt me rassurerait plutôt : les ulcères à l’âme possèdent également leurs cataplasmes.
Gérard
Cotillons, mirlitons et confettis ne tiennent plus en place en cette veille d’an neuf. Champagne pour tout le monde dans un quart d’heure et que le sablier de l’année se retourne !
Gérard est livide au fond d’une chambre que je découvre dans la pénombre. Les veines qu’il s’est maladroitement tailladées ne saignent déjà plus à mon arrivée, zébrant les avant-bras maigres de balafres éloquentes. Il a la courtoisie de me prévenir : « Gaffe au sang, j’ai le virus. » Un plateau de médicaments sur la table de nuit m’éclaire sur le stade de l’affection, si le visage émacié ne l’avait déjà fait.
Le récit soudain bascule : la mort du frère, atteint comme lui, deux mois plus tôt ; l’agonie partagée et prémonitoire de sa propre fin ; la perte d’un emploi gratifiant dans une multinationale informatique ; les surinfections, les séjours en clinique, l’Espagne lointaine où tout a commencé sur le sable chaud d’une plage. Une ligne de faîte : la solitude. Dans la pièce adjacente, un père absent mâchonne des chips devant une série télévisée insipide. Gérard hausse les épaules : « Bonjour le réveillon : je n’ai plus parlé à personne depuis une semaine. » Je lui propose de le conduire dans le service hospitalier où il est traité, ce qu’il accepte avec empressement. Des vivats et des flonflons venus de l’étage du dessus m’avertissent qu’il est minuit sur le rythme de la danse des canards.
Le court trajet en voiture se révèle d’une densité extraordinaire. J’ai l’impression de voyager avec un troisième passager sur la banquette arrière, muni d’une faux. Gérard ne craint guère la camarde mais en redoute les prémices. Nous dépassons quelques feux de Bengale lancés par de joyeux fêtards, la bouteille à la main. Mon compagnon pleure silencieusement. Je cherche une phrase pour le réconforter et opte finalement pour un silence complice. Avec quels mots souhaite-t-on la bonne année à quelqu’un pour qui l’avenir est barré par un sens interdit ?
Achille
À quel âge acquiert-on une odeur de vieux ? Achille a guidé trois générations de collégiens sur les sentiers des Horaces et des Curiaces, sous les cimes fleuries des Bucoliques de Virgile et dans les citadelles de la guerre des Gaules. S’il récite encore de mémoire des pages entières de L’Iliade, se souvenir des titres du journal télévisé de la veille pose maintenant problème. Un repos mérité l’a mené dans une maison de repos dont il a franchi les portes sans regret : son quotidien à domicile s’annonçait périlleux. Il a pu emporter sa table de travail, ses livres et quelques bibelots anciens, précieux repères pour sa mémoire défaillante.
Ma première visite dans sa nouvelle tanière me surprend : je reconnais dès le seuil l’odeur âcre du vieux bureau enfumé sur lequel il a corrigé tant de copies, mélange subtil d’effluves de tabac refroidi, d’absence de savon et de linge changé une fois par mois. Il a tout emporté avec les rayons de sa bibliothèque, y compris l’arôme du passé.
Je le félicite pour l’aménagement général de la chambre, lui propose une aide pour le rangement des ouvrages et lui demande s’il a bien passé sa première nuit. Il a dormi comme un loir et rêvé de son ancien collège. Il sourit d’un air juvénile qui me rassure.
L’odeur des vieux leur survit-elle, nichée dans les costumes, les coussins, le vieux bureau, les livres jaunis, combien d’années ? Assurément elle les accompagne comme une mémoire, ancrage dans un monde qui n’est plus mais auquel on tient.
Adeline
Une douleur à l’état brut. Adeline a fondu brusquement et s’est laissé tomber sur le lit où elle se ramasse toute, sanglotant. Son gracieux corps d’adolescente bondit, soulevé par le chagrin, l’amour déçu, une colère contenue qui n’ose éclater. Ses vingt ans paient un lourd tribut à une passion qui l’a emportée, transformant la timide collégienne en une gracieuse amazone accrochée à un beau cavalier sur un scooter rouge-grenat. Hier, c’était Noël : un coup de téléphone impromptu a brisé le rêve en plein vol et fait voler en mille éclats un bonheur qu’elle croyait éternel.
La maman pleure doucement en m’accueillant, comme lors d’un deuil ; le papa ne dit rien mais son visage livide parle pour lui. Ils ne trouvent plus les mots de miel et de douceur qui consolaient jadis si aisément leur aînée, les sparadraps sur la poupée, les rubans dans les cheveux défaits par les chutes. Elle se détachait progressivement d’eux, savourant un bonheur sans partage, la revoici tout entière entre leurs quatre bras désemparés, si lourde de chagrin à supporter. J’essaie de trouver une place adéquate dans la chambre soudain devenue trop étroite pour une telle intensité de sentiments mêlés, glane quelques confidences au vol, hoquets douloureux qu’interrompent de longs silences.
Je tente en quelques minutes de reconstituer ce puzzle amoureux de mille pièces éparses, propose de les revoir le lendemain s’ils le souhaitent, m’esquive sur la pointe des pieds. Premier amour qui ne se reconstruira sans doute pas, premières ridules aux paupières d’une enfant soudain devenue adulte.
Aline
« Cette fois, j’y vais. » Je décroche le téléphone pour la cinquième fois et forme avec peine le numéro d’Aline, la gorge serrée. Je souhaite la rencontrer pour l’informer du résultat de ses examens, bredouille une formule d’encouragement au lieu d’une formule de politesse, ce qui me trahit, raccroche.
Elle est maintenant assise en face de moi, les jambes bien droites, les mains nouées sur les genoux et attend. Elle se tait, une flamme anxieuse dans le regard : une fraction de seconde qui me paraît un siècle. Son mari, à ses côtés, transpire de grosses gouttes qui tombent sur le tapis comme la première pluie avant l’orage. Lui non plus ne dit rien. Je m’éclaircis la voix, me donne une contenance et tout à coup m’abandonne aux mots qui spontanément me viennent aux lèvres. « Je suis inquiet, Aline, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. N’hésitez pas à m’interrompre si je ne suis pas clair. N’avez-vous jamais ressenti une gêne au foie… » J’enfile les phrases avec attention, conscient qu’elles résonnent dans mon bureau comme les cloches sonnent le tocsin.
« Pourrait-ce être un cancer ? » Nos regards se croisent, il n’est même plus nécessaire de chercher les mots. Elle a compris. Son mari lui prend la main et je le vois pleurer doucement. Son visage se décompose progressivement, une arborescence de petites rides que je ne lui avais jamais remarquées précédemment lui sillonnent brusquement les alentours des yeux et les commissures des lèvres. Dix ans se sont écoulés en deux minutes et je suis pris d’une nausée incoercible à la seule pensée des mots que je viens de prononcer. Une lâche envie de fuir, de claquer la porte et de courir éperdument en rue me saisit, j’en ai honte. Un long silence habite la pièce où la pénombre d’un soir de novembre s’est soudain installée.
Un sourire las clôt la consultation, une poignée de mains, je les raccompagne à la porte. Le reste appartient à l’oncologue qui va prendre Aline en charge ; je la reverrai épisodiquement pendant la chimiothérapie, bien plus tard au moment de l’ultime glissade « de l’irréel vers le réel, du rêve vers la conscience » pour paraphraser la Gîtâ. Mais dans mon bureau aujourd’hui, pour ce couple en détresse, la sagesse et la philosophie me parurent bien impuissantes à calmer la douleur de l’annonce.
Alice
Comment raconter l’automne mieux que par la fenêtre d’Alice ? À chacun ses trésors, mais vieillir avec un paysage pareil n’est plus dépérir. Je suspends l’auscultation un moment, ébloui par le platane dont les lumières mordorées inondent la baie vitrée. Comment raconter les roses, les mauves, les bourgognes et les violets qui succèdent aux oranges, aux cuivres, aux ocres et aux ors ? Le regard se promène, bondit de buisson en bosquet, enchanté et rêveur devant cette nature qui resplendit dans son agonie. De la cime au sol jonché de feuilles craquantes, l’arrière-saison invite la palette du peintre à faire chanter les dernières heures précédant les feux dans l’âtre, les frimas et le retour des mitaines.
Il y a quinze ans qu’Alice a rangé ses valises au vestiaire, troquant les paysages lointains pour un superbe appartement de la banlieue verte de la capitale. Les billets d’avion ont été remplacés par les longues flâneries du regard dans le sillage des oiseaux, les tables d’hôtes par le sobre repas pris sur la terrasse d’un soir d’octobre. Les rayons du soleil couchant donnent à sa vie un éclairage pointilliste dont elle se plaît à souligner la valeur symbolique : « Moi aussi, je disparais doucement de l’horizon, c’est doux. » Elle prend congé de la vie sans se presser, avec de bonnes manières, soucieuse de n’importuner personne. L’automne est une mort douce.
Lydie
Une mauvaise sciatique lui cloue la jambe depuis une semaine. Elle est vêtue de terne des pieds à la tête, porte un tricot rapiécé aux coudes. Quatre-vingt-deux années de grisaille et de service comme femme de chambre lui ont courbé l’échine et esquinté la charnière lombo-sacrée. Mon traitement reste modeste, à son image : quelques jours de repos, un antalgique et un baume révulsif salicylé afin que la guérison pénètre également par les narines.
Un rituel immuable préside à l’acquittement des honoraires. Dans une enveloppe de réemploi, elle a glissé six cents francs1, m’épargnant la gêne de lui rendre la piécette de vingt francs qu’exigerait un respect scrupuleux des barèmes conventionnés.
Elle prend congé avant que j’ouvre l’enveloppe, selon une convention tout aussi immuable. Ce paiement à l’acte modeste, lui fût-il remboursé entièrement, demeure sa fierté et délimite son espace de liberté : « J’étais souffrante, j’ai consulté, je paie ce que je dois sans recevoir de monnaie en retour. » Digne. L’espace d’une consultation, Lydie a conquis le droit d’être appelée « Madame ».
Évelyne
Elle a la peau sombre de la Côte d’Ivoire, où elle n’est pas née. Dix-sept ans à raser les murs d’une ville dont elle n’a jamais quitté le centre, sans identité, ni numéro d’identification au registre national, ni nationalité. Évelyne Personne, comme elle se présente avec un sourire de dérision, n’a aucune existence légale. Elle doit être née à Bruxelles en 1981, mais sa naissance clandestine n’a jamais été notifiée. Sa maman s’en excuse, honteuse de la succession de petits boulots mis bout à bout pour survivre, bien insuffisants dans la recherche d’un appui efficace qui la naturaliserait. Ses études d’infirmière, qui l’ont amenée en Belgique, ont été interrompues, l’essai n’a jamais été converti. Un tiers d’existence en Afrique, où il lui reste une sœur, deux tiers en Belgique où sa fille est sa seule famille.
On pourra débattre sans fin des abus de l’immigration clandestine, des filières juteuses et des soutiens louches. Il a, ce soir, au terme de ma consultation, un contour obsédant. Celui d’un visage d’ébène au sourire identique à celui de ma fille cadette, si gâtée par l’existence. Sa jumelle sans papiers d’identité ne demande rien qu’un petit bout de reconnaissance officielle, le droit à porter un nom. Elle ne dort pas dans une église, n’arbore aucun masque blanc à la télévision, sourit comme les autres filles de son âge et persiste à espérer qu’un jour, on lui dira qu’elle existe.
Bernard
« Vieux vicieux, tous les mêmes, l’air innocent en plus. Vous mériteriez qu’on vous coupe la main, espèce de sale pépé. » La maman a empoigné la menotte de son fiston et sort furieuse de la salle d’attente. Le vieux Jules, éberlué de l’incident qu’il a involontairement provoqué, hoche la tête en silence le rouge au front en me lançant un regard de chien apeuré.
La maman de Bernard s’est absentée un moment aux toilettes, laissant en tête-à-tête son rejeton et le vieux retraité bon-enfant. La frimousse poil-de-carotte du gosse et ses cheveux de feu attirent la sympathie comme le pollen les abeilles. Il a cinq ans et encore toutes ses dents de lait, une santé de bon augure et une mère effarouchée par des fantasmes d’attouchements et de regards lubriques. Jules a proposé un caramel mou à Bernard, la sympathie a été immédiate et réciproque, tous deux dégustent le bonbon partagé quand maman regagne sa place… La suite se devine et il n’y a plus de quoi en sourire.
C’est peu dire qu’un caramel mou signe un crime de nos jours, mais il est tout de même des gestes simples qu’il faudra réinventer : donner la main à un enfant pour lui apprendre à traverser la rue, les caresses dans les cheveux que tous les pépés du monde ont depuis l’aube des temps prodiguées aux petits d’homme, l’apprentissage de la tendresse simple des adultes pour les plus jeunes, les fous rires complices et les jeux improvisés. Une pesante ère de soupçon a remplacé tout cela et c’est peut-être le pire des crimes.
Eugène
N’avais-je jamais vu un homme si vieux ? Une tête de plumeau prolongeant un corps recroquevillé dans un fauteuil en osier. Ma première impression est de l’amusement à observer le curieux contraste formé par la chemise boutonnée avec cravate, le chapeau bien mis et l’absence de pantalon révélée au moment où il se lève pour m’accueillir. Rose, en épouse attentionnée, prévient le moindre faux pas et couve son homme avec des yeux de biche, s’éclipsant soudainement lors de l’auscultation.
Jaillit du fond du siècle sur le torse maigre, un tatouage moiré orne l’anatomie d’Eugène entrelaçant sensuellement deux dragons et un serpent d’où s’échappait un vibrant « À Juju pour la vie ». L’embarras de Rose explique bien sa prompte disparition au moment de l’effeuillage du haut : septante-cinq années de vie commune n’y changent rien. L’espace d’un instant, j’imagine Eugène aux mains du tatoueur chinois rencontré lors d’une escale lointaine dans l’entre-deux-guerres. Son navire a parcouru le monde, il a parcouru les femmes et l’une d’elles a laissé une empreinte durable.
Il tousse pour s’éclaircir la voix et les dragons se contorsionnent. Je le laisse se rhabiller, Rose réapparaît une chemise fraîche sur les bras et nous sourit. Si la jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est bien le temps de la pratiquer.
Étienne