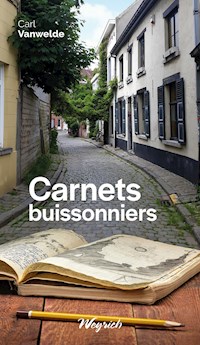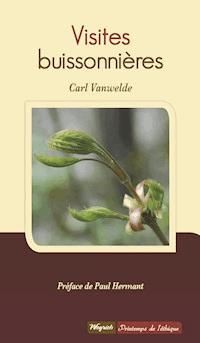
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Le Printemps de l'éthique
- Sprache: Französisch
Relation patients-médecins : des professionnels de la santé racontent
Une parole autour de ce que l'auteur - un médecin généraliste - a de plus intime : l'amour de la vie, l'amour des hommes et des femmes qu'il croise, un certain point de vue sur le bonheur...
Par petites touches, ce récit tendre, émouvant, drôle, réaliste, nous ouvre à l'humanité de l'autre, qu'il soit soignant ou patient. Il nous raconte l'essence même d'un métier que certains disent en perdition.
À lire... À offrir... À méditer... mais sachez-le : vous ne regarderez plus jamais la médecine ni les médecins comme avant !
EXTRAIT
Ce matin, j'ai découvert un perce-neige, inattendu, une vraie merveille. Ses clochettes paraissent surprises de se retrouver là, dans l'enclos givré que leur forment les dernières croûtes de neige qui luttent contre un pâle soleil. On se prend à guetter l'appel lointain des oies rieuses qui se rassemblent dans les lagunes en attendant que les souffles printaniers les poussent plus au nord, ou le chant de la sarcelle amoureuse appelant au renouveau. En pinçant avec deux doigts un fragment de leurs délicates enveloppes, la main s'assure de la réalité de tant de douceur inespérée hier encore, quand le vent nocturne faisait claquer les volets dans leurs rails.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En guise de remerciement à …
Marius, Agathe, Alphonse, Marie-Louise et tant d’autres, dont les prénoms et les traits distinctifs ont été soigneusement retouchés afin d’assurer leur anonymat, mais sans qui ce livre n’existerait pas.
Ils m’ont appris que la vie scintille, et que tout ce qui n’est pas donné est perdu : qu’ils en soient ici sincèrement remerciés.
Ces pages ne contiennent ni secrets de famille, ni aucun élément de leur dossier médical mais tissent la chronique d’un de ces innombrables villages urbains qui constituent la capitale de l’Europe.
Ils y ont gardé leurs racines, séduits par ses jardins secrets, ses placettes à fontaine, ses ruelles où des diables en pierre décrochent encore toujours les nuages, et par la chaleur humaine sans fard de ses habitants. Certains sont actuellement décédés, et retrouveront ainsi une étincelle d’éternité.
Préface
Pourquoi, en lisant ces portraits, ai-je l’impression qu’il s’agit là du carnet d’un médecin de campagne ? Peut-être à cause de la chaise tirée. On la voit très bien la chaise tirée, quand on lit les chroniques de Carl Vanwelde. On entend très bien l’horloge aussi. Et je ne sais pas pourquoi, ces chroniques pour moi ont la couleur de nappes à fleurs et l’odeur de café repassé.
On a le temps.
Et le docteur, donc, est assis.
Parce qu’il sait que le temps pris est surtout du temps donné.
Et que le temps se donne assis. Debout, il court.
Il y a donc des gens, comme ça, qui ont appris à s’asseoir. Une dame magnifique, me résumant sa vie, me disait ceci récemment : « Avec les événements et les gens, il faut trouver la bonne distance, c’està-dire la bonne proximité. » Je me dis que ça a dû lui demander des années, à Carl Vanwelde, d’apprendre à tirer sa chaise pour trouver la bonne proximité. À moins qu’il ne l’ait su tout de suite et qu’il ait compris très vite que, pour être médecin, il fallait surtout être patient.
Le docteur est assis et pourtant nous ne sommes pas à la campagne. Ce médecin pratique en ville : à Bruxelles, capitale et cosmopolite, bruyante et fuyante. C’est un citadin dont les heures sont de pointe. On mesure mieux encore ce que coûte la lenteur à l’homme qui entend ausculter – c’està-dire écouter, prêter l’oreille – comment passe le temps des autres quand il ne passe plus tout seul, que l’accident vient ou que la santé se perd.
Nous avons donc entre les mains un livre d’humanité. Mais ce ne serait pas assez ni bien dire. Il faut préciser aussi que ce livre est écrit. Et qu’il n’est pas facile d’écrire avec peu de mots. On connaît la célèbre formule : « Pardonnez la longueur de ma lettre, mais je n’ai pas eu le temps de faire court. »
Ici, on dirait que chaque mot a justifié une visite. Car les mots sont pesés, c’est-à-dire qu’ils ont du poids. Ils ont la pesanteur de la main et la gravité de l’oreille tendues. C’est ce qui se passe quand un prescripteur devient un écrivain.
Ces chroniques, Carl Vanwelde les a écrites voici quelques années pour Le Journal du Médecin sous le pseudonyme de Zénon, celui de Marguerite Yourcenar. On comprend pourquoi.
Un autre Zénon qui était grec et philosophe disait ceci : « L’homme a deux oreilles et une seule langue, pour écouter deux fois plus qu’il ne parle. » C’est bien dommage que les médecins n’écrivent pas plus souvent des livres comme ceux-là. On se mettrait enfin à comprendre leur écriture.
Paul Hermant
Toute rencontre est une étincelle dans l’éternité.
Proverbe zen
Je ne regrette pas d’avoir été à Ravensbrück, puisque j’y ai rencontré Miléna.
Margarete Buber-Neumann
Il y a une fissure, une fissure dans tout, comme ça, la lumière peut entrer…
Leonard Cohen
Agathe
Ce matin j’ai découvert un perce-neige, inattendu, une vraie merveille. Ses clochettes paraissent surprises de se retrouver là, dans l’enclos givré que leur forment les dernières croûtes de neige qui luttent contre un pâle soleil. On se prend à guetter l’appel lointain des oies rieuses qui se rassemblent dans les lagunes en attendant que les souffles printaniers les poussent plus au nord, ou le chant de la sarcelle amoureuse appelant au renouveau. En pinçant avec deux doigts un fragment de leurs délicates enveloppes, la main s’assure de la réalité de tant de douceur inespérée hier encore, quand le vent nocturne faisait claquer les volets dans leurs rails.
Comment nommer ce temps qui s’ouvre devant Agathe, petite merveille de quelques jours née avec les derniers frimas d’un hiver rude, si désirée, si choyée dès sa naissance par de jeunes parents amoureux qui s’en émerveillent ? Comment décrire cette impatience dans l’espérance, ce renouveau de l’air respiré éclatant d’un amour qui s’est incarné ? Les petites menottes qui battent dans le vide paraissent répondre aux clochettes de mes perce-neige matinaux, annonçant avec quelques semaines d’avance le retour de la grande gaieté du soleil, des jardins qui vont renaître aux fenêtres pour fêter la noce éternelle de Gaia, la Terre, et du Soleil. Je me surprends à chantonner en sourdine, oubliant un moment les gémissements douloureux du patient arthritique de chez qui je viens, les céphalées sans fin de sa voisine et les purulences qui poissent mes instruments. Ce qui est fragile aurait-il ce matin raison de ce qui est fort ; ce qui commence, de ce qui finit ; la vie sous la neige, de la mort en surface ? Bienvenue Agathe, la terre t’espère.
Alice
Comment raconter l’automne mieux que par la fenêtre d’Alice ? À chacun ses trésors, mais vieillir avec un paysage pareil n’est plus dépérir. Je suspends l’auscultation un moment, ébloui par le platane dont les lumières mordorées inondent la baie vitrée. Comment raconter les roses, les mauves, les bourgognes et les violets qui succèdent aux oranges, aux cuivres, aux ocres et aux ors ? Le regard se promène, bondit de buisson en bosquet, enchanté et rêveur devant cette nature qui resplendit dans son agonie. De la cime au sol jonché de feuilles craquantes, l’arrière-saison invite la palette du peintre à faire chanter les dernières heures précédant les feux dans l’âtre, les frimas et le retour des mitaines.
Il y a quinze ans qu’Alice a rangé ses valises au vestiaire, troquant les paysages lointains pour un superbe appartement de la banlieue verte de la capitale. Les billets d’avion ont été remplacés par les longues flâneries du regard dans le sillage des oiseaux, les tables d’hôtes par le sobre repas pris sur la terrasse d’un soir d’octobre. Les rayons du soleil couchant donnent à sa vie un éclairage pointilliste dont elle se plaît à souligner la valeur symbolique : « Moi aussi, je disparais doucement de l’horizon, et c’est doux. » Elle prend congé de la vie sans se presser, avec de bonnes manières, soucieuse de n’importuner personne. L’automne est une mort douce.
Aline
« Cette fois, j’y vais. » Je décroche le téléphone pour la cinquième fois et forme avec peine le numéro d’Aline, la gorge serrée. Je souhaite la rencontrer pour l’informer d’une mauvaise nouvelle, bredouille une formule d’encouragement au lieu d’une formule de politesse, qui me trahit, et raccroche.
Elle est maintenant assise en face de moi, les jambes bien droites, les mains nouées sur les genoux et attend. Elle se tait, une flamme anxieuse dans le regard : une fraction de seconde qui me paraît un siècle. Son mari, à ses côtés, transpire de grosses gouttes qui tombent sur le tapis comme la première pluie avant l’orage. Lui non plus ne dit rien. Je m’éclaircis la voix, me donne une contenance, et tout à coup m’abandonne aux mots qui spontanément me viennent aux lèvres. « Je suis inquiet, Aline, et vais essayer de vous expliquer pourquoi. N’hésitez pas à m’interrompre si je ne suis pas clair. N’avez-vous jamais ressenti une gêne au foie… » J’enfile les phrases avec attention, conscient qu’elles résonnent dans mon bureau comme des cloches sonnent le tocsin. « Pourrait-ce être un cancer ? » Nos regards se croisent, il n’est même plus nécessaire de chercher les mots. Elle a compris. Son mari lui prend la main et je le vois pleurer doucement. Quant à elle, son visage se décompose progressivement, et une arborescence de ridelles que je ne lui avais jamais remarquées précédemment lui sillonnent brusquement les alentours des yeux et les commissures des lèvres. Dix ans se sont écoulés en deux minutes et je suis pris d’une nausée incoercible à la seule pensée des mots que je viens de prononcer. Une lâche envie de fuir, de claquer la porte et de courir éperdument en rue me saisit, et j’en ai honte. Un long silence habite la pièce où la pénombre d’un soir de novembre s’est soudain installée. Je regarde à nouveau Aline, esquisse un pâle sourire, suscite d’éventuelles questions. La veille, j’ai lu Françoise Henry1, était-ce prémonitoire ?
Le sol se dérobait sous elle. Le ciel se déchira, devint transparent, et toutes les choses qu’elle aimait du fond d’elle-même, l’air de septembre, l’odeur lointaine d’un feu de broussailles arrêté par la pluie dans un champ, celle plus proche de l’herbe un peu humide, et les sensations d’avant l’automne, celle du tissu léger de sa robe sur ses jambes encore nues, même le léger crépitement des gouttes sur le tissu du parapluie, tout cela fut douloureux d’un seul coup.
Un sourire las clôt la consultation, une poignée de mains, je les raccompagne à la porte. Le reste appartient à l’oncologue qui va prendre Aline en charge ; je la reverrai épisodiquement pendant la chimiothérapie, et plus tard au moment de l’ultime glissade « de l’irréel vers le réel, du rêve vers la conscience » pour paraphraser la Gîtâ. Ô mes yeux bienheureux, tout ce que vous avez vu, que cela soit comme cela voudra, c’était quand même si beau ! (Goethe).
1. Françoise Henry, Le postier, Calmann-Lévy, 1999.
Alphonse et Marie-Louise
Il y a du Brassens dans ce visage : la moustache rieuse, le pétillement au fond des yeux, l’absence de malice dans les rides. Alphonse vieillit bien, je le lui rappelle les jours d’anniversaire et quand il parle de vendre… Marie-Louise ne vieillit pas, elle le suit et le protège, couvrant ses rhumatismes de laine chaude et de liniments durant la saison hivernale, discrète et efficace petite main que le travail ne rebute guère. Je les traite six mois par an, passant le relais le jour du printemps à un confrère du pays profond, collaboration médicale inhabituelle mais efficace.
Alphonse et Marie-Louise ont repris la route hier, troquant la chaude demeure familiale pour la caravane foraine, le tir aux pipes et la pêche aux canards. Leurs septante ans rassurent les enfants des kermesses de village qu’ils vont amuser de fête en fête durant l’été, ayant connu les visages radieux de leurs parents et grands-parents quand ils étaient gosses eux-mêmes. Je les imagine sur la route, cliché vivant de mes livres d’enfance quand je rêvais d’accompagner un cirque, semant la fête sur son passage et attirant le badaud avec de grands rires sonores. Je tente de guérir les corps, ils guérissent les bleus à l’âme en distribuant aux regards d’enfants émerveillés du rêve plein leur roulotte.
Bonne route, les forains, on vous envie.
Archibald
Suzanne a la main qui traîne quand elle prend congé, la hanche qui ondule quand elle dégrafe la robe pour dégager le bras où se mesure la pression artérielle, le soupir profond quand on lui demande de respirer pour déplisser les bases pulmonaires. Elle est vêtue de dentelle affriolante, de justaucorps savamment découpés pour habiller sans rien cacher si ce n’est sa cinquantaine qu’elle abhorre. Elle est délicieusement exaspérante, s’inquiète de la réussite de notre petit dernier ou de la destination de nos prochaines vacances : c’est si doux d’être intime.
D’aucuns séduiraient-ils simplement pour survivre, et vit-on encore quand on ne charme plus personne ? Je la retrouve ce matin décoiffée, le regard un peu hagard par une nuit d’insomnie. Par bribes, je crois comprendre qu’elle a rêvé d’un chevalier d’enfance prénommé Archibald, amené de sa lointaine Australie en Belgique par une mission économique durant l’exposition universelle de 58. Elle avait douze ans, et il venait dîner en tête-à-tête avec ses parents. Il revint dix ans plus tard, elle était en fleur maintenant. Ils se sont aimés, promis mille choses, échangé les bagues et des serments éternels ? Elle a dansé avec lui sous les lustres scintillants de salons victoriens de Canberra. Les familles se sont entendues pour la suite matrimoniale de l’histoire, et puis plus rien : un silence vide, l’air du soir qui fraîchit progressivement avec l’automne qui vient, les lettres en poste restante qui reviennent sans avoir été cueillies et des questions sans réponse qui dansent la sarabande du crépuscule jusqu’à l’aube.
Depuis, elle séduit sans relâche, honte ni retenue, éperdument. Miroir, mon beau miroir, suis-je belle ? Et que m’a-t-il manqué pour passer à un souffle du bonheur ?
Armand
Ce pourrait être une journée merveilleuse, avec un vrai soleil qui vient casser l’hiver, et une première chaleur dans l’air qui fait tomber les vestes. Les dames ont sorti leurs robes légères et leurs compagnons ont retroussé les manches. Une furieuse envie de promenade et de sieste allongée sur les pelouses du Parc Royal s’insinue, prolongeant la pause repas de fonctionnaires tout ragaillardis par une poussée de sève printanière.