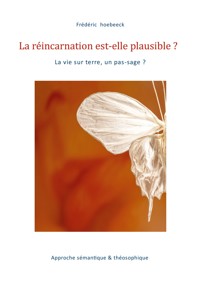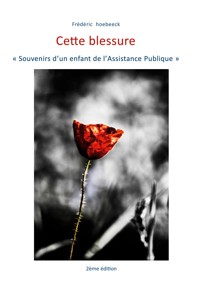
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Voilà un livre qui aurait très bien pu aussi s'appeler "Un vrai témoin chez les faux témoins ". Il y a d'abord dans ce livre une dimension documentaire et historique dans la mesure où il donne une description en immersion de la réalité des institutions de Belgique pour enfants du juge dans les années 1962 à 1983. Le ton est subjectif mais sonne très juste, ce qui en fait toute la richesse et toute la force. Les aventures de Frédéric pourraient être décrites comme le cas d'école absolu, dans la mesure où rien ne lui est épargné dans son parcours d'enfant de l'assistance publique. Ce qui est marquant, c'est la constance de cette lumière vitale qui accompagne Frédéric depuis toujours au travers des épreuves qu'il traverse et qui ne se dément jamais. Même dans les moments de désespoir, elle irradie en souterrain et se tient en réserve. Cette lumière témoigne de la vie, et l'auteur en fait sa vérité et en retire sa force. C'est cette vérité qui a triomphé des idolâtres narcissiques, de ceux qui s'érigent précheur, maîtres de la fin des temps... J'ai nommé : Les témoins de Jéhovah. Au milieu de ces gens qui se gargarisent de toute puissance et qui ne témoignent de rien d'autre que de leur orgueil et de leur ignorance des choses de l'esprit, Frédéric a témoigné de la vie, du sens, de la justice. Il l'a fait avec l'obstination des humbles lorsqu'ils accomplissent un devoir sacré, celui de vivre ! C'est un livre vrai et beau qui rive leur clou à tous les illuminés qui fantasment sur la spiritualité. La légitimité de parole appartient à ceux qui ont traversé les épreuves et qui en ont triomphé. A ce titre, Frédéric a prouvé sa légitimité, cela doit être reconnu comme tel. Gilbert BonneFoy
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce livre aurait pu s’intituler :
« De couleur écarlate » (Mention au vêtement du Christ avant sa mort)
« Éducation perverse d’une religion mal arrangée »
« L’embellie » (Référence à la chanson de Jean Ferrat)
« La vie vaut-elle la peine d’être vécue ? »
« Témoin de la vie ». (Se rapportant aux Témoins de Jéhovah)
« Mes tréfonds »(Allusion au livre de Jean-Jacques Rousseau : « Mes confessions »)
Mais je l’ai finalement appelé :
« Cette blessure »(Référence à la chanson de Léo Ferré)
© Fh. 2015
« Paul et moi, photo prise en 1976, jour de Noël »
Paul nous a quittés le 20 janvier 2015 et a consacré toute sa vie à soutenir les enfants en difficultés.
Il est mort le jour de sa retraite, à croire qu’il ne put y avoir pour lui une autre vie en dehors des institutions.
Ce livre est dédié à tous les acteurs sociaux, aux enfants des homes et en particulier à :
Paul Wittebols
Qui est Frédéric hoebeeck ?
Prévert aurait pu écrire de lui :
Il est comme il est Il est fait comme ça Quand il a envie de rire Oui il rit aux éclats Il aime celui qui l'aime Est-ce sa faute à lui Si ce n'est pas le même
Qu'il aime chaque fois Il est comme il est Il est fait comme ça Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de lui
Guy JOLLY
Table
Préface
Avertissement
I/ Mes premiers pas dans la vie
1962-1969
II/ Home, la Consolation, 81
1969-1971
III/ L’Abbaye d’Oignies
1971-1973
IV/ Le home du Père Damien
1973-1975
V/ La Chapelle de Bourgogne
1975-1982
VI/ Kristel
1978-1980
VII/ Chapelle…suite et fin
1982
VIII/ Patricia
1982
IX/ Le Home de jeunes travailleurs
1982
X/ Mon service civil
1983
XI/ Claudine
1984-1986
XII/ Léonie
1976-1997
XIII/ Claudine…suite et fin
1986
XIV/ Christiane, ma sœur
1962-1986
XV/ Mes études d’éducateur
1987-1989
XVI/ Rencontre avec Maharaji
1988-1989
XVII/ Le Condor,
1989-1990
XVIII/ Témoins de Jéhovah
1989-2012
XIX/ L’Asbl « AniMer »
1991-1996
XX/ Éric, mon frère
1964-1998
XXI/ Témoins de Jéhovah suite
1996-2012
XXII/ Céline
1996-?
XXIII/ Léonie…suite et fin
1997
XXIV/ Les Témoins de Jéhovah, notre sortie
2010-12
XXV/ La fin de la vie de ma Maman
2017
Pensées furtives
La chanson de Paul
Le temps qui reste
Remerciements
Crédits photographiques
Préface
Ce livre raconte mon histoire, celle d’un enfant qui a séjourné dans les institutions de l’État de 1962 à 1983. Cette période est marquée par la transition de l’assistance publique vers une professionnalisation du secteur socio-éducatif.
Le clergé s’occupait en général des malades, des hospices pour personnes âgées, des pensionnats pour enfant s, de la scolarisation et de bien d’autres choses qui touchaient de près comme de loin à l’assistance des indigents. Cette transition ne s’est pas faite sans heurts et bien des choses ont changé depuis.
Ce livre retrace, à travers ma vision, l’atmosphère qui y régnait jadis et les incohérences de l’époque. Il était courant de distinguer l’aide par l’âge de la personne et ne tenait pas compte des besoins essentiels individuels. C’était l’âge qui déterminait le placement dans une institution. Il y avait seulement comme distinction institutionnelle les enfants avec les enfants, les adultes avec les adultes et les vieillards avec les vieillards. Les besoins propres à chacun sont maintenant examinés par des spécialistes qui orientent les cas similaires, ou se rapprochant, dans des institutions plus spécifiques à la situation donnée de l’enfant ou de l’adulte. Par contre, le modèle scolaire, où les classes, en primaire, étaient regroupées, a été abandonné. Est-ce une bonne chose ?
À l’époque, il n’existait pas de prisons pour mineurs délinquants. Un tueur mineur était mis dans une institution de l’État sans distinction. Il y avait bien une à deux structures connues à l’époque comme Brasschaat, côté Flandre et Wauthier-Braine, côté Wallonie, mais très vite les places étaient prises et ne permettaient plus d’introduire d’autres mineurs délinquants. Faut-il encore rappeler que les éducateurs n’étaient pas spécialisés et servaient plus de gardiens que d’aides et de soutiens aux mineurs. Il arrivait très régulièrement que des enfants très perturbés rejoignent d’autres enfants qui ne posaient pas de soucis majeurs. Le mélange des deux était une difficulté de taille et empêchait bien souvent de soutenir individuellement l’enfant carencé. Cette dissonance aggravait bien souvent l’attitude des uns sur les autres.
Mon parcours est également une piste vers une compréhension de l’enrôlement sectaire. Les mouvements à caractère sectaire ont vite fait d’appâter ces enfants carencés ou en difficulté ou en révolte contre la société. Je témoigne de ma naïveté et de mon manque de moyens pour éviter ce genre de piège que bien souvent une famille traditionnelle avertie évite par un partage d’opinions et une connaissance plus approfondie des écrits sacrés.
Dans le corps enseignant et éducatif, cette partie de la connaissance est évitée sous un prétexte de neutralité religieuse ou philosophique. En empêchant cette transmission du savoir ancestral et familial, on peut provoquer chez un jeune adulte une recherche sans protection vers ces mouvements radicalisés ou à dérive sectaire religieuse ou philosophique.
De nos jours combien de familles peuvent encore se prévaloir de cet échange philosophique et religieux ? Nos familles se déchirent et se dispersent comme la balle dans le vent. De plus, nous vivons de grosses périodes de crise économique qui provoquent un taux de chômage élevé. Près d’un tiers des habitants de la Belgique vit sous le seuil de pauvreté. Ces situations sont propices à l’endoctrinement et à la manipulation. Nous connaissons de surcroît une montée de la radicalisation et du terrorisme en Europe.
CheCoPa, Asbl créée en septembre 2015 pour prévenir et soutenir les personnes endoctrinées, tente entre autres par l’information, de combler cette absence chez ces enfants, en partageant un moment de savoir sur les grandes lignes des écrits religieux. C’est au travers de cette information que l’enfant devenu adulte pourra comparer et se faire sa propre opinion. Il ne sera pas sans connaissance élémentaire une fois contacté par ces mouvements apocalyptiques. Les points les plus usités pour enrôler les jeunes sont la fin du monde et un devenir radieux dans un hypothétique paradis à venir en s’appuyant sur l’insécurité et le désir de vivre en appartenance à un groupe. Si nous pouvons démontrer par les écrits sacrés que ces choses ne sont en fait que de la manipulation et rien d’autre, les jeunes seront à même de discerner et d’éviter les pièges tendus.
J’en ai payé les frais et m’en suis tiré miraculeusement à l’âge de cinquante ans. J’en témoigne dans les derniers chapitres de mon livre.
Mon histoire est l’histoire d’une famille parmi tant d’autres et qui est propre à la Belgique. Les circonstances de la vie et les rencontres m’ont permis d’éviter ou de susciter une voie différente pour chacun d’entre nous. Le hasard et la providence ont été fortuits et ne permettent pas d’en tirer une conclusion, mais mon vécu est une approche et une réflexion pour le secteur socio-éducatif.
Le récit est linéaire aux temps passés et donne l’impression d’être une narration descriptive des faits sans s’appesantir sur mes sentiments. Pourtant, tout est émotion, émotion qui revient à la vie à chaque souvenir transposé sur la page. Ce livre est au sens propre du terme un vécu réel et émotionnel depuis le début jusqu’à sa fin. Il vous appartient, vous lecteur, de pénétrer dans cette intimité et d’en décoder le sens selon votre propre vécu et votre perception de la vie.
J’ai ajouté à cette deuxième édition deux chapitres, celui de ma sortie de ce mouvement sectaire qu’est l’organisation des Témoins de Jéhovah et la fin de vie de ma maman.
Frédéric hoebeeck, Membre-fondateur de CheCoPa
« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. »
Antoine de Saint-Exupéry
Avertissement
L’histoire qui va suivre est une autobiographie. Je tenterai de suivre de façon chronologique ma vie et m’appuierai sur ce que ma mémoire veut bien me dévoiler au moment de l’écrit. Je m’efforcerai d’être le plus fidèle à la réalité. C’est pourquoi si certaines personnes se retrouvent dans ce livre, qu’elles ne se vexent pas dans leur for intérieur de la description que j’en ferai, car mon but n’est nullement de porter préjudice à autrui ni de revendiquer une certaine justice.
Je nommerai la personne par son prénom avec la première lettre du nom de famille afin de garder l’anonymat.
J’écris ce qu’est ma réalité, celle que ma perception et ma mémoire veulent bien me révéler selon mon angle de vision. Ma perception des événements est toujours en relation avec les informations que je connais au moment des faits , selon les capacités à les comprendre et de les analyser avec ou non une influence de ma structure émotionnelle et cognitive.
Cette autobiographie suscitera chez le lecteur un lien avec ses propres expériences et comparera son vécu avec le mien si celui-ci se trouvait dans une circonstance proche de la narration.
J’ajouterai à cette autobiographie les pensées qui me traverseront l’esprit et le coeur. Je ferai une auto-analyse et une autocritique de mon histoire selon ce que j’ai compris et appris à travers mes expériences, mes lectures et mes observations de la vie. Cela apparaîtra en italique dans le texte. Je serai direct et franc et quelquefois cru dans mes propos.
Je ne veux d’aucune façon romancer ma vie ni l’embellir, mais bien la révéler dans son état originel. Je me présenterai à l’état brut, sans fioritures, sans compromis. Il vous appartiendra de me façonner au travers de votre jugement comme on façonne une pierre pour lui donner son éclat et en finalité lui donner la valeur que vous lui prêteriez.
Mon plus grand désir serait donc d’apporter un espoir pour toutes les personnes qui auraient pu vivre une situation similaire à la mienne et de partager avec tous les acteurs sociaux une partie de ma vie afin qu’ils puissent mieux cerner l’apport affectif, psychologique, matériel et spirituel qui sont une nécessité pour guider enfants et jeunes adultes dans leur devenir.
Je veux juste que mon histoire, si elle vaut la peine d’être contée, soit une expérience utile à partager.
La trame de mon histoire expliquera la façon dont l’État belge s’occupait des enfants abandonnés ou orphelins au début des années 1960, car inévitablement l’histoire entre en ligne de compte. Il y aura manifestement une grande différence entre le passé et le présent. La société a évolué et évolue toujours vers une professionnalisation de métier socio-éducatif. Apparemment, la bonne volonté d’aider ne suffit plus. Le milieu de l’éducation est devenu une organisation structurée qui s’oblige à limiter la relation filiale à une relation professionnelle.
Je toucherai aux différents inconvénients que suscite l’une ou l’autre méthode d’éducation. La différence réside dans l’approche entre l’adulte et l’enfant. J’ai eu l’occasion d’exercer dans le secteur socio-éducatif et j’ai relevé certaines anomalies, dont celle-ci : la relation humaine entre adulte et enfant ne peut ôter une partie sensible et incontrôlable qu’est la spiritualité. Elle touche une partie non quantifiable ; elle remet en question le professionnalisme par rapport à la bonne volonté humaine qui s’exerce souvent par vocation. Dans les années avant 1970, ce sont essentiellement des volontaires et le clergé qui s’occupaient des orphelins et des enfants abandonnés. Qu’est-ce qui a changé depuis ? De nos jours, cette partie innée à l’homme est volontairement oubliée dans l’éducation institutionnelle. Pourquoi ? Une révolution sociale passée sous silence.
De plus en plus, la partie spirituelle ou engagée de l’âme est basculée vers une neutralité dans le dessein de ne pas choquer les clivages religieux ou pour le sacrosaint de la laïcité. Les fêtes de Noël sont appelées fêtes d’hiver et les fêtes de Pâques, fêtes de printemps. Une minorité impose à la majorité de taire son origine religieuse afin de garder une paix relative et publique. L’avenir nous dira si ce changement aura été pour un mieux, mais permettez-moi d’en douter.
Si j’entreprends cet ouvrage, c’est également pour mieux me détacher du passé et pour y mettre un terme, car ce vécu m’empêche de me sentir comme les autres et de vivre en harmonie avec les autres. Le fait d’écrire permet de me débarrasser de fardeaux trop lourds à porter et de libérer l’esprit ou la conscience d’un poids qui m’empêche de progresser. Ce livre est donc une thérapie qui touche à ma conscience émotionnelle et cognitive.
Je pense avoir fait le tour de mon avertissement, j’entame donc mon récit et je vous souhaite d’y trouver sujet à méditer.
© Fh.2017
«Grand-Place de Bruxelles »
Chapitre I
1962-1969
Premiers pas dans la vie, crèche Marie-Henriette
© Fh. 2015
« Entrée de l’Hôpital St Pierre »
Ancienne bâtisse datant de l’époque de ma naissance
Je suis né à Bruxelles, à l’hôpital St-Pierre, dans le quartier populaire des Marolles, à quelques dizaines de mètres de la gare du Midi et de la porte de Hal.
Cet hôpital St-Pierre était connu du grand public pour le coût modéré qu’il appliquait aux assistés de notre société. Il était et est toujours financé par l’entraide sociale. Il demeure comme par le passé sous le patronat du Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Belgique qui s’appelait à l’époque les Commissions d’Assistance Publique (CAP). Ce service de l’État a vu le jour peu après la Première Guerre mondiale, en 1925. Ce service d’aide avait pour objet d’aider les défavorisés de la société en leur prodiguant, entre autres, des soins médicaux à moindre coût.
L’hôpital ressemblait, vu de l’extérieur, à une caserne. Il a été construit avec des briques rouges. Il comprenait près de cinq étages. Pour y accéder, il fallait passer sous un porche fait de pierres bleues de Belgique. Il y avait souvent un garde posté dans un petit bureau dont la tâche consistait à filtrer les entrées. Une barrière empêchait les véhicules de pénétrer dans la cour. Seules les ambulances pouvaient y accéder ; elles avertissaient de leurs arrivées inopinées par une sirène stridente qu’on entendait dans tout le quartier, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Le gardien levait alors la barrière. Les visiteurs ou les patients devaient passer quant à eux par un second petit porche, situé juste à côté et muni d’une petite grille. Ce petit porche ne permettait pas à deux personnes de passer de front, ce qui obligeait le sortant ou l’entrant à céder systématiquement le passage à l’autre. L’afflux était grand pendant la journée.
Cet hôpital se caractérisait par sa position géographique puisqu’il était au début d’une rue très commerçante nommée la rue Haute. Beaucoup de restaurants méditerranéens s’y étaient installés.
À partir de dix-huit heures, les odeurs d’agneau ou de scampis à l’ail envahissaient la rue. En journée, l’afflux de voitures et de bus était intense. De fait, ces odeurs se mêlaient à la pollution de la ville et quelquefois, une forte odeur de combustion vous prenait à la gorge et vous empêchait presque de respirer. Cette rue était très fréquentée par des touristes qui désiraient également faire des affaires. Près de là se trouvait le célèbre « marché aux puces », place du Jeu de Balle, ainsi que nombre d’antiquaires et de petits magasins aux prix modérés.
C’est dans ce quartier que je suis né, au mois de mars, de l’année 1962, le 27 à 6 heures du matin, d’une mère, elle même âgée de 27 ans. Ma famille, qui était pauvre, comprenait déjà une soeur, âgée d’un an et un demi-frère, de 5 ans. Ma vie a commencé avec une tare, je suis né dans une famille de parents divorcés. Ma mère avait eu un garçon avant de vivre avec mon père. Mon père avait eu trois garçons avant de vivre avec ma mère.
Ma sœur Christiane et mon demi-frère Eddy ont été durant ma plus tendre enfance ceux qui m’ont choyé avec ma mère et mon père. Peu de temps après, un autre frère, prénommé Patrick, est venu élargir notre cellule familiale. Un an après, un autre frère, Éric, s’est ajouté. Ma mère et mon père ne se sont d’ailleurs pas arrêtés en si bon chemin puisqu’un an après la naissance d’Éric, un autre frère lui a succédé : Édouard. Et pour finir, Daniel, le benjamin de la troupe, est né 15 mois après Édouard. Nous étions donc, en fin de compte, six frères et une sœur.
Ne me demandez pas comment s’est passée ma toute petite enfance, car je ne me souviens de rien si ce n’est d’une anecdote que ma mère me racontait souvent : celle d’aimer les bananes. Chaque fois que nous en recevions, ma sœur et moi, je me précipitais pour manger la mienne et celle de ma sœur. Pour tout dire, ma sœur n’aimait pas les bananes. D’où son dévouement à me les refiler, sous le regard médusé de notre mère.
Très vite, ma vie a pris une direction chaotique, étant né de parents divorcés, d’un père alcoolique et d’une mère qu’il faut bien qualifier d’« hystérique ». Mon avenir se traçait devant moi comme une pièce de théâtre de mauvais goût dont on pouvait déjà deviner le scénario à l’avance.
Peu de temps après nos naissances, nous étions soigneusement déposés chaque matin dans une grande crèche catholique, appelée « crèche Marie-Henriette ». Cette crèche se situait dans une rue du même nom à Schaarbeek, une des 19 communes de Bruxelles. Ce nom de Marie-Henriette faisait référence à la dévotion d’une dame qui avait donné sa vie entière pour de bonnes causes. La crèche était tenue par des religieuses habillées de longues robes noires et de coiffes tantôt blanches, tantôt noires qui symbolisaient la soumission au Seigneur. On y mettait les enfants pour la plupart abandonnés par leurs parents ou en danger, selon l’estimation des assistants sociaux du CAP. Juste à côté, il y avait une école d’infirmière.
À l’époque, le voisinage de la gare du Nord métamorphosait déjà le lieu en le rendant plus moderne. Des immeubles d’appartements s’érigeaient en donjons majestueux devant les portes de la vieille crèche. Ces immeubles se répandaient dans le quartier à la manière des mauvaises herbes. La folie du nouveau frappait de plein fouet ce vétuste quartier, dont les différents chantiers paralysaient une bonne partie du fonctionnement. Peu de temps après, la vétuste crèche devint à son tour un chantier. Elle allait faire peau neuve.
Dès que l’on passait la porte-cochère située à l’entrée de la crèche, on se trouvait devant à un grand escalier qui donnait accès aux étages supérieurs où se trouvaient les chambres et le bureau de la sœur directrice. La crèche ressemblait à un vieux monastère avec ce qui caractérise un tel établissement : l’odeur de sainteté, l’odeur de la bonne vieille cire.
À l’intérieur, tout était en bois sauf les larges escaliers de quatre marches en marbre blanc moucheté, situés directement à gauche de l’entrée. Ces grands escaliers donnaient accès à une double porte ouvrant sur le parloir. Le sol du parloir comprenait un vulgaire vieux plancher bruni par les couches de cire que mettait régulièrement la sœur -nettoyeuse. Dès que l’on pénétrait dans cette pièce, une forte odeur de cire envahissait nos poumons. Sur la gauche, à l’entrée de cette pièce, se trouvait un grand socle surmonté d’une statue qui représentait une grande Madone tenant dans ses bras un petit enfant Jésus.
Cette salle servait d’accueil pour les visiteurs et pour les parents, un lieu de retrouvailles avec leurs bambins déposés le matin. Pour les moins chanceux, les parents ne revenaient les chercher que le vendredi pour passer le week-end en famille.
Le couloir d’entrée se prolongeait jusque dans la cour principale qui ressemblait à une cour de ferme. Sa surface était celle d’un demi-terrain de football. Entourée de hauts murs, elle n’avait d’autre sortie que celle de l’école primaire qui lui était annexée.
Sur le côté sud, il y avait l’internat et sur le côté nord, l’école primaire et maternelle. Cette école avait deux entrées, l’une qui donnait dans la cour et permettait aux pensionnaires de la crèche de ne pas quitter leur demeure, la seconde qui s’ouvrait de l’autre côté du pâté de maisons et était accessible aux enfants du quartier.
Dès que l’on pénétrait dans cette cour, on pouvait entrevoir une annexe, côté est. Elle se composait de matériaux peu esthétiques puisque la façade était faite de plaques en polystyrène bleu et de vitres plastifiées, toutes griffées par l’usure du temps ou par la négligence des enfants. Des tôles opaques blanches et ondulées protégeaient des intempéries. Cet ajout contenait les urinoirs et les cabinets au nombre de cinq ou de six. Les portes de ceux-ci ne se fermaient plus. Peut-être n’étaient-elles jamais fermées pour éviter toute imprudence des enfants ?
Au départ, nous restions à la crèche pour la journée, le temps que notre maman puisse faire son travail dans une usine de tissus. Elle avait un horaire très varié, ce qui l’empêchait quelquefois de venir nous prendre en fin d’après - midi. Une bonne partie de notre enfance se résumait à attendre que notre maman vienne nous reprendre pour nous ramener à la maison. Souvent, notre attente se terminait par une longue nuit dans les dortoirs de la crèche où des centaines d’enfants vivaient un jour de plus sans leurs parents.
Notre avenir se profilait à l’horizon semblable à un fractionnement de la matière dû à des chocs incessants. Nous vivions une existence difficile par son cahot et son irrégularité. Notre personnalité se dessinait mal. Notre avenir était hypothéqué.
Quelquefois, nous avions la chance de voir notre maman un après-midi de week-end et alors c’était un moment de plaisir accompagné de surprises, de friandises et d’autres bonnes choses comme celle d’aller boire une orangeade au café du coin. Mais cela se terminait presque invariablement par un retour à la crèche où nous avions fini par élire domicile.
Je me souviens d’une anecdote. Nous avions tellement peu l’occasion de boire une limonade que quand cela arrivait, je tenais mon verre, en main, si fort que ma mère m’en faisait le reproche : « Laisse ton verre sur la table, on ne va pas te le voler ! », disait-elle. Mais elle ne savait pas à quel point cette limonade était pour moi un bien précieux. Je n’arrivais pas à le lâcher…J’avais cette peur intense qu’on me le prenne. À la crèche rien ne nous appartenait, tout était pour la collectivité. Si vous reveniez de votre visite avec quelques friandises, elles étaient automatiquement reprises pour en faire le partage. L’intention n’était pas mauvaise, mais je ressentais cela comme une violation de mon être. Recevoir de ma maman un bien, fût-il éphémère, était pour moi comme recevoir un câlin ; me le prendre provoquait en moi comme une déchirure profonde de mon être.
Je ressentais ces visites comme un abandon renouvelé, mais notre maman devait travailler et ne pouvait pas s’occuper de nous tous. Notre papa apparaissait et puis disparaissait, selon les bêtises qu’il avait commises, comme celles de voler ou de ne pas payer ses amendes de circulation. La police le recherchait pour diverses autres raisons. Mon papa était le plus souvent absent de notre vie d’enfant qui commençait à devenir de plus en plus douloureuse. Et lorsqu’il était là, il était pour la plupart du temps saoul et violent, à cause de la boisson.
Je me souviens, un jour, d’avoir entraperçu ma mère à la crèche, je devais avoir 4 ou 5 ans. Un compagnon de ch ambrée m’avait signalé sa présence dans le parloir. Je ne m’y attendais pas, car nous n’étions pas un vendredi ni un jour de week-end. Je soupçonnais donc une mauvaise blague de ce compagnon puisque les soeurs de la crèche n’étaient pas venues me quérir. Je suis néanmoins allé me poster dans un couloir annexe qui menait au parloir. Une bonne partie du bâtiment était en construction à ce moment, de sorte qu’il n’y avait pas encore de portes. Cette partie du bâtiment n’était d’ailleurs pas accessible aux enfants de mon âge, mais comme j’avais déjà la fâcheuse habitude de n’en faire qu’à ma tête, j’étais passé par un chemin plus rapide pour accéder au parloir qui avait de surcroît l’avantage de ne pas m’obliger de passer devant la sœur surveillante qui m’aurait sans hésitation empêché d’y accéder.
Arrivé par la petite porte du fond du parloir, j’entendis la voix de ma mère et celle de ma sœur Christiane qui pleurait. Une responsable de la crèche tenait Christiane par le bras tandis que ma mère tirait ma sœur par l’autre bras. Elles se disputaient ma sœur comme on se disputerait un morceau de chiffon que l’on préférerait voir déchiré que de le laisser à son adversaire. La Soeur responsable criait que ma mère ne pouvait pas reprendre Christiane sans l’autorisation de l’assistance publique (CAP). Ma mère hurlait qu’elle voulait reprendre Christiane chez elle ; et ma sœur pleurait, déchirée, impuissante, entre l’autorité constituée et l’amour d’une mère.
Ce moment douloureux pour ma soeur, et pour ma mère, qui se voyait refuser ce qui lui est sien, m’a fortement bouleversé. En assistant à cette scène, je me suis rendu compte que ma maman était venue pour prendre Christiane. Et moi qui étais-je à ses yeux ? Je ressentis très douloureusement cette étrange préférence d’une maman pour un autre, fûtelle ma sœur. Dans cet univers où l’on est seul et où on le restera toujours, dans cet univers de solitude où tout n’existe qu’au travers de notre propre moi, une déchirure s’était produite dans ma petite tête d’enfant, provoquée par l’amour égoïste et possessif de ma mère pour ma sœur. Je n’ai pas pleuré au moment des faits, je n’en ressentais pas le désir. Je suis parti, interpellé par cet événement avec une sorte de blessure, mais sans aucune entaille apparente. À l’époque, je n’ai d’ailleurs rien dévoilé de cet incident à qui que ce soit. Ni la responsable ni ma mère ne m’ayant vu pénétrer dans le parloir, je suis parti sans rien dire par ce chemin dérobé qui m’avait conduit en ce lieu de vertu troublé. Néanmoins, il y avait une douleur en moi, tapie au plus profond de mon être, une douleur qui attendait le moment propice pour se révéler et me meurtrir. Ce n’est que bien plus tard que j’ai ressenti cette déchirure au plus profond de mes entrailles.
Aujourd’hui encore, quand je repense à cette scène, je ressens cette meurtrissure ; elle me laisse un sentiment de dégoût et de tristesse pour toute la portion de la vie qui a suivi ces événements. Évidemment, maintenant que je connais la suite de la vie de ma soeur, je suis heureux de ne pas avoir été le préféré de ma mère. Il n’en reste pas moins que tout enfant aspire légitimement à l’amour profond d’une personne qu’il considère lui appartenir.
Mes frères n’ont rien su de cette histoire. Je crois d’ailleurs que même actuellement, ils n’en ont toujours pas connaissance. Par contre, ils ont très vite compris que nous n’étions pas des enfants désirés. Notre mère avait une forte attirance émotionnelle pour Christiane, simplement parce qu’elle était une fille. Je crois d’ailleurs que cette propension du sexe a dû nous marquer dans notre petite enfance et s’imprégner en nous comme une évidence d’un organe non désiré. À ce propos, je me rappelle que lors des quelques week-ends que je passais à la maison, ma mère me mettait les bas collants et les robes de ma sœur Christiane. Était-ce par souci d’économie ou par désir de maquiller ce qu’elle n’aimait pas ? Je me promenais donc dans cet accoutrement dans les rues de Bruxelles. J’étais gêné et humilié ! J’avais alors entre 7 et 9 ans.
Souvent, les parents ne se rendent pas compte du mal qu’ils font subir à leurs enfants parce qu’ils pensent bien souvent qu’un enfant ne comprend pas ces choses comme la pudeur, l’affection, l’amour, la différence, la douceur. Les adultes oublient qu’ils ont été enfants. Ils ont acquis un autre mode de communication, celui d’un langage raisonné. L’enfant est comparable à une éponge qui absorbe et qui s’imprègne de tout.
Le contenu que l’enfant amasse est au départ à l’état brut. Il le classe dans sa petite mémoire selon le genre et selon ce qu’il connaît déjà. Tout ce qui lui est inconnu trouve une place dans un tiroir d’objets bizarres. Ce n’est qu’après, lorsqu’il aura compris, qu’il le classera dans le tiroir approprié. L’enfant ne comprend souvent les événements que bien plus tard dans sa vie.
L’enfant voit tout, entend tout, sent tout, vit tout et enregistre tout. Il est un réservoir extraordinaire d’émotion, de spontanéité, d’amour véritable, mais aussi de méchanceté non contournée et d’égoïsme. Il voit, mais il ne sait pas toujours tout !
L’adulte, lui, a oublié ce qu’il était jadis, un enfant avec ses émotions, ses désirs, ses peurs, ses envies... L’adulte est passé d’un état d’inconscience à un état de conscience, comme le papillon passe au stade de la chenille avant sa mutation finale. Nous sommes là, coincés dans un stéréotype de comportement socialement admis et qui nous empêche de vivre plus profondément la vie.
Nous avons perdu ce regard fabuleux qu’un enfant peut porter aux choses de la vie, ce regard merveilleux qui découvre, qui admire et qui est fort par sa simplicité. Nous nous blasons et nous nous enfermons dans notre tour d’ivoire. Nous nous revêtons très fréquemment d’un scaphandre pour nous protéger de projectiles que nous nous envoyons bien souvent nous-mêmes.
La prise de conscience du danger, n’existe-t-elle pas seulement à travers notre propre prise de conscience ?
L’enfant n’a pas encore compris le sens de la vie, cette prise de conscience qui lui donne finalement une raison d’exister ou de ne pas exister. L’enfant ne sait pas au départ ce qu’est la mort, l’amour, la douleur... Il vit, c’est tout.
Je paraissais, probablement, aux yeux de ma mère comme un enfant difficile alors que...
Ma vie dans cette crèche de la rue Marie-Henriette à Schaerbeek a duré près de 6 ans. Je m’appelais à l’époque : « Frédéric Vandroogenbroeck ». Je me rappelle qu’en gardienne, l’institutrice m’épargnait cette corvée de l’écrire, et je me contentais d’écrire mon prénom. Ce nom bien compliqué me venait d’un père qui n’était pas le mien, mais celui de mon grand frère Eddy. Ma mère était encore en instance de divorce au moment de ma naissance. Ce père de mon grand frère Eddy était, si j’ai bonne mémoire, militaire de carrière. Il a fini sa vie comme balayeur de rue pour la commune de Bruxelles. Pour l’administration, j’étais de toute façon un enfant adultérin, né de père inconnu. Je crois qu’il n’y a rien à ajouter si ce n’est que le divorce est une question d’argent aussi bien pour les parties concernées que pour la justice. Et c’est probablement cela qui a été la cause de la longueur excessive de ce divorce qui a duré plus de cinq ans. À cette époque, les personnes qui n’avaient pas les moyens de divorcer pouvaient, moyennant une séparation de cinq années, divorcer à moindre frais. Actuellement cette période a été revue à la baisse. Six mois de séparation suffisent désormais pour divorcer.
À cette époque, j’étais déjà différent des autres. Je bénéficiais déjà de faveurs. Durant la longueur de ma vie, j’ai souvent bénéficié de différents avantages par rapport aux autres.
Ce n’est donc qu’au moment de mon départ en 1969 vers une autre demeure (dont je dirai mot plus loin), que mon nom a changé. Je me suis appelé : « Frédéric hoebeeck ». C’était le nom de jeune fille de ma mère.
Pourquoi m’avoir signalé ce changement de nom seulement deux ans après le changement officiel, qui datait de 1967 ? En fait, les responsables de la crèche ne voulaient pas m’en parler avant mon départ définitif, pour ne pas me perturber davantage. Les bonnes soeurs préféraient tout régler en une fois plutôt que de m’annoncer plusieurs ch angements successifs. Résultat : Je devais quitter la crèche qui était devenue ma demeure et changer mon nom de famille le même jour !
Mon nom de famille s’écrit avec une minuscule. D’où vient cette particularité ? Je n’en sais rien. Est-ce une faute administrative ou une volonté délibérée ? Je ne le sais toujours pas à ce jour. Toute ma famille porte cette minuscule sur sa carte d’identité. J’en ai tiré parti quelques fois, non pas pour revendiquer un quelconque signe de noblesse, car seuls les petits « de » bénéficient d’une reconnaissance officielle. Cette particularité du petit « de » représente un signe de noblesse qui date probablement de l’époque romaine, mais que les Français ont banni durant la période de la Révolution française de 1789, période de la naissance de la République française. En Belgique, le signe de noblesse est toujours d’actualité, car nous sommes sous un régime royal, dominé par une particratie dont la noblesse tire encore les ficelles.
La particularité de mon nom de famille a toujours été une anecdote amusante à partager avec mon entourage quand cela s’y prête. C’est une particularité qui nous différencie des autres, un signe qui nous identifie et nous classe à part.
Dernièrement, j’en ai tiré une qualité personnelle et un objectif à atteindre. Cette particularité est devenue pour mes enfants comme pour moi, un point fort : Le petit « h » représente la première lettre du mot « humilité » que j’oppose à la première lettre du mot « d » à la « désinvolture » que la noblesse arbore fièrement à l’égard des pauvres. Je tâche quotidiennement de mettre cette qualité qu’est l’humilité en valeur dans notre vie de tous les jours, une qualité bien nécessaire.
Mon passage chez les bonnes soeurs m’a fortement marqué et a laissé des séquelles semblables à l’empreinte qui permet d’identifier son bétail. J’ai été énurétique jusqu’à l’âge de cinq ans. Cette énurésie ne se liait pas, comme certains le pensaient, à un problème d’ordre affectif ou à une quelconque raison psychique due à l’absence de ma mère, mais bien à une éducation religieuse mal conçue. À chaque bêtise, la bonne sœur m’enfermait dans un placard pour me punir.
Ce placard servait pour le rangement des brosses et d’autres matériaux d’entretien. Ce placard devait avoir une profondeur d’un mètre environ. Il y avait deux étagères suspendues sur le côté droit en entrant. À mes yeux, cet endroit ressemblait à une cave profonde et poussiéreuse, remplie de toiles d’araignées. Comme j’étais petit de taille, je n’arrivais pas à l’interrupteur pour allumer la lampe, ni à atteindre la poignée de la porte pour l’ouvrir. La bonne sœur m’enfermait sans lumière et m’avertissait que si je n’étais pas cal me, les rats, les araignées, les serpents et le méchant loup me mangeraient. Cette méthode était radicale : à peine enfermé dans ce placard, je me blottissais contre la porte. J’angoissais ! Je criais et sautillais sur place de peur qu’une éventuelle araignée, un rat ou un serpent, rôdant sur le sol, ne vienne me dévorer.
Cette torture durait de longues minutes. Mais le pire était le lieu où se trouvait le placard ; il se situait dans mon dortoir. Dans celui-ci, il y avait près de dix lits, soit des lits d’une personne et de petits lits à barreaux. Je dormais dans un petit lit à barreaux qui se trouvait près de la porte du placard. La porte se situait au nord-ouest par rapport à l’emplacement de mon oreiller. Et chaque nuit, quand le moment venait où je devais aller aux toilettes, je n’osais pas me lever de peur qu’un serpent, une araignée ou un rat ne vienne se loger dans mes draps et attende mon retour pour me surprendre. Je préférais faire pipi dans mon lit et m’humilier le lendemain devant mes camarades de chambre que de subir l’attaque surprise de ces horribles bestioles.
Certaines nuits, je me réveillais en sueur après avoir vécu un cauchemar. Je rêvais souvent que le méchant loup ouvrait la porte du placard pour me dévorer ; il sortait juste sa tête et me menaçait d’un regard furieux. Pour me rassurer que c’était bien un rêve, je regardais la porte du placard pour voir si elle ne bougeait pas et quelquefois, ne rêvant pas, je voyais cette porte s’ouvrir et la tête du méchant loup sortir. Je me cachais dans mes couvertures et me mettais les draps bien au-dessus de ma tête, pensant être mieux protégé. Je tremblais à l’idée que ce loup vienne me prendre dans mon sommeil. L’apparence du méchant loup était identique au méchant loup que nous connaissons dans l’histoire du petit chaperon rouge ; à la différence près que mon loup était bien vivant.
C’est seulement à l’âge de cinq ans que j’ai commencé à vaincre ma peur de la nuit, de ces monstres nocturnes. J’ai, petit à petit, réussi à me lever la nuit pour aller aux toilettes. Au début, je courais vite pour aller faire pipi et ensuite je longeais les murs en frissonnant pour rejoindre finalement, par un énorme saut, mes couvertures dans lesquelles je me blottissais pour ne laisser plus qu’entrevoir mes yeux qui exprimaient la peur envers ce fameux placard.
Mon corps était tremblant. Souvent, je pensais que les araignées, les rats ou le méchant loup s’étaient cachés près de mon lit. J’avais peur de les voir apparaître d’un coup, surgissant de derrière un lit ou de la couverture qui ensevelissait mon corps.
Depuis ce jour, j’ai gardé de ces moments passés la position de mon sommeil. Je ne dors que du côté gauche du lit et je ne dors vraiment bien qu’en me couchant sur le ventre et le visage tourné vers le nord-ouest. Mon édredon me couvre tout le corps et une bonne partie de mon visage. Mon regard se dirige toujours vers cette porte, devenue fantôme.
À partir du 27 mars 1967, le jour de mon cinquième anniversaire, je n’ai plus fait pipi au lit de manière systématique. Je devais cet exploit à une bonne sœur qui me réveillait deux fois la nuit et qui m’accompagnait jusqu’aux toilettes. Après avoir tenu quinze jours sans mouiller mes draps, la bonne sœur m’octroya un grand lit. J’en étais quitte des barreaux qui couvraient mon petit lit d’enfant. J’avais enfin l’espace pour mes jambes et mes bras. Je n’étais plus considéré par les autres comme un tout petit, mais maintenant comme un grand faisant partie de la bande des grands plumards. Néanmoins, je prenais le pli de dormir près du bord du lit et non en plein milieu comme tous les autres avaient coutume de faire. Et un jour, la bonne sœur m’avait dit que si je n’utilisais pas la totalité du lit, je reprendrais l’ancien. À partir de ce moment, je m’arrangeais pour occuper l’ensemble de l’espace, en écartant mes membres au maximum. Cette possibilité n’était pratique que si je me mettais sur le ventre, car à défaut je ne pouvais plus fixer la porte du placard.
Depuis ces événements, près de trente ans se sont écoulés et je ne sais toujours pas dormir autrement. J’ai été marqué au fer rouge et je souffre encore aujourd’hui de ces meurtrissures d’enfant.
D’autres scènes m’ont encore marqué dans mon enfance. Dans l’une d’elles, j’insulte une sœur simplement parce qu’elle m’imposait de dormir en début d’après-midi au lieu de me laisser jouer avec mes camarades de chambre. Il était de coutume de faire une sieste après le dîner. À cause des rénovations, nous dormions tous dans une grande pièce qui servait temporairement de dortoir, où des lits de camp en toiles bleues jonchaient le sol. Cette façon de nous imposer une chose qui n’allait pas de soi me faisait bondir. Je ne supportais pas que l’on m’oblige à dormir alors que je n’avais pas sommeil. Et comme la sœur surveillante était du genre sévère et intransigeant, je lui faisais sentir mon désaccord en perturbant la sieste collective. Pour cela, je parlais avec un autre compagnon. La sœur insistait pour que je dorme, mais comme je n’y arrivais pas, je ne pouvais lui obéir, et faire semblant me paraissait absurde. Cet état de fait ne lui ayant pas plu, elle me mit sur le balcon en guise de punition. Ce balcon, qui se situait au troisième étage, donnait sur la cour de récréation et on pouvait y voir l’école d’infirmière en cours de rénovation. Quoi qu’il en soit, j’ai hurlé de rage, adressant à la sœur toutes les insanités que je connaissais déjà. Je l’ai traitée, entre autres, de putain. Je tapais en même temps sur la porte de la terrasse avec mes mains et mes pieds.
Toutes les personnes qui étaient à la crèche et les étudiantes de l’école d’infirmière toute proche m’avaient entendu distinctement. La sœur pensa que j’allais me calmer. Elle attendait sans dire un mot derrière la porte en espérant que je me calme. Mais je continuais de plus belle, au point que la sœur responsable est venue voir ce qui se passait. Voyant la situation, elle me libéra de ma prison temporaire pour ne pas répandre le scandale dans tout le quartier. Ma connaissance rudimentaire des jurons était néanmoins parvenue aux oreilles de tout le monde et je passais désormais pour un garnement, à la fois impoli et impudent.
Cet événement anodin me rappelle un autre souvenir. J’avais rencontré, probablement dans les couloirs de la crèche une étudiante qui fréquentait l’école d’infirmière d’à côté. Elle s’appelait Christiane B. Je me rappelle fort bien de son prénom, car ma propre sœur portait le même. J’allais quelquefois avec elle chez sa maman qui tenait une pharmacie proche de la crèche. Le samedi, nous partions souvent en balade et nous la terminions chaque fois dans la petite pièce derrière la pharmacie. Je me régalais en mangeant des petits pots de miel que la pharmacienne recevait probablement en échantillons et qui étaient donnés pour prévenir les rhumes de saison. Christiane B. était très douce et très gentille. Elle devait avoir près des dix-huit ans et, en plus de sa gentillesse et de sa douceur, elle était jolie. Ces visites étaient pour moi un moment de plaisir. La fois où j’avais hurlé sur la terrasse, je devais justement la voir. Je me souviens d’ailleurs en avoir discuté avec elle. J’étais fier et content qu’elle m’ait entend u et que d’autres personnes apprennent mon existence par la même occasion, car elle avait parlé de moi à ses copines de classe. Christiane me sermonna pourtant, mais comme on sermonne un enfant qu’on aime : avec de la douceur et de l’amour. C’était un sermon moralisateur qui venait du fond de son cœur et d’une manière qui correspondait à son éducation chrétienne. C’était du genre : « Ce n’est pas bien ce que tu as fait, Frédéric ». Ce qui m’intéressait le plus dans cette affaire c’est que l’on s’occupe de moi et que je ne sois pas un oublié parmi tous les autres enfants. Je ne voulais pas être « un » parmi les autres.
Je crois que tout au long de mon enfance, je suis arrivé à faire passer ce message. Je sais que malgré le nombre d’années qui me sépare de ces moments, les soeurs de la crèche et les autres personnes qui ont eu cette responsabilité de m’éduquer ne m’ont pas oublié. De même que certaines personnes qui ont connu ma famille se rappellent encore, aujourd’hui, de mon existence. Pour certaines, c’était un calvaire, pour d’autres non. Et j’en ai eu des preuves lors du procès qui a condamné mon frère Éric d’un emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d’un quinquagénaire. La sœur supérieure, psychologue de formation et directrice, à l’époque, de la crèche Marie-Henriette, était venue témoigner et avait en effet parlé de la vie difficile que nous traversions à cette époque. Mais pour ne pas perturber le bon déroulement de mon autobiographie, je traiterai de cette affaire le temps venu.
La suite de mes relations avec Christiane B. est confuse. Je me rappelle vaguement qu’elle voulait me prendre chez elle les week-ends et m’adopter, mais je pense que les responsables de la crèche ont dû le lui refuser. Je ne l’ai plus revue par la suite. Peut-être valait-il mieux que nos relations se terminent rapidement afin de ne pas agrandir une blessure déjà ouverte : celle d’un enfant non aimé de sa maman et qui ne demandait juste une seule chose, celle justement d’être aimé.
Ma mère passait quelquefois, par hasard, pour nous prendre le week-end, mes frères, ma sœur et moi. Comme ses visites n’étaient pas régulières, nous restions très souvent sur le carreau.
La sœur directrice de la crèche essayait de nous trouver des familles d’accueil. Pour pallier les différents problèmes qu’elle rencontrait avec ma mère, cette responsable faisait tout son possible pour la faire déchoir de ses responsabilités parentales. Elle multipliait les rapports à l’attention des assistants sociaux du CAP. Ces rapports mentionnaient les absences répétées de ma mère, les perturbations psychologiques que nous subissions à cause de ses visites irrégulières et d’autres choses encore dont je n’ai jamais vraiment eu connaissance. Plusieurs de mes petits frères côtoyaient une fausse marraine qui venait les prendre le samedi ou le dimanche. Ils partaient la journée et ne revenaient que le soir. En ce qui me concerne je n’ai jamais été dans une famille d’accueil, je ne sais pour quelle raison. Étais-je déjà trop vieux ou était-ce pour pallier à l’absence de mes autres frères qui partaient le week-end dans des familles provisoires. Restais-je à la crèche pour servir d’alibi au cas où ma mère passerait nous rendre visite ?
Il aurait été inconvenant et embarrassant de dire à ma mère que nous étions partis en week-end chez une personne étrangère à la famille. Cela aurait été une injure insoutenable pour elle qui semblait faire tout son possible pour nous voir. Elle devait jongler entre son travail, mon père alcoolique, ses responsabilités ménagères et d’autres choses qui sont souvent les parasites du temps et dont on ne sait que faire.
Daniel, mon petit frère cadet, m’a raconté, bien plus tard, comment il vivait ces moments dans les familles d’accueil. Il m’expliquait qu’il lui arrivait de voir une famille pendant quelques week-ends et ensuite pour des raisons inconnues, il ne les voyait plus. Il m’a expliqué une anecdote, vécue dans une famille d’accueil qui le recevait pour la première fois. Il m’expliqua qu’il devait aller aux toilettes et qu’il avait demandé l’autorisation pour s’y rendre. La dame l’accompagna, ensuite Il m’a expliqué qu’il avait fait un caca tellement long que son caca était parti dans la canalisation sans laisser de trace avant même de tirer la chasse. La dame lui avait demandé pourquoi il avait pris tant de temps pour aller aux toilettes et mon frère de répondre qu’il avait fait caca. Comme il n’avait pas tiré la chasse, la dame s’est empressée de le faire pour lui et ne voyant pas de trace de son pas sage dans le fond de la cuve, réprimanda mon frère en le traitant de menteur. La dame était outrée de l’attitude effrontée de Daniel qui avait insisté en lui réexpliquant la situation fortuite. Par la suite, il ne dit plus mot, mais la famille d’accueil mit un terme à la visite et reconduisit Daniel à la crèche. Daniel n’a plus jamais entendu parler de cette famille. Très régulièrement, il était parti en visite chez des personnes qu’il ne connaissait pas. Daniel avait 5 ans de moins que moi et on considérait probablement qu’il était plus facile de l’intégrer dans une nouvelle famille d’accueil. Daniel ne comprenait pas pour quelle raison il devait aller voir ces personnes. Il ne vivait pas de déchirure puisqu’il n’avait pas encore eu le temps de s’attacher, mais il était dubitatif devant ce défilement de personnes qui désiraient le prendre et qui, par la suite, le rejetaient pour des broutilles
Si ma mère passait pour nous voir et que mes autres frères étaient en visite dans des familles d’accueil provisoires, les soeurs lui disaient que mes frères étaient partis en activité avec le groupe d’enfants et qu’ils ne reviendraient que très tard dans la soirée. Ma mère attendait quelquefois leur retour. Elle comprenait le manège des soeurs et s’en était très souvent plainte auprès des assistants sociaux du CAP, mais en vain. Elle se trouvait impuissante devant l’autorité, elle ne connaissait rien de la loi et des droits parentaux. Elle devait s’incliner devant l’illustre savoir dont peuvent se targuer ceux qui pensent le maîtriser. À l’âge de quatorze ans, ma mère travaillait déjà et elle subvenait aux besoins de sa famille. À l’époque, seules les familles riches avaient accès au savoir et pouvaient s’instruire.
De son ignorance découlent beaucoup d’actes qui ont bouleversé sa vie et la nôtre. Elle ne connaissait rien et cela lui a valu beaucoup de déboires et de peines.
Y avait-il dans les démarches administratives de la crèche Marie-Henriette quelque chose d’inconvenant ? Pour ma part, le rôle que joue le Centre Publique d’Action Sociale est très ambigu. C’est le seul organisme d’État qui peut pénétrer dans ta vie privée sans ton accord et qui peut, de ce fait, se substituer à ton rôle paternel ou maternel. L’objectif est, en théorie, d’apporter une amélioration à l’éducation des enfants et à la vie journalière des parents. Et ma mère ne savait pas qu’une simple démarche de demander une aide ponctuelle allait entraîner automatiquement une enquête sur sa vie privée et aboutir à cette situation complexe pour son devenir et le nôtre.
Avant de connaître la crèche Marie-Henriette, ma sœur et moi l’accompagnions tous les jours à l’usine de vêtement. Nous étions avec elle jusque très tard le soir. Pour aller à son travail, ma mère devait tenir mon grand frère par la main et de l’autre main guider la poussette où nous étions ma sœur et moi. Ma mère ne connaissait personne pour nous garder en journée et le soir. Elle ne savait pas conduire et mon père ne la conduisait pas à son travail. Sa famille habitait à Anvers, à 60 kilomètres de Bruxelles environ et ne pouvait pas nous garder. Elle nous trimballait probablement de la commune d’Anderlecht qui était à 1 heure de trajet jusqu’à son lieu de travail. Nous prenions chaque fois le train. Et pour le retour comme il était souvent très tard, nous retournions en taxi. Un jour, son patron l’avait exhortée à demander une aide à l’assistance publique afin d’alléger son fardeau. Elle voulait que le C.A.P. l’aide à trouver une crèche à prix modique, car elle n’avait pas les moyens de payer la totalité des frais que cela exigeait.
Cette simple démarche a été le déclencheur de la suite de notre vie. Le CAP a commencé à faire une enquête administrative et psychologique sur la famille. Cette enquête avait abouti à la conclusion que nous étions en danger dans ce noyau familial. L’assistante sociale nous avait, suite à ce rapport, orienté vers la crèche Marie-Henriette. C’est après la naissance d’Éric que nous y avons élu domicile. Seul mon grand frère, Eddy était resté à la maison. Peu après notre placement, il est parti loger chez ma grand-mère maternelle, à Anvers où il est resté jusqu’à l’âge de 15 ans.
Ma mère pensait qu’elle pouvait nous reprendre quand elle le voulait. Mais elle s’est très vite rendu compte qu’on l’avait déchue de ce droit. Les soeurs nous avaient cloîtrés. Il lui était impossible de nous reprendre. Elle avait juste droit à des visites le week-end. Mais ce droit même allait, petit à petit, lui être rogné, car les soeurs jugeaient que notre mère était une mauvaise mère pour notre santé affective et psychologique et qu’il était préférable de la remplacer par un substitut parental.
Comme si on pouvait remplacer une maman. Même si elle en venait à ne pas en être digne, rien au monde ne pouvait lui enlever cet état de fait. Ma mère est et restera ma mère. Quoi qu’elle ait commis, les liens qui unissent l’enfant à une mère sont indissociables et il est absurde et dangereux d’essayer de détruire cette relation même si cette relation ne cadre pas avec le mode de pensée en vogue. Ce n’était certainement pas en voulant se substituer à ma mère qu’on aurait pu nous aider. Pour notre équilibre psychologique et affectif, il était néanmoins nécessaire de recevoir de l’affection et de l’attention. À défaut de ces choses, l’acteur social se devait de pallier temporairement les parents, mais jamais il ne devait les remplacer. À l’époque, l’éducation en vogue était de remplacer la mère et le père par une nouvelle maman et un nouveau papa ou une mamy et un papy. Et tous les moyens étaient bons pour interdire une mère et/ou un père de voir ses enfants. Mes petits frères ont connu une maison d’accueil : La Chataigneraie, dirigée par une famille qui s’est substituée entièrement à notre mère et à notre père. J’en parlerai dans la suite de mon récit.
À l’âge de trois ans, j’ai commencé à fréquenter l’école maternelle. J’apprenais à écrire mon prénom et à différencier les lettres de l’alphabet. J’ai fait mes trois gardiennes sans problème. À l’âge de six ans, je suis passé en première primaire qui correspond en France au CP, l’école élémentaire. L’institutrice qui m’instruisait devait être bonne pédagogue, car elle savait utiliser mes perceptions visuelles à merveille. C’est de cet enseignement que j’ai appris à distinguer ma gauche de ma droite. La fenêtre était à gauche et la porte à droite. Mon banc se trouvait juste à côté de l’entrée. Certes, il m’a fallu de longues années pour me détacher de cette astuce. À chaque fois que je devais différencier la gauche de la droite, je devais me représenter mentalement la position de la porte et la fenêtre de la classe de ma première année primaire. Si je n’appliquais pas cette méthode, je risquais très souvent de me tromper et alors c’était la catastrophe : je montrais à tous ma grande ignorance et mon manque de connaissances élémentaires.
Chaque individu a un de ses cinq sens qui lui sont plus développés ; certains c’est l’ouïe, d’autres l’odorat ; pour moi c’est la vue. J’ai une très bonne perception visuelle des choses et des visages. Par contre, ma mémoire cognitive me fait souvent défaut ; je n’arrive presque jamais à retenir les prénoms ou les adresses de mes amis ou de mes connaissances professionnelles. Souvent quand je téléphone, je dois faire un exercice mental pour me rappeler tous les noms des personnes que je suis susceptible de toucher. Et c’est souvent au dernier moment que les prénoms me reviennent, juste avant que la personne décroche. Mais quelques fois, le prénom ne me revient pas. Je suis alors très embêté, car je donne l’impression de ne pas considérer l’ami et de paraître hautain ou prétentieux.
Les seuls souvenirs qui me restent de ces moments scolaires à la crèche sont les relations que j’entretenais avec les personnes du sexe opposé. J’étais le préféré de ces demoiselles de sixième primaire et j’avais, lors de chaque récréation, le loisir de m’asseoir sur les genoux de ces belles et de me réfugier dans leurs bras. J’aimais beaucoup ces moments privilégiés, car les autres de ma classe me jalousaient. Quelquefois, je recevais une gaufre qu’on achetait dans une petite aubette annexée à l’école et qui était accessible de la cour.
Les filles aimaient me choyer, elles me trouvaient tout mignon. Il faut dire que je paraissais plus jeune que mon âge. J’étais, pour ces amantes, leur petit enfant adoré. Je leur suscitais ce désir de materner et elles trouvaient certainement en moi la réponse à leur instinct maternel . J’étais cet objet, capable de donner du plaisir à leur sens primal. Je ne m’y arrachais que lorsque la sonnerie retentissait. Alors je rentrais en classe encore avec ce goût de jouissance extrême qui me faisait frémir de plaisir. Cette chaleur maternelle m’était prodiguée par de belles demoiselles à la peau douce, humide et chaude. J’aimais attendre le moment de la récréation pour me blottir dans leurs bras et sentir en moi cette sensation troublante et agréable qu’est l’amour maternel.
Un jour de récréation, un ami de classe avait voulu montrer son audace et sa bravoure pour épater les filles. Pour cela, il avait décidé de grimper sur la gouttière qui descendait de la petite toiture d’un des bâtiments qui venaient d’être construits. Cette gouttière en acier était attachée par des colliers de serrage qui sortaient du mur et qui entouraient le tuyau tous les trente centimètres environ. L’ami en question était de forte corpulence, pour tout dire, il était très gros. Après avoir grimpé d’un à deux mètres, il s’était planté et était tombé par terre, non sans dommage, car une bonne partie de sa cuisse avait rencontré, sur le passage, une attache qui servait de serrage pour le tuyau. Cette rencontre a eu pour effet d’entailler sur au moins deux centimètres de profondeur sa cuisse et de laisser apparaître à notre vue une matière visqueuse et blanchâtre. Cette matière blanchâtre ressemblait étrangement à du riz cuit et pâteux. C’était un amas de graisses qui apparaissaient à cause de l’entaille. Curieusement, il n’y avait pas de sang qui coulait.
Un enseignant et une sœur l’avaient soulevé pour le mettre sur une civière et le conduire à l’infirmerie. Il n’avait même pas mal et semblait fier d’avoir attiré tous les regards sur lui. Son passage triomphant devant les filles ressemblait étrangement à celui d’un gros gibier cuit dressé sur un énorme plateau décoré de petits légumes préparés. Il se donnait en spectacle à ses admiratrices, tel le met principal d’un festin de noce. Sa prestance était, en fait, tellement majestueuse, que l’on aurait pu entendre, de sa bouche, sortir cette phrase : « Je me donne à vous mes belles, prenez-moi ! » J’étais pour ma part dégoûté par cette vue répugnante d’un amas de graisse qui couvrait son corps comme un manteau de fourrure. Cet incident m’avait coupé l’appétit. Et chaque fois que nous mangions du riz, je repensais à cet amas visqueux de graisses de couleur blanchâtre qui ressemblait à du riz pâteux et qu’on entrevoyait dans la jambe de ce héros d’un jour.
De cette cour, il me reste encore quelques autres souvenirs, comme celui de m’être disputé avec mon frère Patrick. Nous étions, mes frères et moi, reconnus pour notre mauvais caractère. Nous étions souvent punis. Nous piquions également des crises de nerfs et nous étions très colériques. Nous étions jaloux de l’affection que l’un pouvait avoir au détriment de l’autre. Si par malheur, l’éducatrice apportait une attention plus particulière à mon frère, je lui faisais sentir ma désapprobation en piquant une crise, en cassant quelque chose ou en me battant avec un de mes compagnons de groupe. L’éducatrice pouvait s’attendre à une soirée mouvementée.
C’est sans doute pour cela que les soeurs ont voulu me mettre en pension quelques mois sur la côte belge, histoire de vivre autre chose et de me discipliner par un rythme de vie différent de celui que je connaissais.
La mer du nord, passage obligé qui a marqué mon enfance !