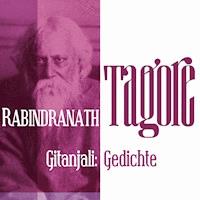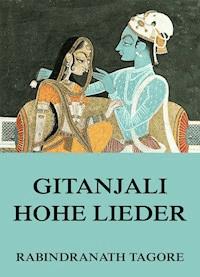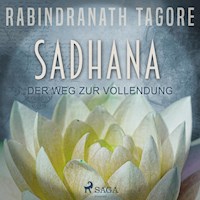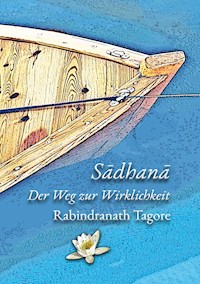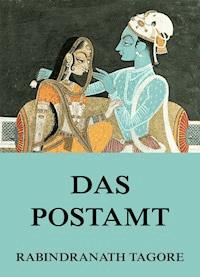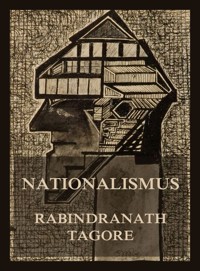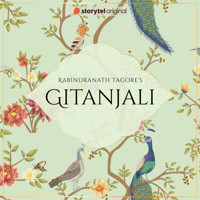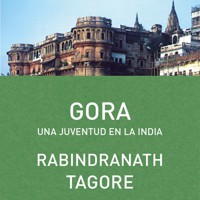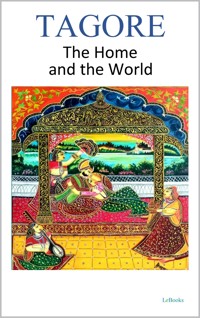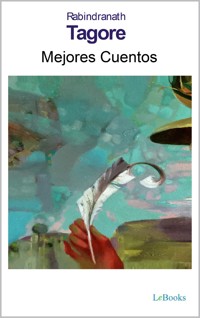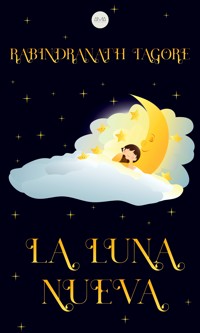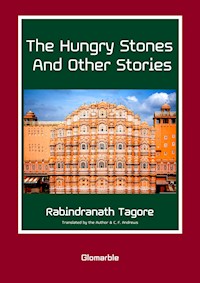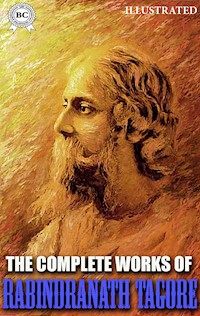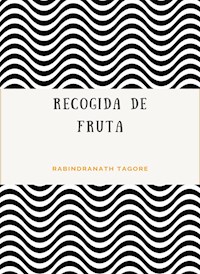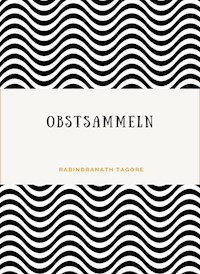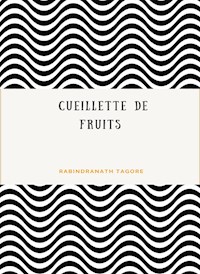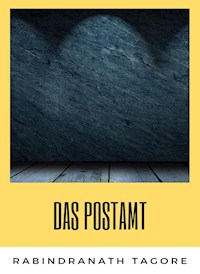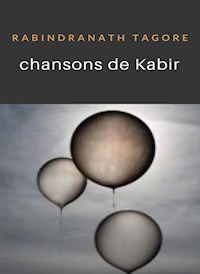
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Cette édition est unique;
- La traduction est entièrement originale et a été réalisée pour l'Ale. Mar. SAS;
- Tous droits réservés.
Le poète Kabir, l'une des personnalités les plus fascinantes et les plus célèbres de l'histoire du mysticisme indien, a vécu au XVe siècle. Grand réformateur religieux, il a laissé derrière lui un corpus exquis de poèmes d'illumination qui tisse des liens entre les philosophies du soufisme, de l'hindouisme et de la Kabbale. Ces poèmes expriment un large éventail d'expériences mystiques, des abstractions les plus élevées à la réalisation la plus intime et personnelle de Dieu, et sont devenus un texte soufi classique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Table des matières
INTRODUCTION
LES POÈMES DE KABIR
CHANSONS DE KABIR
RABINDRANATH TAGORE
L'INTRODUCTION D'EVEVEVEVEVE D UNDERHILL
1915
INTRODUCTION
Le poète Kabîr, dont une sélection de chants est ici pour la première fois offerte aux lecteurs anglais, est l'une des personnalités les plus intéressantes de l'histoire du mysticisme indien. Né à Bénarès ou dans ses environs, de parents mahométans, probablement vers 1440, il devint très tôt le disciple du célèbre ascète hindou Râmânanda. Râmânanda avait apporté en Inde du Nord le renouveau religieux que Râmânuja, le grand réformateur du brâhmanisme du XIIe siècle, avait initié dans le Sud. Ce renouveau était en partie une réaction contre le formalisme croissant du culte orthodoxe, en partie une affirmation des exigences du cœur contre l'intellectualisme intense de la philosophie Vedânta, le monisme exagéré que cette philosophie proclamait. Elle prenait dans la prédication de Râmânuja la forme d'une dévotion personnelle ardente au Dieu Vishnu, comme représentant l'aspect personnel de la Nature Divine : cette mystique "religion de l'amour" qui fait partout son apparition à un certain niveau de culture spirituelle, et que les credo et les philosophies sont impuissants à tuer.
Bien que cette dévotion soit indigène dans l'hindouisme et trouve son expression dans de nombreux passages de la Bhagavad Gîtâ, il y avait dans sa renaissance médiévale un grand élément de syncrétisme. Râmânanda, par qui son esprit serait parvenu à Kabîr, semble avoir été un homme de grande culture religieuse et plein d'enthousiasme missionnaire. Vivant au moment où la poésie passionnée et la philosophie profonde des grands mystiques persans, Attâr, Sâdî, Jalâlu'ddîn Rûmî et Hâfiz, exerçaient une influence puissante sur la pensée religieuse de l'Inde, il rêvait de concilier ce mysticisme mahométan intense et personnel avec la théologie traditionnelle du brâhmanisme. Certains ont considéré que ces deux grands chefs religieux avaient également été influencés par la pensée et la vie chrétiennes, mais comme il s'agit d'un point sur lequel les autorités compétentes ont des opinions très divergentes, nous ne tenterons pas de l'examiner ici. Nous pouvons cependant affirmer sans risque de nous tromper que dans leurs enseignements, deux - peut-être trois - courants apparemment antagonistes d'intense culture spirituelle se sont rencontrés, comme la pensée juive et hellénistique s'est rencontrée dans l'Église chrétienne primitive : et c'est l'une des caractéristiques remarquables du génie de Kabîr que d'avoir été capable dans ses poèmes de les fondre en un seul.
Grand réformateur religieux, fondateur d'une secte à laquelle appartiennent encore près d'un million d'hindous du Nord, c'est pourtant avant tout comme poète mystique que Kabîr vit pour nous. Son destin a été celui de nombreux révélateurs de la Réalité. Détestant l'exclusivisme religieux et cherchant par-dessus tout à initier les hommes à la liberté des enfants de Dieu, ses disciples ont honoré sa mémoire en réédifiant dans un nouveau lieu les barrières qu'il s'efforçait de faire tomber. Mais ses merveilleux chants survivent, expressions spontanées de sa vision et de son amour, et c'est par eux, et non par les enseignements didactiques associés à son nom, qu'il lance son immortel appel au cœur. Dans ces poèmes, une large gamme d'émotions mystiques est mise en jeu : des abstractions les plus élevées, de la passion la plus extra-terrestre pour l'Infini, à la réalisation la plus intime et personnelle de Dieu, exprimée par des métaphores familières et des symboles religieux tirés indifféremment des croyances hindoues et mahométanes. Il est impossible de dire de leur auteur qu'il était Brâhmane ou Sûfî, Vedântiste ou Vaishnavite. Il est, comme il le dit lui-même, "à la fois l'enfant d'Allah et de Râm". Cet Esprit Suprême qu'il a connu et adoré, et à l'amitié joyeuse duquel il a cherché à faire adhérer les âmes des autres hommes, transcendait, tout en les incluant, toutes les catégories métaphysiques, toutes les définitions crédibles ; pourtant, chacune a contribué à la description de cette Totalité Infinie et Simple qui s'est révélée, selon leur mesure, aux amoureux fidèles de toutes les croyances.
L'histoire de Kabîr est entourée de légendes contradictoires, sur lesquelles on ne peut se fier. Certaines émanent d'une source hindoue, d'autres d'une source mahométane, et le présentent tour à tour comme un saint Sûfî et un saint Brâhmane. Son nom, cependant, est pratiquement une preuve concluante d'une ascendance musulmane : et l'histoire la plus probable est celle qui le représente comme l'enfant réel ou adopté d'un tisserand mahométan de Bénarès, la ville dans laquelle les événements principaux de sa vie ont eu lieu.
Dans la Bénarès du quinzième siècle, les tendances syncrétistes de la religion bhakti avaient atteint leur plein développement. Sûfîs et Brâhmanes semblent s'être rencontrés pour discuter : les membres les plus spirituels des deux croyances fréquentaient les enseignements de Râmânanda, dont la réputation était alors à son apogée. Le jeune Kabîr, chez qui la passion religieuse était innée, voyait en Râmânanda le maître qui lui était destiné ; mais il savait combien les chances étaient minces qu'un gourou hindou accepte un mahométan comme disciple. Il se cacha donc sur les marches du fleuve Ganges, où Râmânanda avait l'habitude de se baigner ; le résultat fut que le maître, descendant vers l'eau, marcha sur son corps à l'improviste, et s'exclama dans son étonnement, "Ram ! Ram !", le nom de l'incarnation sous laquelle il adorait Dieu. Kabîr déclara alors qu'il avait reçu le mantra d'initiation des lèvres de Râmânanda, et qu'il était par lui admis comme disciple. Malgré les protestations des Brâhmanes et des Mahométans orthodoxes, tous deux également irrités par ce mépris des repères théologiques, il persiste dans sa prétention, manifestant ainsi en action le principe même de la synthèse religieuse que Râmânanda avait cherché à établir en pensée. Râmânanda semble l'avoir accepté, et bien que les légendes mahométanes parlent du célèbre Sûfî Pîr, Takkî de Jhansî, comme du maître de Kabîr dans sa vie ultérieure, le saint hindou est le seul maître humain auquel il reconnaît une dette dans ses chansons.
Le peu que nous savons de la vie de Kabîr contredit bien des idées courantes concernant le mystique oriental. Des étapes de la discipline par lesquelles il est passé, de la manière dont son génie spirituel s'est développé, nous ignorons tout. Il semble être resté pendant des années le disciple de Râmânanda, se joignant aux discussions théologiques et philosophiques que son maître tenait avec tous les grands Mollahs et Brâhmanes de son temps ; et c'est à cette source que nous devons peut-être sa connaissance des termes de la philosophie hindoue et Sûfî. Il peut ou non s'être soumis à l'éducation traditionnelle de l'hindou ou du contemplatif Sûfî : il est clair, en tout cas, qu'il n'a jamais adopté la vie de l'ascète professionnel, ou s'est retiré du monde pour se consacrer aux mortifications corporelles et à la poursuite exclusive de la vie contemplative. À côté de sa vie intérieure d'adoration, de son expression artistique en musique et en paroles - car il était un musicien habile aussi bien qu'un poète - il menait la vie saine et diligente de l'artisan oriental. Toutes les légendes s'accordent sur ce point : Kabîr était un tisserand, un homme simple et sans instruction, qui gagnait sa vie au métier à tisser. Comme Paul le fabricant de tentes, Boehme le cordonnier, Bunyan le rétameur, Tersteegen le fabricant de rubans, il savait allier vision et industrie ; le travail de ses mains aidait plutôt qu'il n'entravait la méditation passionnée de son cœur. Détestant les simples austérités corporelles, il n'était pas un ascète, mais un homme marié, père de famille - circonstance que les légendes hindoues de type monastique tentent vainement de dissimuler ou d'expliquer - et c'est du cœur de la vie commune qu'il a chanté ses paroles d'amour divin. Ici, ses œuvres corroborent l'histoire traditionnelle de sa vie. Il ne cesse de vanter la vie du foyer, la valeur et la réalité de l'existence diurne, avec ses possibilités d'amour et de renoncement ; il déverse son mépris sur la sainteté professionnelle du yogi, qui "a une grande barbe et des cheveux emmêlés, et ressemble à une chèvre", et sur tous ceux qui pensent qu'il est nécessaire de fuir un monde imprégné d'amour, de joie et de beauté - le théâtre approprié de la quête de l'homme - afin de trouver cette Réalité unique qui a "répandu sa forme d'amour dans le monde entier".1
Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande expérience de la littérature ascétique pour reconnaître l'audace et l'originalité de cette attitude à une telle époque et en un tel lieu.
Du point de vue de la sainteté orthodoxe, qu'elle soit hindoue ou mahométane, Kabîr était clairement un hérétique ; et sa franche aversion pour toute religion institutionnelle, toute observance extérieure - qui était aussi complète et aussi intense que celle des quakers eux-mêmes - achevait, pour l'opinion ecclésiastique, sa réputation d'homme dangereux. La "simple union" avec la Réalité Divine qu'il ne cessait d'exalter, comme étant à la fois le devoir et la joie de chaque âme, était indépendante à la fois du rituel et des austérités corporelles ; le Dieu qu'il proclamait n'était "ni dans la Kaaba ni dans le Kailâsh". Ceux qui le cherchaient n'avaient pas besoin d'aller loin, car il attendait d'être découvert partout, plus accessible à "la lavandière et au charpentier" qu'au saint homme vertueux.2
C'est pourquoi tout l'appareil de la piété, tant hindoue que musulmane - le temple et la mosquée, l'idole et l'eau bénite, les écritures et les prêtres - a été dénoncé par ce poète à la lucidité incommode comme de simples substituts de la réalité, des choses mortes intervenant entre l'âme et son amour...
Les images sont toutes sans vie, elles ne peuvent pas parler :
Je le sais, car je leur ai crié à haute voix.