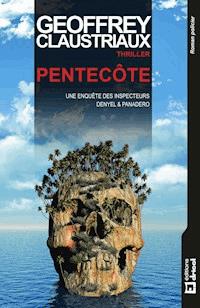Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Terre de Brume
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Une seule mission : survivre après la terrible invasion d’un virus exterminateur.
Depuis que sa famille et ses amis ont été décimés par un virus mortel, la jeune Casca mène une existence solitaire dans la station souterraine qui l’a vue naître. Son quotidien est rythmé par les réparations des machines qui la maintiennent en vie. Mais une fillette ne peut entretenir seule un immense abri prévu pour accueillir des centaines d’habitants. Les unes après les autres, les machines finissent par tomber en panne. Le jour où le système de survie lâche à son tour, Casca n’a plus le choix : elle doit abandonner la station… Le problème, c’est qu’en surface le monde n’est plus qu’un désert aride depuis que les pluies de bombes nucléaires ont rasé les villes et irradié les sols. Du moins, c’est ce qu’on a toujours raconté à Casca qui va découvrir, à son grand étonnement, que l’Homme est capable de s’adapter, d’évoluer… mais surtout de régresser.
Découvrez vite ce roman de science-fiction visionnaire et troublant !
EXTRAIT
Vous dire mon nom me paraît bien futile, car, depuis le temps que j’erre dans les landes désolées et ravagées de ce que les autochtones appellent l’Après-Monde, on m’a désignée de bien des façons différentes.
La Marcheuse, l’Étrangère, l’Ombre Furtive et l’Errante sont quelques-uns des sobriquets dont on m’a affublée au fil des ans et des villes. Néanmoins, puisque la politesse est l’une des rares choses que ma mère ait pu me transmettre avant de disparaître, il convient de vous apprendre mon nom. À ma naissance, mes parents m’avaient baptisée Casca. Je n’avais pas douze ans quand ils sont morts, tout comme le reste de ma famille, mes amis et la totalité des gens de mon entourage.
À cette époque, d’aussi loin que je me souvienne, j’avais toujours vécu dans ce labyrinthe de couloirs et de pièces étroites, ce dédale souterrain censé me protéger de je ne savais quel danger invisible et j’avais tellement arpenté ses corridors bétonnés, remplis de tubulures métalliques, éclairés par une multitude de guirlandes clignotantes, que j’avais l’impression que cet enchevêtrement de niveaux superposés était devenu une extension de moi-même. Je pouvais l’entendre respirer à travers les tuyaux du système d’aération, je savais quand il grondait de colère, et je comprenais même ses envies de plus en plus pressantes de se reposer.
Cette maison souterraine, enfouie des dizaines de mètres sous la surface du monde foulé autrefois par les hommes, s’appelait l’abri 101-42-1, et c’était le seul endroit que je connaissais. C’était mon
chez moi. Petite, j’aurais tout donné pour m’en extraire afin de partir à l’aventure. Je me sentais l’âme d’une exploratrice.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un chef d’œuvre dont on attend la suite avec impatience. -
Culture remains
Un style d'écriture autant percutant que fluide et très agréable à lire. Une histoire qui pourrait être vraie. -
Chroniques étoilées
À PROPOS DE L’AUTEUR
Geoffrey Claustriaux est un jeune auteur belge, admirateur fervent des romans de Howard Phillips Lovecraft et Stephen King. Il rédige également des critiques de cinéma, plus particulièrement sur les films d’horreur, de science-fiction et fantastiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En hommage au Maître de Providence.
CHAPITRE PREMIER
Probablement sur Terre. Peut-être dans le futur.
Vous dire mon nom me paraît bien futile, car, depuis le temps que j’erre dans les landes désolées et ravagées de ce que les autochtones appellent l’Après-Monde, on m’a désignée de bien des façons différentes. La Marcheuse, l’Étrangère, l’Ombre Furtive et l’Errante sont quelques-uns des sobriquets dont on m’a affublée au fil des ans et des villes. Néanmoins, puisque la politesse est l’une des rares choses que ma mère ait pu me transmettre avant de disparaître, il convient de vous apprendre mon nom. À ma naissance, mes parents m’avaient baptisée Casca. Je n’avais pas douze ans quand ils sont morts, tout comme le reste de ma famille, mes amis et la totalité des gens de mon entourage.
À cette époque, d’aussi loin que je me souvienne, j’avais toujours vécu dans ce labyrinthe de couloirs et de pièces étroites, ce dédale souterrain censé me protéger de je ne savais quel danger invisible et j’avais tellement arpenté ses corridors bétonnés, remplis de tubulures métalliques, éclairés par une multitude de guirlandes clignotantes, que j’avais l’impression que cet enchevêtrement de niveaux superposés était devenu une extension de moi-même. Je pouvais l’entendre respirer à travers les tuyaux du système d’aération, je savais quand il grondait de colère, et je comprenais même ses envies de plus en plus pressantes de se reposer.
Cette maison souterraine, enfouie des dizaines de mètres sous la surface du monde foulé autrefois par les hommes, s’appelait l’abri 101-42-1, et c’était le seul endroit que je connaissais. C’était mon chez-moi. Petite, j’aurais tout donné pour m’en extraire afin de partir à l’aventure. Je me sentais l’âme d’une exploratrice.
Stupide rêve de fillette ignorante.
Je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait à l’extérieur. Pour tout vous dire, j’étais née à l’intérieur de l’abri, à l’instar de mon père, ma mère, mes grands-parents et leurs ancêtres avant eux. Eux non plus n’avaient jamais vu la lumière du soleil. À ce qu’on racontait, elle n’avait rien à voir avec l’éclairage froidement artificiel de nos corridors. Je rêvais de la voir, un jour. Plût à Dieu qu’il n’en fût jamais ainsi.
Ma vie d’alors se résumait à apprendre quantité de choses que je considérais comme inutiles — comme je me trompais ! — en compagnie d’autres enfants. Notre école se limitait à une unique pièce carrée de dix mètres sur dix, remplie d’une vingtaine de bancs disposés en rangs d’oignons face à un tableau tactile, lui-même connecté à la tablette individuelle que possédait chacun des élèves par le biais du réseau informatique. Notre professeur s’appelait Herbet Varrick. Monsieur Varrick était malingre, petit, chauve et se tenait légèrement voûté. Sa longue veste bleue trop grande pour lui, du même bleu que celui des travailleurs manuels, était éliminée aux endroits où elle touchait le sol. L’homme n’était pas agréable à regarder, mais il compensait son physique disgracieux par un intellect hors du commun et un dévouement de tous les instants. Je me souviens que lorsqu’il parlait, nous l’écoutions avec respect — et une pointe de crainte, il me faut l’avouer. C’est lui qui m’a appris les bases de ce que je sais aujourd’hui, et si je suis devenue telle que je suis c’est à lui que je le dois ; cet homme trop frêle pour se servir de ses mains a façonné mon esprit durant des années, lorsque j’avais de quatre à onze ans pour être précise. Et même après sa mort il aura continué à m’instruire, via les innombrables antiquités qu’il avait entassées dans sa chambre et qu’il appelait des livres.
Quand je n’étais pas à l’école, je passais le plus clair de mon temps à m’amuser avec les autres enfants. Les activités récréatives dans cette forteresse souterraine étaient, vous vous en doutez, fortement limitées. De fait, nous jouions souvent à cache-cache ou aux jeux de dés, mais ce que nous préférions était de loin les jeux de rôle. En effet, puisque nous ne pouvions pas voir le monde extérieur et que nous n’en connaissions que les informations contenues dans la banque de données, nous avions décidé de le recréer en interne. La salle de jeux fut ainsi repeinte par nos soins — je me chargeai moi-même, honneur suprême, de la représentation du soleil — tandis que les costumes furent confectionnés par nos mères. Souvent, nous nous amusions à reproduire des scènes de la vie quotidienne de nos ancêtres, comme faire les courses au supermarché ou s’occuper du jardin, mais parfois, nous nous montrions plus ambitieux en réduisant à l’échelle d’une pièce les derniers instants de la vie à la surface. Nous nous répartissions alors en deux groupes : l’Alliance Totale de l’Atlantique Nord, soit l’ATAN, et la Coalition Afro-Russe Asiatique, aussi appelée CARA. Il n’y avait ni gentils, ni méchants et puisque de toute façon, au final, tout le monde avait perdu, personne ne rechignait à appartenir à un camp ou à l’autre. Ensuite, nous jouions à la guerre, comme tous les enfants de notre âge. Au début, nous nous tapions dessus à l’aide d’objets en mousse et en mimant des armes à feu, mais petit à petit, à mesure que les lacunes dans nos connaissances se voyaient comblées et que nous grandissions, nous avons ajouté des éléments géostratégiques jusqu’à finir par ne plus nous battre que via des groupes de pions sur une carte du monde. Nous avions, en quelque sorte, créé un jeu de société.
À côté de ces divertissements puérils, j’accompagnais également, une fois par semaine, mes parents à leur travail : mon père dans la salle des machines, afin qu’il m’apprenne les rudiments de la mécanique, et ma mère dans son laboratoire de chimie. Cette dernière, à l’instar de la plupart de ses confrères, faisait des recherches sur un vaccin et essayait à chaque fois de me convaincre du caractère vital de ses expériences. Je la revois encore me dire Casca, un jour, je sauverai peut-être le monde. Il y avait un tel feu dans ses yeux, une telle passion. Mais moi, à la vérité, je n’aimais pas ces séances ; je ne comprenais rien au tableau de Mendeleïev et encore moins à la composition chimique des substances multicolores qui tapissaient les murs du labo. Par contre, j’attendais toujours avec impatience les cours particuliers de mon père. Technicien dans la salle des machines, il s’occupait de réparer les défaillances dues à l’âge antédiluvien des installations : fuites du système de refroidissement, trous dans les canalisations d’eau, ainsi que toute une série de rénovations mineures. J’adorais le voir se glisser sous les tuyaux, outils à la main, et transpirer pour le bien-être de ses camarades. Cela me parlait beaucoup plus, me semblait infiniment plus utile que les petites fioles de Maman. Je me trompais, bien sûr, mais vous savez comment sont les enfants à cet âge, certaines réalités leur échappent et je ne faisais pas exception à la règle.
Ma vie souterraine s’écoulait donc ainsi dans l’abri 101-42-1, tranquille, prévisible et ponctuée de jalons immuables. De temps à autre, un incident venait troubler la monotonie de mon quotidien, comme lorsque le petit Gorius avala un appareil de traçage ou que Boris perdit un bras à cause de l’explosion d’une conduite. Mais dans l’ensemble, la routine engluait tout. Pas d’imprévus, pas de frissons, pas d’excitation. Je crois d’ailleurs que c’est ce qui rendait ma mère si triste, en dehors du fait qu’elle et papa ne s’entendaient plus très bien, même s’ils évitaient de le montrer en public — et encore moins devant moi. Cela dit, l’isolement rendait la plupart des couples fragiles et il n’était pas rare d’apprendre qu’untel entretenait une relation extraconjugale avec une telle.
On ne peut pas dire que la nourriture dont nous disposions était excellente. Elle était peu variée, souvent végétale et peu goûteuse. Je m’en lamentais régulièrement auprès de ma mère qui se contentait alors de me sourire avec tristesse. Elle aurait voulu m’offrir plus, je le savais, et je ne pouvais lui en vouloir de n’avoir « que » des légumes à me proposer. À cinquante mètres sous la surface, c’était déjà un miracle d’avoir de quoi se nourrir en permanence. Mais mes papilles gustatives n’appréciaient guère la répétition des légumes qui garnissaient mon assiette.
Heureusement, mes déceptions culinaires étaient compensées par les distractions visuelles dont j’étais très friande. À l’écart du ronronnement des machines, nos ancêtres avaient transformé un hangar en salle de spectacle, laquelle pouvait accueillir aussi bien des pièces de théâtre que la projection de films sur grand écran. Le premier samedi du mois était le jour du théâtre tandis que la séance de cinéma était hebdomadaire, toujours le mercredi soir. L’ensemble des familles se réunissait alors dans la grande salle obscure du niveau B pour assister à la diffusion d’un chef-d’œuvre disparu, la base de données contenant une impressionnante collection de longs métrages aux origines diverses. Je pus ainsi admirer des films d’Alfred Hitchcock, de S. Shankar, de Jean-Jacques Annaud ou de Stankey Kubrick. Je me souviens d’ailleurs du traumatisme qu’a provoqué chez moi la vision de Shining. Durant des semaines après la projection, j’eus peur de me promener seule dans les couloirs, effrayée que j’étais à l’idée de tomber nez à nez avec les jumelles fantômes.
Le cinéma constituait la principale source de distraction au sein de l’abri 101-42-1 et l’unique activité familiale. Certes, les adultes avaient le bar où ils jouaient aux cartes en consommant un alcool artisanal distillé à base de pommes de terre, mais les plus jeunes ne disposaient souvent que de leur imagination.
Si j’ai l’air de me plaindre, sachez que ce n’est pas le cas. J’aimais le confort de mon existence et je n’aurais voulu en changer pour rien au monde. Seulement, quand on est enfant, et même plus tard, on fantasme toujours sur les choses que l’on ne peut avoir. Dans mon cas, il s’agissait du monde extérieur. Tous les jours, j’en rêvais. Cela virait à l’obsession. J’espérais me lever un matin en admirant l’apparition de l’astre solaire derrière l’horizon ; je désespérais de me rouler dans l’herbe comme les enfants sur les bandes vidéo d’archives ; j’aurais voulu courir à l’air libre, et non pas dans ces couloirs à l’atmosphère stérile et conditionnée. Seulement, il y avait la Loi, gravée dans le métal au-dessus du sas de sortie : nul être vivant ne peut ouvrir cette porte sous peine de mort. Cette simple phrase constituait le fondement même de notre société. Mes parents, les parents de mes parents et leurs propres parents avaient tous respecté la Loi. Personne, à ma connaissance, n’y avait dérogé et était encore en vie pour le clamer sur tous les toits. Il faut dire que les histoires qu’on racontait sur l’extérieur étaient horribles. Certes, il s’agissait du genre d’histoires que l’on sert aux garnements pour les dissuader de faire des bêtises. Du style si tu n’es pas sage, le grand méchant loup va venir te manger. Sauf qu’ici, elles étaient vraies. Je le savais, j’avais vu les images.
Bien sûr, il n’y avait pas de loups au-dehors. Uniquement, comme je l’apprendrais plus tard, des radiations et des virus, vestiges moins visibles que les autres stigmates laissés par la guerre entre l’ATAN et la CARA. Mais ces choses microscopiques pouvaient faire cracher ses boyaux à un homme en pleine fleur de l’âge, lui faire vomir du sang après avoir fait fondre sa peau. C’était l’une des premières choses que Monsieur Varrick nous avait montrées en classe. Inutile de préciser que personne, après avoir assisté à un tel spectacle, n’aurait eu envie d’ouvrir le sas. Pourtant, quelques imprudents — il y en a toujours — s’y étaient tout de même risqués au fil des siècles, pour la frime, pour le frisson de l’interdit, au mépris du danger que cet acte insensé représentait pour les autres survivants de l’abri. Leurs squelettes doivent encore décorer le sol de la grotte, derrière le sas.
Générations après générations, le peuple de l’abri 101-42-1 s’organisa donc pour survivre à l’intérieur des galeries souterraines, conformément à la Loi, comme cela avait été prévu lorsque nos lointains ancêtres sentirent qu’ils ne laisseraient derrière eux qu’un monde mort. Une tâche fut attribuée à chacun en fonction de ses capacités physiques et/ou mentales. Des jardins hydroponiques furent créés, de même que des espaces de loisirs et des salles communes.
L’abri avait été construit de manière fonctionnelle, pas confortable. Les premiers habitants durent tout aménager eux-mêmes et faire face à des problèmes inattendus. Par exemple, ils furent forcés de réguler les naissances pour éviter la surpopulation. Il fut décidé que tous les cinq ans, une quarantaine de nouveau-nés serait autorisée à voir le jour. Ensuite, ils basèrent leur modèle social sur le processus démocratique, avec des élections tous les trois ans et une assemblée représentative. Ce modèle perdura jusqu’à la fin de l’abri.
J’admire ces pionniers d’avoir eu le courage de survivre dans cet environnement particulier, eux qui avaient connu les joies de la vie à l’air libre. Leur adaptation fut tout à fait étonnante, même si l’on compta parmi eux quelques cas de folie claustrophobique. Ce fut plus facile pour leurs descendants puisque tous naquirent directement au sein de l’abri, sans jamais avoir connu l’incroyable sentiment de liberté que procure un paysage enchanteur.
CHAPITRE II
Sur les événements qui suivirent, seuls les Anges de l’Apocalypse, sinistres et facétieux, connaissent la vérité ; eux seuls savent quelle malédiction s’empara de l’abri et les tourments que j’endurai dans l’obscurité. Mais de nombreux souvenirs me sont restés et me resteront jusqu’à ce que la mort, à mon tour, m’appelle. J’ai préféré garder le silence jusqu’à aujourd’hui, tant l’affaire remuait de bien tristes souvenirs dans ma mémoire ; mais maintenant, c’est une vieille histoire qui ne suscite plus mon effroi — malgré une certaine chair de poule à son évocation — et j’éprouve un étrange désir de raconter au monde les effroyables années que j’ai passées dans ce lieu de survie transformé en havre de mort. Le seul fait d’écrire m’aide à reprendre confiance en moi. Il m’aide aussi à enfin faire le deuil de tous ceux que j’ai aimés.
J’avais onze ans lorsque mon existence fut chamboulée par une tragédie sans précédent. Je m’en souviens fort bien, je devais fêter mon douzième anniversaire trois semaines plus tard. Mon père avait déjà confectionné mon cadeau ; j’en avais aperçu l’emballage fleuri caché au fond d’un placard. Il n’eut jamais l’occasion de me le donner et je crois qu’à l’heure qu’il est, le paquet moisit toujours dans les ruines de l’appartement de mon enfance.
La catastrophe se produisit dans la nuit du 3 au 4 septembre de l’année 632 Après-Apocalypse. Aucun signe avant-coureur n’avait laissé présager d’une telle issue. La journée de la veille s’était déroulée tout à fait normalement, sans accro, ni incident. Après un détour à l’infirmerie où Maman m’avait injecté plusieurs rappels de vaccins, j’avais passé le reste de la journée à l’école, à mémoriser le fonctionnement du purificateur d’eau, pendant que mes parents vaquaient à leurs occupations ; le soir, Maman était rentrée la première, comme d’habitude, pour préparer une potée de carottes avant le retour de Papa ; ensuite, nous avions un peu discuté de ce que j’avais appris en classe avant d’aller nous coucher. Je m’étais endormie assez vite, bercée par les ronflements de Papa qui me parvenaient à travers la cloison.
Plus tard dans la soirée, je fus réveillée par le biper de Maman. Je détestais cet appareil réservé aux scientifiques et aux médecins. Sa sonnerie signifiait toujours qu’il y avait une urgence. Comme prévu, j’entendis Maman se lever, dire quelques mots à Papa et sortir précipitamment de notre appartement. Il n’était pas rare qu’elle soit ainsi rappelée en pleine nuit par un collègue pensant avoir fait une découverte capitale ; généralement, elle revenait au bout d’une heure. Aussi, je ne m’en formalisai pas et reposai la tête sur l’oreiller sans me douter de l’horreur qui se tramait derrière la porte close.
Je dormis à poings fermés cette nuit-là, d’un profond sommeil parcouru de rêves fantasmagoriques à base de soleil et de vastes étendues d’herbes. Je gambadais joyeusement au milieu des papillons, me roulais dans l’herbe, un oiseau se posa sur ma tête tandis que des lapins me chatouillaient les pieds. Mon réveil sonna à l’instant où j’allais pénétrer dans une forêt rose bonbon. Le retour à la réalité se fit en douceur et lorsque je m’éveillai, je ne constatai rien de bizarre ou d’inhabituel. Le silence régnait dans l’appartement. Ce n’est qu’au bout de quelques minutes que je m’étonnai de ne pas avoir entendu Maman rentrer après son urgence nocturne. En onze ans, pas une fois je n’avais manqué d’ouvrir les yeux lorsque le chuintement de la porte d’entrée retentissait, a fortiori en pleine nuit. Sans doute avais-je dormi plus profondément que d’habitude.
En arrivant dans la cuisine, un détail attira mon attention : la veste bleue de Papa pendait au portemanteau. Or, à cette heure, il aurait déjà dû être au travail depuis longtemps. La vue de cette simple veste me remplit d’effroi. La seule fois où elle était restée accrochée au mur, c’était lorsque Papa avait été victime d’un empoisonnement au radon. Il avait mis deux semaines à s’en remettre.
Je me précipitai dans sa chambre et le trouvai emmitouflé dans les couvertures. Maman était absente. Son côté du lit n’était pas défait. Je n’osai m’aventurer plus loin que le pas de la porte.
– Tout va bien ? risquai-je tout de même.
Le silence me répondit. Papa ne bougea pas, ne ronfla pas. Je décidai de croire qu’il dormait et tournai les talons. Avec le recul, je me dis que j’aurais dû faire le tour de la chambre, observer son visage et vérifier son état de santé, même si cela n’aurait rien changé à son triste sort. Mais peut-être cela m’aurait-il évité la culpabilité de l’avoir laissé mourir sans rien tenter. Quoi qu’il en soit, du haut de mes onze ans, je regagnai la cuisine et me servis un bol de céréales, que j’accompagnai d’une tasse de lait de synthèse.
Une fois mon petit-déjeuner englouti, j’enfilai mon uniforme scolaire bleu et blanc. La journée s’annonçait longue : M. Varrick avait programmé une interrogation écrite sur la matière vue en classe la semaine précédente et je n’avais pas révisé ; la résistance des matériaux ne m’intéressait pas. Je m’aventurai dans le couloir avec des pieds de plomb, en rasant les murs, la tête basse. Si quelqu’un m’avait vu passer, il aurait pensé à une condamnée à mort en partance pour l’échafaud.
Je venais de tourner à l’angle des corridors 3-A-12 et 3-A-13 quand je m’arrêtai brusquement. Il se passait quelque chose d’inhabituel ; je n’avais croisé personne depuis ma sortie de l’appartement. Je tendis l’oreille et fus frappée par le silence qui régnait, seul maître à bord de l’abri transformé en vaisseau fantôme. Exception faite du ronronnement du circuit de ventilation, je ne percevais aucun bruit. Étrange. Fichtrement angoissant. En temps normal, il y avait toujours une toile de fond sonore provenant des entrailles mécaniques de l’abri, l’écho du pas des ouvriers, des coups de marteau ou des éclats de voix, le tout mêlé au ronronnement des machines. Mais ce matin-là, le monde semblait s’être mis sur pause.
Alors, sans avertissement, s’éveilla dans mon esprit une terreur tout à fait irrationnelle. Je sentis l’angoisse étreindre ma gorge. Mes muscles se tendirent en un réflexe de fuite et sans même y réfléchir, je me mis à courir vers l’ascenseur. Je ne savais pas pourquoi, mais plus vite je l’atteindrais, plus vite je me sentirais en sécurité. Il me semblait qu’une présence invisible rôdait dans l’atmosphère. Je ne me risquai pas à regarder derrière moi. L’image des jumelles fantômes de Shining se forma dans un coin de ma tête. J’accélérai encore l’allure. Mon sac d’école rebondissait en cadence sur mon dos.
L’ascenseur se trouvait au bout du couloir 3-A-15, donc deux croisements plus loin, croisements que je traversai sans m’arrêter. Toujours aucun bruit. L’abri ressemblait à une ville morte. Je courais à en perdre haleine, si bien qu’en arrivant devant la double porte de l’ascenseur, je dus m’appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. J’appuyai sur le bouton de la cantine. Je DEVAIS trouver une personne à qui parler, et puisqu’il y avait toujours du monde là-bas, j’allais forcément y rencontrer quelqu’un. C’était une évidence. Je n’osais pas envisager le contraire.
C’est fou comme on peut se sentir désorienté lorsque l’on assiste à un bouleversement de ses habitudes. En courant à travers les coursives interminables, j’avais l’impression d’être prise au piège dans un vaisseau spatial gigantesque, très élaboré et à la complexité labyrinthique surnaturelle. Je connaissais pourtant par cœur chaque cloison intérieure, chaque porte, chaque croisement, ainsi que la plupart des raccourcis entre les niveaux. Mais en cet instant, je n’étais qu’une étrangère qui visitait les installations pour la première fois. J’étais seule, démunie. Les couloirs s’allongeaient, se superposaient, s’entremêlaient de manière absurde. Les portes ne s’ouvraient plus sur les mêmes pièces qu’auparavant.
Je mis un temps infini à rejoindre la cantine et quand, enfin, j’arrivai devant l’ouverture ronde, je ressentis un soulagement tel que je n’en avais jamais connu auparavant. Répit de courte durée s’il en fut. J’actionnai la poignée, la porte roula sur elle-même dans un chuintement sonore et révéla à mes yeux un spectacle inattendu.
Je manque de mots pour décrire l’horreur engendrée par ces corps bouffis, striés de veinules mauves, gisant à même le sol, sur les tables et le comptoir du restaurant. On eut dit qu’ils étaient morts sur le coup, car, exception faite des cadavres, la pièce était comme d’habitude, blanche, propre et stérile. Aucune trace de lutte ou de violence débridée. Tout était à sa place (si l’on ne tenait aucun compte des personnes avec la tête dans leur assiette ou des corps étendus, bien entendu). J’enjambai le coordinateur Mcmanus, un grand gaillard blond qui officiait avec mon père dans la salle des machines, et d’un pas chancelant me dirigeai vers le fond de la salle ; j’avais repéré Cassy, une camarade de classe, une fillette du même âge que moi. À cause de mes jambes flageolantes, j’avais l’horrible impression de marcher sur du coton. J’allais certainement me réveiller, cette horrible vue de l’enfer ne pouvait être pas réelle. Pourtant, lorsque je trébuchai sur Madame Percy — la grosse Percy comme on l’appelait — et que je dus me rattraper à une table pour ne pas tomber, la réalité me frappa aussi durement qu’une gifle en plein visage. Je ne rêvais pas, ou plutôt je ne cauchemardais pas. Ils étaient morts. Tous morts. Ce n’était pas possible. Je ne pouvais croire que la cantine s’était transformée en un océan morbide au bord duquel les corps de mes compatriotes s’étaient échoués telles d’immondes baleines. Alors, quand je vis la bave rouge fraîchement luisante s’écoulant en filets épais de tous les orifices de Cassy, sa peau parcourue de nervures mauves et son corps puant de cette odeur morbide que seuls les croque-morts connaissent, je saisis l’horreur de la situation. Et la terreur s’empara de moi.
Il serait difficile de donner un compte rendu détaillé, complet, de la suite des événements et de mes innombrables allées et venues dans ce dédale de métal transformé en cimetière géant. Mes bribes de souvenirs m’indiquent que je suis partie vers la salle des machines en hurlant. Pourquoi ? Aujourd’hui encore je ne sais quel cheminement a poussé mes pieds à emprunter cette route. Rien ne bougeait dans les couloirs morts, et le grondement des machines couvrait le bruit de mes pas. Au bout d’un moment, je bifurquai vers l’escalier du niveau supérieur. Il y avait encore une trotte jusqu’à mon appartement, et les grands murs métalliques autour de moi semblaient, je ne sais pourquoi, plus effrayants que les cadavres nervurés. Je vis enfin le corridor qui aboutissait à mon appartement.
C’est là que mon esprit défaillit et que je m’évanouis.
Bien plus tard, lorsque je revins à moi, j’allai voir mon père. Il n’avait pas bougé d’un pouce ; il était toujours couché sur le flanc, enrobé par ses draps. Je m’avançai près de lui et constatai que son visage était hachuré de veines mauves. Il avait vomi. Un liquide d’une couleur indéfinissable s’était écoulé le long du matelas jusque sur le sol pour former une flaque visqueuse. Sa langue pendait entre ses lèvres entrouvertes, ses yeux étaient révulsés et son regard vitreux, il me fixait d’un air accusateur. Je ne pus en supporter davantage et m’évanouis de nouveau.
Les jours suivants, entre deux crises de pleurs incontrôlables, j’entrepris d’explorer l’abri. Partout des corps m’attendaient. Si j’avais un temps entretenu l’espoir de retrouver quelqu’un en vie, je me rendis vite compte que j’étais l’unique survivante. Je déambulais, hagarde, au milieu d’une foule silencieuse de morts aux yeux ouverts. Une mystérieuse épidémie semblait s’être répandue dans la station car l’entièreté de mes compagnons présentait les mêmes marques mauves sur le visage, les mains, les pieds… etc. Je ne comprenais pas comment un virus avait pu s’introduire dans l’environnement stérile de l’installation souterraine, ni comment il s’était faufilé à travers les filtres du système d’aération. Ma mère et mon père m’avaient toujours certifié que c’était rigoureusement impossible. Une partie du travail de mon père consistait d’ailleurs à vérifier ces filtres et je savais qu’il prenait cette activité très au sérieux. Il ne fallait surtout pas que l’air contaminé de la surface parvienne jusqu’à nous. Il s’était montré très pointilleux à ce sujet. Évidemment, une erreur humaine était toujours possible, mais je n’y croyais pas. J’en voulais pour preuve que les symptômes du virus n’avaient rien de commun avec ce que j’avais vu sur les vidéos de M. Varrick. Seul un mal peu commun pouvait provoquer chez un individu d’aussi graves et radicales transformations anatomiques, affectant jusqu’à la pression sanguine et la résistance des veines. La maladie avait-elle muté ? Ou un nouvel agent pathogène s’était-il développé dans les couloirs de l’abri 101-42-1 ? Dans ce cas, pourquoi tout le monde était-il mort, sauf moi ? Qu’avais-je de si spécial ? Cette question me hanta durant des années, et ce n’est que récemment que j’ai obtenu la réponse. Toutefois, à onze ans, ce n’était pas ma principale préoccupation. J’étais seule dans une immense installation souterraine, enterrée vivante avec les cadavres pourrissants de ma famille et de mes amis, et ce que j’y voyais quotidiennement était si monstrueux, si démesuré, si contraire à la nature humaine, qu’il m’était impossible de m’en défaire, même aux heures les plus avancées de la nuit lorsque mes songes remplaçaient mes pensées conscientes.
Pour être certaine que je ne rêvais pas, je pris des photos ; rassemblai les corps que je disposai en rang dans les pièces transformées en caveau ; condamnai momentanément les niveaux où l’odeur pestilentielle de la décomposition devenait trop forte ; et pleurai tant et plus sur le corps de mon père. Car malgré tous mes efforts, je ne retrouvai jamais celui de ma mère. Elle semblait s’être volatilisée, à l’instar d’une petite dizaine d’autres personnes. En effet, alors que le nombre d’habitants s’élevait au total à neuf cent trente-deux, moi comprise, je ne dénombrai que neuf cent vingt-cinq cadavres. Peut-être les absents se trouvaient-ils dans des endroits inaccessibles à une fillette de onze ans, auquel cas je finirais bien par les retrouver, un jour ou l’autre. Mais ce ne fut pas le cas. Mes multiples tentatives de « récupération » se soldèrent toutes par des échecs.
Trois semaines après la propagation du virus, je soufflais seule les bougies de mon gâteau d’anniversaire. Happy Birthday to me…
Vous savez comment c’est quand on est jeune, on espère souvent que nos parents disparaissent afin que nos contraintes fassent de même. Moi-même, j’avoue qu’il m’était arrivé de caresser cette idée. Mais au bout d’une semaine à errer seule dans les méandres de l’abri 101-42-1, je compris que la vie en solitaire allait être beaucoup moins amusante que prévu. Il y avait les jardins hydroponiques à entretenir si je voulais manger, les synthétiseurs de lait, le purificateur d’eau, et plus important encore, le système d’aération. J’avais peut-être acquis les bases pour réparer tout cela, mais entre les cours théoriques de Papa et la mise en pratique, sans personne pour me guider, il y avait un gouffre de différence. De fait, petit à petit, les machines tombèrent en panne, les unes après les autres, et je tâtonnai des semaines durant avant de réussir à les remettre en état. J’aime à croire que mon père veillait sur moi depuis les étoiles, car jamais deux systèmes vitaux ne me lâchèrent simultanément.
Moi qui m’étais si souvent plainte des légumes que préparait ma mère, voilà à présent que je les appréciais plus que tout. Il faut dire que je les avais fait pousser de mes mains, à la sueur de mon front. Rien n’était plus gratifiant que de les savourer accompagnés d’une bonne sauce au beurre de synthèse. Mais outre les légumes, le lait ne m’avait jamais paru aussi bon, et je remerciais Dieu de continuer à m’envoyer chaque jour de l’air frais. Comment avais-je pu vivre jusque-là sans me rendre compte de la chance que j’avais ? Quelle ingrate j’avais été ! Pour me faire pardonner, je décidai de continuer à étudier. Pour ce faire, les livres de M. Varrick me furent très utiles et, étonnamment, je finis par les trouver plus pratiques que la base de données informatique même si, de temps en temps, je m’y référais pour consulter des vidéos. J’appris ainsi à construire, puis réparer des machines de plus en plus complexes, j’affinai mes connaissances en chimie et je consolidai ma culture générale au travers d’œuvres intemporelles telles que les Trois Mousquetaires.
Parallèlement à mes activités littéraires, je continuais d’organiser chaque mercredi la séance de cinéma, en prenant soin d’éviter les films d’horreur ; les couloirs lugubres étaient déjà bien assez effrayants sans que j’aie besoin de me remplir la tête d’images épouvantables. Je ne dérogeai qu’une seule fois à ma séance hebdomadaire : quand plusieurs conduites de ventilation cédèrent sous la pression, usées par le poids des ans. Je dus m’activer toute la nuit pour colmater les brèches. J’avais treize ans. Cela dit, contrairement à ce que vous pensez peut-être, ce n’était pas l’enfer, ma vie. Question d’habitude, sans doute.
Afin de contrer la solitude, je m’étais inventé trois amis imaginaires : A-mi (prononcer é-mi), un garçon de mon âge toujours partant pour faire des bêtises ; Cop-1, un androïde de maintenance qui ne quittait jamais la salle des machines ; et Camrade, une scientifique. Certains diront que j’étais devenue folle, mais je ne vois pas les choses de cette manière ; l’esprit humain est capable de bien des adaptations pour conserver son intégrité. Le mien avait choisi les hallucinations. Mais à la différence de la folie, j’avais parfaitement conscience que mes compagnons n’étaient réels que dans ma tête. Ils m’étaient néanmoins utiles pour ordonner mes idées et affronter les difficultés du quotidien. Par exemple, lorsque Cop-1 m’aidait à la réparation des machines, il m’indiquait la marche à suivre. Toutefois, comprenez bien qu’il n’était qu’une projection de mon esprit. En aucun cas il n’aurait pu savoir quelque chose que j’ignorais. De plus, il lui arrivait parfois de se tromper.
Vers mes quatorze ans, je connus une semaine de frayeur intense : du sang s’écoulait de moi, en continu, sans que je me sois blessée ! Le premier jour, je ne m’en inquiétai pas, bien que l’endroit du saignement soit inhabituel. Mais au bout du troisième jour, je commençai à paniquer et me mis à chercher avec frénésie les causes de ce phénomène perturbant. Aucun de mes trois amis ne put me venir en aide, pas plus que les livres de M. Varrick. Je dus donc me résoudre à fouiller dans la base de données. J’entrai « saignement + entrejambe » dans le moteur de recherches. Vingt-deux réponses s’affichèrent instantanément. La première de la liste portait le nom de Menstruations. Un mot bien étrange. C’est de cette façon que j’appris que tous les mois, pendant plusieurs jours, mon corps se viderait de son sang. Dans la foulée, en poussant un peu plus loin mes investigations, je découvris aussi les secrets de la reproduction. Voilà bien une chose qui ne risquait pas de m’arriver.
J’acquis au fil des ans une quantité considérable de connaissances pratiques, à défaut d’être toujours intéressantes. Construire et réparer, voilà ce qui m’attirait le plus. En mémoire de ma mère, je m’efforçais néanmoins de parfaire ma culture scientifique en compagnie de Camrade. Je ne le savais pas encore, mais cette connaissance me sauverait la vie à plusieurs reprises.
Je ne m’attardai pas trop sur l’Histoire du monde et passai rapidement sur les raisons qui avaient poussé l’ATAN et la CARA à s’entredéchirer ; j’aurais tout le temps plus tard d’apprendre le pourquoi de cette guerre sans doute inutile. De toute façon, c’était dans la nature de l’Homme de se battre et, au final, les raisons importaient peu. Je fis aussi l’impasse sur la géographie puisque la configuration de la planète avait été profondément modifiée par les ogives nucléaires et que les frontières entre nations n’existaient plus. Bref, à l’exception de mes écarts scientifiques, je focalisai mon attention sur tout ce qui pouvait m’être utile pour survivre dans ma prison souterraine. N’importe qui aurait fait pareil, je pense.
À la lecture de ces quelques lignes, vous vous dites sans doute que tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Que dans mon malheur, j’avais de la chance ! À la vérité, c’était loin d’être le cas. Une petite fille ne peut entretenir seule une station souterraine de dix niveaux de haut et de 3 280 pieds de large. Malgré mes efforts constants, le délabrement gagnait du terrain, chaque jour un peu plus. La vieillesse était pareille à un cancer qui rongeait les murs et les organes internes de l’abri 101-42-1. Les conduites d’eau explosaient les unes à la suite des autres ; le système d’aération ne permettait plus d’alimenter tous les secteurs en même temps ; le chauffage avait du mal à vaincre le froid des profondeurs ; les jardins hydroponiques tombaient progressivement en ruines, envahis par la végétation et l’humidité. En dix ans, la station qui avait accueilli mes ancêtres, les premiers colons souterrains, résisté durant des siècles, et vu naître des milliers d’enfants, passa du statut de cocon confortable à celui de navire en perdition. Faute de meilleure option, je décidai de concentrer mes réparations sur les systèmes vitaux, ceux qui me permettaient de rester en vie. Je savais que cela ne résoudrait rien et qu’à long terme les problèmes iraient en s’aggravant, mais cette mesure me permettrait au moins de gagner un peu de temps.
Finalement, ce qui devait arriver arriva : un grand coup de canon vint déchirer la nuit. Le système d’aération venait de lâcher. Le choc ébranla toute la station et les machines avoisinantes, et dans la foulée, le purificateur d’eau rendit l’âme. Après un examen attentif, il apparut qu’il était irréparable sans pièces de rechange. Pièces qu’il fallait, bien évidemment, fabriquer soi-même. Or, l’état de mes connaissances ne me permettait pas de réaliser des rouages aussi petits ou des moteurs aussi complexes. Cop-1 fit ce qu’il put pour m’aider à remettre en état l’énorme installation hydraulique, mais c’était inutile ; la machine était bel et bien fichue.
Et sans eau potable, mes jours étaient comptés.
J’avais alors vingt-deux ans et pour la jeune femme que j’étais, qui croyait avoir déjà tout vécu, qui connaissait son petit monde sur le bout des doigts, la vie n’allait faire que commencer.
CHAPITRE III
Dire que j’étais angoissée à l’idée d’affronter le monde extérieur ne serait pas exagéré. Je crois même pouvoir affirmer que j’étais littéralement morte d’inquiétude. Pourtant, Dieu sait que j’avais espéré ce moment. Sortir de l’abri, mon rêve d’enfant s’accomplissait ! J’aurais dû être la plus heureuse des femmes — en même temps, j’étais peut-être la dernière. Mais l’instant n’était pas à la fête. Je devais la concrétisation de mon fantasme à la mort d’un millier de personnes, dont mes parents adorés. De plus, j’avais toujours en tête les images de personnes suffoquant dans leur sang que M. Varrick nous avait montrées. J’espérais que ma combinaison étanche suffirait à repousser les virus rôdant dans l’air. J’avais une réserve d’oxygène de quarante-huit heures, ce qui, couplé au système de purification intégré, me permettrait de me déplacer durant une semaine. Je disposais donc de sept jours pour rejoindre un endroit sûr. Pour ce faire, j’avais consulté les archives stratégiques de l’ATAN afin de dénicher l’abri le plus proche et glissé une carte de la région dans mon sac à dos.
Vous ai-je déjà précisé que l’abri 101-42-1 n’était pas le seul existant ? Si ce n’est pas le cas, excusez ma négligence due à l’évidence que représente cette information pour moi, à présent.
Lors des dernières années de conflit entre l’ATAN et la CARA, il apparut clairement aux dirigeants de l’époque que personne ne gagnerait la guerre. Malgré cela, ces stupides inconscients, égoïstes, au lieu de capituler ou de signer un traité de paix, ont préféré continuer de jouer à qui a la plus grosse. Ce faisant, il était inévitable que l’anéantissement de l’autre soit la seule issue envisageable. S’en rendant compte, les dirigeants décidèrent, pour le bien de l’Humanité, de mettre les populations à l’abri dans des stations souterraines — alors qu’il aurait suffi qu’ils arrêtent de se battre pour assurer la pérennité de l’espèce, mais allez comprendre un militaire… Des bunkers comme le mien furent construits à tour de bras, disséminés aux quatre coins de la planète, et les élites purent y trouver refuge. Les scientifiques, les artistes confirmés, les ingénieurs, les politiques et tous ceux qui rentraient dans les critères de sélection eurent la « chance » de continuer leur vie en sous-sol, tandis que le gros des populations s’éteignait sous les pluies atomiques et les infections bactériologiques. Je descends moi-même d’une longue lignée de chercheurs. On estime à 2 % le nombre de survivants par rapport à la population mondiale de l’époque.
Je lus également plusieurs notes éparses sur un projet américano-canadien visant à envoyer en mer une vingtaine d’immenses forteresses navales, lesquelles pourraient, en théorie, résister à l’Apocalypse et voguer jusqu’à la fin des temps. À l’heure où j’écris ces lignes, je me demande si ces vaisseaux chargés des espoirs d’un continent entier naviguent encore sur les océans de glace de l’hémisphère sud ou, au contraire, s’ils ont rejoint les galions pirates d’autrefois dans les profondeurs de l’antre de Davy Jones. Car, comme on le sait, et comme j’en avais fait l’amère expérience avec la dégradation progressive de mon abri, aucune machinerie humaine n’est éternelle.
L’ensemble des abris souterrains était relié par un réseau de communication semblable à Internet, lequel tomba en panne au bout de six mois. Malchance, sabotage ou accident ? Personne ne le sut jamais. Les historiens supposent que la précipitation dans laquelle le réseau fut créé n’est pas étrangère à ce dysfonctionnement. Pour ma part, je pense que des armes EMP furent utilisées par la CARA afin de déstabiliser ce qu’il restait de l’ATAN. Quoiqu’il en fût réellement, chaque communauté se retrouva isolée des autres, sans aucun moyen de communiquer. Je ne savais donc pas si je trouverais des survivants dans l’abri 99-24-12, le plus proche du mien. Pour ce que j’en savais, il se pouvait très bien qu’il ait été détruit des siècles auparavant. Au pire, je trouverais un trou béant à son emplacement. Dans ce cas, je ne donnais pas cher de mes chances de survie. Mais je n’avais pas d’autre alternative : le second abri le plus proche se trouvait à au moins dix jours de marche.
Debout devant le sas de sortie, je ne parvenais pas à détacher mon regard de la bande métallique qui surplombait la porte ronde ; dedans était gravée la Loi : nul être vivant ne peut ouvrir cette porte sous peine de mort