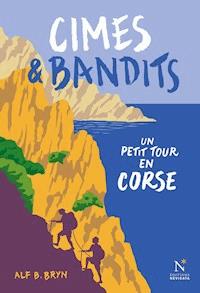
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'épopée mémorable de deux jeunes alpinistes.
Au printemps 1909, deux jeunes alpinistes – l’un Norvégien, l’autre Australien – rêvent d’une expédition en Himalaya. Pour s’y préparer, ils recherchent une région de montagnes vraiment reculées, comme on les trouve en Asie. La Corse leur semble tout indiquée. La décision est prise de profiter de leurs vacances de Pâques. Sommairement équipés, ils s’embarquent pour l’île de Beauté. De péripéties hilarantes en imprévus cocasses, voici le récit de leur équipée mémorable au cœur du maquis et sur les hautes crêtes de Corse. Un indémodable classique de la littérature norvégienne et un régal d'humour britannique, traduit ici pour la première fois en français !
Découvrez un indémodable classique de la littérature norvégienne et un régal d'humour britannique, traduit ici pour la première fois en français !
EXTRAIT
Après une fouille minutieuse de l’établissement, on finit par retrouver l’objet de nos désirs dans une pièce du sous-sol, sous la forme d’un grand baquet en zinc, rempli d’une quantité phénoménale de détritus divers, et dont une chatte au caractère exécrable s’était approprié une partie, pour en faire une litière à l’usage de ses six chatons. Nous nous montrâmes inflexibles quant à notre désir de propreté et, sous la férule énergique de George, le baquet fut débarrassé de ses détritus et de ses chats, transporté dans notre chambre commune et installé en son milieu. Puis nous mîmes les femmes au travail, pour apporter de l’eau chaude dans de gros récipients, si bien qu’avant le dîner – consommé avec modération et en prenant cette fois tout notre temps, instruits par notre expérience de la veille – nous étions baignés et rasés de près.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alf B. Bryn (1889-1949) est un ingénieur, alpiniste et écrivain norvégien, connu à la fois pour ses exploits alpins et ses romans policiers.
Cimes et Bandits est son livre le plus célèbre, réédité sans interruption en Norvège depuis sa première parution en 1943.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface
Le Norvégien Alf Bryn rencontra l’Australien George Ingle Finch à l’Université de Zurich en 1908. George, son aîné d’un an, était déjà un alpiniste célèbre pour ses nombreuses ascensions dans les Alpes suisses, dont la première de la face nord du Castor, réalisée avec son frère cadet Max, son compagnon de cordée préféré.
Sa renommée était telle qu’il fut nommé président du Club alpin universitaire de Zurich. Le comte italien Aldo Bonacossa, lui-même excellent alpiniste, le considérait comme l’un des tout meilleurs alpinistes de l’époque, ainsi qu’il l’écrivit des années plus tard dans le journal de l’Alpine Club : « L’alpiniste numéro un et la personnalité la plus remarquable parmi eux (les alpinistes grimpant dans les Alpes suisses) était de loin George Finch ».
Alf Bryn, qui réalisa plus tard plusieurs premières ascensions remarquables dans les montagnes norvégiennes, était lui aussi un sportif accompli, pratiquant la boxe, l’aviron, le tennis et l’alpinisme, et même plus tard la course automobile. Ce fut donc tout naturellement que George l’invita à se joindre à lui et à son frère pour une expédition d’entraînement en Corse, avant la réalisation de son rêve : partir gravir des sommets himalayens.
George et Max Ingle Finch n’auraient pu trouver meilleur compagnon qu’Alf Bryn, comme il le démontra lors de cette expédition, en particulier en franchissant en tête, sans faillir, le passage clé de la face nord-est de la Paglia Orba, passage qu’il avait découvert lui-même (ce que le « modeste » Alf, selon le récit qu’en fit George lui-même dans son livre The Making of a Mountaineer1, oublia de préciser dans le sien). La voie Finch à la Paglia Orba, leur plus belle réussite lors de cette expédition dans les montagnes corses, reste aujourd’hui une très belle escalade classique des montagnes de l’île de Beauté. Ils en réussirent la première en avril 1909, en chaussures à tricounis et dans des conditions difficiles, car la majorité des fissures étaient bouchées par la glace et une chute d’eau gelée recouvrait la longueur clé, barrant l’accès à l’arête sommitale. Cet exploit a laissé un souvenir très vif aux grimpeurs habitués des montagnes corses.
Remarquable alpiniste, George Ingle Finch était également un grand scientifique, doublé d’un personnage totalement iconoclaste. Venu d’Australie où son père était un riche éleveur, il avait suivi sa mère à Paris pour entamer ses deux premières années de médecine avant de décider qu’il était fait pour les sciences exactes, ce qui l’amena à rejoindre la célèbre École polytechnique de Zurich.
En 1922, il fut sélectionné pour la première expédition britannique à tenter sérieusement l’Everest, en compagnie de George Mallory, Howard Somervell et Edward Norton. Finch parvint à l’altitude de 8236 m, où il fut arrêté à cause d’une panne de l’appareil à oxygène de son compagnon de cordée George Bruce, qu’il réussit à réparer, lui sauvant ainsi la vie avant de redescendre. Malgré cet exploit, il ne fut pas retenu par l’Alpine Club pour participer à l’expédition à l’Everest de 1924, où Mallory et Irvine trouveront la mort.
Alf Bryn écrivit ce « petit tour en Corse » à l’âge de cinquante-quatre ans, alors qu’il avait de nombreux romans policiers à son actif. Et le plus étonnant, c’est que le plus « British » des deux protagonistes est Alf le Norvégien, avec son humour et sa dérision permanents, exprimés avec beaucoup de finesse et de tact.
Les détails des rencontres avec les « autochtones » corses, ou ceux de la conduite extravagante de George, qui font tout le sel de son récit, sont totalement absents du récit de Finch, qui se cantonne à la description de leurs réalisations en montagne.
Peut-être les « gentlemen » de l’Alpine Club finirent-ils par admettre que George Ingle Finch était lui aussi un gentleman, ce dont Alf Bryn était persuadé. Après tout, son ascension de la Tour de Pise, telle que la raconte Alf, après celle de Notre-Dame de Paris avec Max, alors qu’il n’avait que dix-huit ans, correspondaient à l’excentricité nécessaire d’un gentleman pour être admis à diriger l’Alpine Club. George Ingle Finch finit par en être nommé président en 1959, à soixante-dix ans. Mieux vaut tard que jamais…
Les alpinistes français peuvent se souvenir, lorsqu’ils font cette belle balade en montagne qu’est la célèbre arête des Cosmiques à l’Aiguille du Midi, que c’est George Ingle Finch qui en réussit la première ascension en 1911 avec son frère Max. Quel dommage qu’Alf Bryn, qui était alors retourné en Norvège, ne les ait pas accompagnés. Il nous aurait régalés d’un autre récit à l’humour décalé et peut-être évoqué les rencontres de George et de Max avec la faune chamoniarde, comme il l’a si bien fait avec les Corses.
Il est fort possible qu’Alf Bonnevie Bryn, comme il le raconte à la fin de son livre, ait été apparenté à la famille de bandits corses Bonelli par son ancêtre Torres Bonnevie Bryn, le « pirate ». Lui aussi, comme George Ingle Finch, était un iconoclaste résolument opposé à tous les nationalismes. Qu’il soit remercié du petit bijou qu’il a laissé à la postérité, bijou jusqu’à présent réservé aux seuls Norvégiens, et enfin présenté aux lecteurs français (et corses).
Eric VolaChamonix, mai 2017
1Comment on devient alpiniste, Librairie Dardel, Chambéry, 1926.
Alf B. Bryn (1889–1949) est un ingénieur, alpiniste et écrivain norvégien, connu à la fois pour ses exploits alpins et ses romans policiers. Cimes et Bandits est son livre le plus célèbre, réédité sans interruption en Norvège depuis sa première parution en 1943.
Chapitre 1
Prélude helvétique
Par une belle fin de journée, un dimanche d’août 1909, je pendais la tête en bas au bout d’une corde, dans la face sud du Gross Ruchen, à quelque six ou sept mètres en contrebas de l’arête sommitale. À l’autre extrémité de la corde et à peu près à la même distance, mais sur le versant nord, pendait Max van Heyden van der Slaat. Un peu derrière nous, sur l’arête, attaché à la même corde, se trouvait George, avec un énorme sac à dos, lourdement lesté d’instruments d’enregistrements météorologiques.
Nous nous retrouvions dans cette position plus que fâcheuse à la suite de la rupture d’un morceau de l’arête neigeuse sur laquelle Max progressait à califourchon, et qui l’avait entraîné dans sa chute. Pour éviter que nous subissions tous les trois le même sort, je m’étais jeté dans la face sud, et lorsque la corde s’était tendue, le choc m’avait fait basculer cul par-dessus tête.
Précisons qu’il s’agit bien là de la technique à appliquer en pareille circonstance. Je l’avais apprise dans les livres de montagne, ce qui donne à penser que les alpinistes ont assez fréquemment l’occasion de pratiquer ce type d’exercice. Mais en ce qui me concerne, c’était bien la première fois que j’étais amené à le faire, et pour tout dire, la manœuvre me parut terrifiante, cette première fois en tout cas : ce fut un peu comme sauter à skis d’un tremplin gigantesque, ou plonger de très haut dans une eau glacée. Si le saut en parachute avait été inventé à cette époque, c’est le premier exercice comparable qui me serait venu à l’esprit.
On dit que dans ces instants où l’on voit la mort en face, votre existence tout entière défile sous vos yeux en une fraction de seconde : les moments clés de votre enfance et de votre vie familiale, les actions que vous regrettez d’avoir faites et celles que vous regrettez de n’avoir pas faites. Cela ne concorde guère avec mon expérience personnelle. La seule chose dont je me souvienne, en dégringolant le long de ce mur de glace, c’est de m’être demandé si Max était solidement attaché à la corde qui nous liait. Non que son sort me préoccupât outre mesure, mais il avait une fonction vitale pour moi : me servir de contrepoids et bloquer ma chute. Dieu merci, Max était solidement attaché, et la corde tint bon.
Bien pire, ou plus palpitante, c’est selon, fut la mésaventure d’O.G. Jones, qui en 1887 gravit la Dent Blanche en compagnie de son ami – du moins le pensait-il – le docteur H. Robinson. Ce que Jones ignorait, c’est que Robinson venait de découvrir que lui, Jones, entretenait depuis fort longtemps une liaison avec sa femme à lui, Robinson. Un genre d’aventure plutôt mal vu dans les milieux puritains de la bourgeoisie anglaise de l’époque.
Ils avaient quitté Zermatt la veille pour gravir la Dent Blanche par une voie particulièrement difficile qui, pour une raison qui m’est inconnue, avait été nommée l’arête des Quatre Ânes.
Quand on approche du sommet de la Dent Blanche, la configuration du terrain ressemble grosso modo à celle de l’arête sommitale du Gross Ruchen, à ceci près que son altitude est bien plus élevée et que sa face nord est quasi verticale sur les trois ou quatre cents premiers mètres. Puis la paroi se transforme en un mur de glace dont la pente s’adoucit progressivement jusqu’au sommet, 1500 mètres au-dessus du glacier. La hauteur de la face sud est presque aussi importante, mais elle n’est pas aussi raide.
Sur la Dent Blanche, ce jour de 1887, soufflait un vent violent, accompagné de fortes chutes de neige, et Jones distinguait à peine Robinson qui progressait en tête, à une quinzaine de mètres devant lui. Il le vit soudain perdre l’équilibre, basculer et commencer à glisser le long de la pente, puis se retourner sur le dos avant de disparaître. Un peu avant de tomber, Robinson s’était détaché de la corde, la laissant ainsi porter par Jones pour le reste de l’ascension.
Jones, quant à lui, descendit du sommet de la Dent Blanche jusqu’au glacier, 1500 mètres plus bas, emporté par une avalanche conséquente, dont il se tira sans la moindre égratignure. Quelque peu sonné cependant, il finit par reprendre ses esprits sur le glacier et passa la nuit dans une cabane à proximité, avant de poursuivre jusqu’à Zermatt le lendemain. Après avoir organisé l’opération de sauvetage pour retrouver son ami laissé derrière lui, il put, en toute bonne conscience, entourer de son attention celle qu’il supposait désormais veuve.
Robinson avait cependant réussi à enrayer sa chute avec son piolet et à regagner le fil de l’arête. Il rencontra les pires difficultés pour redescendre de la Dent Blanche, contraint de bivouaquer deux nuits en pleine montagne avant d’arriver à Zermatt, dans un état d’épuisement extrême mais heureux d’avoir sauvé avec brio l’honneur de la famille. À Zermatt, il tomba nez à nez avec son ami Jones et sa femme (à lui, Robinson), lesquels reprenaient des forces dans un café devant une tasse de thé, au terme d’une nuit très agitée dans un hôtel local.
Bien qu’amputée des quelques menus détails et explications que je viens de fournir, cette anecdote fut rapportée dans l’Alpine Journal de 1888. Il n’y est toutefois aucunement fait mention de la façon dont les relations amoureuses du trio évoluèrent par la suite.
Les démêlés du type Jones-Robinson ne nous concernaient en rien, Max et moi, car nous étions par bonheur tous deux célibataires. Qui plus est, Max n’était pas l’instigateur de cette ascension. Bien au contraire, il n’avait consenti à m’accompagner qu’avec réticence, pour ce qui était sa toute première ascension – et selon toute vraisemblance, sa dernière.
Comme son nom ne l’indique pas, Max van Heyden van der Slaat n’était pas Néerlandais. Son père, qui avait émigré en Russie quand il était jeune, y avait édifié une fortune considérable. Il était propriétaire, entre autres, de vastes domaines forestiers et de l’une des plus importantes usines de caoutchouc du pays. Mais Max n’avait rien d’un fils à papa, et encore moins d’un fils à papa ploutocrate : il fréquentait des personnages louches et faisait partie de plusieurs cercles estudiantins révolutionnaires. Ces relations étant clairement antinomiques avec les intérêts économiques de papa, celui-ci envoya Max étudier à Zurich, muni d’un valet âgé et d’un pécule d’un million de francs, destiné à couvrir ses besoins pour la durée de ses études.
Malheureusement, à cette époque, Zurich était, de toutes les villes d’Europe, celle qu’il fallait éviter à tout prix si l’on voulait éloigner un jeune homme du bolchevisme naissant : c’est précisément là que se tramait ce qui allait provoquer la révolution bolchevique, huit ans plus tard. C’est à Zurich, dans son appartement ou dans son café préféré, que Vladimir Oulianov2 donnait des conférences sur Marx, Engels et diffusait ses propres idées devant un cercle d’admirateurs des deux sexes sans cesse grandissant. Max, qui gravitait autour de ce cercle, mit rapidement un terme à ses études pour se consacrer à l’une des nièces du peintre russe Verechtchaguine, relation qui allait lui apporter plus de chagrin que de bonheur. Et si Max se retrouvait aujourd’hui pendu au bout d’une corde dans la face nord du Gross Ruchen, c’était bien de sa faute, à elle.
Voici l’histoire.
Un soir, dans une modeste salle de spectacles, j’assistai à un combat de boxe dit professionnel. Pour autant que je me souvienne, la joute opposait Battling Kid, champion du Missouri, à Pete alias la Terreur de Milwaukee, et tous deux se livraient à une démonstration pour le moins médiocre du « noble art ».
Au terme du combat, le propriétaire de la salle grimpa sur le ring et offrit une récompense de 100 francs à quiconque tiendrait un round de trois minutes face à l’un des deux boxeurs dits professionnels.
C’est un genre de défi qui se pratiquait depuis longtemps – un treizième round ouvert, en somme – à l’image de ce qu’on voit dans les cirques, lorsqu’on invite un spectateur à descendre sur la piste pour se jucher sur le large dos d’un cheval, lequel fait le tour de ladite piste en sautillant pour désarçonner le volontaire, dans l’hilarité générale. Au fil du temps, le nombre de volontaires s’était réduit et il fallait donc faire appel à des victimes rémunérées, OK pour se laisser mettre KO sans rouspéter, à raison d’un par soirée.
Mais ce soir-là, nous eûmes plus de chance. Un grand jeune homme blond et efflanqué se leva de son siège, au premier rang, enjamba la fosse d’orchestre et grimpa sur le ring. C’est ainsi que je rencontrai George pour la première fois. C’était également une première pour la Terreur de Milwaukee, qui fit là une douloureuse expérience. Le combat dura moins d’une minute. Après être allée au tapis pour la troisième fois, la Terreur refusa de se relever. Cette malheureuse Terreur n’avait pas la moindre chance de gagner : l’allonge de George dépassait la sienne de quinze bons centimètres, et il ne parvint à aucun moment à forcer le barrage des gants de son adversaire, que ce soit le gauche ou le droit. Il n’eut même pas la possibilité de le saisir au corps-à-corps, solution que tout boxeur professionnel en difficulté adopte en désespoir de cause.
Sous les ovations du public, George proposa aimablement à Battling Kid de faire à son tour un round contre lui, invitation que ce dernier déclina.
Puis vint pour George le moment de retomber sur terre à son tour : pas question de toucher la prime annoncée. Le prix était convenu pour un round de trois minutes. Le combat ayant duré moins d’une minute, il n’avait droit à rien. La négociation entre George et les gérants de l’établissement se poursuivit derrière des portes closes, si bien que la plus grande partie échappa au public. Les gérants, qui devaient être costauds et nombreux, remportèrent le round.
L’incident clos, je retrouvai George à l’extérieur en train de discuter avec un Max débraillé, qui tentait de le convaincre d’accepter 100 francs, au titre de la reconnaissance du public admiratif, qu’il représentait. George avait un esprit ouvert aux questions d’argent et il se laissa convaincre sans résistance.
Je me joignis à eux et nous nous rendîmes dans un café voisin, où nous eûmes droit à une version inédite des Souffrances du jeune Werther : Max ne s’amusait guère avec sa Verechtchaguine. Elle n’avait rien contre lui personnellement, mais elle était communiste jusqu’à la moelle, ce qui incluait la sphère érotique. En 1908, elle maîtrisait déjà parfaitement les idéaux bolcheviques qui n’allaient connaître leur officialisation qu’au début des années 1920 (l’histoire nous a depuis enseigné qu’avant cette époque, la Russie comptait plusieurs crapules de cet acabit, et pas seulement dans la gent féminine). Comme indiqué plus haut, elle se servait de Max mais plaçait le bien commun avant les intérêts personnels de son amant, auquel d’ailleurs elle reprochait de n’avoir rien d’un véritable prolétaire. Pour dire les choses franchement, elle le considérait même comme un vil produit de la ploutocratie, indigne de se trouver dans le même café qu’Oulianov.
— Comme si je n’étais pas un aussi bon prolétaire que lui, se lamentait Max. Tout ça parce que mon père est riche – et alors ? Le sien est un aristocrate, ça ne vaut guère mieux. Qu’y puis-je après tout, si aucun de mes frères n’a été pendu ? De toute façon, je n’ai pas de frère, ce n’est tout de même pas de ma faute. Rien n’y fait, quoi que je fasse, poursuivait-il en sifflant un second verre. J’espérais qu’elle aimerait mon idée d’acheter une station météo dernier cri pour l’installer à Alstadt, à deux pas de son café favori. « Tu parles ! m’a-t-elle répondu, qu’est-ce que j’en ai à fiche du temps qu’il fait à Zurich ! Tu ferais mieux de m’offrir une tenue de sport ! » C’est ce que j’ai fait, naturellement. Et elle, aussi sec, elle est partie dans une cabane avec un de ces maudits Finnois – ce que j’ai pu l’entendre plastronner, celui-là, à se vanter d’avoir tué un policier à Helsingfors ! Un tir accidentel, probablement – et c’est là qu’elle habite maintenant, la garce ! À votre santé ! Ah, les femmes, bon Dieu ! Allez, je rentre à la maison. Et bonne nuit, les amis !
Cruel destin, assurément, que de perdre ses illusions à vingt ans à peine.
— Écoute, me dit George peu après que Max fut parti, je pense que nous devrions faire quelque chose pour lui.
J’acquiesçai. Max nous considérait comme ses amis, et pas question de laisser tomber un ami. Nous partîmes à la recherche de sa station météo, qui attendait dans sa boîte de verre, dans une allée où elle ne servait strictement à rien. Elle était remplie d’instruments coûteux, de mécanismes compliqués et de cylindres rotatifs. Mais le plan de George ne se limitait pas à s’emparer de la station. C’était un organisateur né, un visionnaire, très en avance sur son époque.
— Nous allons l’emballer, m’expliqua-t-il, puis emmener Max et sa station au sommet du Gross Ruchen. De toute évidence, il est bien plus intéressant d’étudier la météo dans des endroits où il n’y a personne, plutôt qu’au beau milieu de la ville, où tout un chacun peut constater le temps qu’il y fait3.
J’ai d’excellentes raisons de ne pas dévoiler la manière dont nous nous y sommes pris pour nous emparer de la station. Mais aux alentours de 3 heures, portant l’ensemble des instruments enveloppés dans un vieux pardessus, nous nous sommes rendus au Baur au Lac, le meilleur hôtel de Zurich, port d’attache de Max et de son valet.
De toute évidence, Max avait fait bien meilleure impression sur le portier de nuit que sur son infidèle petite amie bolchevique, faute de quoi nous n’aurions pas eu la moindre chance de franchir le seuil à cette heure tardive de la nuit. Nous le tirâmes du lit et aussitôt lui exposâmes notre plan, auquel il ne trouva qu’un intérêt mitigé. Ce n’est que lorsque George l’eut convaincu que non seulement ce coup d’éclat améliorerait sa confiance en lui, mais que de surcroît il amènerait sa volage petite amie à réaliser à quel point son nouveau compagnon était un individu terne et méprisable, que Max finit par céder et accepta de participer le jour même à l’expédition au Gross Ruchen.
Et voilà pourquoi nous étions là, pendus à notre corde. Il faisait un temps de chien, et la nuit tombait rapidement. Ce n’est pas évident de se sortir d’un aussi mauvais pas, ça prend du temps. Rien que gesticuler frénétiquement pour se remettre dans le bon sens est un travail de longue haleine. Ensuite, tout en vous tenant d’une main à la corde, vous devez tailler une marche de l’autre avec votre piolet. Au-dessus de nous, à cheval sur l’arête, George, que la situation semblait beaucoup amuser, dirigeait les opérations.
Finalement, Max et moi parvînmes à remonter sur l’arête, et nous nous y installâmes à califourchon tous les trois. Il était près de 21 heures et il faisait maintenant nuit noire. Sous le vent du nord, la neige tourbillonnante masquait le précipice du versant sud. C’est tout juste si par moments nous pouvions entrevoir le relief des dalles rocheuses qui menaient au sommet principal, devant nous. Tant qu’il ne ferait pas jour, pas question de monter ou de descendre. Que faire alors, en pareil cas ?
Rien. Il n’y a aucun danger. Vous devez juste attendre. Nous avons mangé de la viande séchée, fumé la pipe et tapé du pied contre la glace avec nos talons pour nous réchauffer. De temps à autre, George entonnait une chanson, bien qu’il n’eût rien d’un grand artiste. Il n’en connaissait d’ailleurs qu’une, qu’il braillait d’une voix de fausset :
J’aimais une fille qui se prénommait Lill,Mais elle fut séduite par Buffalo Bill,Puis fut violée par Seladon Hill,Que son âme au Diable file,Car j’aime encore cette fille.
George était originaire du Sud de l’Australie, où il était né et où il avait grandi. Qu’il connût cette ballade typiquement américaine, et qu’elle fût même la seule qu’il eût jamais mémorisée, voilà qui en dit long sur l’influence précoce de la culture américaine sur les régions les plus lointaines du globe.
Il n’y a pas grand-chose à ajouter sur notre expédition météorologique. Je n’ai plus jamais entendu parler de ces instruments, que nous avons soigneusement installés au sommet, le jour suivant, en construisant un cairn. À propos de Max van Heyden van der Slaat, il n’y a vraiment rien à ajouter non plus si ce n’est que, comme on le dit de la plupart des Norvégiens, il ne fait plus partie de cette saga. Il ne fut qu’un élément secondaire dans ce prélude, me permettant de faire la connaissance de George, ce qui devait nous amener, quelque temps plus tard, à découvrir la Corse.
2 Plus connu sous le nom de Lénine.
3 Il est intéressant de noter que George (nommé depuis professeur, à Londres) était à l’époque un véritable pionnier en la matière. Il faudra attendre de très nombreuses années pour que les météorologues, en particulier à l’initiative du professeur Bjerknes, entreprennent des travaux systématiques visant à installer des stations au sommet des montagnes. À ce jour, on en compte de nombreuses, tant en Suisse qu’en Norvège, mais en toute équité, il conviendrait qu’un hommage nous soit rendu, à George, Max ou moi-même, en reconnaissance de notre rôle pionnier dans ce domaine.
Chapitre 2
Préparatifs, financement et ravitaillement
Qui fut à l’origine de ce périple en Corse ? On n’en saura sans doute jamais rien, la littérature disponible sur le sujet nous livrant des informations contradictoires. Ainsi, le bref compte rendu de l’expédition et de ses résultats (paru dans L’annuaire de l’Office du tourisme norvégien) rapporte que l’initiative en revient aux Norvégiens. Compte rendu dont je suis l’auteur.
Si, en revanche, vous vous plongez dans l’Alpine Journal, vous en tirerez la nette impression que l’idée originale fut australienne. Ce compte rendu est signé de George.
On trouve une troisième version, sans aucun doute la plus diplomatique, dans The Making of a Mountaineer, dans laquelle un George très magnanime accorde la paternité simultanée de l’initiative à chacun de nous.
En ce qui me concerne, j’ai cessé de me préoccuper de cette question de prestige international, mais je ne serais guère surpris de découvrir que la version de l’Alpine Journal était la bonne. Ce dont je me souviens très bien, en revanche, c’est que selon le programme élaboré par ma famille, j’étais censé passer les vacances de Pâques 1909 à Lausanne pour y étudier le français. Ce qui est sûr également, c’est que quelques semaines avant le début des vacances, George et moi étions tombés d’accord sur l’impérieuse nécessité de partir en Corse.
Très vite, un plan fut établi. Mais nous devions au préalable obtenir l’aval de nos autorités parentales respectives, australiennes et norvégiennes, ce qui alimenta de longues délibérations. À l’évidence, le fait d’asseoir cette expédition sur des bases légales satisfaisantes constituerait, ne serait-ce qu’au plan financier, un énorme soulagement. Mais au cas où notre projet n’obtiendrait pas le soutien escompté – ce qui, nous le pressentions, était plus que probable – les conséquences pourraient s’avérer infiniment plus sérieuses que si nous partions sans autorisation, certes, mais sans interdiction formelle non plus.
Tout bien considéré, la solution que nous adoptâmes finalement s’avéra la meilleure possible. Comme tout ce qui est ingénieux, elle était d’une simplicité déconcertante : lorsqu’il serait trop tard pour nous forcer à renoncer, chacun de nous écrirait à sa famille respective pour lui annoncer que, pour les vacances de Pâques, nous avions dû renoncer in extremis au programme prévu car nous avions été invités par un ami fortuné – George par moi et moi par George – à visiter en sa compagnie le Nord de l’Italie et la Corse.
Mais il nous restait plusieurs obstacles à surmonter, dont le plus épineux était la question financière. De tout temps, le financement des voyages d’exploration a constitué un écueil sérieux. Par essence, la noblesse des valeurs associées à la découverte, quelle qu’elle soit, a toujours échappé à l’entendement des pontes de la finance. L’explorateur qui ne parvient pas à démontrer un intérêt mercantile à son projet – à l’instar de Christophe Colomb ou de Marco Polo –, ou qui comme Stanley, n’a pas le soutien d’un organe de presse cossu, celui-là se retrouvera confronté à des difficultés financières souvent insurmontables.
Et si vous y réfléchissez bien, notre situation était encore moins enviable que celle de nos prédécesseurs : eux au moins pouvaient présenter leur projet à tout mécène sans la moindre dissimulation. Cette option nous était interdite.
Il y a eu de grands découvreurs, c’est vrai, avant et après George et moi, et loin de moi l’idée de les dépouiller d’une gloire légitimement acquise. Mais que l’on ne s’y trompe pas : en ce qui les concerne, leurs problèmes les plus inextricables furent résolus par d’autres, tandis que nous dûmes résoudre nous-mêmes les nôtres.
Nous élaborâmes donc un budget prévisionnel. Le voyage à destination de la Corse via Gênes, Livourne et Bastia, puis retour à Zurich via Ajaccio et Nice en troisième classe (voire en quatrième, lorsqu’elle existait) coûtait à l’époque environ 200 francs. Nous estimions à environ 250 francs le gîte et le couvert pour une expédition de six semaines, avec six nuits sous un vrai toit – le reste du temps, nous dormirions à la belle étoile. Avec les imprévus, pour lesquels nous prévoyions une cinquantaine de francs, nous arrivions à un budget global de 500 francs chacun. La moitié de cette somme serait couverte par notre allocation du mois précédent, à condition de ne pas payer nos loyers ni quelque dette que ce soit. Pour le reste, il allait falloir racler nos fonds de tiroir.





























