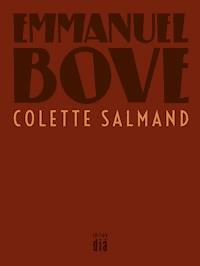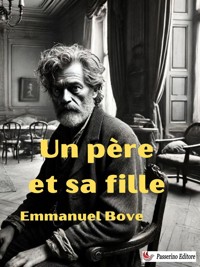1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Cœurs et visages est le huitième roman d'Emmanuel Bove, après La Mort de Dinah. Un long travelling, le banquet célébrant la nomination de l'industriel André Poitou dans l'ordre de la Légion d'honneur. Extrait Chapitre 1 |Par une douce soirée d’hiver, André Poitou s’achemina à pas lents vers l’hôtel Gallia. De nombreux consommateurs étaient attablés à la terrasse des cafés. Ils apercevaient, à travers un brouillard jaunâtre et mobile, les arbres dénudés du boulevard, les lumières tremblantes des enseignes et cette foule où même le promeneur aux vêtements clairs passe inaperçu. Les fêtes de Noël approchaient. Derrière les vitres embuées des restaurants, aux tringles des rideaux, non de dentelle innocente mais de velours, pendaient des pancartes de carton glacé sur lesquelles les patrons vantaient, en caractères d’imprimerie, les avantages de leur réveillon. André Poitou avait voulu se rendre seul à l’hôtel Gallia où ses parents et amis avaient organisé, ce soir-là, un banquet pour fêter sa récente nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur. Mais cela n’avait pas été sans mal qu’il s’était débarrassé de son frère Maurice qui, depuis plusieurs jours déjà, souhaitait de faire une sorte d’entrée triomphale dans la salle du banquet au côté du nouveau légionnaire. André Poitou ne se hâtait pas. Cet instant de solitude précédant un hourvari comme jamais il n’en avait connu lui semblait délicieux. Tout contribuait d’ailleurs à entretenir sa joie...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table of Contents
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X
CHAPITRE XI
CHAPITRE XII
CHAPITRE XIII
EMMANUEL BOVE
COEURS ET VISAGES
ROMAN
Paris, 1928
Raanan Éditeur
Livre 1239 | édition 1
raananediteur.com
CHAPITRE PREMIER
Par une douce soirée d’hiver, André Poitou s’achemina à pas lents vers l’hôtel Gallia. De nombreux consommateurs étaient attablés à la terrasse des cafés. Ils apercevaient, à travers un brouillard jaunâtre et mobile, les arbres dénudés du boulevard, les lumières tremblantes des enseignes et cette foule où même le promeneur aux vêtements clairs passe inaperçu. Les fêtes de Noël approchaient. Derrière les vitres embuées des restaurants, aux tringles des rideaux, non de dentelle innocente mais de velours, pendaient des pancartes de carton glacé sur lesquelles les patrons vantaient, en caractères d’imprimerie, les avantages de leur réveillon.
André Poitou avait voulu se rendre seul à l’hôtel Gallia où ses parents et amis avaient organisé, ce soir-là, un banquet pour fêter sa récente nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur. Mais cela n’avait pas été sans mal qu’il s’était débarrassé de son frère Maurice qui, depuis plusieurs jours déjà, souhaitait de faire une sorte d’entrée triomphale dans la salle du banquet au côté du nouveau légionnaire.
André Poitou ne se hâtait pas. Cet instant de solitude précédant un hourvari comme jamais il n’en avait connu lui semblait délicieux. Tout contribuait d’ailleurs à entretenir sa joie. La proximité du jour de l’an unissait le monde de la rue. Les voitures circulaient comme en une immense figuration sur les côtés de laquelle il n’y eût point eu d’espace désert. En criant les journaux, les camelots avaient une intonation inhabituelle. Ce n’était plus des camelots misérables, souffrant du froid ou de la faim, mais des camelots semblables aux déménageurs, aux charbonniers, aux sergents de ville que les enfants rêvent de devenir.
Bien qu’il ne fût pas en retard, André Poitou se contraignit à ne pas presser le pas. Mais il avait beau se persuader que peu nombreux devaient être encore les convives, il lui apparaissait, parfois, qu’ils étaient tous arrivés, qu’ils s’étonnaient de son absence, que certains même étaient déjà partis à sa recherche. Il tirait alors sa montre avec inquiétude et les aiguilles, sans force sur huit heures moins vingt, le rassuraient aussi rapidement qu’il s’était ému un instant auparavant.
Cela avait été sur une liste du ministère du Commerce que le nom de M. André Poitou avait figuré et même, pour être plus précis, le lendemain de la publication de cette liste, au côté de deux autres noms qui, comme le sien, avaient été omis.
André Poitou méritait cette croix. Il remplissait toutes les conditions requises. Son âge, sa situation, les services qu’il avait rendus au commerce national, les nombreuses sociétés, corporations, associations dont il faisait partie l’avaient poussé jusqu’à cette dignité. Cependant, la chance l’avait quelque peu aidé puisque un millier d’autres candidats, offrant autant de titres que lui, avaient été évincés.
Directeur d’une des plus importantes fabriques de chaussures de France, il employait trois mille ouvriers. À Paris seulement, sept ou huit magasins portaient son nom. C’était un homme d’une soixantaine d’années dont l’ascension s’était subitement arrêtée au lendemain de la guerre. Les longues années de lutte l’avaient lassé. À présent il se détournait de ses occupations et c’était un sujet d’étonnement pour ses proches que de voir ce sexagénaire, modeste et travailleur, rechercher de plus en plus un aspect jeune et sportif. Dans le ralentissement des affaires que connut sa fabrique au cours des années 1920 et 1921, il s’était peu à peu transformé. Le calme subit, après la surproduction de la guerre, l’avait amené à réfléchir. Les plaisirs de la vie, émergeant lentement de la brume qui jusqu’alors les avait baignés, s’étaient présentés à ses yeux.
Une seconde jeunesse succéda à l’âge mûr. Les effets d’une littérature lointaine commencèrent à se manifester. Brusquement il voulut vivre, voyager, aimer, prendre à la hâte tout ce qu’il avait dédaigné ou ignoré. Il calcula qu’il avait encore devant lui dix années de santé. Le passé lui inspira horreur. Comme l’homme qui évite une maison où il vécut avec une maîtresse et qui lui rappelle qu’il n’a pas su aimer, qu’il a été injuste, il le supprimait. S’il s’observait, c’était pour ne plus y penser. Son regard se porta en avant. Les souvenirs de l’adolescent, dont les yeux agrandis par la joie de vivre se promènent sur l’avenir, sont d’une fraîcheur et d’une pureté extraordinaires. Il ne peut croire que déjà des biens lui sont ôtés. Cette incrédulité fait qu’il les conserve en lui aussi palpitants, aussi lumineux que ceux qu’il entrevoit. Il n’en était pas de même en l’esprit d’André Poitou. Son passé était bien mort. Il pensait qu’il fallait désirer son abolition complète pour que la vie, demain, fût belle, qu’il fallait tout oublier, et ses débuts pénibles et sa lente ascension, pour que le futur ne fût pas gâché.
Sa situation était à présent des plus brillantes. Obéissant à une sorte de bon sens, André Poitou n’avait rien fait, durant longtemps, pour la considérer d’une autre manière qu’au commencement de sa carrière. Il n’avait eu, d’ailleurs, aucun mal à prendre cette détermination. Chaque pas en avant avait été accompli si péniblement qu’il eût fallu un léger effort de sa part pour juger du chemin parcouru. Cette façon de considérer avec indifférence son ascension s’était pourtant modifiée avec l’âge. Depuis plusieurs années déjà, André Poitou prenait plaisir à s’écarter, en imagination, de ses biens et à se les représenter sous un aspect définitif. Parfois, lorsqu’il était seul, il murmurait, comme absent : « Voilà ma vie ! Elle a commencé modestement. Peu à peu, je me suis élevé. Sa courbe est celle de toutes les vies normales. » Et c’était un peu la certitude que ses écarts ne pourraient la modifier qui avait amené cette soif de vivre dont il ne se défendait plus.
Dernièrement, il avait fait raser sa moustache. Mais on devinait, même ceux qui le voyaient pour la première fois, que son visage glabre avait été longtemps barré par une moustache. Le dessus de la bouche, d’être tout à coup à l’air après avoir été masqué durant près de quarante ans, semblait d’une chair plus fragile. C’était comme si André Poitou fût sorti avec, à son veston, un accroc qui eût laissé paraître un peu de peau. Et le reste du visage, inconscient de la modification apportée, demeurait celui de la moustache, c’est-à-dire que le nez paraissait un peu trop haut, les joues un peu trop pleines, et les yeux même un peu trop clairs, privés qu’ils étaient de l’ombre de la moustache.
Il allait au théâtre, parfois même il soupait dans quelque restaurant. Lui qui, jusqu’alors, ne s’était jamais lié, il commençait à avoir des amis. Il devenait plus indulgent pour ses employés et souffrait moins de la difficulté de surveiller ses succursales. L’après-midi, il lui arrivait même de se laisser entraîner par quelque jeune femme. Il remarquait certaines de ses vendeuses, se souvenait dans quel magasin elles étaient employées et, fréquemment, s’arrangeait pour les inviter à dîner.
Peu après avoir obtenu son permis de conduire, il acheta une automobile. Il conduisait d’une manière raide, saccadée et avec une telle prudence qu’à son côté l’on rougissait tant il était visible qu’il craignait de détériorer sa voiture. Lui qui, jamais, n’avait eu de relations, il commençait à recevoir des invitations et, parfois, ce qui le transportait de joie, des places pour le théâtre. Il était heureux comme un enfant d’entrer ainsi dans la vie, de se mêler au monde. À chaque instant, des détails le surprenaient. Pour masquer son ignorance, dont seulement à présent il avait honte, il simulait, au milieu de son entourage, une sorte d’indifférence. Lui parlait-on de la Pavlova, qu’il s’efforçait de ne pas déformer ce nom bizarre et de répéter exactement les syllabes qu’il avait entendues.
— La Pavlova a le sens inné de la danse, lui disait-on.
Il répondait d’une voix douce, comme pour se la représenter avec plus de netteté :
— La Pavlova.
C’était tout. Il lui arrivait, pourtant, d’écorcher des noms propres.
— Si vous aviez entendu de Max, lui dit-on, une fois.
Alors, toujours avec le même air, il répéta :
— Max.
De nouveau il regarda sa montre. « Cette fois, il est temps », pensa-t-il. Il pressa le pas. Il était guilleret. Cette Légion d’honneur, pour une des rares fois de sa vie, lui donnait du recul. En cet instant de consécration, comme à une halte, il se retournait. Le chemin parcouru se perdait derrière lui en une perspective toujours plus floue. Les années de piétinement se confondaient avec celles d’avancement excessif. L’ensemble formait une ligne droite et toujours ascendante.
« Est-ce que je vais boire un petit verre ? » se demanda-t-il.
Il entra dans un bar, commanda un anis au comptoir.
« Cela me donnera du courage. Après tout, c’est bien mon tour. »
Il lui plaisait d’opposer pour lui seul, à la grandeur du banquet, un geste de promeneur désœuvré, d’autant que ce geste faisait partie des libertés qu’il avait prises depuis peu. Il alluma une cigarette. Jusqu’à ces dernières semaines, avec un entêtement extraordinaire, il n’avait jamais fumé et avait refusé toutes les cigarettes qu’on lui avait offertes. À présent, il achetait du tabac égyptien. Il n’avait pas la gaucherie des femmes. C’était bien comme un homme qu’il fumait, mais d’une manière si méticuleuse, si prudente que chaque fois qu’il allumait une cigarette on eût dit un événement.
— Je bois cet anis et je vais…, dit-il en souriant au garçon.
Il était pâle. L’émotion qu’il ressentait l’oppressait.
— Ce serait tout de même ridicule qu’on me vît ici avant, murmura-t-il. Il est d’ailleurs huit heures et quart. C’est le moment ou jamais.
Ses mains étaient moites. Par moments, un frisson le secouait.
« Joli petit visage ! » se dit-il en sortant, comme il venait de croiser une passante.
On apercevait, à deux cents mètres, la rampe rouge de l’hôtel Gallia qui éclairait le boulevard. Il se dirigea vers elle, le visage brûlant et baigné par un air humide et tiède. Bientôt, il distingua, tout illuminées, les grandes baies vitrées du hall de l’hôtel. Des tentures les voilaient. Au travers on apercevait pourtant les lustres comme entourés d’une gaze.
CHAPITRE II
En entrant dans l’immense salle dont les lames neuves du parquet, les cristaux étincelaient, André Poitou, ébloui, s’arrêta un instant. Sa silhouette se répétait à l’infini dans les glaces. Une foule d’invités allait et venait. Un murmure, qui parut au commerçant toujours grandissant, vibrait dans l’air.
L’hôtel Gallia venait d’être achevé. Aussi tout était-il prévu, dans cette sorte de galerie réservée aux banquets, pour que le service et le confort ne laissassent rien à désirer. Aucune porte n’était condamnée. À cause de la hauteur du plafond, l’hôtel n’avait pas de premier étage. À partir du deuxième seulement se trouvaient les chambres. On sentait que, durant plusieurs années, tout demeurerait neuf, confortable et pratique. Plus tard peut-être, le monde fuyant l’espace, la vaste galerie serait divisée en petits salons particuliers, les boiseries aujourd’hui peintes de couleurs fraîches, couvertes de lourdes tentures.
À l’extrémité de la salle, dans une sorte de fumoir-serre, des hommes buvaient debout et parlaient. On entendait le bruit, un peu trop criard, des monte-charge qui descendaient jusqu’aux cuisines aménagées sous le sous-sol, celui-ci ayant été réservé à une académie de billard, aux vestiaires et aux cabines téléphoniques.
Ce système de monte-charge était une des particularités de l’hôtel Gallia. Comme les chambres étaient superposées les unes exactement au-dessus des autres, le même monte-charge, dans la cage duquel on entendait à la fois des rires, des conversations, des scènes de jalousie, des pleurs, des commandes de garçons, en desservait autant qu’il y avait d’étages. Dans chaque chambre, il suffisait de sonner pour qu’une minute après une ampoule rose signalât que, dans l’espèce de meuble-gramophone qui masquait ce monte-charge, se trouvait le petit déjeuner commandé.
Le commerçant fit quelques pas. Les invités l’avaient remarqué, mais personne ne bougea ni ne s’interrompit de parler. Il en est presque toujours ainsi lorsque l’homme attendu paraît. Bien qu’il ait été vu par tout le monde, le murmure des voix continue durant une seconde comme si rien n’était.
Les convives étaient, les uns disséminés par groupes, les autres assis à deux ou trois sur le même fauteuil. D’autres encore lisaient le menu et cherchaient leur place. Des garçons s’empressaient de mettre la dernière main aux couverts. La longue table était parsemée de fleurs et de fruits. Un calicot, comme on en voit les jours de vente-réclame, fixé sur la longueur d’une paroi, annonçait que la direction du Gallia s’était assuré, pour les fêtes du jour de l’an, le concours d’un jazz, ainsi que celui du violoniste Carré, premier prix du Conservatoire de Paris. Par les portes vitrées, donnant sur le hall, on apercevait les habitants de l’hôtel que la curiosité amenait presque jusqu’au seuil de la galerie et qui se gardaient de faire un pas de plus, de peur de se trouver dans un endroit défendu.
Cette soirée était peut-être la plus belle qu’André Poitou eût connue. Elle rendait plus tangible sa réussite. Sur la fin de sa vie, c’était un recommencement tellement imprévu qu’il semblait au commerçant que chaque jour qui allait suivre serait comme avantagé. Il dissimula son émotion sous un air de satisfaction et s’avança franchement. Un petit vieillard, vêtu pour la circonstance d’une jaquette bordée de soie noire, vint tout de suite à sa rencontre. Il voulait être le premier à le complimenter pour que le commerçant en gardât plus nettement le souvenir. Par cet échange de paroles qui, parce qu’elles seraient les premières, sembleraient encore appartenir à la vie quotidienne, il créerait une sorte d’entente tacite qui durerait autant que le repas et qu’il se proposait de ranimer au moment du départ.
— Te voilà enfin, mon cher Poitou ! dit-il. C’est pour toi, ce décor grandiose. C’est pour toi que nous sommes tous réunis ici. Comme tu dois être heureux !
— Ne me parle pas, Lorieux, fit le commerçant. Je suis trop ému en cet instant pour te répondre comme tu le mérites.
Ce Lorieux était le docteur auprès de qui, depuis ses débuts, André Poitou se rendait chaque fois que sa santé laissait à désirer. Trente ans durant, les deux hommes n’avaient eu que de vagues relations. Cela n’avait été que dernièrement qu’André Poitou, obéissant au besoin subit de se lier, s’était mis à fréquenter le vieillard. Celui-ci, devant l’importante situation de son client, fit alors taire l’animosité que la froideur et le dédain du commerçant avaient provoquée en lui. Du jour où André Poitou lui avait consenti son amitié, il avait compris qu’il était de son intérêt de l’accepter sans faire la moindre allusion au passé. Aussi, pour justifier cette acceptation rapide, affectait-il d’avoir, lui aussi, un caractère bizarre et simulait-il avec bonheur un goût de rajeunissement et un besoin de rompre avec une longue solitude, ce qui ne l’empêchait d’ailleurs pas de confier à ses proches que Poitou lui faisait l’effet d’une « coquette en retraite ».