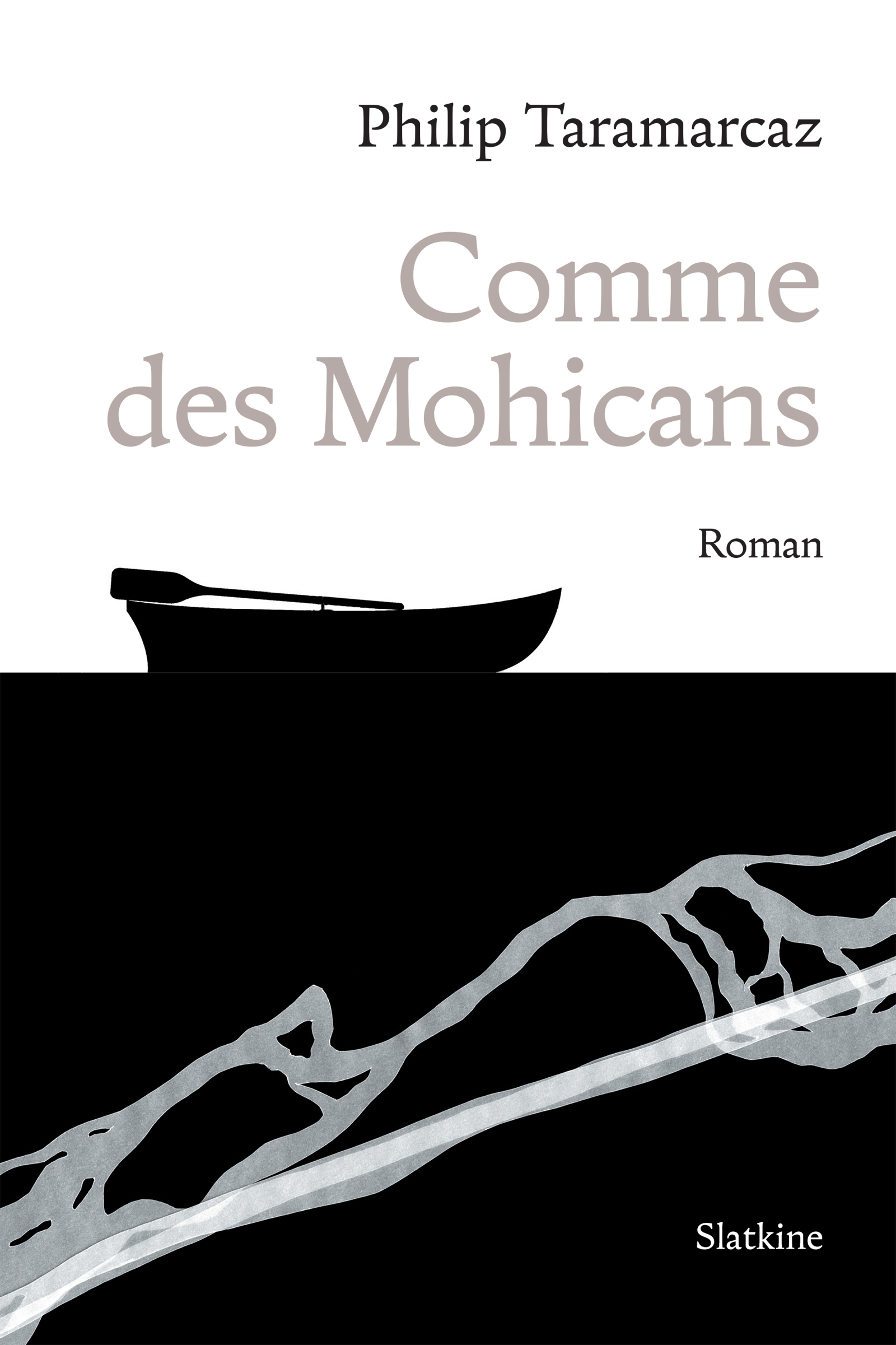
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Slatkine Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Tiraillé par la colère, la culpabilité et l'envie d'être ailleurs, le jeune Séraphin décide de fuir ses obligations de moine. De son côté, Guérin, fatigué des coups de ceinturon de son oncle, quitte son domicile.
Été 1874. L’orage menace sur le col du Simplon. Par une nuit sans lune, Séraphin, quinze ans, s’enfuit de l’hospice pour atteindre la vallée. En route, il fait la rencontre de Guérin, un adolescent décidé à rejoindre sa mère de l’autre côté de la montagne. Des Alpes valaisannes aux eaux boueuses du Mississippi, en passant par les faubourgs de Genève,
Comme des Mohicans fait le récit d’une fuite placée sous le sceau d’une amitié indéfectible. Roman initiatique, il est aussi un face-à-face souvent tragique, parfois jubilatoire, avec le destin.
Voici le récit de deux âmes en fuite qui vont se lier pour partager leurs aventures.
EXTRAIT
Les cloches annonçaient les vêpres et offi cialisaient la clôture de la journée d’étude. – Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, initia le prêtre. – Ainsi soit-il, murmura l’assemblée, composée d’une vingtaine de moines. Un jeune homme de quinze ans, à la chevelure châtain, cachait sa corpulence fi ne et élancée dans le confort apparent de sa soutane noire. Il écoutait distraitement le sermon du prieur. Une colère froide et enténébrée l’avait terrassé depuis quelques semaines. Le sermon commentait certains aspects peu connus des sept péchés capitaux. Le jeune homme se reconnut surtout dans l’ira* des anciens. Il dut admettre que ses propres vertus théologales, telles que la foi, l’espérance ou la charité, étaient insuffi samment développées. Ses vertus cardinales étaient, en revanche, nettement plus aff ûtées : en particulier la force et la justice. La prière et la méditation durant la liturgie du soir avaient paradoxalement renforcé sa volonté et sa détermination à agir, à mettre en œuvre son plan cette nuit.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Philip Taramarcaz est né en 1964 et exerce comme médecin à Genève.
Comme des Mohicans est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
La colère
La température de cette fin de journée du début du mois de juillet 1874 était étouffante. L’altitude du col ne semblait pas avoir d’emprise sur la canicule qui sévissait depuis quelques jours. Une brise légère, un vent thermique de début de soirée venait heureusement de se lever. Le parfum des prairies en fleur embaumait l’atmosphère, l’orage estival menaçait. Les crêtes nappées de neiges éternelles se dressaient vers le ciel.
Les cloches annonçaient les vêpres et officialisaient la clôture de la journée d’étude.
– Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, initia le prêtre.
– Ainsi soit-il, murmura l’assemblée, composée d’une vingtaine de moines.
Un jeune homme de quinze ans, à la chevelure châtain, cachait sa corpulence fine et élancée dans le confort apparent de sa soutane noire. Il écoutait distraitement le sermon du prieur. Une colère froide et enténébrée l’avait terrassé depuis quelques semaines. Le sermon commentait certains aspects peu connus des sept péchés capitaux. Le jeune homme se reconnut surtout dans l’ira* des anciens. Il dut admettre que ses propres vertus théologales, telles que la foi, l’espérance ou la charité, étaient insuffisamment développées. Ses vertus cardinales étaient, en revanche, nettement plus affûtées : en particulier la force et la justice. La prière et la méditation durant la liturgie du soir avaient paradoxalement renforcé sa volonté et sa détermination à agir, à mettre en œuvre son plan cette nuit.
L’aiguillon de l’iniquité le faisait particulièrement souffrir. Pour pouvoir résister et faire front, l’action radicale était la seule route vers la liberté. L’adolescent venait d’engager un pugilat entre sa bonne et sa mauvaise conscience qui se confondaient pour mieux le troubler.
La colère, qui l’habitait depuis quelques semaines, camouflait gauchement un sentiment de culpabilité, composé de bribes d’humiliation, de honte et de dégoût. Une colère épaisse comme contrepoids, comme protection contre une innommable trahison.
La célébration touchait à son épilogue, alors que l’hostie pâteuse finissait de fondre sur son palais.
– Amen, allez dans la paix, mes frères.
Au sortir de la crypte, le fumet de la soupe aux orties, assaisonnée à la viande sèche, caressait les narines des membres de la communauté. Le chant du carillon confirmait l’imminence du souper.
– Séraphin, viens t’asseoir à ma table, maugréa Gabriel, un novice rondouillard et rêveur, de sa voix terne et nasillarde. Le ton était déterminé et l’esquive impossible.
Six autres novices complétaient la tablée qui restait silencieuse au fond du réfectoire, comme le voulait la règle. Le bruit des lapements de soupe et de la mastication du pain de seigle durci, ainsi que les grincements du bois des tabourets, couvraient le silence pesant qui planait sur le réfectoire. Seul Gabriel n’avait rien mangé ; son appétit déclinait ces dernières semaines. Était-il malade de ses viscères ou souffrait-il du mal des montagnes ?
* Les mots et expressions suivis d’un astérisque sont expliqués dans le lexique figurant en fin de volume.
La soumission
Gabriel et Séraphin étaient des amis d’enfance et avaient partagé les bancs de l’école en plaine. Ils habitaient des villages voisins avant de se retrouver sur le col. Malgré leurs tempérament et physique si disparates, les deux camarades se soutenaient indéfectiblement lors des différents incidents qui pouvaient émailler la rude existence montagnarde et communautaire qu’ils menaient. Gabriel était un garçon intelligent et sensible, mais sa gaucherie et son physique potelé le desservaient à maints égards. Il était aussi résigné et soumis à l’ordre établi que Séraphin était aventurier et révolté face à la partialité.
Le caractère de Gabriel s’était profondément modifié ces dernières semaines et Séraphin était rempli d’une inquiétude sincère pour son ami. Sa bonhomie et son esprit badin avaient fait place à une humeur sombre et renfrognée.
Les deux amis se retrouvèrent dans la cellule de Gabriel après le souper, durant le temps de récréation. Gabriel essaya encore une fois de dissuader son ami d’agir et, finalement résigné, baissa les bras devant sa détermination sans faille. Gabriel l’aida machinalement à préparer quelques effets et lui donna une pomme ; il replongea instantanément dans cet état de rêverie qui l’accaparait si souvent.
La cloche carillonna à vingt heures trente, pour l’appel à la prière du soir et à la lecture de la méditation du lendemain. Sur le pas de la porte de sa cellule, alors qu’ils se mettaient en route pour rejoindre la crypte, Gabriel murmura d’une voix presque éteinte :
– Sois prudent, Séraphin, et bonne chance ; ne m’oublie pas, je t’en conjure, ne m’oublie pas !
– Bien sûr, rétorqua ce dernier, ému et inquiet. Je sais ce que je fais. Et toi mon ami, retrouve ton entrain.
La tiédeur était revenue avec le coucher du soleil et il faisait bon dans la crypte. Toute la congrégation était soulagée par cette baisse de température qui annonçait une nuit agréable et un sommeil serein. Cette nuit étoilée allait être fraîche en altitude.
– Qui aime Dieu pardonne comme Dieu ! L’amour corrige et pardonne ! Luc chapitre 18, versets un à six, récitait solennellement le prieur.
Comme chaque soir, la méditation se terminait par une résolution qui ne fit pas tout à fait l’affaire, ni de Gabriel ni de Séraphin. Ils répétèrent à voix basse, à la suite du prieur et de toute la communauté :
– Je ferai un examen de conscience pour voir s’il n’y a pas quelqu’un à qui je n’ai pas pardonné. Dans ce cas, je pardonnerai à cette personne avec l’aide de Dieu. Amen.
À la sortie de la crypte, Gabriel jeta un regard mélancolique et suppliant en direction de Séraphin, alors que novices et chanoines allaient se coucher dans leur cellule, dont ils ne ressortiraient que le lendemain à cinq heures, pour la célébration des matines.
La congrégation
Le prieur Jean-Marie Salix finissait son examen de conscience. En enroulant son corps émacié par six décennies de pénitence dans un drap de chanvre rugueux, il loua encore une fois le Seigneur pour les bienfaits de cette journée. Il pensa aussi à l’arrivée, il y avait presque deux ans, des quatre nouveaux novices, qui avaient amené de la joie et une nouvelle vitalité au sein de la communauté, ancrée sur ce col depuis près de septante ans par la volonté de Dieu et par l’ordre de Napoléon. Il était parfois saisi d’un vertige lorsqu’il prenait conscience que la congrégation demeurait sans interruption, depuis près d’un millénaire, sur l’autre col, pour offrir l’hospitalité et venir en aide aux voyageurs…
La chaleur humaine était la pierre angulaire de l’harmonie de cet hospice ; les anciens la prodiguaient chacun à leur manière, en fonction de leur caractère et de leur entregent.
Le tempérament flegmatique du prieur était une grande force pour guider les âmes si diverses de cette communauté. C’est en tout cas ce qu’il croyait. Il détestait le conflit et les prises de décision. Il compensait gauchement son indécision chronique par une façade sévère et rigide, surtout à l’attention des novices.
Lorsque le prieur prenait la parole en chaire, il grattait systématiquement son crâne chauve, mal à l’aise dans son corps et dans sa fonction.
Le noviciat était une manière formidable de voyager à travers le vaste monde des hommes, en étant paradoxalement hors du monde, sur cette montagne inhospitalière. Le prieur en était intimement persuadé. L’exotisme de l’Orient se déplaçait en Valais ! Salix aimait rappeler aux novices que le don de soi, ici au col, permettait d’approfondir son cheminement intime vers Dieu. Il était presque convaincant, lorsqu’il affirmait qu’il suffisait de servir les pèlerins et les voyageurs avec humilité et charité, pour que l’abondance divine se manifeste sous les formes les plus inattendues. Tenter de suivre la trace humble de Jésus-Christ, le fils de Dieu fait homme !
Il se remémora un épisode désagréable, où il avait dû sévèrement intervenir le mois passé. Séraphin, qui était pourtant un novice apprécié, doté d’une intelligence affûtée et d’une belle vivacité d’esprit, donnait malheureusement trop souvent son avis lors du service aux pèlerins-voyageurs. Un commerçant bourguignon, transitant par l’hospice à la fin du mois de juin, l’avait adoubé, d’une tape sur l’épaule, de l’épithète de libre-penseur. Le prieur avait très mal pris cet éloge dédié à son novice, qu’il jugeait insidieusement connoté par l’esprit laïque révolutionnaire.
Séraphin avait été ébranlé par l’incompréhension que cette remarque du négociant français, a priori pleine de sympathie, avait déclenchée au sein de la communauté. En fait, il ne se considérait pas du tout comme un libre-penseur, mais seulement comme un étudiant en humanités classiques.
Les pensées du prieur flottèrent ensuite pleines de reconnaissance, en direction du joyeux chanoine Betuloz, l’aîné de l’hospice et père maître des postulants et novices, qui prenait son enseignement de rhétorique, de grammaire, de latin et de grec très au sérieux. Il passa ensuite en revue toute sa congrégation avec gratitude. Le chanoine Duchêne, le clavandier bedonnant, qui savait transformer une maigre pitance en un plat revigorant. Le chanoine Vernelaid, récemment arrivé en provenance du Chablais, toujours discret et secret, mais qui s’occupait merveilleusement des trois chiens saint-bernard. L’érudit chanoine Meslarzes, enseignant passionnant de botanique, d’entomologie et de géologie. L’incontournable chanoine Auguste Tilliaz, économe d’une efficacité redoutable, sans qui la cohabitation entre les laïcs de passage et la congrégation ne se ferait pas aussi harmonieusement. Il savait qu’il pouvait aussi compter sur quelques oblats et employés pour gérer les passages des gros contingents de voyageurs.
Tous les hommes et femmes qui transitaient de ou vers la Lombardie chantaient les louanges de cette hospitalité, unique au monde ; à plus de deux mille mètres d’altitude. D’ailleurs, nombre de riches commerçants et de nobles personnalités avaient légué des avoirs considérables à la congrégation. C’était chaque fois avec fierté que le prieur faisait admirer le petit trésor de l’hospice aux voyageurs ; tout en expliquant que le vrai trésor était à la maison mère, sur l’autre col, où tout était bien plus somptueux qu’ici.
Il s’endormit, satisfait de constater, une fois de plus, que tout allait pour le mieux.
Les préparatifs
Séraphin n’aurait pas pu décrire et circonscrire cette gêne, cet aiguillon planté en permanence dans son cœur. Elle lui donnait si souvent l’envie d’être ailleurs, en particulier en plaine, dans la chaleur et le réconfort du foyer familial.
Il se coucha tout habillé sous les couvertures et veilla fébrilement jusqu’à minuit. Il repassa en boucle le fil de sa vie, durant les trois heures qu’il devait tuer. Son engagement pseudo-volontaire dans la congrégation, pour faire plaisir à ses parents ; la déchirure de quitter ses sœurs, sa mère et son père à treize ans ; l’odeur de sa mère lorsqu’elle l’avait enlacé pour la dernière fois, il y avait déjà deux ans ; le départ en calèche du village, qui ressemblait à l’exil ; le transit par la ville du haut, où plus personne ne parlait le français ni le patois de son village ; l’arrivée au col avec la rigueur de la règle monastique et de la haute altitude ; la sévérité du prieur ; ses doutes sur sa foi ; les regards graveleux et insistants du chanoine Vernelaid. Il se remémora également les moments de bonheur et de joie avec gratitude. Le plaisir de l’étude, en particulier des humanités, de l’entomologie et de la botanique où il excellait ; l’espièglerie du clavandier ; le réconfort et le soutien indéfectible de son professeur de latin et père maître. Le chanoine Betuloz avait dépassé les septante ans et officiait comme père spirituel à l’hospice. Séraphin sentait que le père maître mettait sa foi à l’épreuve, par des questions sans réponses qui en appelaient d’autres, qui se révélaient tout aussi énigmatiques. Il l’avait aussi abreuvé de lectures sélectionnées, presque pour le dissuader de s’engager dans le noviciat. C’était en tout cas l’interprétation que le jeune homme préférait. Betuloz lui avait en particulier offert un livre de Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans. L’ecclésiastique avait reçu cet ouvrage des propres mains de l’écrivain américain, lors de son passage au col en 1832. Séraphin avait lu et relu ce roman d’aventures tant de fois ! Le père maître avait probablement, sans le vouloir, contribué à ce qui allait survenir sous peu.
Il se rappela également l’ascension de plusieurs cimes, dont le Monte Leone, et de sa passion naissante pour la montagne. Il était fasciné par ces alpinistes étrangers qui avaient déjà vaincu presque tous les quatre mille des Alpes. Il se souvint également de tous ces récits envoûtants de voyageurs qui s’arrêtaient au col. Il se remémora enfin la belle camaraderie qui régnait entre postulants et novices, que ce soit avec Gabriel, mais aussi avec Jean-Marie d’Évolène, Hubert de Sion, François-Xavier du Châble, Léonce de Liddes ou Étienne de Praz-de-Fort.
Le calme qui envahissait l’hospice n’était qu’apparent. Une musique à peine perceptible, douce et terrifiante, se dégageait de ce silence, pour celui qui scrutait la nuit et qui tremblait devant sa peur. Il devinait un chœur polyphonique de carillons éthérés et cristallins, ponctué par une rythmique peuplée de grincements et de froissements. Cette scansion était soutenue par le battement rapide et oppressant de son cœur, qu’il sentait vibrer dans sa poitrine.
Il fallait se ressaisir et se lever. Il s’assit au bord du lit et laça minutieusement ses chaussures de marche. Ensuite, il remplit son sac à dos de quelques victuailles et d’une gourde d’eau. Sa maigre subsistance était composée de la pomme de Gabriel, d’un bout de fromage d’alpage et d’un demi-pain de seigle. Il ajouta dans la poche supérieure du sac un briquet, un couteau de poche vénitien sculpté d’arabesques, et coinça sa veste en toile imperméable sous le rabat. Il laissa sa bible sur la table de sa cellule, mais glissa encore dans son paquetage le précieux cadeau du chanoine Betuloz : Le Dernier des Mohicans.
Le père maître
Le chanoine Gaston Betuloz comptabilisait bientôt cinquante ans d’apostolat au service de Dieu, des voyageurs et des novices. À septante-deux ans, il faisait office d’exception à l’hospice, car rares étaient les chanoines qui restaient en altitude après soixante ans. Il était, de plus, le dernier survivant de ceux qui avaient inauguré le nouvel hospice en 1832. Certains attribuaient sa forme et sa longévité à son amour de la philosophie antique, en particulier à sa vénération pour Épictète. En fait, il puisait son énergie vitale dans son rôle de père spirituel, qu’il prenait très au sérieux. Ce grand échalas, aux yeux bleu-vert, aux pommettes saillantes et à la longue barbe blanche, avait endossé comme mission de conduire chaque postulant vers sa destinée. Il aimait à dire que c’était un péché d’avoir un don et de ne pas l’utiliser, tout autant que de recevoir des guidances des hiérarchies célestes et de ne pas les écouter.
Assis sur sa couche, il lissait sa barbe en méditant sur cette journée et sur les dernières semaines. Il sentait que quelque chose d’indéfinissable, de pesant et de profondément refoulé menaçait l’harmonie de sa congrégation. Personne, ni les novices, ni les chanoines, ni les voyageurs, ni les pèlerins, non, personne n’aurait réussi à formuler le contour de cette étrange sensation. Cependant, il était difficile de ne pas noter que Gabriel était continuellement absorbé par ses pensées et que sa mémoire s’était métamorphosée en passoire. Il semblait se déconnecter progressivement de la communauté en s’enfermant dans une bulle de tristesse. Séraphin était devenu plus irritable et moins passionné par l’étude des humanités. Un mal des montagnes, peut-être ; un malaise communautaire, vraisemblablement ; un mal-être de solitude, indubitablement.
Pour ne pas porter de jugement hâtif, pour ne pas imaginer l’indicible, l’innommable ou l’impensable, il invoqua une fois de plus l’aide d’Épictète. Les propos et les anecdotes du grand philosophe grec le soulageaient souvent en cas de détresse. Il se plaisait à répéter certaines de ses citations en boucle et les laissait infuser dans son âme, comme s’il récitait le chapelet.
Cet esclave grec affranchi devenu stoïcien l’aidait simplement à mieux vivre sa vie, à relativiser ses afflictions, en particulier lorsque sa foi chrétienne vacillait.
« Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l’opinion que nous nous en faisons. »
Il finit par s’allonger sur son inconfortable couche. Il s’endormit tard avec une boule au ventre, sensation qui n’était pas de bon augure.
La fuite
Séraphin referma précautionneusement sa cellule et traversa l’hospice à pas de loup. Il entrouvrit la porte principale du monastère, dont il avait graissé les gonds quelques jours auparavant, et se fondit dans la nuit, après avoir minutieusement refermé derrière lui.
Le ciel était étoilé et un petit croissant de lune le contemplait. L’air était frais ; son corps tressaillit. Sans se retourner, il fonça droit vers la vallée du Rhône, par l’ancienne route Stockalper*, qui n’était plus guère fréquentée depuis la construction de la route napoléonienne. L’ancienne route suivait le fond de la vallée, en épousant les aspérités du terrain et en léchant les précipices. Elle était également plus courte de deux lieues*. Il s’enfuit de l’hospice du Simplon, le ventre noué, vers son nouveau destin. Le jeune homme arriva à proximité de Brigue au lever du jour, après avoir machinalement marché une bonne partie de la nuit, sans boire ni manger. Il n’avait rencontré âme qui vive. Ses seuls compagnons de route furent les crissements de ses pas, le chant limpide de la Saltine et les innombrables bruissements inquiétants de la nuit.
Le marcheur solitaire contemplait la crête des montagnes qui cloisonnent ce pays, alors que l’aube naissait enfin. L’étendue de la plaine rhodanienne se déployait en majesté sous son regard inquiet et émerveillé. Le fleuve occupait tout le fond de la vallée en zigzaguant d’un versant à l’autre. Il se divisait tantôt en plusieurs ramifications pour se réunir un peu plus loin en de larges bras qui enlaçaient une multitude d’îles, telles des maîtresses soumises aux désirs insatiables d’un amant capricieux. Les sinuosités, les divisions et les réunifications formaient un lacis aqueux aussi tentaculaire que spectaculaire. Le ravissement du Rhône indompté ! Adossé à l’écorce ravinée d’un vieux mélèze, Séraphin semblait calme et soulagé – état dans lequel se trouve une personne qui vient d’agir selon sa conscience et, de surcroît, contre l’ordre établi. Un instant de pure présence à soi et au monde, un instant à savourer avant le retour inévitable et impitoyable du balancier. Il reprenait en main les rênes de son destin, avalant de petites gorgées d’eau glacée, lapées dans le lit du torrent. Il tenta ensuite d’entrevoir son reflet dans une vasque sculptée dans le roc, en aval d’une modeste cascade. Il aperçut, entre deux brumisations, un visage d’adolescent habité d’un regard bleu incandescent, encadré par une chevelure drue, couleur d’écorce de mélèze.
Ce qu’il vit ou crut voir lui plut énormément. Il se reconnut serein et déterminé, comme quelqu’un qui trace son propre chemin, tel un peintre devant une toile encore vierge. Il avala encore quelques gorgées d’eau froide, pour fixer et avaliser cette vision.
Séraphin avait contourné les faubourgs de Brigue par les hauts. Il évoluait sur un sentier forestier qui suivait l’axe de la vallée à flanc de coteau.
L’urgence d’une transformation vestimentaire était devenue une obsession. Il fallait se débarrasser de l’habit sacerdotal, comme un évadé qui tenterait de jeter son costume de bagnard. Il ne faisait aucun doute qu’il serait renvoyé au col du Simplon par la première diligence postale, qui circulait deux fois par jour entre Brigue et Domodossola, s’il était repéré et rattrapé. L’adolescent était résolu à tout entreprendre pour ne pas subir l’humiliation et la punition du retour au col.
La ville de Brigue, visible du sentier, suintait l’opulence avec ses trois châteaux qui surplombaient la ville avec arrogance et qui étaient maintenant perceptibles, dans le jour naissant. Séraphin avançait furtivement, tel un Mohican sur la piste de son gibier. À la lisière d’un hameau qui trônait sur un alpage surplombant la ville, il identifia une fermette dont l’un des côtés était caché par l’épaisseur de la forêt de vernes, qui semblait intentionnellement non entretenue pour faire office de mur végétal. À l’embuscade derrière un muret de pierre, il put apercevoir le flanc sud de l’habitation, où des habits et du linge séchaient, étendus sur une cordelette de chanvre, dans une petite cour en terre battue. La multitude de vêtements qui pendaient suggérait, a priori, une famille nombreuse. Il identifia préalablement les effets qu’il convoitait. Les habits désirés flottaient avec indécence dans la brise matinale, tels de fiers drapeaux implorant qu’on daigne les enfiler. Lorsqu’il fut convaincu que la maisonnée était vide et que chacun vaquait à ses occupations quotidiennes aux champs, dans la forêt ou à l’alpage, il sauta souplement par-dessus le muret, sprinta jusqu’à la courette et arracha une chemise bleu roi en lin, ainsi qu’un pantalon beige en chanvre, muni de renforts en cuir sur le postérieur et les genoux. Il s’enfuit au petit trot avec la délicatesse d’un voleur patenté, son butin plaqué par son bras droit sur son ventre. Il courut sans se retourner pendant une dizaine de minutes sur le sentier forestier et enfin, après avoir enjambé un pont sur la Saltine, entreprit sa mue vestimentaire. Il prit le temps de se changer, caché derrière un chêne au large tronc, planté en contrebas du sentier, au bord du torrent. Il se déshabilla de la tête aux pieds et glissa en frissonnant dans une large vasque d’eau glacée. Ce bain purificateur le rendit presque joyeux. Le jeune homme laissa voluptueusement son corps s’engourdir dans l’eau qui devait avoisiner les huit degrés centigrades. Le chant du torrent l’emmena encore plus loin dans une rêverie légère où il n’était plus tout à fait Séraphin, mais un esprit dissous dans l’élément liquide. Il émergea de cet état de béatitude lorsqu’il réalisa qu’il ne sentait plus ses membres, qu’il claquait des dents et que sa peau était marbrée. Nu et grelottant sur une pierre plate, le jeune homme s’essuya en frictionnant son corps mince et élancé à l’aide de la soutane noire, avant de la jeter rageusement dans le lit du torrent. Le chapeau à bords relevés et l’écharpe blanche fendue connurent le même sort. Le chapeau flotta gaillardement dans le courant tumultueux du torrent, comme un frêle et téméraire esquif, abandonné à la furie des eaux. Il finit également par se faire engloutir par un tourbillon. Une grimace imperceptible était inscrite sur le candide visage de Séraphin, dont le front était précocement ciselé d’une double ride horizontale. Les nouveaux habits furent enfilés en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Le jeune homme souriait en pensant à la justesse du dicton qui affirme que l’habit ne fait pas le moine.
La correction
Un fermier au cou de taureau, avec de la bave mousseuse aux commissures des lèvres, hurlait en patois suisse allemand. Il transpirait abondamment, sentait la vinasse et tenait un large ceinturon dans sa pogne droite. Il s’apprêtait à punir une nouvelle fois son fainéant neveu, qui avait l’outrecuidance de lui demander un salaire, alors qu’il recevait le gîte et le couvert depuis presque deux ans. De plus, une brebis avait été blessée à mort par un chien errant, la semaine précédente, par la négligence de ce bâtard impertinent.
Un adolescent à torse nu se tenait debout dans la cuisine de la ferme, le regard baissé devant celui de son oncle qui distillait hargne et terreur. Son dos était musclé par le travail harassant de la ferme et sa peau était hâlée par le soleil de l’été. Mais son épiderme laissait aussi deviner d’anciennes cicatrices, comme si un artiste vénéneux lui avait tatoué des branches de sapin sur le dos. Lorsque son oncle fit siffler le ceinturon, le jeune homme sut, à la fraction de seconde, alors même qu’il étouffait un cri, que ce serait la dernière fois que son tortionnaire le fouetterait. Les six coups suivants ne firent que renforcer indéfectiblement cette conviction.
Lorsque le fermier fut satisfait de la peine infligée, il alla s’asseoir à la table de la cuisine, s’épongea le front du revers de la manche, puis agrippa le pichet de Dôle de Salquenen et se versa un nouveau godet à ras bord.
En se redressant, le jeune homme fit onduler ses cheveux noirs. Il n’y avait aucune larme dans ses yeux mordorés foncés, mais beaucoup de détermination et une haine implacable. Son large visage arborait un front bas, des pommettes saillantes et des lèvres charnues et crispées. Il appliqua sa main droite sur son dos endolori et contempla plein de rage sa paume ensanglantée. Sa grande bouche se tordait comme chaque fois qu’il était en souffrance ou en désaccord. Quelque chose avait pourtant profondément changé. Malgré la douleur, il se sentait apaisé, car il s’agissait de la dernière punition corporelle à subir. C’était plus qu’une espérance : c’était une certitude profonde.





























