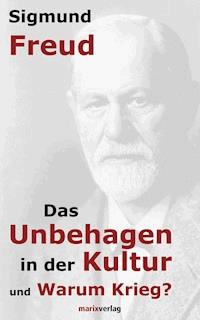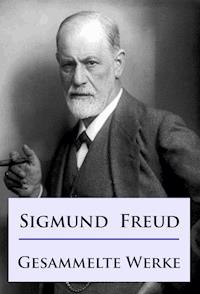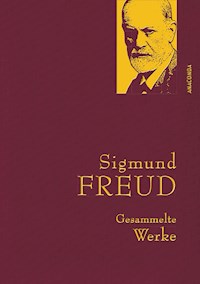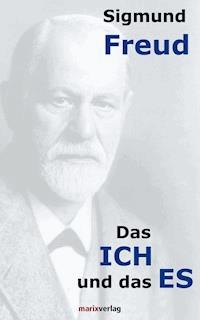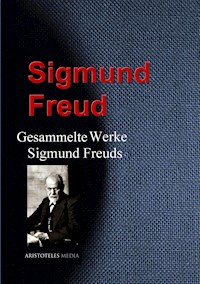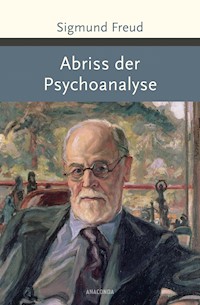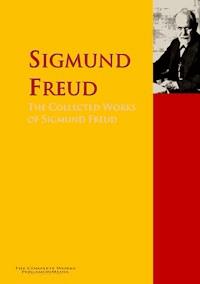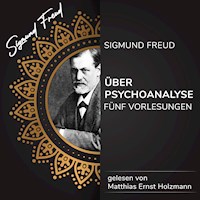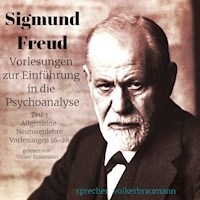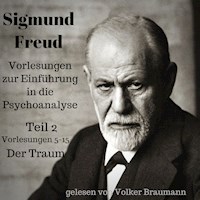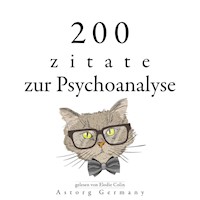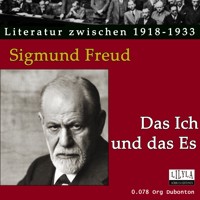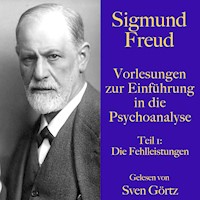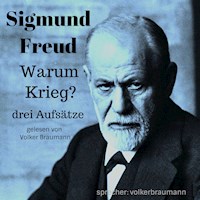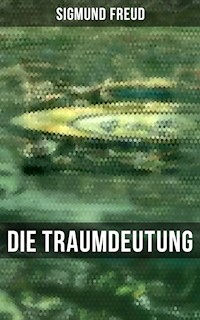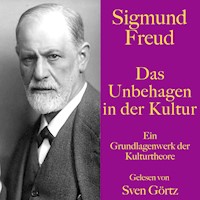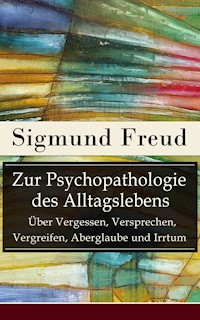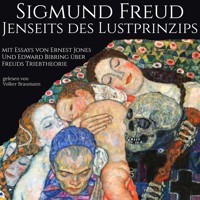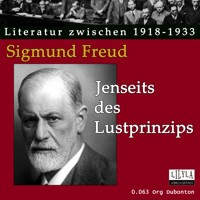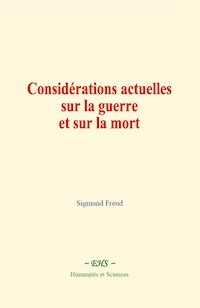
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Entraînés dans le tourbillon de ce temps de guerre, insuffisamment renseignés, sans un recul suffisant pour porter un jugement sur les grands changements qui se sont déjà accomplis ou sont en voie de s'accomplir, sans échappée sur l'avenir que se prépare, nous sommes incapables de comprendre la signification exacte des impressions qui nous assaillent, de nous rendre compte de la valeur des jugements que nous formulons. Il nous semble que jamais un événement n'a détruit autant de patrimoine précieux, commun à l'humanité, n'a porté un tel trouble dans les intelligences les plus claires, n'a aussi profondément abaissé ce qui était élevé. La science elle-même a perdu sa sereine impartialité ; ses serviteurs, exaspérés au plus haut degré, lui empruntent des armes, afin de pouvoir contribuer, à leur tour, à terrasser l'ennemi. L'anthropologiste cherche à prouver que l'adversaire appartient à une race inférieure et dégénérée ; le psychiatre diagnostique chez lui des troubles intellectuels et psychiques. Mais il est probable que nous subissons d'une façon trop intense les effets de ce qu'il y a de mauvais dans notre époque, ce qui nous enlève tout droit d'établir une comparaison avec d'autres époques que nous n'avons pas vécues et dont le mal ne nous a pas touchés.
L'individu, qui n'est pas combattant et ne forme pas un rouage de la gigantesque machine de guerre, se sent désemparé, désorienté, diminué au point de vue du rendement fonctionnel. Aussi acceptera-t-il sans doute avec empressement toute indication susceptible de l'aider, tant soit peu, à s'orienter dans ses idées et sentiments. Parmi les facteurs qu'on peut considérer comme les causes de la misère psychique des hommes de l'arrière et contre lesquels il leur est difficile de lutter, il en est deux que je me propose de faire ressortir et d'examiner ici : la déception causée par la guerre et la nouvelle attitude, qu'à l'exemple de toutes les autres guerres, elle nous impose à l'égard de la mort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort.
Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort
La guerre est une brute aveugle. On dit : « La science de la guerre ». Ce n’est pas vrai. Elle a beau avoir ses écoles, ses ministères, ses grands hommes, la guerre n’est pas une science ; c’est un hasard. La victoire, la plupart du temps, ne dépend ni du courage des soldats, ni du génie des généraux, elle dépend d’un homme, d’une compagnie, d’un régiment qui crie : « En avant ! » de même que la défaite ne dépend que d’un régiment, d’une compagnie, d’un seul homme qui aura, sans raison, poussé le cri de : « Sauve qui peut ! » Que deviennent les plans des stratèges, les combinaisons des états-majors, devant cette force plus forte que le canon, plus imprévue que le secret des tactiques ennemies : l’impression d’une foule, sa mobilité, sa nervosité, ses enthousiasmes subits ou ses affolements ? La plupart des batailles ont été gagnées, grâce à des fautes fortuites, à des ordres non exécutés ; elles ont été perdues par un entêtement dans la mise en œuvre de plans admirables et infaillibles...
(Octave Mirbeau, La guerre et l’homme).
1. La guerre et ses déceptions.
Entraînés dans le tourbillon de ce temps de guerre{1}, insuffisamment renseignés, sans un recul suffisant pour porter un jugement sur les grands changements qui se sont déjà accomplis ou sont en voie de s'accomplir, sans échappée sur l'avenir que se prépare, nous sommes incapables de comprendre la signification exacte des impressions qui nous assaillent, de nous rendre compte de la valeur des jugements que nous formulons. Il nous semble que jamais un événement n'a détruit autant de patrimoine précieux, commun à l'humanité, n'a porté un tel trouble dans les intelligences les plus claires, n'a aussi profondément abaissé ce qui était élevé. La science elle-même a perdu sa sereine impartialité ; ses serviteurs, exaspérés au plus haut degré, lui empruntent des armes, afin de pouvoir contribuer, à leur tour, à terrasser l'ennemi. L'anthropologiste cherche à prouver que l'adversaire appartient à une race inférieure et dégénérée ; le psychiatre diagnostique chez lui des troubles intellectuels et psychiques. Mais il est probable que nous subissons d'une façon trop intense les effets de ce qu'il y a de mauvais dans notre époque, ce qui nous enlève tout droit d'établir une comparaison avec d'autres époques que nous n'avons pas vécues et dont le mal ne nous a pas touchés.
L'individu, qui n'est pas combattant et ne forme pas un rouage de la gigantesque machine de guerre, se sent désemparé, désorienté, diminué au point de vue du rendement fonctionnel. Aussi acceptera-t-il sans doute avec empressement toute indication susceptible de l'aider, tant soit peu, à s'orienter dans ses idées et sentiments. Parmi les facteurs qu'on peut considérer comme les causes de la misère psychique des hommes de l'arrière et contre lesquels il leur est difficile de lutter, il en est deux que je me propose de faire ressortir et d'examiner ici : la déception causée par la guerre et la nouvelle attitude, qu'à l'exemple de toutes les autres guerres, elle nous impose à l'égard de la mort.
Lorsque je parle de déception, chacun devine sans peine ce que j'entends par ce mot. Sans être un apôtre de la pitié et tout en reconnaissant la nécessité biologique et psychologique de la souffrance pour l'économie de la vie humaine, on ne peut cependant s'empêcher de condamner la guerre dans ses fins et ses moyens et d'aspirer à la cessation des guerres. On se disait bien que les guerres ne pourront pas cesser, tant que les peuples vivront dans des conditions d'existence aussi différentes, tant que différeront aussi radicalement leurs critères d'appréciation des valeurs, en rapport avec la vie individuelle, et tant que les haines qui les séparent seront alimentées par des forces psychiques aussi profondes et intenses. On s'était donc habitué à l'idée que, pendant de nombreuses années encore, il y aurait des guerres entre peuples primitifs et peuples civilisés, entre des races séparées par des différences de couleur, voire entre certains petits peuples de l'Europe peu avancés ou en voie de régression. Mais on osait espérer que les grandes nations dominatrices de race blanche, auxquelles est échue la mission de guider le genre humain, qu'on savait absorbées par des intérêts s'étendant au monde entier, auxquelles on doit les progrès techniques leur ayant assuré la maîtrise de la nature, ainsi que tant de valeurs artistiques et scientifiques, il était permis d'espérer, disons-nous, que ces nations du moins sauraient vider leurs malentendus et leurs conflits d'intérêts autrement que par la guerre. Chacune de ces nations avait établi pour les individus qui la composent des normes morales élevées, auxquelles devaient se conformer dans leur vie tous ceux qui voulaient avoir leur part des biens de la civilisation. Ces prescriptions, d'une sévérité souvent excessive, exigeaient beaucoup de l'individu : un grand effort de limitation et de restriction, un renoncement à la satisfaction d'un grand nombre de ses instincts. Il lui était interdit avant tout de profiter des avantages extraordinaires que, dans la concurrence avec les semblables, on peut retirer de l'usage du mensonge et de la ruse. L’État cultivé voyait dans l'observance de ces normes morales la condition de son existence, il intervenait sans pitié toutes les fois qu'on osait y toucher, voyait même d'un mauvais œil ceux qui voulaient les soumettre à l'épreuve de la raison critique. On pouvait donc supposer qu'il était lui-même décidé à les respecter et à ne rien entreprendre contre elles, car ce faisant, il ne pouvait qu'ébranler les bases de son existence. On pouvait enfin admettre qu'au sein de ces grandes nations existaient, en formant une sorte d'enclave, certains restes ethniques qui, n'étant pas tout à fait désirables, n'étaient pas admis à prendre une part aussi active que le reste de la population au travail commun ou n'y étaient admis qu'à contre-cœur, bien qu'ils se fussent montrés suffisamment aptes à s'acquitter de ce travail. Mais, pensait-on, les grands peuples eux-mêmes doivent avoir acquis un sentiment suffisant de ce qui les unit et assez de tolérance pour ce qui les sépare, pour ne pas confondre, ainsi que le faisait encore l'antiquité classique, l'étranger avec « l'ennemi ».