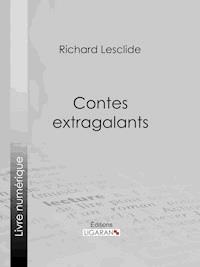
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Voici ce que Casanova raconte à moitié dans ses Mémoires : Je fus abordé, à la sortie de l'Opéra, par un jeune homme de bonne mine, le comte Poli, qui me dit que j'avais eu tort de passer deux mois à Mantoue sans aller voir le cabinet d'histoire naturelle de son père, Don Antonio de Capitani, commissaire du Canon."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Voici ce que Casanova raconte à moitié dans ses Mémoires :
Je fus abordé, à la sortie de l’Opéra, par un jeune homme de bonne mine, le comte Poli, qui me dit que j’avais eu tort de passer deux mois à Mantoue sans aller voir le cabinet d’histoire naturelle de son père, Don Antonio de Capitani, commissaire du Canon. Je m’excusai sur mon ignorance. Le jeune homme m’offrit poliment de venir me prendre le lendemain pour m’y conduire. J’acceptai avec reconnaissance, et nous nous quittâmes très bons amis.
Le lendemain, en effet, il me présenta à Don Antonio, qui me parut un original des plus bizarres. Les curiosités de son cabinet consistaient en livres de magie, reliques, médailles antédiluviennes, modèle de l’arche de Noé, fait d’après nature sur le mont Ararat, en Arménie, enfin, en un vieux couteau rouillé pour lequel il montrait une grande vénération. Il me confia que ce couteau était celui avec lequel saint Pierre avait coupé l’oreille de Malchus.
Comme je n’étais pas bien sûr qu’il ne se moquât pas de moi, j’essayai de me moquer de lui.
– Quoi ! dis-je, vous possédez cet objet et vous n’êtes pas millionnaire ?
– Comment le deviendrais-je avec ce couteau ?
– Tout naturellement, en le vendant au pape. Ignorez-vous que ce talisman vous rend maître de tous les trésors cachés dans les terres de l’Église ?
– Je l’ignorais ; je vous remercie de me l’apprendre. J’irai certainement voir le pape un de ces jours.
– Un moment ! fis-je, en voyant qu’il s’échauffait ; il ne faut pas seulement avoir le couteau, mais sa gaine.
– J’en ferai faire une.
Pas du tout ; il faut avoir la gaine authentique dans laquelle saint Pierre plaça le couteau, quand Dieu lui dit : Mitte gladium tuum in vaginam. Elle existe, je l’ai vue dernièrement. Le couteau ne vaut rien sans la gaine, ni la gaine sans le couteau.
– Où est cette gaine ?
– Chez un marchand du Transtevere qui en connaît la valeur et ne la donnerait pas pour moins de mille sequins.
– Combien vaut mon couteau alors ?
– Le même prix ; le marchand vous l’achètera sans doute.
– Je ne veux pas le vendre. Il est bien plus simple que je m’associe avec ce marchand ; nous partagerons tous deux les trésors que nous découvrirons.
– Impossible, dis-je ; la Kabbale du Magistère s’y oppose formellement ; la gaine et le couteau doivent appartenir à une seule et même personne.
– Ah ! fit le bon commissaire… – et vous croyez que votre marchand me donnerait mille sequins de mon couteau ?
– J’en suis si sûr que si vous en doutez, je vous les avancerai moi-même.
– Je demande à réfléchir.
Nous prîmes rendez-vous. Cette plaisanterie m’avait mis en gaieté ; je résolus de la pousser plus avant, sans trop savoir à quoi elle aboutirait.
Le lendemain j’allai dîner chez Don Antonio qui s’était mis en frais. Je tirai une bourse d’or de ma poche.
– Voici les mille sequins, dis-je ; où est le couteau ?
Le commissaire se récria, jurant qu’il ne l’avait pas vendu. La nuit avait porté conseil. Il connaissait un trésor de plusieurs millions, caché chez un de ses amis, lequel ferait toutes les dépenses nécessaires pour connaître l’endroit où il était enfoui. Seulement, cet ami n’avait pas d’argent comptant et ne voulait rien payer qu’après la découverte du trésor.
Ce mélange de défiance et de crédulité m’irrita ; l’affaire resta pendant plusieurs jours en suspens. J’offrais régulièrement à Don Antonio d’acheter son couteau ; il s’y refusait, mais n’avait pas de quoi payer la gaine. Je me vantai un jour, dans un accès de bavardage, d’avoir reçu cette fameuse gaine de Rome ; le père et le fils me tourmentèrent tant qu’il fallut la leur montrer. Un peu embarrassé d’abord, je rentrai chez moi et fis bouillir à grande eau, pendant plusieurs heures, une vieille semelle de botte. Quand elle fut amollie et gonflée, j’y pratiquai un trou suffisant pour recevoir le couteau, et, la frottant avec de l’ocre et du sable, la rognant, la polissant, je lui donnai une forme antique si saugrenue que je ne pouvais la regarder sans rire. C’est avec un saint respect que le commissaire du Canon approcha son couteau de l’étui. J’avais eu le coup d’œil juste ; le couteau et la gaine s’adaptaient admirablement ; les bonnes gens étaient émerveillées. Ils ne doutaient plus que je ne fusse un des plus grands magiciens du monde.
Cela fit avancer nos projets. L’ami dont la maison renfermait un trésor demeurait à Césène ; il fut convenu que le fils de Don Antonio m’accompagnerait chez lui, me présenterait, et conserverait le couteau jusqu’au moment où j’en aurais besoin pour accomplir les opérations magiques qui devaient mettre le trésor en notre possession.
En échange de mon intervention, le commissaire me signa une lettre de change de mille écus romains, payable après réussite. Le jour d’après je partis avec le jeune homme béni par son père, et tout lier du titre de « comte palatin » qui venait de lui être accordé.
Nous nous embarquâmes ; après avoir passé par Ferrare et Bologne, nous arrivâmes à Césène où l’on nous attendait. Mon compagnon me conduisit à un quart de mille de la ville, chez un riche paysan nommé Georges Franzia, qui n’était autre que l’homme au trésor. Franzia me reçut avec une grande déférence, ébloui par mon pouvoir surnaturel dont il ne doutait pas. Lejeune comte lui fit à ce sujet mille histoires merveilleuses. Le brave homme m’offrit cent sequins pour mes frais de voyage. Je les refusai noblement, ce qui le transporta d’admiration.
La famille Franzia se composait de trois personnes, une bonne femme de mère, une très jolie fille nommée Javotte, et un garçon tout jeune à peu près idiot. La ferme était considérable ; trois ou quatre servantes faisaient le ménage de la maison.
Je me rapprochai naturellement de Javotte ; il fallait bien que mon métier de sorcier me rapportât quelque chose. Je lui dis qu’elle ne devait pas avoir moins de dix-huit ans. D’un air moitié sérieux, moitié piqué, elle me répondit que je me trompais, et qu’elle n’en avait que quatorze.
– Quatorze ! m’écriai-je, vous n’êtes alors qu’une enfant ! Et je la pris sur mes genoux sans qu’elle osât résister.
Le soir, après le souper, les femmes sortirent, et nous parlâmes affaires. Nous convînmes que Franzia aurait le premier quart du trésor, Don Antonio le second quart ; le reste me serait acquis. On oublia complètement le saint-père et même saint Pierre, malgré le couteau qu’il nous fournissait.
Ces points importants réglés, on passa aux détails de l’opération. J’avoue que l’aimable Javotte me troublait l’imagination autant que le vin du pays. Quand une Italienne est femme à quatorze ans, c’est la plus charmante des femmes. Javotte, malgré son teint un peu hâlé, était un bouton de rose en pleine éclosion…
Je dis à mes auditeurs recueillis que j’avais besoin d’une chambre à deux lits pour moi seul, et d’une antichambre avec une baignoire neuve.
Dans ma chambre il devait y avoir trois tables, deux petites et une grande. Il était en outre indispensable qu’on me procurât une couturière de douze à vingt ans, d’une virginité parfaite et d’une complète discrétion. Je leur fis comprendre que le moindre bavardage pouvait donner l’éveil à l’Inquisition, et que malgré l’innocence de notre conjuration, les Pères commenceraient par s’emparer du trésor d’abord, et de notre personne ensuite.
On comprit la gravité de ma recommandation. Georges Franzia s’engagea au secret le plus absolu pour lui et sa famille.
– Je viendrai loger chez vous dès demain, lui dis-je ; je ferai deux repas par jour, un le matin à dix heures, l’autre le soir à six. Je ne puis boire à mes repas que du vin de Jévèze, et du meilleur. Vous aurez en réserve trois torches et cent bougies. Assurez-vous d’un commissionnaire sûr pour apporter ici mes effets. Comme vous avez fait rouir du chanvre qui sent mauvais, vous purifierez l’air de la maison avec de la poudre à canon. Si mon entreprise manque, ce qu’à Dieu ne plaise, je vous paierai la dépense que j’aurai faite chez vous.
Le lendemain j’étais établi à la ferme de Franzia, qui nous servit un déjeuner splendide. Je l’en blâmai.
– Pas d’avarice, lui dis-je, mais pas de profusion ; toutes les exagérations déplaisent aux esprits dont la bienveillance nous est utile.
Le soir, Franzia et sa bonne femme vinrent me dire qu’ils croyaient avoir trouvé la couturière que j’avais demandée. C’était tout bonnement la petite Javotte ; la mère en répondait absolument. Je ne pus m’empêcher d’admirer les voies de la Providence, qui plaçait ainsi sous notre main la créature qui nous était nécessaire. J’en fis mes compliments à madame Franzia.
– Maintenant, dis-je au paysan, voulez-vous me dire ce qui vous a fait croire que vous aviez un trésor chez vous ?
– Dame ! répondit-il, c’est un secret de famille qui passe chez nous de père en fils depuis plus de deux cents ans. Ensuite des bruits souterrains se font entendre sous les fondations de notre maison à certaines grandes fêtes ; ce sont comme des coups qu’on frappe à de longs intervalles. Enfin, ces jours-là, la porte de notre cave s’ouvre et se referme seule toutes les trois ou quatre minutes, et il y a des flammes, pendant les nuits d’orage, qui dansent autour de l’habitation.
Quoique je fisse la part des exagérations et des superstitions rustiques, ces confidences ne laissèrent pas de m’émouvoir. Les gens de la ferme me confirmèrent le discours de Franzia.
– Si ce que vous dites est vrai, fis-je, il est évident que vous avez un trésor caché dans votre maison. Gardez-vous bien de verrouiller ou d’assujettir cette porte mystérieuse qui s’ouvre et se ferme d’elle-même ; il vous en arriverait malheur. Les esprits ne font rien sans motif et n’aiment pas qu’on les contrarie.
– Monsieur, dit Franzia, un savant que mon père a fait venir, il y a quarante ans, lui a dit justement la même chose. Ce magicien n’avait plus que trois jours à attendre pour avoir le trésor, quand l’Inquisition vint l’arrêter. Comment se fait-il que l’Inquisition soit plus forte que la Magie ?
– C’est qu’elle est bien mieux que les magiciens avec le diable, répondis-je, mais ce sont des choses dont il vaut mieux ne pas parler. Faites apporter un seau d’eau, et appelez les enfants.
Javotte arriva avec son frère, et je jugeai à propos de faire quelque chose de magique dès le premier soir. Je couvris le seau d’eau de bénédictions et d’exorcismes ; puis, y trempant une serviette, je priai Franzia de se déshabiller complètement jusqu’à la ceinture, et je lui lavai la poitrine de cette eau bénite. Après quoi, je l’envoyai faire des prières dans un coin.
Je passai ensuite à la mère, et j’en eus quelque ennui. Quoiqu’elle n’eut pas plus de trente ans, madame Franzia avait nourri ses enfants et m’étala des cascades de chair peu appétissantes. Je ne laissai pas de la purifier comme son mari, remarquant que Javotte s’étonnait de cette cérémonie, à laquelle elle ne se serait pas prêtée, sans l’exemple qu’on lui donnait.
J’expédiai le petit frère assez vite et passai ensuite à la jeune fille, qui rougit jusqu’au blanc des yeux en m’étalant le plus beau corsage de vierge qu’il soit possible de voir. C’était blanc, ferme, solide, palpitant. Elle n’osait rien dire pendant que je la lavais avec une rare complaisance, mais elle était rouge comme du feu.
Je ne lui permis pas de s’habiller avant quelques autres petites cérémonies, notamment avant de lui avoir fait jurer qu’elle était sage, et pour qu’il n’y eût aucun malentendu à ce sujet, je lui expliquai devant ses parents ce que signifiait ce mot, prenant à cela un plaisir pervers. Elle le jura de bon cœur et même avec une certaine fierté. Je terminai cette séance en embrassant mes paysans sur la bouche, – toujours pour en arriver à Javotte, dont les lèvres roses me causèrent un désagrément imprévu…
– Comment, malheureuse ! lui dis-je, tu as mangé de l’ail ?
– Oui, répondit-elle, est-ce qu’il ne faut pas en manger ?
– Jamais !
– Il n’y en aura plus dans la maison, dit le père.
Je congédiai la famille et me couchai, le sang échauffé par ces belles opérations. Je fis une toilette un peu longue, me baignai la tête d’eau froide et me glissai dans mes draps. J’avais à peine posé ma tête sur l’oreiller que des coups sourds et terribles, qui semblaient venir d’une profondeur inouïe, ébranlèrent la maison. On entendait en même temps un battement de portes dans le sous-sol.
Je me levai, tout pâle. – Qui me prouvait qu’il n’y avait pas un trésor dans cette maison ? Qui me prouvait que le couteau du commissaire n’était pas un couteau magique ?… Avais-je prophétisé juste sans le savoir ?…
Il est des choses qu’il ne faut pas approfondir. Je restai plusieurs heures comme une âme en peine, essayant de calmer mes nerfs que j’avais imprudemment excités. Je finis par m’endormir en pensant à Javotte.
C’était vraiment une très agréable fille, avec de beaux cheveux blonds qui s’accordaient à son teint un peu coloré. Elle avait des dents admirables et la lèvre inférieure un peu saillante, comme si elle eût été faite pour recevoir des baisers. Sa gorge, bien située, était d’une résistance à l’épreuve ; au demeurant, c’était un merveilleux morceau d’ensemble, sans tempérament encore et ne faisant pas grand état de sa beauté. Je n’espérais pas la rendre amoureuse, mais je croyais pouvoir compter sur son obéissance.
Les précautions que je prenais pour arriver à mon but, sous prétexte de magie, n’étaient ni inutiles ni exagérées. Les bons Italiens, si crédules aux miracles et aux couteaux de saint Pierre, sont plus futés quand il s’agit d’amour et de galanterie. La mère Franzia s’était émue en me voyant prendre avec Javotte les libertés dont j’ai parlé. Mais la cupidité et la volonté de son mari l’avaient emporté sur ses scrupules.
J’avais pu juger mes hôtes. Aller trop vite, c’était tout perdre. Je déclarai le lendemain que toutes les personnes de la famille souperaient avec moi, l’une après l’autre et par rang d’âge. Une heure avant le repas, mon convive devait entrer dans une baignoire que j’avais fait placer dans mon antichambre, pour être purifié par moi des pieds à la tête.
Sans doute il était peu ragoûtant de nettoyer ainsi le fermier, la fermière et leur benêt de fils, mais il fallait arriver à Javotte par une route prudente.
J’ordonnai en outre à Franzia d’aller à Césène acheter trente aunes de toile blanche, du fil, des ciseaux, des aiguilles, du storax, de la myrrhe, du soufre, de l’huile d’olive, du camphre, une rame de papier, des plumes, de l’encre, douze feuilles de parchemin, des pinceaux, des couleurs et un bâton d’olivier, sans rien marchander.
Comme le jeune comte Poli m’incommodait et paraissait prendre à mes conjurations un intérêt tout particulier, surtout lorsqu’il s’agissait de Javotte, je lui donnai la mission d’aller passer ses journées à la ville, au Grand-Café, et d’y recueillir soigneusement tout ce qui s’y dirait pour me le rapporter.
Franzia revint avec ses achats. – Je n’ai pas marchandé, dit-il, et j’ai payé les choses un tiers au-dessus de leur valeur.
– Tant mieux, répondis-je ; envoyez-moi maintenant Javotte, et laissez-moi seul avec elle.
Dès qu’elle fut venue, je lui fis couper la toile en sept morceaux, pour fabriquer la robe nécessaire à notre comédie.
– Asseyez-vous auprès de mon lit, lui dis-je ; vous coudrez toute la journée et ne partirez qu’à l’heure du repas.
Je soupai le premier soir avec le père, puis avec la mère, puis avec le fils, faisant auparavant l’office de garçon baigneur, les grisant de vin de Jévèze, et attendant impatiemment le jour où Javotte me paierait de toutes ces corvées.
– Allez, Javotte, lui dis-je gravement quand l’heure fut venue, allez vous mettre au bain ; vous m’appellerez quand vous y serez, et je procéderai à votre purification.
Il me parut que cela faisait faire une sorte de grimace à notre comte palatin, mais je ne m’en inquiétai pas, car il montrait une grande docilité et s’éloignait quand je le trouvais gênant.
Un quart d’heure après Javotte m’appela. C’était bien la plus charmante fille qu’on pût voir, des pieds à la tête, et je vous prie de croire qu’elle se baignait sans camisole et sans peignoir. Le métier que je faisais en la savonnant du haut en bas avait ses agréments et ses souffrances, car je m’étais promis de ne pas me trahir. Je tournais et retournais la pauvre fille avec un grand sérieux, levant quelquefois les yeux au ciel pour le prendre à témoin de ma sagesse.
La belle enfant était d’une obéissance parfaite, si parfaite qu’elle me causa des tentations auxquelles je faillis ne pas résister. Enfin, avec la grâce d’en haut, je sortis vainqueur de cette redoutable épreuve, et me sauvai dans ma chambre, n’ayant pas la force d’aider la jolie paysanne à s’habiller.
Sa toilette ne fut pas longue, car les jours de bain je faisais jeûner mes convives du matin au soir ; la petite mourait de faim. Elle me rejoignit à table, mangea avec un appétit dévorant, et le vin de Jévèze, qu’elle but comme de l’eau, lui donna les plus belles couleurs. Au dessert, elle battait la campagne…
– Ma chère Javotte, lui demandai-je, ce que nous avons fait t’a-t-il déplu ?
– Non, dit-elle, cela m’a plutôt fait plaisir.
– Alors, tu voudras bien me rendre le même service ?
– Volontiers, seigneur, mais je ne saurai pas peut-être…
– Je t’instruirai ; – à partir de ce moment tu coucheras toutes les nuits dans ma chambre ; je ne veux m’en rapporter qu’à moi du soin de veiller sur ta virginité.
– Je le veux bien, dit-elle.
De ce jour, Javotte prit avec moi une contenance plus assurée ; sa gêne disparut rapidement ; elle me regardait en souriant d’un air d’intelligence. L’esprit lui venait évidemment, et ces étranges opérations commençaient à l’émouvoir. Je lui défendis d’en parler au jeune Poli qui paraissait s’intéresser très fort à notre expérience.
Le lendemain – chaque jour son œuvre – Javotte vint me frotter et m’éponger dans le bain où je me plongeai à mon tour.
Elle y mit le plus doux zèle et toute la bonté de cœur dont elle était capable. Nous nous regardions parfois d’un air singulier, et j’estime avoir montré une grande force de caractère en ne franchissant pas la limite que je m’étais imposée.
Javotte vint désormais occuper le second lit dressé près du mien ; elle soupa tous les jours avec moi. Elle fut du moins censée occuper ce second lit, mais un soir qu’elle se déshabillait sans façon, sachant qu’elle n’avait rien d’inconnu à me montrer elle tourna la tête et me dit avec une adorable naïveté :
– Est-ce que nous gâterions la conjuration si nous couchions ensemble ?
– Non, ma chère Javotte, au contraire ; il suffit que tu restes sage.
– Eh ! dit-elle, vous veillerez de bien plus près sur ma vertu si je couche avec vous.
Je ne pus en disconvenir.
– Est-ce qu’il est défendu de s’embrasser ? reprit Javotte.
– Non, ma mignonne ; il n’y a qu’un point, tu le sais, qui nous soit défendu.
Il ne convient pas que je dévoile le mystère de nos nuits, mais j’affirme que cet ange, qui faisait couler du feu dans mes veines, sortit vierge de mes bras.
Le comte palatin, que je n’avais pu renvoyer tout à fait de la ferme, paraissait fort inquiet. Javotte lui parlait peu ; il ne la regardait qu’avec timidité.
Cependant le jour de la grande opération approchait. Le surplis de toile blanche avait été orné par moi de figures et de caractères effroyables ; Franzia ne regardait pas ma robe sans trembler. Je m’étais fait une couronne de parchemin à sept pointes, sur laquelle couraient les sept planètes. Une ceinture constellée, une baguette magique, une étole impie complétaient mon costume diabolique. Mes hôtes n’osaient entrer dans ma chambre, dans laquelle je me livrais à des pratiques mystérieuses. La plus brave était Javotte, dont l’esprit s’ouvrait chaque jour davantage et dont l’œil m’interrogeait curieusement. Il est vrai que, lorsqu’elle arrivait, mes pratiques mystérieuses consistaient surtout à la couvrir de baisers.
Un jour que j’essayais ma tunique et que, pour la mieux voir, Javotte s’était placée sur mes genoux, le père Franzia m’appela d’une voix épouvantée… Je quittai ma robe et le rejoignis. La maison était en proie aux phénomènes bizarres que j’ai cités. Des grondements sinistres retentissaient sous le sol comme un orage souterrain ; des coups affreux s’y mêlaient. Leur bruit ressemblait à celui que produirait un énorme pilon frappant vigoureusement un mortier de bronze. Je pris deux pistolets chargés et une lanterne ; je descendis à la cave. Je vis la porte s’ouvrir lentement et une minute après se refermer avec violence. Personne n’était là ; aucun courant d’air ne la poussait ; cela était inexplicable. En remontant, j’aperçus des ombres ayant forme humaine allant et venant çà et là ; des flammes s’allumaient dans la cour…
– Qu’avez-vous ? me dit Javotte ; qu’est-ce que cela peut vous faire puisque vous êtes magicien ? Pourquoi ne m’embrassez-vous plus comme tout à l’heure ?
L’envie m’en était passée.
La pleine lune arriva. Je l’avais désignée d’avance pour l’époque de notre grande conjuration, et, entre nous, pour le jour de la défaite de Javotte dont j’étais éperdument amoureux.
Comment je me tirerais d’affaire au sujet du trésor, je ne m’en inquiétais guère ; j’étais sorti de pas plus difficiles ; la crédulité des Franzia me rassurait. Le bon paysan disait lui-même que ce serait trop beau de réussir aussi vite. Le comte palatin me suppliait de ne pas me décourager, si quelque difficulté retardait notre succès. Quant à Javotte, j’étais sûr de l’avoir pour alliée, grâce au rôle spécial que je lui donnais dans la cérémonie. Le trésor était douteux, la fille ne pouvait me manquer.
J’ajoute que j’avais pris un intérêt réel au jeu que j’avais imaginé. Personne ne doutant de mon pouvoir, je commençais à y croire moi-même. Je ne discute pas cette aberration de l’esprit humain, je la constate. Elle devait m’entraîner plus loin que je ne pensais.
Le jour solennel venu, je dessinai à grands traits un CERCLE MAXIME sur de larges feuilles de papier cousues par Javotte. Mon travail de nécromant consistait à forcer les esprits de la terre, gnomes ou kobolds, à soulever jusqu’à la surface du sol le trésor enfoui dans ses profondeurs. Mon cercle n’avait pas moins de trente pieds de circonférence ; il fut placé dans la cour de la ferme dont les domestiques avaient été éloignés. Je l’avais couvert de figures abominables, extraites de livres de sorcellerie auxquels pourtant j’ajoutais peu de foi. Le Pentacle, la Poule noire, le Triangle, le Tétragrammaton y figuraient ; ce salmigondis cabalistique avait l’air le plus farouche du monde. Mes paysans le considéraient avec terreur, et, puisque je suis décidé à dire toute la vérité, j’avoue que j’étais moi-même troublé par mon ouvrage. Mille circonstances, qui ne m’eussent pas préoccupé dans un autre moment, semblaient se réunir pour me faire perdre mon sang-froid ; elles donnaient je ne sais quel aspect lugubre à une plaisanterie qui commençait à me peser.
La plus brave dans cette affaire était ma petite Javotte ; elle traversait la situation avec une assurance parfaite, soit qu’elle fût réellement courageuse, soit que ma protection la rassurât.
Je ne lui avais pourtant pas caché le sort qui l’attendait. Le dernier mot de la conjuration devait être dit dans mon lit, après les évocations du dehors, et la conquête du trésor dépendait en grande partie de l’héroïsme avec lequel elle cesserait d’être fille.
Ses bons parents, que je mêlais effrontément à tout cela, savaient que nous disparaîtrions au moment solennel. Pour Javotte, le vin de Jévèze et les caresses que nous échangions lui avaient absolument formé le caractère. Elle se promettait de m’étonner.
Le comte palatin était profondément soucieux. Il aspirait au trésor, mais tournait beaucoup trop autour de Javotte.
L’heure arriva. Le temps était douteux ; de gros nuages passaient devant la lune. La nuit tiède, l’atmosphère lourde, me parurent pourtant favorables. La famille Franzia et le comte Poli se placèrent à la fenêtre d’une grange, d’où ils pouvaient observer toute la cérémonie sans me déranger.
Javotte prit le soin de me revêtir de la robe magique, œuvre de sa main virginale. Je me couvris d’ornements sacrés ; je me coiffai de ma couronne à pointes dorées, – et une baguette d’olivier dans une main, le couteau de Malchus dans l’autre, je pénétrai dans le cercle maxime, après en avoir fait trois fois le tour.
Je m’y agenouillai et saluai les quatre points cardinaux, le Zénith et le Nadir. Je commençai d’une voix sourde à réciter les formules magiques qui devaient me soumettre les esprits : – ABRACADABRA ! EMEN-HÉTAN ! EMEN-HÉTAN ! ! EMEN-HÉTAN ! ! ! Les spectateurs de la conjuration, accrochés à leur fenêtre, serrés l’un contre l’autre, me contemplaient avec épouvante. Au milieu de mon évocation, la lune se couvre de nuages sombres, l’obscurité m’enveloppe, un éclair incendie le ciel, et pendant qu’un grondement formidable annonce la foudre, je sens la terre trembler sous mes pieds !…
Rien de plus naturel qu’un orage ; un magicien habile eût assurément prévu celui qui nous menaçait et en eût tiré parti. Mais j’étais dans de fatales dispositions ; l’ouragan qui se déchaîna subitement me fit perdre le jugement et presque la raison. Les éclairs se succédaient sans intervalles. À leurs lueurs désordonnées, j’apercevais Franzia et le comte, les cheveux hérissés, croyant assister à une lutte entre leur magicien et les esprits infernaux.
La fermière et son fils avaient disparu. Les faces hagardes de mes deux spectateurs trahissaient une frayeur telle qu’elle devint contagieuse et s’empara de moi. La pluie ruisselait ; l’orage, à son paroxysme, se déchaînait à coups redoublés ; j’étais tombé sur mes talons, au centre de mon cercle magique, inondé, trempé, étourdi, ébloui… Une idée m’envahissait, je cherchais vainement à la repousser. Je supposais que les puissances surnaturelles, irritées de la parodie que je faisais de leurs mystères, réunissaient leurs vengeances contre moi. La peur, dans ce qu’elle a de plus hideux et de plus intense, m’étouffait sous son oppression. Il est certain que des illusions imprévues centuplaient ma terreur. Peut-être n’étaient-elles dues qu’au désordre de mes sens… J’entendais distinctement battre à grands coups la porte mystérieuse de la cave, et les roulements du tonnerre me paraissaient jaillir des entrailles de la terre. Le comte palatin et Franzia furent le jouet de la même illusion. En était-ce une ? Le temps qui se passa dans ces tortures physiques et morales me parut interminable. Je ne voudrais recommencer cette heure pour rien au monde.
Réfugié au centre de mon cercle, dont les figures grimaçaient sous le feu du ciel, j’étais plongé dans la boue, sans que l’idée me vînt de me lever et de me mettre à couvert. Oui, j’étais comme persuadé que ce cercle imbécile, fabriqué par moi-même, me protégeait contre la colère céleste.
Aussi, battu par l’averse, navré, trempé jusqu’aux os, aveuglé, pantelant, je n’en serais pas sorti pour un empire. Je me croyais voué à une expiation terrible, à une destruction prochaine, dont mon cercle seul me préservait. Aucun homme, je crois, n’a été soumis à de plus rudes secousses, et que je n’en sois pas mort, cela m’étonne encore.
J’en étais arrivé à une stupeur bestiale, à un accablement honteux ; je m’attendais à tout, j’acceptais tout, la mort et l’anéantissement. Cela n’était plus qu’une affaire de temps ; il me tardait presque d’en finir ; je touchais aux limites de la folie…
Je lus rappelé à la vie par l’apaisement de l’orage. La pluie se modéra, le vent se calma, la lune reparut ; la tempête, emportée vers d’autres régions, ne fit plus entendre que des grondements lointains. Seule, la porte de la cave continuait à battre, mais avec moins de violence ; l’espoir me vint que je pourrais échapper à ce cataclysme. Les Franzia n’étaient plus là. Par un reste de superstition, je m’enveloppai de mon cercle-maxime comme d’un bouclier et me réfugiai dans la ferme dont je refermai la porte sur moi.
Je ruisselais comme un fleuve. Rentré, verrouillé, isolé, séparé de tous, je repris courage et me débarrassai de mon accoutrement avec une espèce de fureur. Je n’en voulus pas garder une parcelle ; je ne respirai que quand j’eus quitté ces vêtements maudits qui m’avaient valu d’affreuses disgrâces. Je les jetai par la fenêtre, que je repoussai aussitôt pour pouvoir dire aux Esprits, s’ils venaient me reprocher mon évocation intempestive : – Ce n’est pas moi !…
Je passais une chemise innocente de toute magie, quand un soupir venu du fond de la chambre me fit bondir. – Qui est là ? m’écriai-je.
– Moi ! répondit une voix douce, est-ce que vous m’avez oubliée ?
C’était Javotte.
Oui, je dois l’avouer, je l’avais oubliée, et complètement. Les filles ont plus de mémoire que nous en certaines circonstances. – Sur le petit lit qui faisait face au mien, j’aperçus une blanche figure, soulevée, assise sur ses talons, les cheveux épars sur ses épaules, qui me regardait d’un air désappointé. Une lampe brûlait sur une table voisine. En tout autre moment, ce spectacle m’eût paru charmant ; la chemise de toile bise de la fillette avait glissé d’une de ses épaules et permettait de compter les palpitations et les soulèvements de sa poitrine. Mais j’étais sous le coup des épouvantes qui m’avaient accablé, et cette adorable fille m’inspirait une frayeur qui ne laissait plus de place aux désirs.





























